Le Téléphone au Métropolitain
Le système de communications téléphoniques
Dardeau, destiné aux Compagnies
de chemins de fer et aux grandes Administrations,
permet de desservir jusqu’à vingt-cinq postes. Le problème
qu’a résolu M. Dardeau est le suivant :
Envoyer dans un poste quelconque et dans celui-là seulement un
appel continu ; en cas de non-réponse, supprimer cet appel ;
Appeler un nombre quelconque de postes embrochés sur la ligne
et les mettre simultanément en communication ; Indiquer à
tous les postes si la ligne est libre ou occupée et permettre,
en cas d’urgence, à un poste quelconque de rentrer dans
le circuit pour en appeler un autre; Enfin assurer le secret des communications.
A l'Exposition de Paris de 1900, on pouvait voir
l'appareil Dardeau, qui fonctionne sur les stations du chemin
de fer métropolitain.
Ce système, admirablement exécuté par la Société
industrielle des téléphones, répond à
toutes les exigences du service; par contre il est assez compliqué
et d'un prix fort élevé. Un
réseau télépbonique, système Dardeau, mettait
en communication les stations, un poste intermédiaire établi
dans l'avenue de La Motte-Picquet, la sous-station de transformation
et les bureaux de la compagnie.
Sauf le cas d'urgence, les chefs de station, les inspecteurs de l'exploitation
et les ingénieurs avaient seuls la disposition des postes téléphoniques.
En cas d'urgence, l'arrêt pouvait être ordonné simplement
par la sonnerie du téléphone, au moyen d'un signal réglementaire.
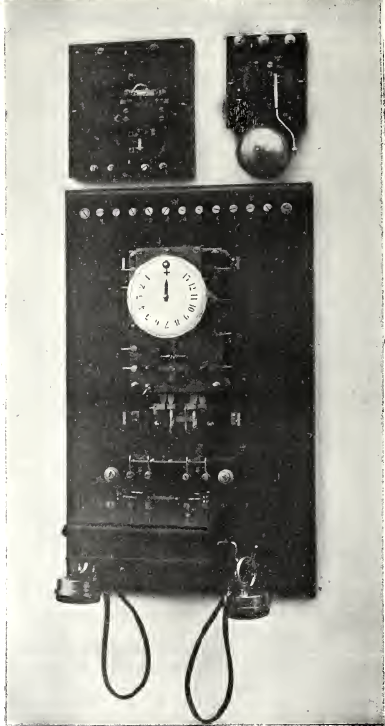
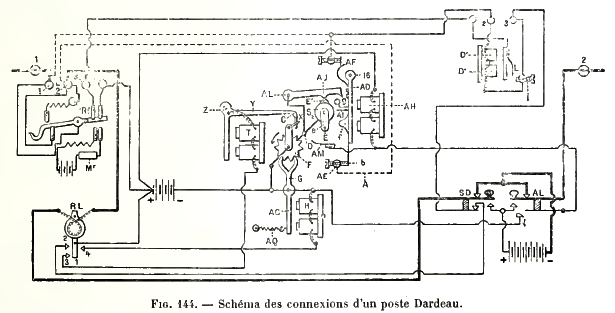
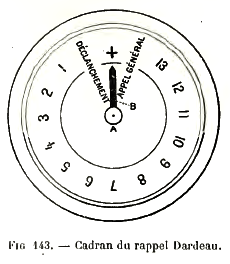
Tous les appareils sont semblables; la photo en montre une vue d’ensemble.
Un mouvement d’horlogerie porte sur son dernier rouage une aiguille
qui peut se déplacer sur un cadran divisé [fig. 143).
Le mouvement d’horlogerie permet de donner 2 000 communica tions
avant d’être de nouveau remonté.
Au repos, l’aiguille est bloquée sur la croix ; elle peut
être dégagée par le jeu d’un électro-
aimant.
Les différents circuits sont fermés par un jeu de cames
adaptées au mouvement d’horlogerie, mais calées différemment
dans chacun des postes.
L’envoi d’un courant positif sur la ligne débloque
toutes les aiguilles par le jeu de l’échap pement G (fig.
144). Toutes les aiguilles se placent alors sur la case déclenchement
du cadran. Si on envoie ensuite une succession de courants négatifs,
l’aiguille]avance d’une division à chaque émission.
Dès que l’aiguille est sur la case qui porte le numéro
du poste appelé, il suffit d’envoyer un courant positif
pour faire fonctionner la sonnerie de ce poste. La sonnerie cesse de
tinter aussitôt que le poste appelé répond, ou bien,
en cas de non-réponse, lorsque le poste appelant a ramené
l’aiguille à la croix ; pour cela, il lui suffit de produire
autant d’émissions négatives qu’il existe de
cases entre le numéro du poste appelé et la croix.
Outre le mouvement d’horlogerie, chaque poste comporte : un transmetteur
téléphonique complet (microphone, bobine d’induction
et récepteurs), dont les communications ont été
légè rement modifiées; un relais Ader à
simple enroulement RL, une sonnerie à trois bornes DD', deux
clés d’appel à double fil SD, AL, une pile microphonique,
une pile d’appel et une pile locale.
La manœuvre de la clé SD oriente le relais Ader RL à
gauche ; la manœuvre de la clé AL l’oriente à
droite.
Lorsque le levier AD, qui est l’armature de l’électro-aimant
AH, est appuyé sur les vis AF, AE, le poste téléphonique
est en court-circuit, ainsi que le montre le tracé en pointillé.
Tout poste dans cette position ne peut participer à la conservation
ni la surprendre.
Le contact entre AD et AE peut être rompu en b électriquement
ou mécaniquement : électriquement par l’action de
l’électro-aimant Ail : c’est le cas du poste appelant;
mécaniquement par la poussée de la came e agissant sur
le renflement f : c’est le cas du poste appelé.
Lorsque le poste appelant abaisse la clé SD, le relais RL est
orienté à gauche dans tous les postes, le circuit de l’électro-aimant
T est fermé ; l’armature, mobile autour de l’axe Z,
est attirée, la roue F devient libre et l’aiguille qu’elle
commande passe de la case croix sur la case déclenchement. Là,
elle est arrêtée par l’échappement G. On peut
d’ailleurs appuyer plusieurs fois sur la clé SD qui reste
sans effet si le déclenchement s’est produit du premier
coup.
Le poste appelant abaissant ensuite la clé AL, le relais RL est
orienté vers la droite dans tous les postes ; il ferme le circuit
local de l’électro-aimant IL Cet électro-aimant,
dont l’armature se termine par l’ancre d’échappement
G, fait avancer d'une dent la roue F et fait aussi avancer d’une
division l’aiguille du cadran à chaque émission né
gative provoquée par l’abaissement de la clé AL.
Mais, dans le poste appelant, et dans celui-là seulement, le
circuit de l’électro-aimant AM est également fermé,
ce qui a déterminé l’embrayage du bras de levier
AI par le cro chet g et ce qui a rompu en h le court-circuit du poste
téléphonique.
Lorsque, par un nombre d’émissions négatives convenable,
les aiguilles de tous les postes sont sur le numéro du poste
appelé, le poste appelant abaisse la clé SD et oriente
ainsi les relais RL vers la gauche. Celte manœuvre n’a d’effet
que dans le poste appelé, car, dans tous les postes, le circuit
local est ouvert; mais, dans le poste appelé, la came e est en
contact avec le rendement f (cela dépend de l’orientation
des cames dans chaque poste), et ce contact ferme le circuit local sur
les bornes 2 et 3 de la sonnerie. L’armature de celte sonnerie
est attirée et, d s cette première attraction, grâce
à sa disposition ingénieuse, elle fonctionne à
la manière d’une trembleuse.
Lorsque le poste appelant répond en abaissant la clé SD,
des effets analogues se produisent au poste appelant; mais le circuit
local est fermé par le contact du crochet g avec le bras de levier
AI.
Dès que les deux postes intéressés ont reçu
l’appel et la réponse, ils décrochent leurs récepteurs,
les leviers-commutateurs se relèvent et rompent le circuit local
entre les bornes 3 et 4 des transmetteurs, ce qui arrête le fonctionnement
des sonneries. Dans tous les autres postes, le transmetteur reste en
court-circuit ; ils ne peuvent donc surprendre la conversation engagée.
Ils sont d’ailleurs avertis que la ligne est occupée, l’aiguille
de leur cadran restant sur le numéro du poste appelé,
tant que l’un des deux postes en communication ne l’a pas
ramenée à la croix.
Lorsque l’aiguille passe entre la case du cadran portant le numéro
du dernier poste de la ligne et la case qui porte l’indication
appel général, la goupille X rencontre un ressort AM.
La durée de ce contact passager suffît pour actionner l’électro-aimant
AH. Si, lorsque l’aiguille est sur la case appel général
, position qui n’a aucun effet si elle est suivie du rappel à
la croix, le poste appelant abaisse sa clé SD, le circuit local
est fermé dans tous les postes par le contact de g avec AI et
toutes les sonneries fonctionnent simultanément. Chaque sonnerie
s'arrête dès qu’on décroche le récepteur
; les transmetteurs cessent d’être en court-circuit et tous
les postes du réseau peuvent prendre part à la conversation.
D’ailleurs, si un poste ne répond pas, sa sonnerie tinte
jusqu’à ce que le poste qui a pro voqué l’appel
général ait ramené toutes les aiguilles à
la croix. La seule précaution à observer dans le montage
des postes consiste à faire pénétrer le courant
dans chaque poste par la même borne.
Le système Dardeau réalise un certain nombre de desiderata importants, dont les principaux sontles suivants :
Il permet
1° De donner un appel continu dans un posto quelconque et dans celui-là seul
2° De supprimer cet appel si le poste n'a pas répondu au bout d’un certain temps :
3” De recevoir la réponse par sonnerie du poste appelé;
4° D'appeler et. de mettre en correspondance collective un nombre quelconque de postes embrochés quel que soit l'ordre de ces postes ;
5° D’appeler tous les postes à la fois pour lotir transmettre simultanément des ordres. (V n poste quelconque pouvant effectuer cet appel) ;
6° De faire connaître dans tous les postes si la ligne est libre ou occupée et. le poste qui est appelé ;
7° Dans le cas d’occupation prolongée de la ligne, de permettre dans un cas urgent à un poste quelconque d’avertir au moyen d’un signal convenu qu’il y a nécessité de lui céder la ligne nécessité pour appeler le poste voulu;
8° D’assurer le secret absolu des communications entre les postes occupés.
Ajoutons que les appareils sont tous identiques de façon à pouvoir être répartis indifféremment sur le réseau et être facilement interchangeables
Il est à remarquer d’augmenter sans difficultés sérieuse le nombre des postes dans une installation déjà en service une disposition ingénieuse de la roue d échappement permet de la retirer et de la remplacer par une autre roue spécialement divisée par nouveau nombre de postes à désservir.
Cette substitution se fait sur place en suelques minutes sans qu'ilsoit nécessaire de démonter l’appareil sasn interrompre le service.
La manoeuvre de l'appareil est d'une extrême simplicité.
Elle consiste à presser sur deux boutons; l’un, le bouton blanc sert à faire déclancher l’appareil et aussi à lancer l'appel quand on est arrivé par la manoeuvre du bouton noir sur le secteur du cadran correspondant au poste avec qui on désire entrer en communocation.
L’arrèt d'un ou de plusieurs appareils ne peut en quoi que géner le fonctionnement des autres.
On voit déjà par ce qui précède que c'et appareil réalise un très grand progrés sur ses devanciers : l'un des avantage sur le système Dardeau sur la plus part des appreils dits pendulaires connus jusqu’ici, est de pouvoir assurer le secret de la conversation entre les deux posles en communication.
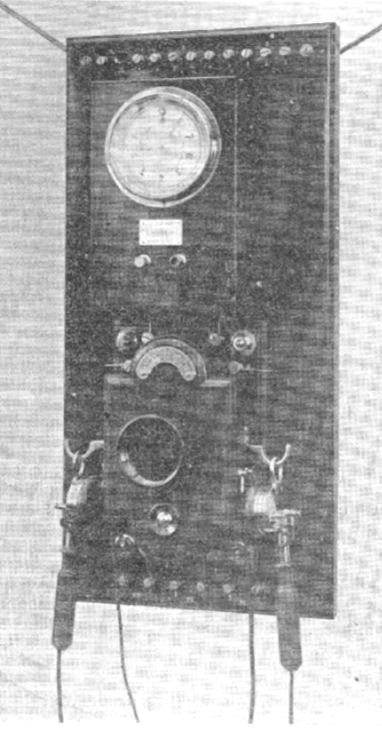


Fig. A. Vue de l"appareil Dardeau.
Description de l'appareil.
— L'appareil Dardeau vue d'ensemble figure A correspond comme organes essentiels un télégraphe à aiguille et un mouvement d’horlogerie, ce dernier est représenté de face, en figure 1, le cadran et la platine étant enlevés pour permettre de voir le mouvement. La ligure 2 est unr vue de derrière. La figure 3 une vue de coté.
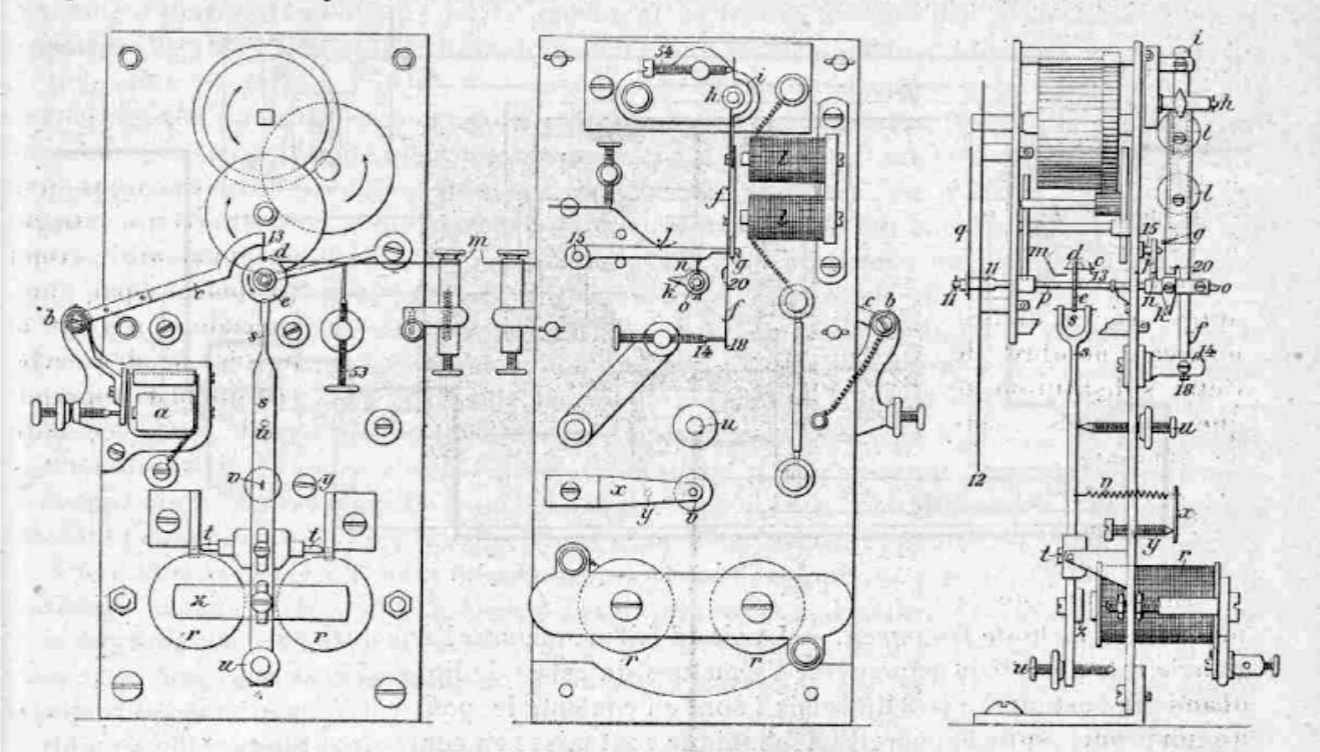
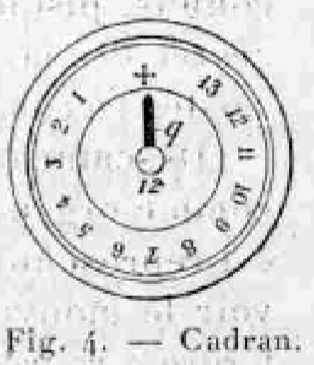
Figures 1 à 3 Vue de face arrière et de côté. La figure 4 représente le cadran.
Le dernier rouage e du mouvement d'horlogerie commandé par un échappement s esl en temps normal bloqué par un levier d’arrêt r que bon peu actionner au moyen d’un électro-aimant a. Après chaque tour complet, ce rouage c, se trouve bloqué par le levier d'arrêt c ce qui assure le synchronisme de tous les appareils.
L'arbre sur lequel il est monté porte d’autre part.une aiguille q se déplaçant devant un cadran (flg. 4) On peut donc suivre avec précision ses déplacements d’ailleurs identiques clans tous les postes.
Sur l’arbre p sont également fixées les cames k et n pouvanL pendant la rotation du système rencontrer des pièces métalliques, et ainsi fermer ou ouvrir des circuits.
La came k est d’ailleurs dans chaque poste placée dans une position différente par rapport à la position d'arrêt (la croix), c’est ce qui nous explique que les appels puissent être réalisés dans un poste quelconque et dans celui-là seulement.
L’envoi d’un courant de sens négatif actionne le levier d’arrêt c et libère le mécanisme.
Toutes les aiguilles sont portées sur le déclenchement.
L’envoi successif de courants du signe positif actionne l’échappement s et Jaisse avaneer le dernier rouage e d’autant do dents qu’il y a eu d'émissions.
Lorsque l'aiguille est en regard du chiffre voulu, l’envoi d'un courant négatif provoque le déclenchement de la sonnerie du poste correspondant, à ce chiffre.
L’arrêt de la sonnerie a lieu quand l’agent du poste appelé répond, ou quand le poste appelant ne recevant pas de réponse remet les aiguilles à la croix en continuant l’envoi de courants de sens posilif.
Examinons maintenant l’agencement et le fonctionnement de l’appareil appliqué à la téléphonie.
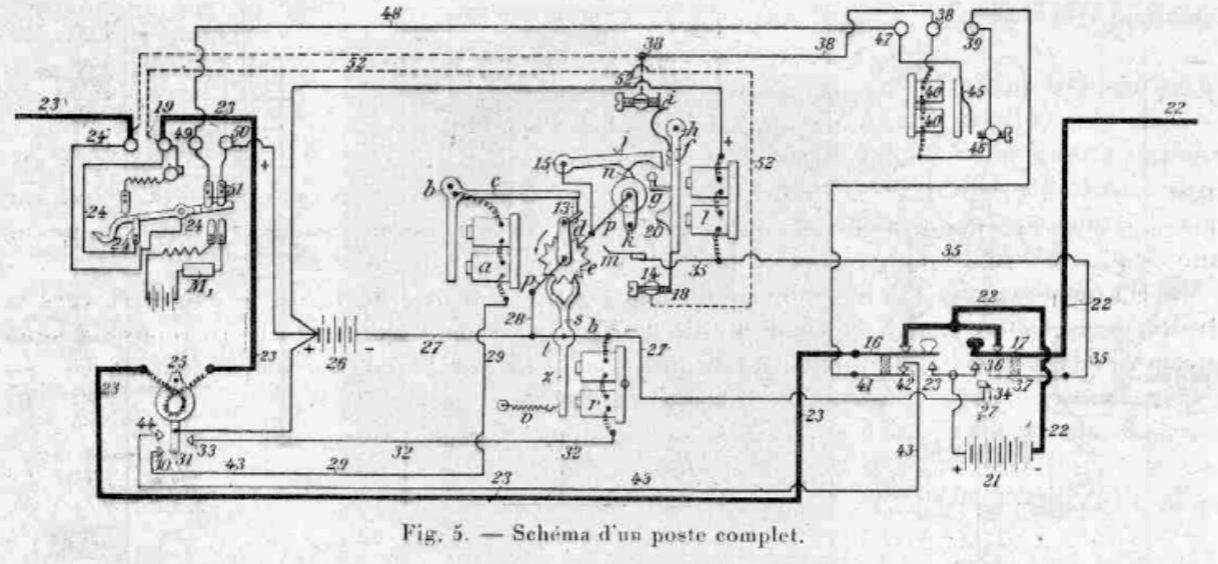
Cas d’un poste complet.
— Chaque poste comprend :
1° Un appareil téléphonique qui peut être d’un modèle quelconque disposé comme il est indiqué (fig. 5) ;
2° Un relais polarisé ;
3° Une sonnerie à trois bornes ou une sonnerie treinbleuse ordinaire suivant le cas ;
4° Deux clés d'appel à deux lames (16-41) et (17-37) ;
5° L'appareil Dardeuu donl les organes sont représentés au centre de la figure :
6° Une pile de ligne (21), une pile locale (26) et une pile pour le microphone.
Fonctionnement de l'appareil.
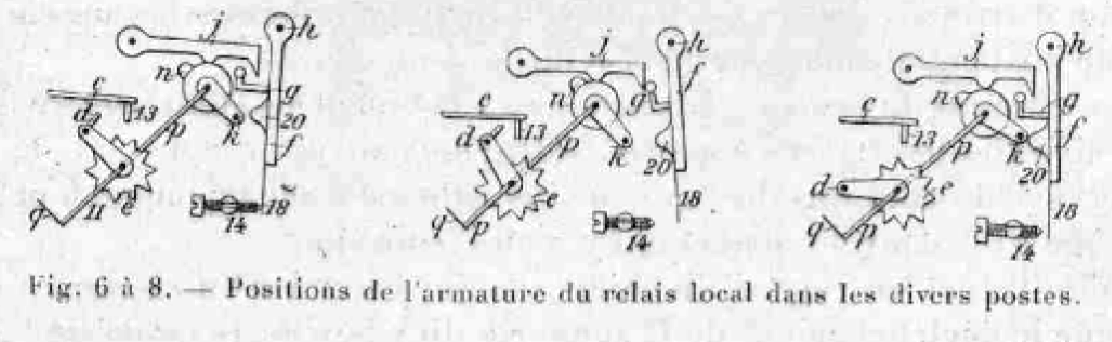
— La clé 16 fait manœuvrer l'armature du relais de ligne. 10 à gauche. La clé 17 fait manœuvrer l'armature du relais de ligne 2e à droite.
Lorsque les points 14-18 du relais l son! en contact, le pont est fermé, c’est-à-dire que les deux bornes 19 de l'appareil téléphonique sont mises en courl-circuit par ses deux points (circuit 52 en pointillé sur Le schéma figure 5) et par conséquent aucune conversation ne peut être surprise.
Ces deux contacts 14. 18, peuvent être rompus de deux façons :
1 ° Lorsque l’électro aimant fonctionne et attire le levier lequel soulève au moyen du crochet g' le levier qui retombe ensuite derrière lui pour l'enclencher (cas du poste appelant, figure 7).
2° Lorsque la pointe de la came k vient pousser o et par suite l'armature de l’électro l (cas du poste appelé, fig. 8).
Poste appelant.
1 ° En appuyant sur la cdé 16 dans un des postes, le relais de ligne est attiré à gauche ; son circuit est fermé sur la pile de ligne ai par : —pile de ligne 21, fil 22. ligne vers la droite, traversée de tous les postes, retour par la ligne de gauche, fils 23, bornes 19 et. fils 24 de l’appareil téléphonique, relai de ligne 3.5 et + pile de ligne 21.
Le relai de déclenchement (t fonctionne, son circuit étant fermé sur la pile locale 26 par : — pile 26, fil de masse du mouvement 28, roue e, goupille d goupille r3. levier c commandé par l’élcctro a, électro a, fil 29, contact 3o du relais de ligne aa, masse 3i du relais de ligne et -f- pile locale 26; l'armature de l'éleclro a est attirée, la goupille i3 fixée à l’extrémité et qui arrêtait le mouvement par 1. est soulevée. le mouvement est libre, la voue e tourne d'une dent vers la gauche et se trouve arrêtée par le système d'échappement (fîg. 10) 11).
L'aiguille du cadran (fixée sur le même arbre) qui était au repos sur 1'indication + (croix) (fig. 4) se retrouve portée devant l'indication « déclenchement» : la came n fixée sur l’arbre p est portée d’une dent vers la gauche (fig. 6), le crochet j est retombé, et son extrémité vient tomber entre g et l'armature f sans y toucher (fig.6). Donc, en appuvant une première fois sur la clé 16, l'aiguille de chacun des postes se trouve sur l'indication « déclenchement » : dans cette position, une nouvelle pression sur la clé 16 n’aurait aucun effet, les contacts d et i3 étant rompus; on pourra donc appuyer une ou plusieurs fois pour produire le déclenchement par la clé r6.
En appuyant sur la clé 17 dans l'un des postes, le relais de, ligne 25 est attiré vers la droite, son circuit étant fermé sur la pile de ligne 21 comme pour la clé 16, mais de sens inverse et vient fermer le circuit de la pile locale 26 sur l’éleclro r d’avancement par : — pile 26. fil 27, électro r. fil 32, contact 33, masse 3i du relais de ligne a5 , et. + pile a6; l'armature de l’électro r est attirée, le svstème d’échappement fonctionne, la rouée échappe d'une dent, l'aiguille avance d’une division et se trouve alors dans tous les postes devant l’indication « poste, n° 1 » (fig. 4) ; de plus, dans le poste appelant seulement, l'éleclro l a fonctionné, son circuit étant formé sur la pile locale 26, par— pile 26, fil 27, contact de passage 34 dans la clé 17, fil 35. électro cl -|- pile 26 ; son armature /'est al tirée, l'extrémité du crochet j est retombée en arrière de g et maintient l'armature. Dans cette position les deux contacts 14 et 18 étant rompus, le contact j g permet de recevoir la réponse de sonnerie du posle appelé (fig. 7).
La clé d’appel 17 est agencée de manière que le fonctionnement, de l'éJcctro r ait lieu avant celui de l’éleclro l ; à cet effet, la grande lame de, la clé 17 touche Je plot 36 allant ail -j-de la pile, avant que la petite lame 37 touche au contact de passage 34. Celte disposition particulière a pour but d’éviter que la conversation soit surprise par un autre poste, si ce dernier appuyait doucement sur la clé 17 de façon à enclencher seulement l’éleetro l et à détruire le court-circuit établi entre les bornes de lignes et venant se fermer au 1.4-18 ; nous appellerons ce court-circuit pont téléphonique.
Chaque fois que l'on appuiera sur la clé 17, les mêmes effets se produiront.; dans chaque poste l’aiguille avancera d’une division, et dans le poste appelant, le circuit do la pile locale 26 se fermera sur l'élcctro L mais l’armature de ce dernier ne fonctionnera plus puisqu’elle est enclenchée par la première pression (voir fig. 7).
Lorsque l’aiguille se trouve sur le numéro du poste avec lequel on désire converser, le posle appelant appuie alors sur la clé r6 ; dans tous les postes, le relais de ligne est attiré à gauche ; ce fonctionnement ne prodnil aucun effet sur les électros locaux des autres postes et du poste appelant, le circuit de la pile locale étant ouvert dans tous ces postes.
Posle appelé.
En admettant, par exemple, que ce soit le numéro 5, la came k est calée sur l’arbre p de manière qu'elle soit sur 20 lorsque l'aiguille de ce poste et des autres péstos se trouve sur l’indication numéro 5; de mémo au poste 4- cette came est lixée sur l'arbre p. de manière qu'elle soit sur 20, lorsque l'aiguille des postes se trouve sur 4, et ainsi de suite pour les autres postes, la position est alors celle représentée fig. 8. La came k pousse donc l'armature f par 20, sans pour cela que j vienne enclencher l’armature par g ; les contacts 14 et 18 sont rompus, le pont téléphonique est ouvert, la came k est en contact avec le circuit de la pile locale 26 est. terme sur les bornes 38 et de la sonnerie par : — pile 26. fil 27. masse 28 du mouvement, arbre p. came k. pointe 20, armature f petit ressort i, borne 38. sonnerie, élecLro 4°r sonnerie, borne 3p. sonnerie petite lame 41 + de la clé 16. contact 42 fil 43, contact 44 du relais de ligne 25. masse 3i du relais 2a et pile 26 : l’armature 4a de la sonnerie est attirée comme dans un éleetro ordinaire ; lorsque le poste appelant lâche la clé 16. le circuit de la pile locale 26 est rompu, dans le poste appelé, sur les bornes 38 et 3p de la sonnerie, puisque le relài de ligne 2a est revenu à sa position de repos; le couvant cesse de circuler dans l’électro de la sonnerie par les bornes 38 et 3p ; mais lorsque l’armature de la sonnerie s’est éloignée de son électro Q, son ressort précédemment tendu par l’attraction de l’armature 45 est. venu par son élan loucher la borne 4b, la sonnerie fonctionne alors en trembleuse par : — pile locale 26, fil 27 masse du mouvement 28, arbre/y, canne k. pointe 20, armature f, petit ressort i, til et borne 38!, sonnerie., éleetro sonnerie, contact. 43, ressort, de l'armature 45, borne 4. sonnerie, fil 48, bornes 4f) 5o de l'appareil téléphonique, et + pile locale 26.
Le poste appelé averti par la sonnerie répond au poste appelant .en appuyant sur la clé 16. il produit an' poste appelant les mêmes effets qu’au poste appelé ; mais le circuit de la pile locale 26 au lieu.d'être fermé par k 20, comme au poste appelé (fig. 8) se ferme par f g, (fig. 7). Il est à remarquer que lorsque le poste appelant appuie sur la clé 16 pour sonner le poste appelé, il coupele circuit de sa sonnerie par le contact 42 et la petite lame 4i de celle clé. La sonnerie du poste apppelant est restée au repos.
Communication téléphonique.
Les deux postes (appelant et appelé) prévenus par la sonnerie décrochent le récepteur de l’appareil téléphonique ; dans chacun d'eux, le circuit de la pile locale. 2b est rompu entre les deux ressorts 5i et les bornes .49 cl 5o de l'appareil téléphonique et la sonnerie s'arrête.
La conversation peut s’engager puisqu’au poste appelant, le pont téléphonique est ouvert entre' 14 et 18 (frg. 7), ainsi qu’au poste appelé (fig. 8). Les autres postes peuvent écouter la conversation, puisque dans ces derniers le pont est fermé (fîg. 7).
Pendant la conversation, les autres postes sont avertis que la ligne est occupée puisque l’aiguille est arrêtée sur le numéro du poste appelé.
Lorsque la conversation est terminée, le poste appelant ou appelé (suivant la convention appuie sur la clé 17 autant de fois qu'il est necessaire pour remettre les aiguilles à la croix ; si par inadvertance, lorsque les aiguilles sont à la croix, on appuie une ou plusieurs fois de plus, les aiguilles restent maigre cela à la croix puisque la goupille d est venue se heurter a la goupille i3 du levier c et qu'il faudrait alors appuyer sur la clé ib pour déclencher de nouveau les aiguilles. Cette inadvertance serait même utile, car en admettant qu'une ou plusieurs aiguilles soient restées en retard pour une cause quelconque, le nombre, de coups supplémentaires de la (de 17 rattraperait ce retard, et assurerait le synchronisme de la position des aiguilles à la croix.
Lorsque le poste appelant vient de faire l'appel au poste appelé, et qu'après quelques instants qu'il juge suffisamment longs, il ne revoit pas de réponse, il peut en conclure que’ le poste appelé est absent, il appuie alors sur la clé 17 pour remettre les aiguilles à la croix dans tous les postes ; il a do ce fait arrêté la sonnerie au poste appelé par la rupture des contacts k 20 (fig. 5).
Appel collectif.
Pendant le cours d'une conversation entre deux postes, il peut y avoir nécessité d’en introduire un ou plusieurs autres ; les manunivros sont les suivantes." Admettons d’abord que ce soit le poste i.qui appelle le 3 ; le postes 1 étant appelant a pris la position figure 7 et y reste jusqu’à ce que l'aiguille revienne à la croix ; le poste 3 appelé a pris la position figure 8. On veut introduire le poste 0 par exemple. Le poste appelé 3 appelle le 5, le 3 devenu poste appelant a pris la position figure 7 et le 0 appelé la position figure 8, et ainsi de suite pour en mettre plusieurs autres successivement en ligne.
Appel général de tous les postes.
Entre l’indication du numéro du dernier poste et la croix, chaquê cadran porte l'indication « appel général », la position de l’aiguille lorsqu'elle se trouve en face celte indication correspond à celle de la goupille d qui vient de rompre le contact, avec la lame m ; le contact, passager se produit en effet lorsque l’aiguille passe entre l’indication du dernier poste et l'indication « appel général »; il est cependant d'une durée suffisante pour actionner l'électro l, le circuit de la pile locale 26 étant fermé sur ce dernier par : —pile 26, fil 27, masse 28 du mouvement, arbre /;, goupille d, lame électro l, et + pile 26.
Ce fonctionnement a lieu même dans la marche normale, mais lorsque l’aiguille revient à la croix (fig. 4), l'enclenchement g,j qui a eu lieu par ce contact passager (fig. 7) est détruit par la came n soulevant le levier (fîg. 5), mais lorsque l’aiguille de chacun des postes se trouve amenée devant l’indication et appel général » par le poste appelant et que dans cette position le poste appelant appuie sur la clé 16, la sonnerie fonctionne dans tous les postes, le circuit de la pile locale 26 étant fermé sur la sonnerie par j et g, tous les postes sont dans la position figure 7, les ponts sont ouverts étions les postes peuvent converser ensemble. Chaque sonnerie s’est arrêtée lorsqu’on a décroché le récepteur du commutateur de l’appareil téléphonique. Si un des postes est absent au moment de l’appel général, sa sonnerie fonctionnera pendant la durée de la conversation de tous les autres et le tout sera remis à la position de repos par le poste appelant, qui après la communication générale remettra les aiguilles à la croix (fig. 4) au moyen de la clé 17.
Poste d’intercommunication.
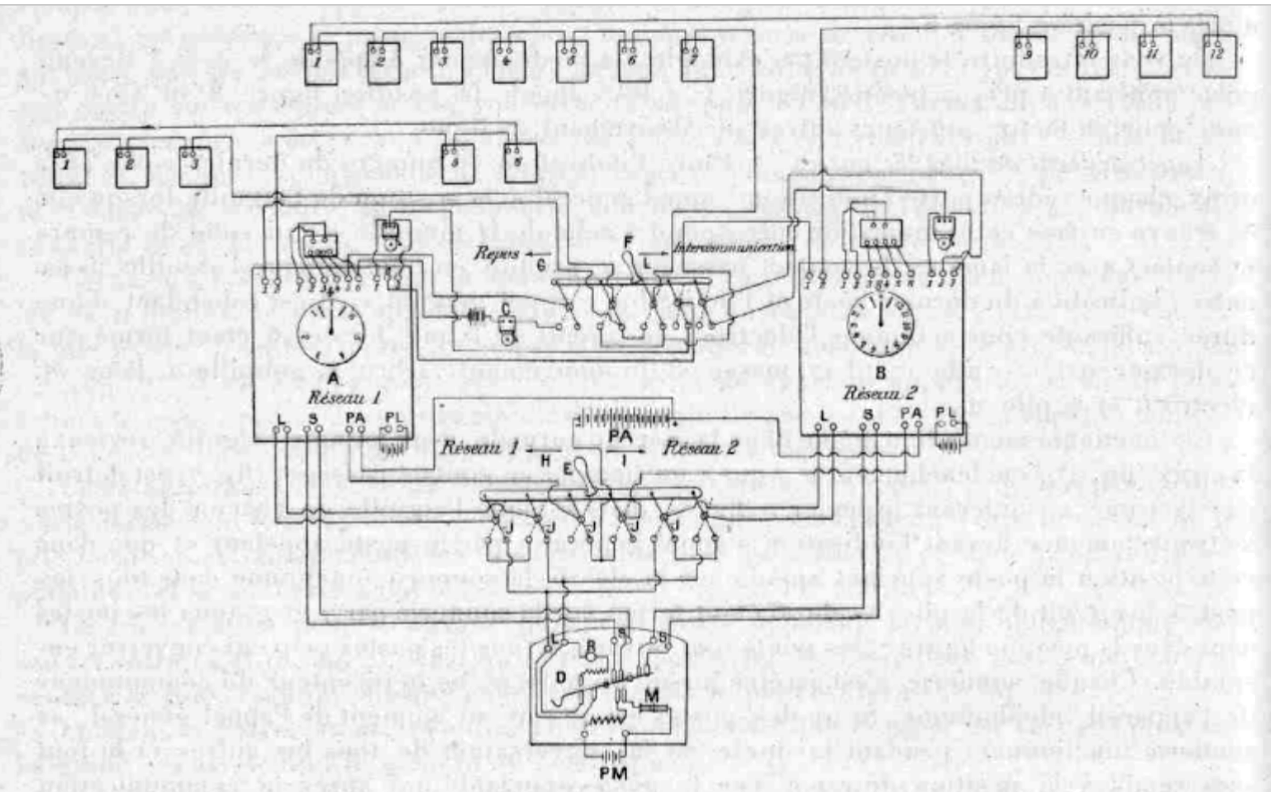
Le poste d’intercommunication représenté schématiquement (flig. 9) comprend : deux appareils Dardeau ordinaires A et R avec relais et sonnerie; une sonnerie fin de conversation C, un appareil téléphonique D et deux commutateurs E et P.
Chaque appareil Dardeau est muni de sa pile locale PL.
Une pile d'appel PA est commune aux doux circuits.
Le commutateur de réseau E est destiné :
1° A placer l’appareil téléphonique sur le circuit sur lequel on doit converser ;
2° A placer la pile d’appel PA sur l'appareil correspondant à ce circuit ;
3° A bouderie circuit avec lequel l’on il n’a pas à échanger de conversation.
Le commutateur d’inlercominutation F a pour but :
1" De séparer les deux circuits ou de les réunir en un seul ;
2” D’interrompre les eireuits’des sonneries d’appel des deux postes ;
3" De fermer le circuit de la sonnerie fin de conversation G.
Fonctionnement. —
Le commutateur d'intercommunication F étant au repos, c’est-à-dire poussé vers la flèche G, les deux circuits sont indépendants.
La figure représente à titre d'exemple un circuit de 6 postes et un de 12 postes.
Le poste double est à la fois poste n° 4 sur le réseau 1 et poste n° 8 sur le réseau 2.
Supposons que le poste double soit appelé par le réseau 1, l'agent de ce poste poussera le commutateur de réseau E vers la flèche H, ce qui est le cas de la figure. L’appareil téléphonique est mis en relation avec le réseau 1 de même que la pile d'appel PA. Il répond ensuite au posté appelant en appuyant sur le bouton blanc comme dans un poste ordinaire, décroche les récepteurs et engage la conversation.
La correspondance terminée il raccroche les récepteurs et abandonne l’appareil sans s’inquiéter de la position du commutateur de réseau.
Il est à remarquer que la disposition de ce commutateur est telle qu’il soit sur le réseau 1 ou sur le réseau 2, le poste peut recevoir l’appel de sonnerie, soit du réseau 1 soit du réseau 2. et même des deux à la fois. Il n’y a donc pas à craindre d’être isolé pur suite de la négligence d’un employé qui n’aurait pas remis le commutateur en place pour l’attente après une communication.
Si l'on avait à répondre au réseau 2, on pousserait le commutateur vers la flèche I, les lames de contact j prendraient la position en pointillé et l’effet serait le même que précédemment.
En résumé, soit pour répondre, soit pour appeler, il devra d'abord pousser (à moins qu’il n y soit déjà) le commutateur de réseau K sur IL ou sur I, suivant que l’on veut communiquer avec l'un ou l'autre réseau.
Intercommuiication.
Supposons qu'un poste du réseau 1 veuille communiquer avec un poste du réseau 2 ou inversement.
Il appelle d’abord le poste d'intercommunication et lui demande le poste avec lequel il désire être mis en relation.
L'agent du poste d'intercommunication appelle lui-même le poste demandé, et établit rinlereommunication en poussant le commutateur vers la flèche L, les deux sonneries des postes sont supprimées, ce qui permet aux postes en relation de s’avertir réciproquement par la sonnerie sans déranger le poste d'intercommunication.
Fin de conversation.
A la lin de la communication l'un quelconque des deux postes ou les deux à la fois appuient sur le bouton noir pour remettre les aiguilles à la croix.
A chaque coup de bouton, une sonnerie spéciale fin de conversation C fonctionne au poste d'intercommunication et avertit le préposé qu'il peut rétablir les deux circuits en remettant le commutateur F au repos.
Nous ne voudrions pas terminer cette étude de l’appareil sans dire quelques mots d’avantages spéciaux au système.
Le dispositif s'applique aussi bien au simple fil qu’au double fil. Il suflit de relier les fils de ligne de manière à ce que le courant circule dans ce même sens à travers tous les appareils . (fig 10 et 11)
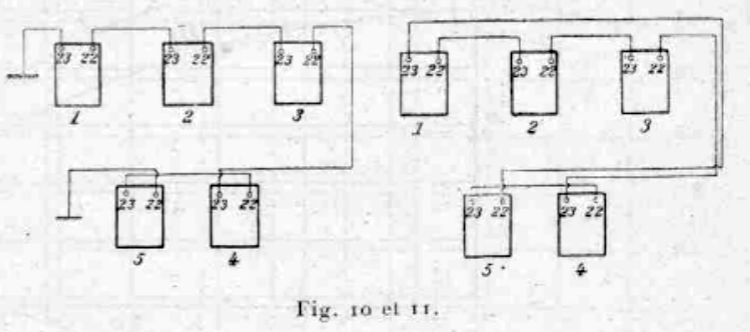
Il est à remarquer également que les seuls enroulements des relais de résistance appropriée à celle de la ligne, sont en série sur celle-ci dans chaque poste, ce qui constitue un avantage au point de vue téléphonique. L’appareil est très peu encombrant. Il permet d'obtenir 2000 tours de cadran sans remontage à la main. Le remontage électro-automatique serait tout aussi simple. Il consomme cependant une quantité d'électricité assez forte et nécessiterait un renforcement des piles. Il suffirait pour cette modification de remplacer le mouvement d'horlogerie par un système électro-magnétique agissant par un cliquet pour la commande de l'arbre p.
Applications
- Bien que très récent, l'appareil Dardeau a été adopté par plusieurs compagnies.
Il fonctionne sur les tramways de Tours (ce postes : ligne de Saint-Martin à Tours), 17 postes desserviront les trottoirs roulants de l’Exposition, et 20 les gares du chemin de fer métropolilain.
Dans les installations précédentes tous les postes sont en série.
 Appareil omnibus
Breguet
Appareil omnibus
Breguet- La Compagnie générale des Omnibus, à la suite d’essais heureux sur la ligne d'Ivrv-les-Hallcs, a décidé l’application des appareils Dardeau à son réseau téléphonique qui comprend plus de 60 km. Cette installation est très intéressante au point de vue des nombreux postes d'intercommunication que présentera ce réseau et grâce auquels deux postes quelconques du réseau pourront communiquer entre eux.
- La Compagnie du chemin de fer sur route de Paris à Arpajon possédera de même trois circuits indépendants comprenant en tout 11 postes dont quatre d’intercommunication.
sommaire
1914 Le chemin de fer métropolilain
Le téléphone occupe au Métropolitain
une large place et le développement de ces lignes téléphoniques
atteint 777 kilomètres pour les 78 kilomètres de voies
actuellementen exploitation. Lorsque le réseau Métropolitain
sera complet, le développement de ces lignes téléphoniques
dépassera 1.000 kilomètres.
Sous la conduite de l'aimable ingénieur du Métropolitain,
M. Dardeau, nous avons pu voir en détail cette organisation si
complexe et
résolue de façon si simple.
 M. DARDEAU Ingénieur
en chef des Services Electriques du Métropolitain
M. DARDEAU Ingénieur
en chef des Services Electriques du Métropolitain
Le problème qui se posait était en effet de pouvoir faire
un appel dans un poste quelconque et dans celui là seul, de supprimer
ce appel si le poste n'avait pas répondu au bout d'un certain
temps; d'appeler et de mettre en correspondance collective un nombre
quelconque de postes embrochés; d'appelertous les postes
à la fois pour leur transmettre simultanément des ordres
et ceci à partir d'un poste quelconque; de faire connaître
dans chaque poste si la ligne téléphonique est libre ou
occupée et par quel poste celle-ci est occupée et, en
cas de prolongation de l'occupation, pouvoir donner aux postes communiquants
un signal leur demandant de céder la ligne; au besoin,en cas
d'urgence, les interrompre pour appeler le poste voulu et dans tous
les cas assurer le secret absolu des communications.
Ces différents points ont été résolus par
le poste Dardeau que l'on peut voir dans les cabines de chef de gare
des stations du Métropolitain.
Dans les installations télégraphiques et téléphoniques
généralement employées dans les chemins de fer,
tramways,etc., le ou les fils partent d'un bout du réseau pour
s'arrêter à tous les postes intermédiaires, sectionnant
ainsi la ligne en autant de tronçons. Il est donc nécessaire
pour communiquer d'un poste -à l'autre d'attaquer successivement
tous les postes intermédiaires et de demander à chacun
d'eux la communication pour le poste suivant. Ceci exige la présence
de tous les employés, immobilise les lignes pendant un temps
très long et ne permet d'avertir les intermédiaires que
lorsque la ligne est redevenue libre.
sommaire
L'Appareil Dardeau pour le métro Parisien
Les appareils Dardeau sont tous identiques, de façon à
pouvoir se répartir sur le réseau et d'être complètement
interchangeables. De plus si par la suite le nombre des postes devait
être augmenté le simple remplacement de la roue interchangeable
par une autre divisée en un plus grand nombre de crans serait
la seule opération nécessaire et cette substitution se
ferait sur place en quelques minutes sans démonter l'appareil
et sans interrompre le service.
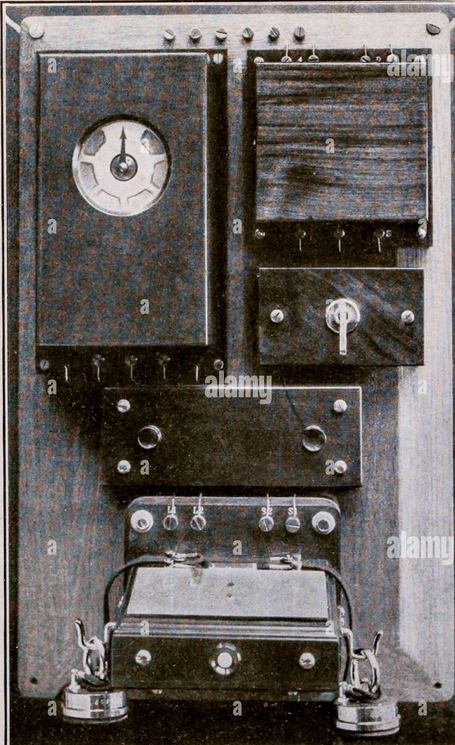
Le poste des stations du Métropolitain se compose d'un appareil
téléphonique d'un modèle quelconque, d'une sonnerie,
d'une pile de ligne ou pile locale et une pile pour le microphone, de
deux clés d'appel et de l'appareil Dardeau. Le fonctionnementen
est extrêmement simple et il est impossible, par suite de l'absence
totale de fiches ou de commutateurs à manoeuvrer, qu'une personne
inexpérimentée entrave le fonctionnement de la ligne.
Et même commandé par un échappement bloqué,
en temps normal, par un levier d'arrêt que l'on peut actionner
au moyen d'un électro-aimant.
Chaque fois que l'aiguille a fait un tour de cadran elle se trouve bloquée
en face d'un certain signe et comme chaque aiguille dans chaque appareil
a fait le même mouvement elles se trouvent bloquées toutes
au même endroit. Le synchronisme des appareils se trouve réalisé.
L'arbre qui porte l'aiguille comporte une came calée différemment
pour chaque poste et qui peut pendant sa rotation, rencontrer des pièces
métalliques et ouvrir ou
fermer les circuits. La position de cette came correspond à une
position d'aiguille en face d'un certain chiffre ce qui permet,en amenant
l'aiguille en face du chiffre correspondant, de converser avec le poste
dont la came se.trouve dans ce cas l'arrêt de plusieurs appareils
ne peut en quoi que ce soit gêner le fonctionnement des autres.
Un cadran sur lequel se déplace une aiguille est fixé
à la partie supérieure de l'appareil et indique à
celui qui le manoeuvre si la ligne est libre et lorsqu'il fait un appel
si celui-ci correspond bien au numéro du poste désiré.
Cette aiguille est commandée par un arbre monté sur un
mouvement d'horlogerie qui est calée pour cette position d'aiguille
et avec celui-là seulement.
Il suffit pour actionner l'appareil d'agir sur deux boutons; l'un porte
le signe 4- , l'autre le signe — . L'envoi d'un courant de sens
négatif actionne le levier d'arrêt et libère le
mécanisme. Toutes les aiguilles sont alors portées sur
le signe dèclanchement du cadran. L'envoi du courant du signe
+ actionne l'échappement et laisse avancer l'aiguille d'autant
de dents qu'il y a d'émissions de courant. Ainsi, l'envoi de
trois courants positifs ferait occuper à l'aiguille la position
marquée3 sur le cadran.
Lorsque l'aiguille est en regard de ce chiffre, l'envoi d'un courant
négatif provoquera le dèclanchement de la sonnerie du
poste 3.
Celle-ci s'arrête lorsque l'employé répond ou quand
le poste appelant ne recevant pas de réponse remet les aiguilles
au signe d'arrêt en continuant l'envoi de courant dans le même
sens.
Dans le Métropolitain, cette émission de courant se fait
par un pendule électro-magnétique placé au central
téléphonique de la Bastille, ce qui assure la régularité
des émissions et évite les émissions précipitées
qui pourraient se produire si celles-ci étaient faites à
la main en appuyant sur le bouton autant de fois pour produire le chiffre
voulu.
Le cadran comprend, en outre, un numéro correspondant à
l'appel général. Chaque sonnerie fonctionnealors dans
tous les postes, et celle-ci n'est arrêtée que lorsqu'on
en décroche le récepteur. Si un des postes est absent,
sa sonnerie fonctionnera pendant toute la durée de la conversation,
jusqu'à ce que tout soit remis à la position de repos
par le poste appelant.
Dans ce cas comme dans les autres, le poste appelant donne un courant
positif pour ramener toutes les aiguilles à la position de repos,
et ceci en appuyant sur un bouton jusqu'à ce que l'aiguille du
cadran qu'il a devant lui se trouve ramenée à sa position.
Si par inadvertance on maintient le bouton appuyé plus longtemps
qu'il est nécessaire, les aiguilles restent malgré tout
à la position de repos, puisqu'un cran spécial les arrête
dans cette position jusqu'à ce qu'en donnant un courant négatif,
c'est-à-dire en appuyant sur l'autre bouton, elles se trouvent
à nouveau déclanchées. Cette inadvertance serait
même utile, car en admettant qu'une ou plusieurs aiguilles soient
restées en retard par une cause quelconque, le nombre d'impulsions
supplémentaires permettrait de rattraper ce retard et assurerait
le synchronisme de toutes les aiguilles par rapport à cette position
de repos.
Chaque ligne métropolitaine est desservie par de nombreuses lignes
téléphoniques qui mettent en relation immédiate
les stations entre elles, les différents services entre eux et
avec le service central de l'exploitation.
Les sous-stations de transformation du courant électrique sont
également en relation immédiate avec la station la plus
voisine du point qu'elles alimentent et avec l'usine génératrice
de Bercy.
En principe, chaque ligne métropolitaine est desservie de la
façon suivante :
Une ligne directe relie entre elles les deux stations terminales pour
régler le départ des trains.
Ensemble du Réseau Téléphonique
Chacune des stations intermédiaires est reliée directement
à sa voisine par une ligne dite omnibus qui permet, le cas échéant,
de suppléer aux signaux du bloc système.
Une ligne dite d'appel général relie à la fois
toutes les stations pour la transmission simultanée des communications
collectives.
Certains signaux éloignés dans le tunnel sont reliés
aux stations intéressées. Les sous-stations de transformation
du courant électrique sont reliées à la station
la plus voisine du point qu'elles alimentent.
Enfin, une ligne de postes Dardeau relie entre elles les stations les
plus importantes et les stations d'échange.
Le central téléphonique est installé dans un local
spécial à la station de la Bastille sur la ligne n°
1, où toutes les lignes de postes Dardeau prévus au nombre
de 20 pour l'ensemble du réseau aboutissent sur un standard de
dispositions particulières. Celui-ci comporte en outre des lignes
ordinaires reliées au standard desservant les bureaux du service
central de l'exploitation, de telle sorte que les différents
services peuvent être mis en n relation avec un point quelconque
du réseau.
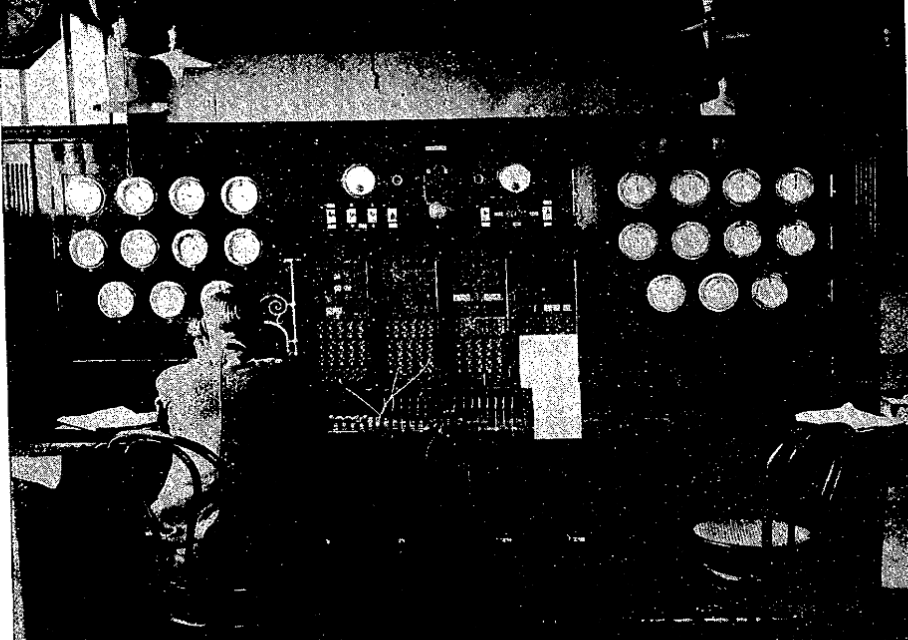
Le Central Téléphonique du Métropolitain (Station
de la Bastille)
TÉLÉPHONE ET AVERTISSEURS D'ALARME
1° Réseau téléphonique.
— Le réseau téléphonique comprend :
une ligne directe entre les stations « Place de l'Étoile
» et « Gare d'Orléans » ;
une ligne de postes omnibus de station à station ;
une ligne de postes Dardeau permettant aux stations les plus importantes
(Quai de Passy — Avenue de La Motte-Picquet Gare Montparnasse —
Place Denfert-Rochereau — Place d'Italie — Gare d'Orléans),
de communiquer entre elles et avec le Service central, quai de la Rapée,
n° 46.
La ligne de postes Dardeau est reliée à celle des postes
de même type de la ligne n° 1, au moyen d'un poste d'intercommunication
situé à la station de la Place de l'Étoile ; elle
est pourvue aussi d'un poste Dardeau spécial installé
au Service central.
Enfin un poste Dardeau est installé dans hacune des sous-stations
Denfert-Rochereau et La Motte-Picquet, et relié au réseau
général des postes Dardeau des sous-stations.
Chaque poste téléphonique comprend : un microphone Bailleux
avec récepteur Ader, une sonnerie du type de celles du service
des Postes et Télégraphes, et un annonciateurpour chacune
des directions desservies.
Les postes Dardeau sont munis, en outre, d'un appareil Dardeau avec
les relais nécessaires.
Chaque conducteur est composé d'un iil en cuivre
rouge étamé haute conductibilité, de 0,001 m. de
diamètre, une couche de caoutchouc naturel, une couche de caoutchouc
vulcanisé, un ruban enduit, un guipage coton.
Les câbles sont à cinq paires depuis la station Avenue
de Villiers jusqu'à la sous-station Opéra, et à
six paires depuis ce point jusqu'à la station Place Gambelta
; sur toute la ligne, il y a dans ces câbles deux paires en attente.
Chaque paire comprend un fil noir et un fil de couleur; ce dernier est
de même nuance que le guipage qui recouvre la paire dont il fait
partie : c'est-à-dire qu'une paire recouverte de coton rouge
se compose d'un fil rouge et d'un fil noir, etc.
Les fils d'une même paire sont câblés ensemble au
pas de 0,20 m. ; les paires sont ensuite câblées entre
elles au pas de 0,30 m.; le câble ainsi formé est recouvert
d'un ruban tanné et d'un tube de plomb de 0,002 m. d'épaisseur
Avertisseurs d'alarme.
— L'installation des avertisseurs aarme comprend les dispositifs
ci-après :
a. Un système permettant l'ouverture automatique des disjonceurs
des sous-stations, avec sonneries annonciatrices de disjontion ;
b. Des postes téléphoniques reliant respectivement les
sous-sta°ns Denfert-Rochereau et La Motte-Picquet aux stations les
plus voisines qui, dans l'espèce, portent chacune le même
nom que la sous-station correspondante.
Le système permettant l'ouverture automatique des disjoncurs
des sous-stations comprend principalement :
1° Dans les centres d'alimentation : des relais avec piles et sonneries
;
2° Sur la voie : des boutons ordinaires de sonneries placés
dans es boites en fonte plombées, avec couvercle en verre.
Les boîtes ont distribuées à raison de une par gare,
et de une tous les 100 mètres environ en voie courante.
Les postes téléphoniques reliant les sous-stations aux
stations voisines sont du système Dardeau avec sonneries d'appel.
La composition des câbles du réseau téléphonique
et des avereurs d'alarme est identique à ceux de même destination
de la n° 3 ; ils sont à 8 paires entre les stations «
Place de l'Étoile » « Place du Trocadéro »
; à 9 paires depuis cette dernière ion jusqu'a la sous-station
de La Motte-Picquet; à 11 paires entre les sous-a Motte-Picquet
et Denfert-Rochereau ; à Paires, entre cette dernière
sous-station et la place d'Italie ; à 14
paires au delà jusqu'à la station « Gare de Lyon
» de la ligne r toute l'étendue de la ligne,
Sur toute la ligne deux câbles supplémentaires ont été
posés en attente.
Sur la voie, des boutons ordinaires de sonneries placés
dans des boîtes en fonte plombées, avec couvercle en verre.
Les boîtes sont distribuées à raison de une par
station et une tous les 100 mètres en souterrain courant.
Les postes téléphoniques placés dans le tunnel
et reliés aux stations sont du système Bailleux avec sonneries
d'appel ; ils sont installés près des signaux intermédiaires
et enfermés dans des boîtes en tôle. Sur la ligne
n° 3, ces postes sont au nombre de quatre : à savoir :
Deux entre les stations « Place de la République »
et « Avenue Parmentier » ils sont, par suite, reliés
l'un avec la première, l'autre avec la seconde ;
Deux entre les stations « Père-Lacbaise » et «
Place Martin-Nadaud ».
Le conducteur d'un train en détresse peut ainsi appeler le chef
de station et inversement.
Les postes téléphoniques reliant respectivement les sous
stations « Opéra » et « Père-Lacbaise
» aux stations les plus voisines, « Rue Caumartin »
et « Père-Lachaise », sont du système Dardeau
avec sonneries d'appel.