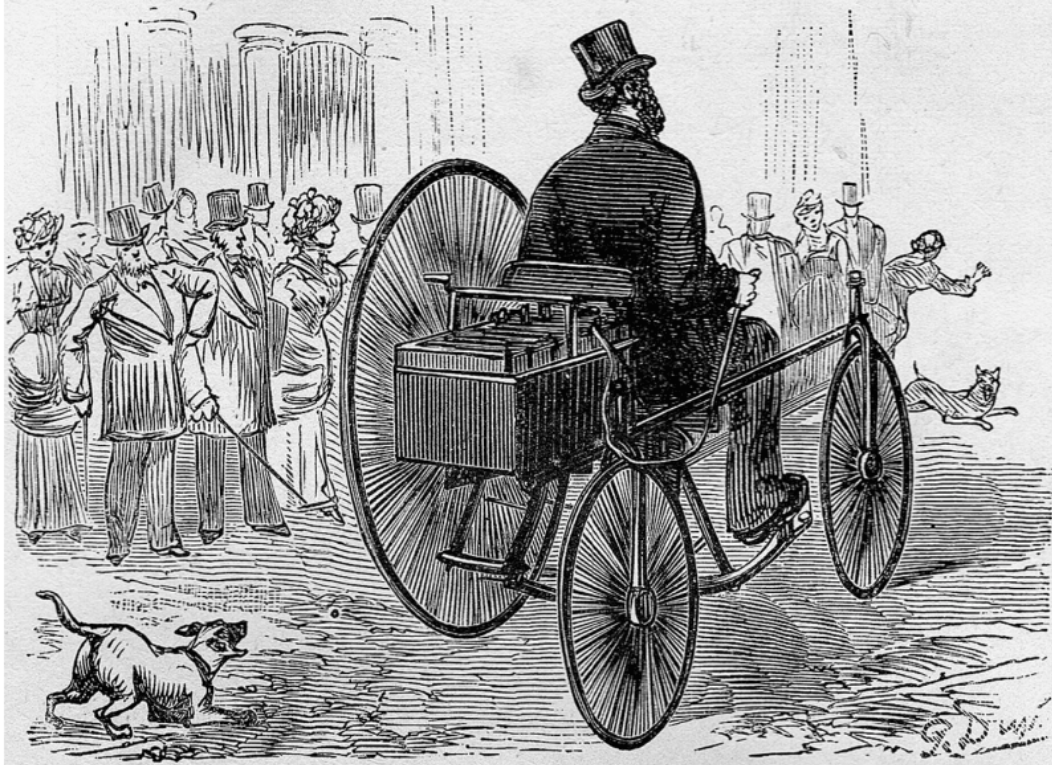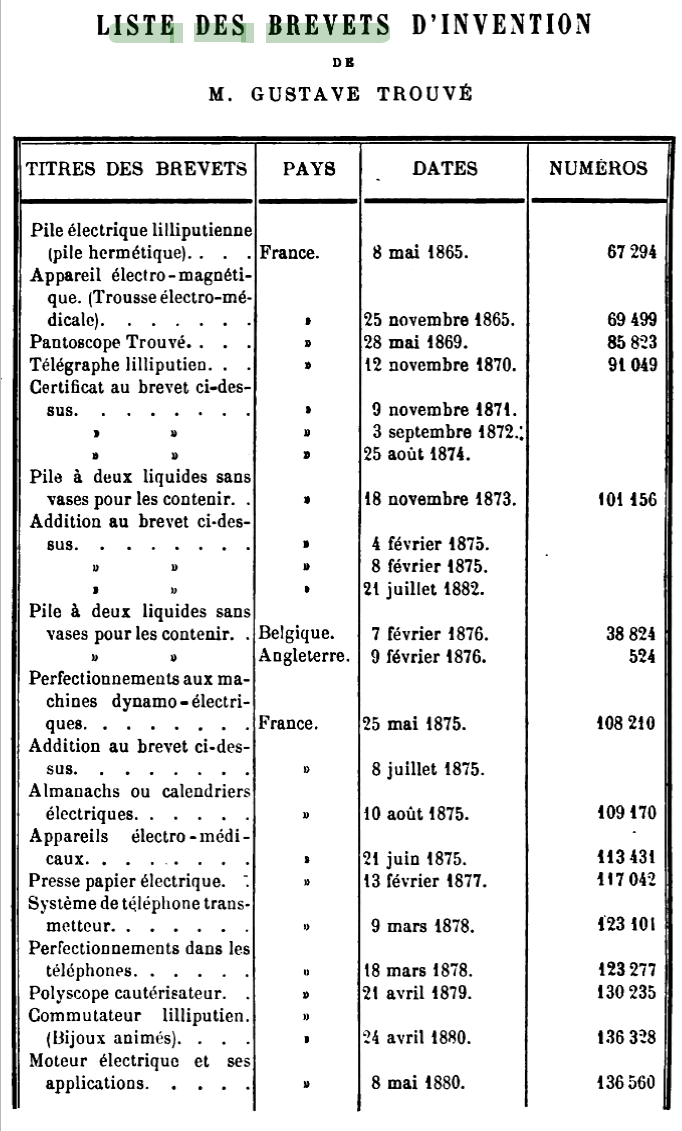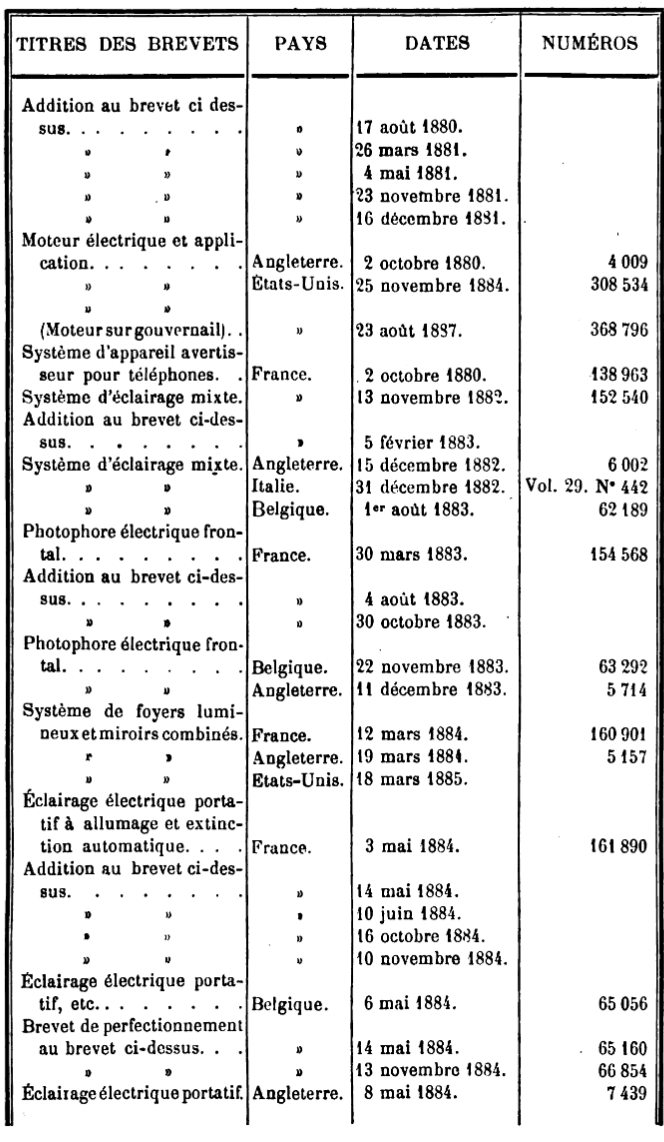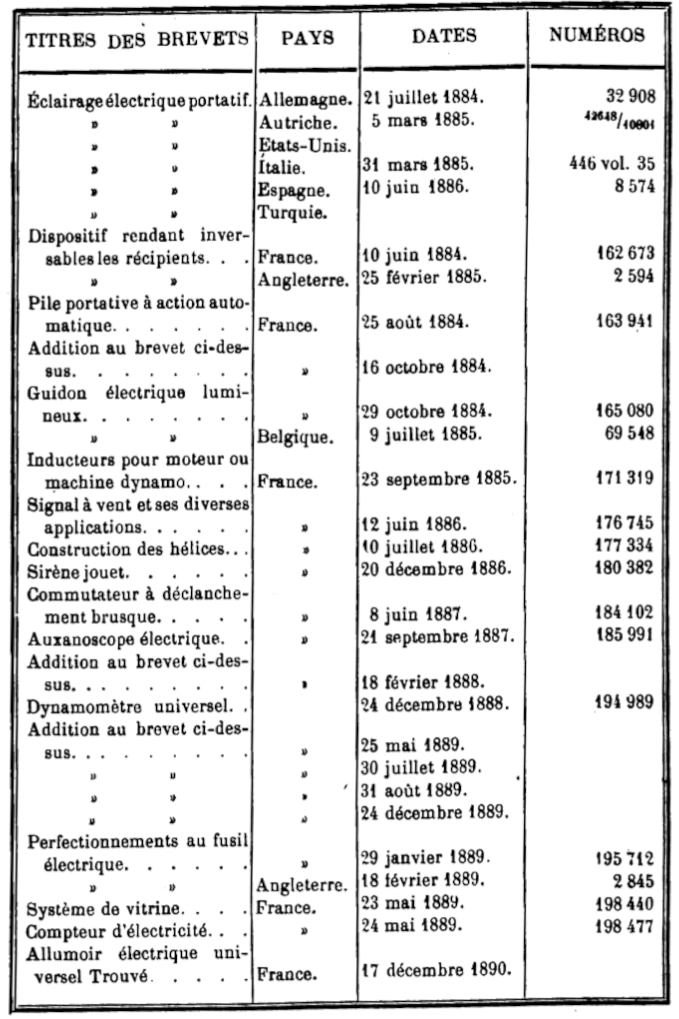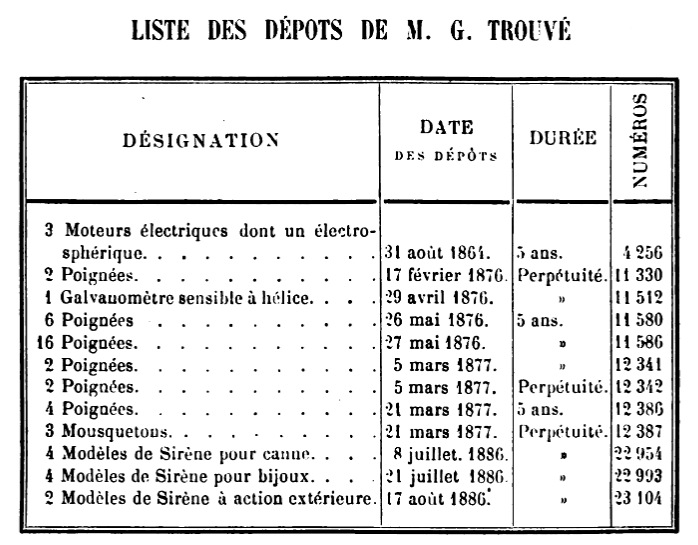GUSTAVE TROUVÉ (1839-1902)
|
Gustave Trouvé est né à
La Haye-Descartes dans une famille de petite bourgeoisie, son
père, Jacques Trouvé, étant marchand de bétail
possédait alors une assez jolie propriété. |
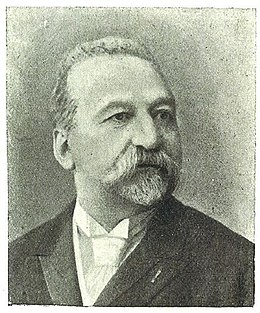 G. Trouvé |
Il fut précisé dans un journal anglais du XIXe siècle citant les travaux de Gustave Trouvé que : « si l’Angleterre a Swan, l’Amérique Edison, la France a Trouvé. »
Sommaire
En préface : Extrait du livre "1891
Histoire d'un inventeur : Exposé des découvertes et des
travaux de M. Gustave Trouvé dans le domaine de l'électricité",
par Barral, Georges, écrivain scientifique. Journaliste et publiciste
français.
Au milieu de l'énorme concours de savants que nous fréquentons,
nous connaissons peu d'hommes aussi simples, aussi laborieux, aussi bons,
aussi ennemis du bruit public, qu'il l'est dans tous les actes de son
existence extraordinairement occupée de chercheur et d'inventeur.
Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de consigner un souvenir
qui fait autant d'honneur à notre pays qu'à l'inventeur
auquel il se rapporte
, Il y a quelques années, lorsque Graham Bell, l'immortel créateur
du téléphone, vint à Paris, il fut accueilli avec
beaucoup d'empressement et de déférence par les Académies
et le monde savant. Avant de quitter la France, il tint à rendre
une visite personnelle à M. Gustave Trouvé, et il lui dit
en l'abordant : « J'ai voulu vous surprendre au milieu de vos travaux
que j'admire si vivement. Je veux, de plus, emporter en Amérique
une collection complète de toutes vos inventions, car elles constituent
pour moi l'expression la plus élevée de la perfection et
de l'ingéniosité de la science électrique française.
» Après ce témoignage d'un tel homme, M. Gustave Trouvé
serait vraiment mal venu de nous reprocher nos éloges, car ils
ne sont que l'écho fidèle du sentiment universel.
Georges BARRAL
Les inventions de M. Gustave Trouvé dans le domaine
de la génération de l'électricité sont :
- Les moteurs électriques. - Le dynamomètre universel. -
La Machine dynamo de démonstration. - Les piles. - Le téléphone.
D’après G. Barral qui a peut-être enjolivé la
précocité de Trouvé, dès son plus jeune âge,
Gustave se passionna pour les mathématiques et le
dessin. Du matin au soir, armé d’un couteau et d’un marteau
il construisait des petits chariots, des automates ou des télégraphes.
Son moulin à marion nettes entraîné par le vent et
installé au portail de la maison, était admiré par
tous les passants ; chacun reconnaissait alors les talents manuels autant
que la créativité de l’enfant. À sept ans, il
construisit une machine à vapeur formée d’une boîte
à poudre – la chaudière – et d’épingles
à cheveux – les bielles et manivelles – soudées
par du plomb et de l’étain, les supports étant coupés
dans du bois. Quoique rudimentaire, l’appareil était très
ingénieusement conçu et une double excentricité de
l’axe permettait une course suffisante des tiroirs.
Malgré la petitesse de ses organes, l’appareil fonctionnait.
On a pu en réaliser un dessin, l’original ayant été
conservé par Trouvé tout au long de sa vie. En 1850, il
commence ses études au collège de Chinon où il a
failli provoquer un incendie avec une machine à vapeur laissée
sous pression dans son pupitre Gustave Trouvé suivit les cours
de l’École des Arts et Métiers d’Angers dès
l’âge de 15 ans. Pendant toute cette période de formation
il cultiva un talent pour le dessin ce qui lui permit de représenter
avec une grande aisance les mécanismes qu’il concevait. Il
exécutait des dessins d’animaux tout en lignes géométriques,
avec une netteté extraordinaire et une rapidité vertigineuse.
Quelques gravures réalisées et signées par Gustave
Trouvé pour illustrer certains de ses articles viennent d’ailleurs
confirmer ses qualités artistiques. Kevin Desmond fait l’hypothèse
que les illustrations signées auraient certainement été
réalisées par Trouvé, jouant ainsi avec les mots.
Vers 1860, à sa sortie des Arts et Métiers, il entra dans
l’entreprise d’un grand horloger parisien. Il apprend aussi
le métier de serrurier.
En 1863, à 24 ans, il fonda une entreprise de fabrication d’instruments
de précision : G. TROUVE, 6 rue Thérèse, Paris.
Il fabriquait des instruments électriques et des instruments de
mesures linéaires en buis et ivoire. Il faut signaler que Trouvé
a su utiliser son nom, providentiel pour un inventeur, en signant ses
instruments soit par son nom soit par eurêka en alphabet
grec.
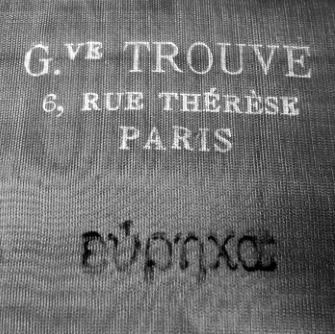 Appareil médical
Trouvé. Tissu du couvercle de la mallette
Appareil médical
Trouvé. Tissu du couvercle de la mallette
À partir de 1865, Trouvé met en place un atelier dans le centre de Paris, où il brevette de nombreuses applications très diverses dans le domaine de l'électricité, inventions décrites régulièrement par les magazines de vulgarisation scientifique de l'époque telles que La Nature. Pour alimenter ses automates électriques miniatures, il invente une batterie de poche carbone-zinc qui devient rapidement très populaire. Une batterie similaire a été inventée et largement commercialisée par Georges Leclanché.
En 1867, il expose un fusil électrique à
l’Exposition universelle de Paris, qui est très apprécié
par l’empereur Napoléon III. En 1869, il présente un
explorateur extracteur électrique de corps étrangers ayant
pénétré dans les tissus organiques, qui sera très
utile lors de la guerre de 1870. En 1873, il produit le polyscope qui
sert à explorer le corps humain.
En 1874, il développe un dispositif de localisation
et d'extraction d'objets métalliques tels que des balles logées
dans les corps des blessés, prototype du détecteur de métal
d'aujourd'hui.
Lors de son association avec Leblanc, il utilisa des locaux situés
au 40 rue de Saintonge entre 1871 et 1872.
Par la suite, il s’établit au 14 rue Vivienne,
où il occupa un ensemble logement-atelier-laboratoire-magasin jusqu’à
sa mort.
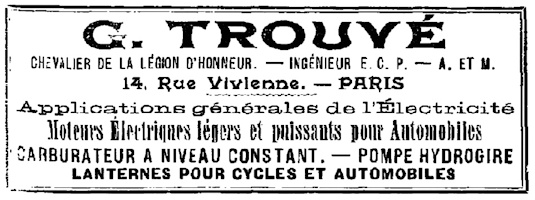
Il installe son atelier et poursuit ses inventions
: un moteur électrique, un tricycle électrique qui est le
premier véhicule de ce type au monde, un bateau à propulsion
électrique, une machine à coudre électrique, le polyscope
et le photophore qui servent d’éclairage électrique
pour l’usage des médecins mais aussi pour les spectacles,
une lampe de sécurité, l’auxanoscope qui est l’ancêtre
des projecteurs, etc...
Il n’a malheureusement pas été possible de trouver
des renseignements sur son entreprise mais elle se limitait certainement
à une ou plusieurs dizaines de personnes, comme celles de nombreux
constructeurs.
Les instruments étaient construits en séries limitées
voire même à l’unité pour une demande particulière
; seules quelques productions se faisaient en grand nombre, comme des
trousses électro-médicales pour l’armée.
L’industrialisation des fabrications électriques qui intervint
vers 1880, a dû certainement concerner la fabrique de Trouvé.
En 1880, celui-ci fit partie des 21 membres de la Chambre syndicale des
Industries électriques qui s’occupait du développement
et des applications de l’électricité. Il œuvra
également dans le comité d’organisation del’Exposition
internationale d’électricité de 1881 sous le titre
de constructeur électricien.
En 1881 au Palais de l’Industrie de Paris,
se tient l’Exposition internationale de l’Électricité.
Gustave Trouvé y présente ses nombreuses inventions et productions
: canot électrique, motorisation du dirigeable de Tissandier, motorisation
de la machine à coudre, huit ans avant Singer, et, sur le stand
551, toute une production d’électrologie médicale.
Trouvé y reçoit la médaille d’argent du jury,
et est décoré de la Légion d’Honneur.
En 1883, le photophore Hélot-Trouvé, conçu et produit
en collaboration avec le Dr Hélot, est présenté à
l’Académie de Médecine. L’idée de ce petit
éclairage électrique porté sur le front de l’opérateur
avec optique de focalisation relié à une pile Trouvé
est géniale ! C’est notre lampe frontale adoptée par
tout le corps médical.
Le 26 septembre 1887, au congrès de l’Association
française pour l’avancement des sciences, Trouvé, l'«électricien,
ingénieur à Paris» présente plusieurs appareils
liés à la fée électricité : des polyscopes
cliniques, une lampe de sécurité, un photophore, une lampe
sous-marine et un nouvel interrupteur. Mais ce qui étonne le plus
les participants, c’est l’utilisation de l’auxanoscope
électrique quand ils voient projetés sur un écran
les portraits de Chevreuil, de Pasteur et de divers objets.
En dehors de ses propres inventions pour lesquelles il
déposa 32 brevets,Trouvé s’efforça toujours
de perfectionner les systèmes existants, en particulier en les
miniaturisant.
Adepte de la recherche appliquée, Trouvé s’est passionné
pour l’électricité. Il a su aussi explorer les domaines
de la mécanique, des télécommunications, de la médecine
et des arts.
Lors de ses recherches, Trouvé collabora avec des confrères
ou des médecins. On peut citer le docteur Hélot pour la
réalisation de la lampe fron-
tale – ou photophore –, Foucault pour le gyroscope électrique,
Caillaud pour un modèle d’alimentation d’appareils d’électrothérapie,
Dunand avec qui il améliora le microphone, et les frères
Tissandier pour l’aérostat électrique.
Sa méthode de travail était empirique mais résolument
scientifique ; Trouvé ne fut certainement pas un inventeur-bricoleur.
En effet, face à un
problème technique, il recherchait de nouveaux procédés
basés sur ses connaissances d’ingénieur et étudiait
précisément les caractéristiques de ses instruments.
Il sut justifier ses choix aussi bien par des mesures que par des calculs.
Il s’attachait résolument au côté pratique de
ses inventions ou de ses améliorations : l’une de ses demandes
de brevets en fait d’ailleurs mention puisqu’il y est précisé
« un moteur et ses applications ».
Les instruments étaient construits en séries
limitées voire même à l’unité9 pour une
demande particulière ; seules quelques productions se faisaient
en grand nombre, comme des trousses électro-médicales pour
l’armée. L’industrialisation des fabrications électriques
qui intervint vers 1880, a dû certainement concerner la fabrique
de Trouvé. En 1880, celui-ci fit partie des 21 membres de la Chambre
syndicale des Industries électriques qui s’occupait du développement
et des applications de l’électricité. Il œuvra
également dans le comité d’organisation de l’Exposition
internationale d’électricité de 1881 sous le titre
de constructeur électricien.
,..
En 1902, en travaillant sur un appareil utilisant la lumière ultraviolette
pour traiter les maladies de peau, il se blesse, sa plaie s’infecte
et il meurt de septicémie à l’hôpital Saint-Louis
le 27 juillet. Gustave Trouvé n’ayant pas de descendants et
ses archives à la mairie de La Haye-Descartes ayant brûlé
en 1980, il tombe dans l’oubli. Même ses restes seront jetés
dans la fosse commune lorsque la concession de sa tombe sera arrivée
à échéance.
Ses archives ont été détruites en
février 1980 à la suite de l'incendie accidentel de la mairie.
En 2012, à la suite d’une biographie de l'historien des transports
anglais Kevin Desmond, une plaque commémorative est dévoilée
sur le site de sa ville natale. Le 15 octobre 2016, une deuxième
plaque est dévoilée sur le mur extérieur de son ancien
atelier, 14 rue Vivienne, dans le 2e arrondissement de Paris par Kevin
Desmond et Jacques Boutault, maire de l'arrondissement.
Une exposition célébrant le 180e anniversaire
de sa naissance, intitulée « Gustave Trouvé, le De
Vinci du XIXe siècle », a eu lieu à son lieu de naissance
à La Haye-Descartes, en France, au mois de mai 2019.
Seize de ses instruments originaux ont été rassemblés,
des voitures électriques, des bateaux, des drones et des vélos
modernes ont été rassemblés en son honneur.
L’ÉLECTRICITÉ, LE DOMAINE DE PRÉDILECTION DE TROUVÉ (1891 Extraits du livre "Histoire d'un inventeur" G.Barral)
Trouvé s’intéressa au domaine naissant
des télécommunications. Il mit au point un télégraphe
couplé à une montre-télégraphe avec manipulateur
et
récepteur. Cela permettait de coder des lettres ou des mots conventionnels
et rendait la transmission d’ordres militaires plus rapide. De plus,
cet appareil était complété par un système
de dérouleur de câble.
L'électricité touche à tout. C'est le type de la
science universelle. Elle devait donc s'adresser aux applications de la
guerre que l'homme de tous les temps, par une aberration singulière,
a cherché à porter au plus haut degré de perfectionnement.
La télégraphie devait donc naturellement contribuer à
servir ce goût inné pour se détruire le plus rapidement
possible, dont l'humanité est douée, La seule chose qui,
aux yeux du moraliste, diminue la hideur guerrière, c'est le sentiment
de la patrie qui est sacré. Dans ce sens, tout ce qu'on fait pour
améliorer les engins militaires est pardonné par la philosophie
et compris par le savant qui cherche avant tout les inventions utiles
à l'amélioration physique et intellectuelle de ses semblables,
C'est inspiré par ces idées très légitimes
que M. Gustave Trouvé a porté ses dons créateurs
sur la télégraphie militaire,
Le système qu'il a imaginé mérite d'attirer l'attention
pour deux raisons. D'une part, en effet, il réalise un ensemble
complet se suffisant à lui-même et pouvant servir dans un
très grand nombre de cas ; d'autre part, il a été
adopté par plus d'une armée européenne, c'est-à-dire
que ce n'est pas une chose récente, recommandée par sa nouveauté,
mais une combinaison qui a été appréciée par
les hommes les plus compétents dans le métier. L'ensemble
se compose d'un câble à deux fils destiné à
réunir deux stations, et, pour chaque station, d'une pile et d'un
appareil de correspondance, Le dessin représente la ligne et les
deux stations, ou, pour parler un langage moins technique, les deux correspondants,
L'officier qu'on voit à droite a choisi son point d'observation,
Il porte en bandoulière une pile et un appareil télégraphique,
gros comme une montre, qu'il peut mettre dans sa poche ou qu'il peut accrocher
au col de son vêtement dans les intervalles de la correspondance,
 1876
1876
Le soldat qui s'éloigne à gauche porte sur le dos un crochet
sac-bobine à la manière du sac ordinaire.
Sur ce crochet on voit d'abord à la partie supérieure une
grosse bobine sur laquelle est enroulé le câble et ensuite
à la partie inférieure, la pile. Il a en outre le petit
appareil télégraphique, qui est, au moment, considéré
suspendu en haut et à gauche du crochet. A mesure que le soldat
marche en avant, le câble se déroule derrière lui
sur le sol et la bobine tourne sur son axe. L'instant venu de correspondre
il décrochera le petit appareil télégraphique et
le prenant à la main commencera l'envoi ou la réception
des dépêches qui se présenteront.
Cette correspondance pourra avoir lieu sans même qu'il arrête
sa marche et sans que tout le câble soit déroulé.
Il faut noter qu'il y a 1 kilomètre de ce câble sur la bobine.
On sera donc obligé de s'arrêter après avoir parcouru
1000 mètres. Mais, on pourra aussi bien correspondre à une
distance moindre, 500 mètres par exemple parce que la communication
a toujours lieu au travers du câble entier, qu'il soit enroulé
sur la bobine ou déroulé sur le sol. Du reste le télégraphiste
est accompagné par des aides portant chacun 1 kilomètre
de câble pour allonger la ligne au fur et à mesure des besoins.
Le câble est à deux conducteurs isolés,Chacun d'eux
est recouvert de gutta-percha, et tous deux ensemble sont réunis
sous une enveloppe de ruban caoutchouté. Avec cette protection
le câble peut être étendu sur un sol sec ou humide,
sans aucun danger de détérioration. Il peut même être
exposé à la pluie ou traverser un ruisseau sans que la communication
en soit aucune ment troublée.
Nous ferons remarquer ici par parenthèse, que, vu le peu de résistance
électrique de la ligne une petite perte serait de peu de conséquence.
Les deux conducteurs sont attachés à la pile de l'officier
stationnaire avant la séparation des deux télégraphistes;
des boutons spéciaux désignés par des lettres ne
laissent place à aucune erreur. Avant de se quitter, ils vérifieront
leurs appareils en transmettant dans les deux sens, une courte phrase.
Après avoir repris sa position le télégraphiste mobile
en avisera son correspondant par l'envoi du mot d'ordre, et l'échange
des dépêches pourra commencer. Le soldat porteur du crochet
recherchera de préférence les sentiers inaccessibles aux
voitures. S'il a une route à traverser, il choisira un endroit
où des arbres puissent lui permettre de monter le fil à
une hauteur suffisante pour laisser passer par dessous les voitures et
les canons, car on comprend, du reste que si ce fil était étendu
au travers du chemin il courrait chance d'être écrasé
et coupé par les roues. A vrai dire pour ce cas et d'autres analogues,
il faudra adjoindre au télégraphiste un compagnon chargé
d'enlever le câble sur les branches des arbres et de divers soins
du même genre. D'ailleurs, quand le moment de cesser la communication
est venu le télégraphiste reçoit l'ordre de revenir
à son point de départ, et, là encore, un compagnon
lui est nécessaire pour enrouler le câble sur la bobine,
L'aide se sert alors d'une manivelle qui s'emmanche sur le bout de droite
de l'axe de la bobine ( fig,221 ). Il la tourne et enroule le câble
pendant que le porteur marche au petit pas pour faciliter l'opération.
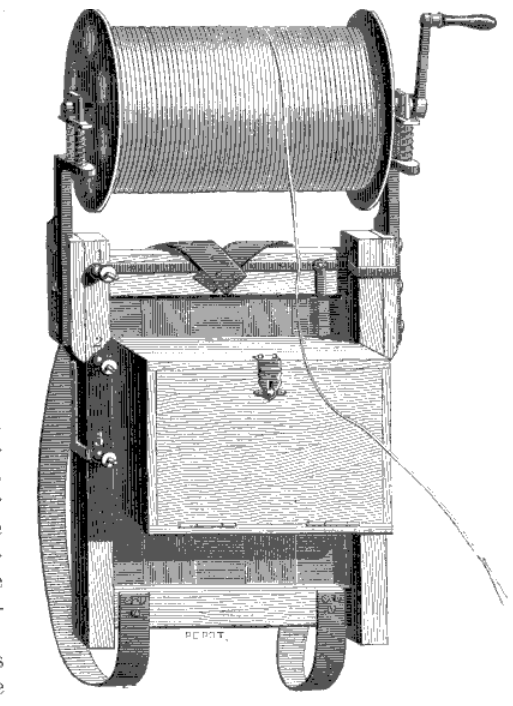 fig 221
fig 221
Nous avons montré ici deux télégraphistes, l'un stationnaire,
l'autre mobile, séparés par une distance maximum de 1000
metres; mais le second peut être accompagné d'un troisième
porteur d'un crochet et d'une bobine identiques. Quand l'un des porteurs
aura épuisé son câble le second commencera à
dérouler le sien non sans avoir établi la liaison entre
les deux câbles au moyen des petits mousquetons très ingénieusement
combinés par M. Gustave Trouvé. Il sera donc possible d'établir
la correspondance entre deux points distants de deux ou un plus grand
nombre de kilomètres. De plus les deux postes peuvent être
mobiles. Pour faire bien saisir toute l'utilité de cet ensemble
si simple il faut insister sur ce point que dans un cas de grande urgence
une ligne de un kilomètre peut être établie, sur un
terrain découvert en dix minutes c'est-à-dire dans le temps
nécessaire pour parcourir à pied cette distance. On aura
remarqué, dans ce qui précède, que nous avons parlé
d'un câble à deux fils tandis que le télégraphe
ordinaire n'emploie qu'un seul fil et se sert de la terre pour suppléer
au fil de retour.
En y réfléchissant, on verra que cette télégraphie
volante ne peut pas fonctionner dans les conditions ordinaires ; l'établissement
d'une bonne perte à la terre est en effet indispensable à
chaque station; or les télégraphistes militaires ne peuvent
pas toujours choisir un terrain convenable à cette communication
avec la terre qui, d'ailleurs, ne peut que bien rarement être établie
d'une manière instantanée. Dans les plaines de sable brûlées
par le soleil, en Algérie par exemple, on n'arriverait pas à
établir un fil de terre ; dans une plaine gelée à
plusieurs pieds d'épaisseur, comme ont été nos campagnes
pendant une notable partie du temps qu'a duré la dernière
guerre on n'y arriverait pas davantage. Ces raisons ont déterminé
M. Gustave Trouvé à employer deux conducteurs et à
s'écarter des habitudes du service télégraphique
ordinaire; et nous sommes convaincus qu'il a eu raison, sans vouloir dire
toutefois que la télégraphie militaire doive dans tous les
cas procéder ainsi. Si l'on avait à employer ce système
de télégraphie militaire à de grandes distances,
il serait à propos de faire usage des deux conducteurs comme d'un
seul ce qui réduirait de moitié la résis tance de
la ligne, et d'employer la terre pour le retour.
Nous nous sommes étendus assez longuement sur la ligne télégraphique
proprement dite, qui est la partie la plus essentielle d'un télégraphe
électrique; les appareils de correspondance n'en sont réellement
que l'accessoire; ils peuvent d'ailleurs être combinés de
bien des façons, et M.
Trouvé en a proposé deux concuremment : l'un est un télégraphe
à cadran très analogue au télégraphe Breguet
; l'autre est un appareil du système Morse à lecture au
son ce que nous appelons en langage technique un parleur.
L'appareil de correspondance désigné sous le nom de parleur
de M. Gustave Trouvé est représenté en demi-grandeur
naturelle par la figure 222.
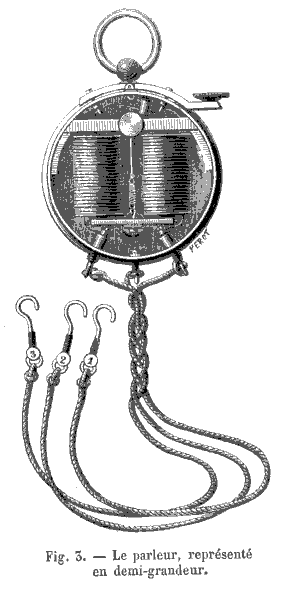
 fig
222
fig
222
Il a la dimension d'une grosse montre et peut être porté
dans un gousset, La boite est en métal ; on la fait habituellement
en laiton nickelé à la pile.
On a figuré l'instrument en demi-grandeur naturelle avec l'un des
fonds enlevé pour montrer le mécanisme qui est d'ailleurs
très simple. Un électro aimant en est le principal organe
; son armature placée au dessous a un mouvement peu étendu
autour d'un axe placé à côté du spectateur
; cette armature vient par un petit appendice frapper un bouton monté
sur le fond de la boîte qui est en arrière. Ces petits coups
font un bruit suffisant avec une pile convenable pour permettre facilement
la lecture sans même qu'il soit nécessaire de mettre l'appareil
près de l'oreille ; on comprend que la boîte du parleur sert
de caisse de résonnance et contribue notablement à la netteté
de la perception.
Le manipulateur, ou clef Morse, est placé à l'extérieur
de la boite ; c'est un petit levier qui pivote autour d'un axe et dont
l'extrémité est relevée ; la manipulation peut se
faire avec le bout de l'index de la main droite la boite étant
tenue dans la main gauche,
Le cadran de M. Trouvé pour son télégraphe système
Bréguet est représenté au recto par la figure 223.
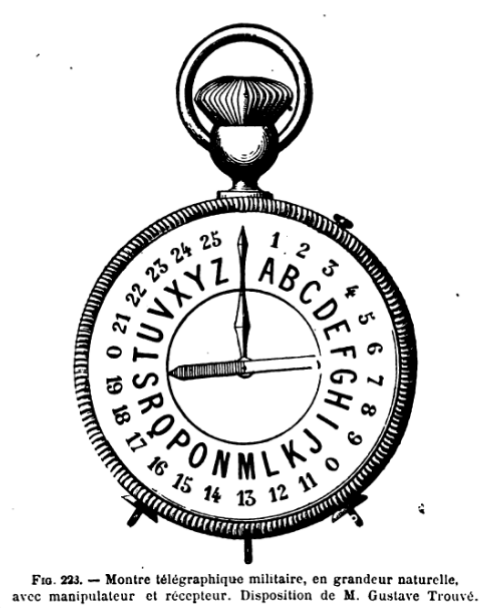
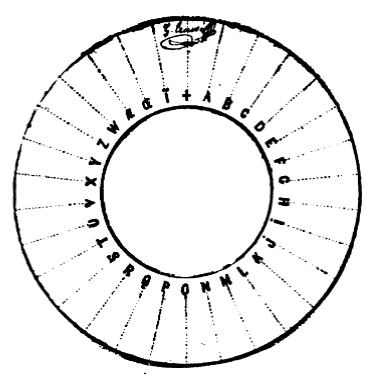 fig
224
fig
224
Le verso représenté par la figure 224, est muni centralement
des lettres de l'alphabet,
Des blancs sont ménagés suivant les rayons pour permettre
aux télégraphistes d'y inscrire des mots appropriés
et en rapport avec leur situation ou le genre d'exercices, Cette disposition
évite les longues épellations des mots.
Fig 225 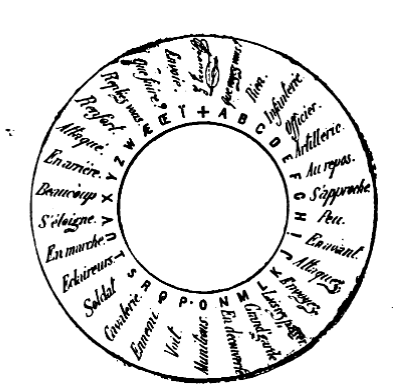 (
(
La figure 225 montre tout préparé par exemple le cadran
des avant-postes. Il indique de quelle arme on est en présence
; si l'ennemi est en repos ou en marche, s'il s'approche ou s'éloigne,
s'il est en nombre, si l'on a affaire à des éclaireurs,
etc. Les ordres usuels y sont inscrits : En avant, en retraite, attaquez,
laissez passer, Enfin demandes de renfort, de vivres, de munitions, etc.
Des lettres sont encore réservées au centre du cadran pour
communiquer un mot ou un ordre qui n'aurait pas été prévu.
Que l'on veuille maintenant correspondre promptement après avoir
échangé le mot d'ordre et le mot de ralliement et indiqué
le numéro du cadran dont il faut se servir, le poste attaquant
ou expéditeur n'a plus qu'à placer l'aiguille de sa montre
télégraphique sur chaque mot qu'il veut transmettre et aussitôt
le poste attaqué ou récepteur lit ce mot indiqué
par son aiguille, Comme cette transmission se fait pour ainsi dire aussi
vite qu'avec la parole il est facile au poste récepteur de retélégraphier
sa dépêche comme moyen de contrôle. Comme les cadrans
sont en papier, légers et peu volumineux, on peut en avoir un certain
nombre préparés d'avance ou disposé spécialement
pour la circonstance avant la séparation des deux postes. D'ailleurs
par des signes conventionnels on passe des lettres aux
mots, ou des mots aux lettres, ainsi que d'un cadran à l'autre,
ou simplement du recto au verso, pour pouvoir, au besoin, expédier
une dépêche chiffrée.
On conçoit l'avantage exceptionnel, avant l'invention des téléphones,
de ce télégraphe militaire; car il permettait de transmettre
une dépêche silencieusement aussi vite que la parole et cela
sans aucun apprentissage du télégraphiste.
Précédemment, M. Trouvé avait réalisé
une autre disposition encore plus compacte ; la manipulation se faisait
par un bouton placé dans l'anneau de la bélière,
comme est le bouton de remontoir dans les montres qui se remontent sans
clef. Il n'est pas impossible qu'on revienne à cette forme qui
offre moins de prise aux accidents. Trois fils conducteurs isolés
sont attachés à l'appareil et servent à le relier
à la pile et au câble de ligne.
Ces conducteurs sont formés chacun de plusieurs fils de cuivre
très fins, tressés, ce qui donne une souplesse extrême
à l'ensemble. Ils sont recouverts chacun de soie, d'une couleur
spéciale ; d'ailleurs, le petit crochet qui les termine est numéroté,
et ces numéros correspondent à ceux des boutons de la caisse
à pile auxquels ils doivent être attachés, de telle
sorte que, malgré la hâte fiévreuse avec laquelle
toutes ces liaisons peuvent être faites quelquefois, il ne parait
pas possible de commettre d'erreur.
Il nous reste à parler de la pile elle -même, qui n'est pas
la partie la moins heureuse de l'ensemble, et qui présente des
avantages tout à fait incontestables pour la télégraphie
militaire. Nous le ferons rapidement, car le lecteur y trouvera la description
détaillée et complète, avec dessins à l'appui,
au chapitre consacré aux sources d'électricité. D'ailleurs,
dès à présent, on a vu le caractère spécial
du télégraphe de M. Gustave Trouvé, qui est la réunion
sur le dos d'un homme de toutes ses parties (câbles, pile, manipulateur,
récepteur, avertisseur ). Tout cet ensemble est comparable à
un sac de soldat et il est d'un moindre poids.
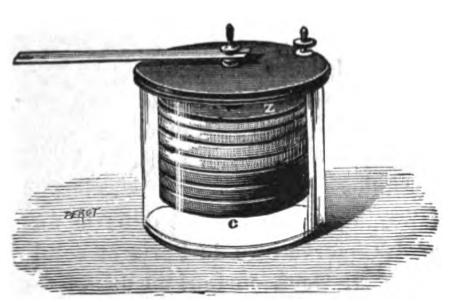 fig 226
fig 226
Quant à la pile de M.Gustave Trouvé (fig. 226), ce qui fait
son inappréciable avantage dans le cas présent, c'est qu'elle
fonctionne sans liquide, ou du moins sans liquide libre pouvant se renverser
ou fuir des vases qui le contiennent. D'une façon succincte, disons,
en passant, que chaque élément est composé d'un disque
rond de zinc et d'un disque de cuivre placés parallèlement
l'un à l'autre et ils sont séparés par des disques
de papier d'un diamètre moindre. Cette masse de papier peut absorber
beaucoup d'eau et rester humide pendant un temps très long, surtout
dans les conditions les plus pratiques, La moitié
inférieure des disques de papier est imbibée d'une solution
saturée de sulfate de cuivre, l'autre moitié d'une solution
de sulfate de zinc, Le lecteur constate qu'on possède ainsi tous
les éléments d'une pile Daniell ordinaire, dans laquelle
les deux liquides restent séparés beaucoup mieux qu'ils
ne le sont par les vases poreux. Avec cette disposition, l'usure du sulfate
de cuivre ne produit guère que par suite du passage du courant
; en d'autres termes, dans cette combinaison ingénieuse, il n'y
a presque pas de travail intérieur de la pile perdu ; or, on sait
que c'est cette usure constante qui est un des graves dé fauts
de la pile si remarquable de Daniell. Le disque de cuivre est maintenu,
au centre, par une tige isolée des rondelles de papier et du zinc
; elle dépasse la table d'ardoise qui surmonte l'élément
et qui sert de couvercle au vase de verre ou d'ébonite dans lequel
on place l'élément à l'abri des courants d'air et
de la poussière. Le bord de ce vase a été rodé
et l'ardoise bien dressée, de telle sorte que l'élément
se trouve dans une capacité hermétiquement fermée
et, par conséquent, préservé de l'évaporation.
Ainsi composé, l'élément peut fonctionner pendant
plus d'une année, sans qu'on ait à s'en occuper en aucune
façon. Tel est l'élément humide, du nom que lui a
donné l'inventeur ; et, pour le dire en courant, cette dénomination
a l'avantage d'être rigoureusement exacte, tandis que le nom de
pile sèche, qui a cours dans l'enseignement classique, est inexact,
appliqué aux piles de Zamboni, qui n'agissent réellement
que grâce à l'humidité qu'elles absorbent.
L'élément humide de M. Gustave Trouvé a la même
force électromotrice que l'élément Daniell, dont
il ne diffère que par la forme. Sa résistance varie avec
le diamètre des rondelles de cuivre et de zinc et avec l'épaisseur
de la pile de papier intermédiaire,
Pour un diamètre donné des rondelles métalliques,
on ne pourrait pas diminuer par trop la quantité de papier sans
faire perdre à la pile les quantités de durée qui
font l'un de ses principaux mérites ; par contre, à mesure
qu'on augmente l'épaisseur du papier, on augmente la durée
possible du service actif et en même temps la résistance.
La première application que M. Gustave Trouvé ait faite
de la pile a été à la thérapeutique. Il réunit
un grand nombre d'éléments de petite dimension dans une
même boite (les plus petites ont des rondelles métalliques
du diamètre d'un sou français ), et constitue un appareil
excellent pour l'application du courant continu ; excellent parce qu'il
a une tension assez grande et point de quantité, de telle sorte
qu'il ne produit pas de décomposition des tissus aux points d'application
des électrodes. L'application à la télégraphie
militaire était donc toute indiquée ; nous avons fait connaitre
le télégraphe portatif dont fait partie une pile du système
que nous venons de décrire.
 FIG 227 Pile militaire
de M. Gustave Trouvé.
FIG 227 Pile militaire
de M. Gustave Trouvé.
Cette pile ( fig 227 ) est composée de trois boites superposées,
dont chacune contient trois éléments ; ces boites sont faites
en caoutchouc durci ; le couvercle auquel sont attachés les trois
éléments est en ardoise, Avec ces neuf éléments
on peut faire fonctionner le parleur à plusieurs kilomètres
de distance. La pile, on le comprend facilement, peut être portée
sans précaution, inclinée sur le côté, ou même
mise à l'envers dans les voitures de transport, sans aucun inconvénient.
On pourra appliquer également cette pile humide à tous les
appareils d'avertissement ou autres fonctionnant dans des trains de chemin
de fer ou dans des voitures.
Nous croyons que pour la télégraphie générale,
la pile de M. Gustave Trouvé est destinée à rendre
de grands services. On l'emploiera de préférence sur les
circuits d'une certaine résistance, auxquels elle est plus particulièrement
adaptée par suite de sa résistance intérieure assez
considérable. En effet, elle présente les avantages connus
de la pile Daniell, dépolarisation complète de l'électrode,
et, par suite, grande constance. On peut même dire que, sous cette
forme, la pile Daniell prend une constance inaccoutumée ; nous
nous expliquons : avec la forme ordinaire, on remarque que la force électromotrice
est absolument invariable, tandis que la résistance intérieure
varie d'une manière continuelle, surtout quand le courant est interrompu
et rétabli; chaque fois qu'on mesure à nouveau la résistance
intérieure d'une pile Daniell, on trouve une valeur différente,
et cependant ces valeurs variables conduisent à une valeur unique
de la force électromotrice ; cela s'explique sans doute par les
variations con tinuelles de la composition du liquide.
Les appareils télégraphiques de M. Gustave Trouvé
ont eu une consécration officielle dans un ouvrage (1872), sur
la matière, de M.
Aurèle Guérin, ancien élève de
l'Ecole polytechnique et de l'Ecole d'application de Fontainebleau,
aujourd'hui chef de bataillon d'artillerie à l'Etat-Major de la
place de Paris.
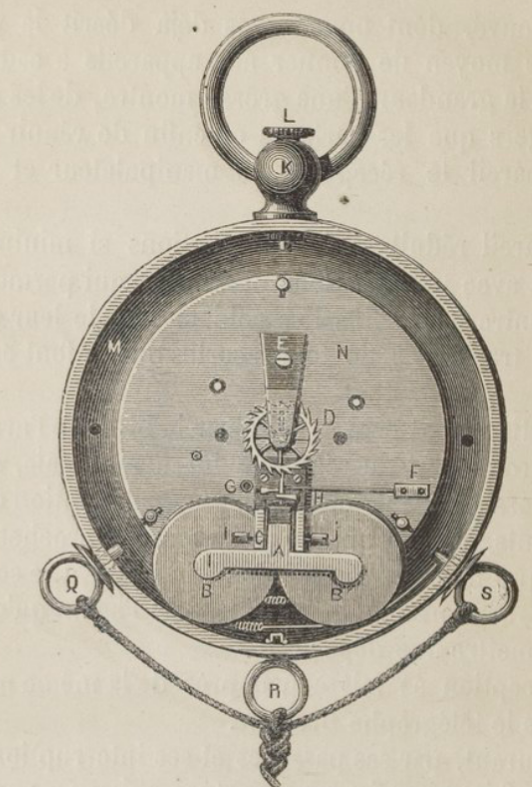
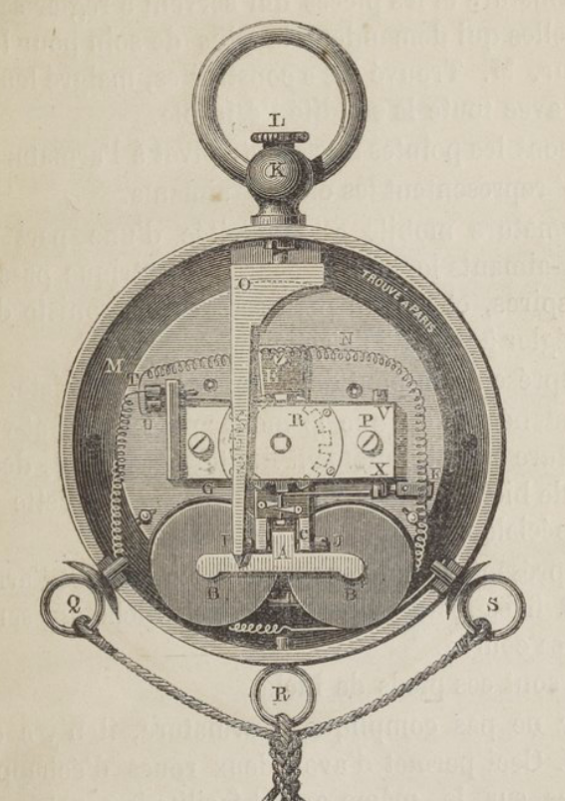
Après avoir passé en revue et examiné les divers
systèmes employés par les gouvernements, l'auteur n'hésite
pas à manifester hautement sa préférence en faveur
des inventions de MM, Morse et Gustave Trouvé.
« Les deux appareils Morse et Trouvé ont chacun leurs
avantages, dit -il. Ils se complètent l'un l'autre. Le premier,
employé à la correspondance internationale, donnerait, avec
un matériel moins encombrant, une solution excellente de la télégraphie
de réserve ; le second, même avec les câbles défectueux
que nous possédons, apporte une solution de la télégraphie
militaire aux avant -postes et pendant le combat. C'est un appareil léger
et transportable comme les parleurs, et en même temps un télégraphe.
Il peut remplacer les télégraphes Bréguet sur les
chemins de fer; on peut l'utiliser partout. La télégraphie
militaire continuera à se servir de l'appareil imprimeur Morse,
mais elle placera le télégraphe Trouvé au premier
rang parmi ceux qu'elle doit employer.»
Non seulement l'appareil Trouvé, préféré par
cet officier distingué à tous les autres appareils, leur
est supérieur sur les champs de bataille par la rapidité
de la transmission et la légèreté de son transport,
mais encore il a cette propriété de convenir aux chemins
de fer, au service intérieur des grands établisse ments,
« Tous les jours, ajoute M. le chef de bataillon Aurèle
Guérin, presque sur chaque ligne de chemin de fer arrive, sinon
un déraillement, du moins un accident qui oblige un train à
rester sur une voie sans pouvoir avancer ni reculer, La voie étant
embarrassée, le service devrait être immédiatement
interrompu, et aucun train ne devrait dépasser les deux stations
de part et d'autre les plus rapprochées du lieu de l'accident.
L'organisation actuelle du service sur les trains de chemin de fer ne
le permet pas, En effet, lorsqu'un cas semblable arrive, une personne
se rend à pied, en suivant la voie, jusqu'à la station la
plus voisine, en prévient le chef, qui, à son tour, télégraphie
la nouvelle à l'autre station et demande du secours, Or, bon nombre
de stations sont distantes l'une de l'autre d'au moins 10 kilomètres,
et si l'on suppose le train arrêté à mi-chemin, une
heure environ se passera avant que les chefs de stations, les inspecteurs
et les commissaires de sur veillance en soient avertis, et pendant ce
temps les trains qui suivent n'auront pas été arrêtés
et pourront amener, par leur rencontre avec le premier, des catastrophes
terribles. « Supposons maintenant que le chef du train en
détresse ait avec lui un petit télégraphe portatif
lui permettant, à un endroit quelconque de la voie, d'envoyer et
de recevoir des dépêches; au moment où le train s'arrêtera,
obligé de rester en place, il notifiera aux stations voisines le
cas où il se trouve et la nature du secours qu'on doit lui envoyer.
On saura donc tout de suite si les deux voies sont obstruées ou
laquelle est libre, et on prendra les mesures en conséquence. Outre
l'avantage immense d'éviter l'arrivée d'un train sur celui
qui est arrêté, on aura encore celui de gagner un temps précieux,
de dégager beaucoup plus rapide ment la voie qui n'est pas libre
et d'éviter ces longs retards si préjudiciables aux voyageurs
et aux compagnies elles-mêmes.«
La montre télégraphique destinée au service intérieur
des grands établissements industriels, manufacturiers ou administratifs,
par M. Gustave Trouvé, est des plus ingénieuses. On sait
que dans de colossales usines existant en Amérique et en Angleterre,
et dans quelques unes de celles plus réduites de France, d'Allemagne
et de Belgique, de petites lignes télégraphiques relient
le bureau du directeur à ceux des contrôleurs et des chefs
d'atelier. Le but principal est de régulariser tout le service
intérieur. On conçoit, en effet, que dans une manufacture
où sont souvent réunis plusieurs milliers d'ouvriers, où
se trouvent des hauts fourneaux, des charbonnières, des forges,
des fonderies, etc., le directeur a intérêt à savoir
immédiatement tout ce qui s'y passe. Son bureau est souvent éloigné
de quelques centaines de mètres de celui de certains employés,
et s'il veut demander à l'un d'eux un renseignement quelconque,
ou lui donner des instructions spéciales sans le secours du télégraphe,
il devra lui envoyer un domestique et attendre une demi-heure, souvent
davantage, sa réponse écrite et signée, ou bien il
le fera venir à son bureau et le distraira ainsi de la surveillance
de l'atelier qu'il dirige. Il arrivera alors que les ateliers se trouveront
pendant un temps plus ou moins considérable, suivant leur distance
au bureau central, sans direction aucune ; la besogne sera moins bien
faite, et si, par hasard, un accident, une chose imprévue survient,
ni l'employé, ni le directeur n'en seront prévenus sur l'heure
et ne pourront prendre immédiatement les mesures commandées
par la circonstance. Si, au contraire, chaque atelier est relié
télégraphiquement avec le bureau central, le directeur peut
exercer de son cabinet une surveillance complète sur les diverses
parties de son établissement, donner ses instructions, demander
les renseignements dont il a besoin, sans enlever un seul instant un employé
à son travail, C'est un avantage de premier ordre qu'ont parfaite
ment compris tous les industriels qui ont organisé dans leurs usines
un service télégraphique régulier.
Le télégraphe employé le plus généralement
est le télégraphe å cadran, Tous ceux qu'on a construits
jusqu'ici exigent par leurs dimensions une installation particulière
dans chaque atelier. Le télégraphe construit par M. Gustave
Trouvé remplacerait très avantageusement ces appareils,
parce qu'il a un très petit volume, ne nécessite aucuns
frais spéciaux pour son établissement et coûte beaucoup
moins cher. On pourra lui conserver le cadran des mots, les noms des contrôleurs
et des chefs d'atelier étant les mots correspondant aux lettres
de l'alphabet; et, si l'on avait soin de disposer les lignes télégraphiques
dans l'intérieur des bâtiments, le long des murs, à
hauteur d'homme à peu près, les employés pourraient
circuler dans leurs ateliers, portant sur eux la montre télégraphique
et un élément Trouvé, et quand une sonnerie les avertirait
qu'une dépêche est destinée à l'un d'eux, ils
établiraient de suite, sans avoir besoin de courir à leur
bureau, la communication de la montre avec la ligne, et sauraient, au
premier signe, si la dépêche leur est destinée ou
non, Dans le premier cas, ils la recevraient et rendraient réponse
immédiatement; dans l'autre, ils supprimeraient la communication
de la montre avec la ligne et iraient terminer leurs instructions à
l'ouvrier qu'ils viendraient de quitter. Tout cela demanderait au plus
deux minutes.
La montre télégraphique réalise donc une économie
notable pour le directeur de l'usine, et une grande diminution de perte
de temps pour les employés, Ces avantages sont très sérieux,
et comme ils se rapportent non seulement aux grands établissements
industriels, mais encore à tous ceux dont les divers corps de bâtiment
sont très éloignés les uns des autres et en particulier
aux grands établissements militaires, nous avons cru devoir appeler
sur eux l'attention,
A l'époque de la publication de l'ouvrage de M. Aurèle Guérin,
le téléphone n'était pas encore inventé et
le cadran de M. Gustave Trouvé présentait un intérêt
capital, un peu amoindri aujourd'hui, Actuellement, quand il y a avantage,
M. Gustave Trouvé remplace son cadran par un petit téléphone
avertisseur, dont nous allons bientôt parler.
Pour donner une idée plus précise de son importance à
l'époque de sa découverte, citons cette page historique
de notre histoire néfaste.
C'était en novembre 1870, les obus prussiens pleuvaient sur Paris
et le blocus affamait la grande ville, M. Gustave Trouvé, par une
froide soirée, présage du rigoureux hiver qui allait commencer,
donnait une conférence, avec l'aide du Dr Mallez, dans l'ancien
théâtre de l'Athénée, situé rue Auber,
près de l'Opéra non terminé alors et qui servait
d'ambulance, de magasin à poudre et d'ateliers de réparations
d'armes tout à la fois ! A cette époque c'était un
volcan mais nous n'y dansions pas, Il démontrait à ses auditeurs,
enfiévrés par la disette, mais non abattus, son explorateur-extracteur
des projectiles, son oiseau mécanique, et le nouveau télégraphe
militaire qu'il venait de créer. A sa parole vibrante et chaude,
l'espoir renaissait au coeur des courageux citoyens et l'enthousiasme
réchauffait leur âme attristée,
« Que l'un quelconque d'entre vous, Messieurs, disait notre
conférencier, veuille bien expérimenter mon télégraphe.
Pourvu qu'il sache lire il pourra, tout aussi bien que moi, recevoir et
transmettre une dépêche. De l'assemblée surgit
un brave Auvergnat : « Tenez, me voilà, clama-t-il avec
énergie, je suis votre homme! » Et aux bravos frénétiques
de la salle, il s'équipait du sac bobine, de la montre télégraphique
et gagnait le seuil de la porte. Quelques hommes de bonne volonté
s'offrirent successivement pour le transmetteur, et, en même temps
qu'ils plaçaient l'aiguille sur les mots du cadran mobile, la voix
de stentor de l'enfant de l'Auvergne répétait : Arlillerie
! Cavalerie ! Infanterie ! Ennemi!, avec l'accent spécial à
sa province. On riait, mais l'admiration, l'enthousiasme n'en étaient
pas diminués, M. Gustave Trouvé fut enlevé de terre
en un instant et porté en triomphe sur les épaules ! Immédiatement
on voulut, d'un élan unanime, le conduire chez le général
Ducrot, membre de la Défense nationale et commandant en chef des
troupes investies, Il était dix heures du soir et, à moins
de force majeure, c'est une heure peu propice aux présentations
et aux expériences ! M. Déhérain, alors professeur
au Collège Chaptal, aujourd'hui membre de l'Institut et l'un de
nos agronomes les plus écoutés, se présenta heureusement
et prit le ferme engagement, devant la réunion, de conduire M.
Trouvé, dès le lendemain matin, chez le général
Frébault, attaché à la Place, et, de là, près
le général Ducrot, Ce qui fut dit fut fait, et M. G. Trouvé
était présenté, à l'heure dite, par M. Déhérain,
à l'excellent général Frebault et au commandant en
chef qu'ils allèrent rejoindre à la Porte -Maillot. De nouvelles
expériences furent faites, avec des soldats inexpérimentés,
et, séance tenante, M. Gustave Trouvé reçut l'ordre
de construire immédiatement cent vingt postes télégraphiques,
Malheureusement la matière première faisait défaut
et, malgré l'activité de notre inventeur qui courut aux
remparts chercher des bras, vingt - cinq postes seulement furent livrés
à M. de la Barre Duparcq, délégué par le Gouvernement
militaire pour les recevoir. Hélas ! les jours passaient et la
capitulation était imminente ...
Sommaire
Les Téléphones et Microphones de M. Gustave Trouvé
.
Le téléphone et le microphone constituent deux applications
vraiment extraordinaires et tout à fait inattendues de l'électricité.
La loi physique universelle de la conservation de l'énergie se
manifeste d'une manière extrêmement remarquable sur le terrain
de la téléphonie et de la microphonie .
Il est prouvé aujourd'hui qu'il y a un enchaînement caché
entre les ondulations sonores, les vibrations moléculaires et les
courants électriques et qu'on peut tirer un parti extrêmement
utile et puissant de cette consta tation de la science moderne .
L'esprit si chercheur et si inventif de M. Gustave Trouvé devait
être attiré aussi vers les problèmes encore nouveaux
et il devait y laisser les marques de son ingéniosité sans
cesse en éveil .
La téléphonie est l'art de transmettre au loin la parole,
comme l'indique son étymologie grecque, loin, et parole . D'abord
subordonnée à la télégraphie électrique,
elle tend de plus en plus à prendre une place prépondérante.
Aucune découverte n'a eu une fortune aussi rapide et aussi brillante.
Lorsque parvint en Europe le récit de l'expérience fondamentale
du 2 juin 1875, il y eut tout d'abord un mouvement d'incrédulité
. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Graham
Bell avait bien, en effet, créé une petite machine magnéto-électrique
réversible, d'une si grande sensibilité qu'elle était
impressionnable par le simple souffle de la voix. Cela fut un enthousiasme
général et cela devint un engouement sans précédent.
L'appareil de Graham Bell fut rapidement perfectionné par les savants
des deux mondes, et il entra sans désemparer dans le domaine de
la pratique courante, sans avoir à compter avec les périodes
d'incubation ou de tâtonnements pénibles et coûteux,
auxquelles bien peu d'inventions, grandes ou petites, parviennent à
échapper.
Dès l'année 1881, le téléphone fonctionnait
dans plusieurs villes d'Amérique et d'Europe; aujourd'hui on en
fait usage dans toutes les parties du monde . Ses admirateurs de la première
heure, tous ceux qui ont eu foi en son avenir, dès son apparition,
n'auraient pas osé lui prédire un semblable succès
.Des plus optimistes le voyaient se substituer peu à peu au télégraphe.
Mais on ne songeait pas qu'il ferait mieux et autre chose.
On ne supposait pas qu'il serait capable d'établir une communication
permanente, non pas seulement entre des bureaux publics, mais encore entre
toutes les demeures particulières. On est obligé d'aller
chercher le télégraphe; on a le téléphone
sous la main . Pour se servir du télégraphe, il faut recourir
à l'assistance d'un tiers ; le téléphone, lui, supprime
tout intermédiaire . Telles sont les causes premières de
sa prodigieuse fortune, comme le fait très bien remarquer M.Émile
Bouant, un de ses historiens.
Télégraphe et téléphone ne sont pas, au reste,
des rivaux qui doivent se gêner l'un l'autre et se porter ombrage
. Chacun dans sa sphère d'action doit contribuer à satisfaire
et à accroître le besoin chaque jour plus impérieux
de communiquer rapidement. Il en résultera nécessairement
un développement parallèle de tous les procédés
de correspondance. Toutefois l'instrument de Graham Bell, dans sa merveilleuse
simplicité, ne se prêtait qu'à des transmissions peu
lointaines, en fournissant un son faible et sourd . Mais il ne resta pas
longtemps dans cet état primitif.
Rapidement amélioré, il devint, en quelques années,
susceptible de satisfaire à toutes les exigences, grâce aux
perfectionnements divers qu'on a fait subir à sa construction première.
Pour son compte, voici ceux quc M. Gustave Trouvé a apporté
à diverses reprises au téléphone primitif.
Le lundi 1er avril 1878, il présenta à l'Académie
des sciences de Paris, dans les termes suivants, un téléphone
à membranes multiples, représenté par la figure 228
: « J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie des
sciences les nouveaux résultats des recherches que j'ai poursuivies
relativement au téléphone, par l'application de membranes
multiples vibrantes tendant à renforcer l'intensité des
courants transmetteurs .
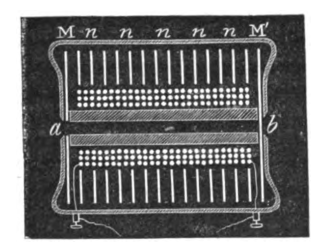 FIG 228 Téléphone
à membranes multiples système de M. Gustave Trouvé
.
FIG 228 Téléphone
à membranes multiples système de M. Gustave Trouvé
.
« Dans ma communication du 10 décembre 1877, j'annonçais,
en effet, qu'on pouvait renforcer sensiblement l'intensité des
courants produits, et, par suite, l'intensité du son lui - même
; et j'avais adopté, à cet égard, une association
polyédrique de membranes vibrant à l'unisson .
Voici une nouvelle disposition qui, mettant à profit le même
principe, donne des résultats supérieurs . ab est un aimant
tubulaire en touré par un solenoide dans toute M n M' sa longueur.
En regard de l'un de ses pôles a est une membrane circulaire M semblable
à celle du téléphone ordinaire, mais percée
en a son milieu d'un trou dont le diamètre est égal au diainètre
intérieur du tube-aimant . A l'autre pôle b est une membrane
semblable M ', mais tout à fait pleine.
On comprend aisément l'avanage de cette combinaison : si on parle
en regard du pôle de l'aimant e devant lequel est la membrane percée
M, les ondes sonores la mettent en vibration et, continuant leur route
dans l'intérieur du tube- aimant, viennent faire vibrer la seconde
membrane pleine M ' placée à l'autre pôle du tube-aimant.
« Il en résulte que l'aimant, influencé à la
fois par ses deux pôles, engendre dans le solénoïde
des courants notablement plus intenses que s'il n'était influencé
que par un seul pôle et par une seule membrane.
« Le récepteur, semblable au transmetteur que nous venons
de décrire, reçoit les courants correspondants, qui mettent
simultanément les deux mem branes en vibration ; l’oreille,
placée en a, perçoit alors directement les sons produits
par la première membrane M, et ceux de la seconde lui arrivent
par l'intérieur du tube -aimant.
Cette nouvelle disposition est des plus heureuses pour comparer expérimentalement
les résultats fournis par un téléphone à membrane
unique (téléphone Bell ) et ceux fournis par un téléphone
à membranes multiples . En effet, il suffit d'écouter alternativement
aux deux faces de ce téléphone pour s'apercevoir immédiatement
de la différence dans l'intensité des sons percus. Ceux
recueillis en a, du côté de la membrane percée, paraissent
sensiblement doubles en intensité de ceux recueillis en b, côté
de la membrane pleine qui constitue un téléphone ordinaire.
« La différence est encore plus frappante si, en transmettant
ou en recevant un son invariable d'intensité à travers le
téléphone multiple, on empêche à plusieurs
reprises la membrane pleine M ' de vibrer .
« Ceci posé, il est facile de voir qu'on augmentera encore
l'intensité des courants, et, par suite, l'intensité des
sons transmis, en intercalant entre les deux membranes primitives une
série de membranes n, n, n, etc., parallèles et équidistantes,
entourant le solénoïde et l'influencant dans toute sa longueur.
« L'Académie me permettra en même temps de lui exposer
le principe d'un nouvel appareil téléphonique que je viens
d'expérimenter et dont je me réserve d'ailleurs de faire
l'objet d'une note spéciale .
« Voici en quoi elle consiste : Une membrane métallique vibrante
constitue l'un des pôles d'une pile à haute tension ; l'autre
pôle est assujetti devant la plaque par une vis micrométrique
qui permet de faire varier, suivant la tension de la pile, la distance
à la plaque, sans pourtant jamais étre en contact. Cette
distance toutefois ne doit pas dépasser celle que pourrait franchir
la tension de la pile.
« Dans ces conditions, la membrane, vibrant sous l'influence des
ondes sonores, a pour effet de modifier constamment la distance entre
les deux pôles, et de faire ainsi varier sans cesse l'intensité
du courant ; par conséquent, l'appareil récepteur (téléphone
Bell, ou à électro-aimant) subit des variations magnétiques
en rapport avec les variations du courant qui l'influence, ce qui a pour
effet de faire vibrer synchroniquement la membrane réceptrice.
« C'est donc sur la possibilité de faire varier entre des
limites très étendues la résistance du circuit extérieur
d'une pile ( batterie) à haute tension, dont les pôles ne
sont pas en contact, que repose le nouvel appareil téléphonique
.
« On pourra, pour varier les conditions de cette résistance,
faire intervenir une vapeur quelconque, ou bien des milieux différents,
tels que l'air ou les gaz plus ou moins raréfiés.»
| Dans le journal "La République
: journal démocratique du Midi" du 17 décembre
1877, voila comment est annoncé le télphone de M.Trouvé
LE TÉLÉPHOME Ce nouveau télégraphe, sur lequel les journaux ont chaque jour à enregistrer de nouvelles expériences,, a été découvert par M. Grahant Bell. Cette découverte dont on devrait, suivant un journal anglais, faire remonter l'origine en 1837, a été en effet publiée par M. Poja de Salem (Etat des Massachussets) dans une encyclopédie célèbre qu'il fit paraître à cette date. Mais l'application n'en avait pas eneore été faite, et la théorie seule avait été émise. Au reste, cette question soulevée à l'académie des sciences a été résolue, et M. Bell a été reconnu comme l'innovateur du téléphone. Dire quels seront tous les résultats d'une pareille invention, serait trop présumer ; mais on peut déjà affirmer , en présence des nombreuses expériences qui viennent d'être tentées, que "ces. résultats seront immenses. Désormais plus de piles , ces moyens de production de l'électricité, si nuisibles aux manipulateurs par les vapeurs qu'elles émettent. Désormais plus de distances ; les nouvelles et les faits seront connus partout , pendant qu'ils se produiront. Le temps même, n'aura plus de mesure, chacun pouvant recueillir les questions qui lui seront adressées et y répondre spontanément , sans intermédiaires. Cette découverte est donc de la plus haute importance. En voici le principe : Un courant électrique est produit par l'action d'un aimant, sur un fil qui l'envcloppe ; il est transmis par les fils télégraphiques ordinaires, et ce même courant développe,dans un appareil identique, une aimantation qui produit une vibration. Ces deux actions, basées sur les principes de l'induction, sont équivalentes quoique contraires. Les appareils dans lesquels ces deux actions se développent, sont de petit volume et facilement portatifs. De plus, le principe est si-si simple, et demande si peu de matériaux pour sa mise en pratique, que chacun pourra se munir d'un appareil dont le prix ne dépassera guère une vingtaine de francs. C'est un véritable porte-voix en petit. Figurez-vous un étui à aiguilles, allongé et grossi jusqu'à occuper vingt à vingt-cinq centimètres do long, sur six à huit centimètres de largo. Vissez à la place du couvcrcle, un cône de grandeur appropriée et pouvant servir d'embouchoir ou de pavillon, et vous aurez uno idée exacte da la forme de cet instrument. Enfin , qu'il nous suffise d'ajouter que lo fil enroulé autour de l'aimant ne pèse pas plus de 25 grammes. Sur le fond de cet étui de bois, s'appuye un aimant puissant, contre lequel vient s'appliquer en avant un barreau de fer doux, non aimanté, de même diamètre, mais d'une longueur moindre ; le tout remplissant l'étui sans en dépasser l'ouverture. Ce barreau est entouré d'un fil de cuivre, très fin , enroulé suivant une hélice, et constituant un solénoïde. Les extrémités de ce fil sortent par deux trous, percés dans le bois. L'une de ces extrémités sert à relier le téléphone au fil de ligne, tandis que l'autre, comme cela se pratique dans le télégraphe ordinaire, est mise en communication avec le sol. Au devant de l'aimant, et, ne le touchant pas, se trouve un rond de tôle, très mince, dont les bords son fixés par le pavillon vissé au-dessus, et qui enferme lo système dans l'étui. C'est cette plaque de fer, flexible et isolée, qui est impressionnée par les sons. On sait, que lorsqu'on approche un morceau de fer d'un aimant, ce fer s'aimante. Le barreau de fer doux, touchant à l'aimant, est dans ce cas. Mais si un son vient à faire vibrer la membrane de tôle, celle-ci s'approchera du fer aimanté par contact, et diminuera l'intensité du magnétisme. Alors, par ce sêul fait que l'aimantation sera diminuée, par induction, un courant électrique sera produit dans le solénoïde qui, à son tour, transmettra le courant dans celui de l'appareil récepteur. (Ampère avait formé un aimant par la seule intervention de l'électricité, bien avant que Faraday ait obtenu de l'électricité au moyen d'un aimant.) Dès lors, le courant reçu dans le récepteur produira une aimantation plus grande dans le barreau de fer doux qui attirera la membrane, et cela avec d'autant plus d'intensité que le courant envoyé sera plus fort. Elle sera autant de fois attirée que le courant passera , c'est-à-dire que la membrane du manipulateur vibrera. Voici donc le fait : les courants engendrés dans le circuit vont renforcer ou dirninuer l'aimantafion dans le récepteur, qui est on tout semblable au manipulateur, de telle sorte que les membranes vibrent à l'unisson. Il n'y aura donc plus pour parler ou entendre parler, à quelque distance que ce soit, qu'à prendre lo petit instrument, et qu'à parler ou écouter contre la membrane. Les expériences ont démontré qu'à 60 ou 100 kilomètres, tout se passait comme nous venons de le dire, mais qu'à de plus grandes distances, l'intensité du courant devenait si laible, qu'il n'y avait plus moyen de communiquer. En pareille circonstance, que faire ? Fallait-il abandonner un système aussi ingénieux ? Non. Après une telle découverle, venue de l'étranger, la France ne devait pas rester en arrière. C'est à un Français, M. Trouvé, habile constructeur de télégraphes, que l'on devra l'application de cet instrument précieux. M. Trouvé a imaginé de parler oud'écouter , non plus devant une seule membrane, mais bien devant cinq membranes impressionnables formant les surfaces d'un cube dont un côté manquerait. Bien plus, il a remplacé le cube par un polyèdre à nombre indéfini de surfaces, toutes formées d'une membrane vibrante, fournissant ainsi une intensité aussi grande qu'on le désire. Derrière chacune de ces membranes est un téléphone qui envoie un courant électrique à un appareil identique, et un simpie commutateur permet de faire agir la totalité des efforts du manipulateur sur une seule membrane du récepteur, et réciproquement. M. Trouvé a proposé de diviser les membranes en deux séries, dont les efforts seraient totalisés en deux parties différentes; c'est à-dire que les circuits des aimants seraient réunis par moitié. On pourrait ainsi établir des postes de renfort, dans lesquels l'employé transmettrait la même note reçue qui serait envoyée au poste suivant en même temps qu'elle retournerait, comme contrôle, au point de départ. Le moyen trouvé, il n'a plus qu'à l'appliquer. On se rappelle que l'électricité est transmise par les fils télégraphiques ordinaires ; or, il arrive très souvent que ces fils sont superposés en assez grand nombre. Chacun da ces fils transmet son courant. Il pourra arriver qu'en même temps qu'un télégraphe Morse enverra une dépêche par un fil, un téléphone en enverra une autre par un autre fil placé à côté. De ces deux courants d'intensité différentes, naîtra dans le téléphone un courant induit qui impressionnera la membrane. Le téléphone commettra donc l'indiscrétion de reproduire la dépêche passant au-dessus ou au-dessous de son fil de ligne. Mais comme il n'y a, dans l'appareil de Morse, que des courants successivement interrompus, on n'entendra qu'une suite de chocs qui couvriront la voix du téléphone, et produiront, sur l'oreille de l'auditeur, comme un bruit do grêlons tombant sur une vitre. Tant que les deux points à relier par le téléphone seront réunis par un seul fil, l'appareil fonctionnera très-bien ; mais dès que plusieurs fils télégraphiques seront établis simultanément, il faudra, ou cesser toute autre communication, ou ne point employer le téléphone. En attendant que cette difficulté soit résolue, nous demandons instamment que des téléphones soient établis en France partout où il sera possible de le faire, et que notre armée ne soit pas la dernière à se servir d'un instrument dont les Prussiens font déjà eux-mêmes un si grand usage. V. T. |
Peu de temps après, M. Gustave Trouvé, toujours
tourmenté par l'idée de mieux faire, trouva le moyen de
perfectionner un nouveau système de téléphone avertisseur
dû au capitaine Perrodon (1878), en se consacrant à
sa construction .
M.Cornu, membre de l'Académie des sciences, se chargea de présenter
à ses confrères, en juillet 1879, ce nouvel appareil basé
sur le principe suivant : Un téléphone quelconque rend un
son continu, élevé et intense quand le courant d'une pile
traverse sa bobine et passe entre l'armature et un contact fixe. Si d'autres
téléphones sont interposés dans le même courant,
ces instruments vibrent tous à l'unisson du premier avec la même
intensité .Quelques jours après, M.le capitaine Perrodon
écrivit dans la Revue d'artillerie : « Si le principe de
mon appareil est simple, l'application était très délicate
et la réussite eût été douteuse sans l'habileté
du constructeur.»

La figure 229 représente ce téléphone avertisseur
auquel M.Gustave Trouvé a donné la griffe d'originalité
de son temperament créateur.
Ce système d'appel est extrêmement pratique, puisqu'il laisse
au téléphone ces deux propriétés précieuses
: son transport si facile, son emploi à la portée de tout
le monde . Cependant, quelques auteurs rejettent
a priori tout système d'appel nécessitant l'emploi d'une
pile . En fait, au point de vue domestique, les avertisseurs sans piles
seraient à préférer, tandis que, au point de vue
militaire, ils seraient un défaut.
En effet, on sait que les avertisseurs sans piles ont le grave inconvénient
de ne transmettre qu'environ le 2/100 du son produit au départ
et à de faibles distances . Dans l'armée, le poste ne pourrait
fournir l'appel sans trahir sa présence, et se ferait entendre,
par une nuit calme, de 1 à 2 kilomètres de distance . Ce
bruit serait en outre très gênant, comme les sonneries, dans
un établissement industriel . Un inconvénient encore aussi
grave, c'est qu'il ne contrôle pas la ligne et qu'on est obligé
quand même d'avoir une pile et un galvanomètre pour ce contrôle
qui est tout à fait indispensable à la guerre . Si la pile
a des inconvénients, ils ne doivent pas être exagérés
. Si elle est embarrassante dans les transports, que dire des bobines
de câble qu'il faudra emporter ? D'ailleurs la pile compense ces
inconvénients par le contrôle de la ligne qu'elle fournit,
le téléphone servant lui même de galvanomètre
pour cette vérification . Au surplus, une pile peut deservir eux
ou plusieurs postes,comme cela pourrait se faire, par exemple, sur les
chemins de fer à une voie où les gardes barrières
seraient munis de téléphones avertisseurs remplaçant
avantageusement les cloches ordinaires et fonctionnant tous par le courant
d'une pile unique et fixe installée à la station voisine.
Cette condition est réalisée par le téléphone
avertisseur représenté par la figure 229. Il ne diffère
des autres que par l'adjonction d'une aiguille A montée sur un
axe E muni de deux cames F, G fixées à angle droit .
Ce système de commutateur a pour fonction d'intercaler l'interrupteur
dans le circuit téléphonique par les ressorts G, H, lorsqu'on
veut produire un appel, et l'interrupteur s'approche du centre de la membrane
pour la mettre en vibration, suivant les positions de l'aiguille . L'aiguille
placée sur la lettre T (téléphone ), le courant ne
met pas la plaque en vibration, tandis que placée en A (avertisseur)
le courant passe par le trembleur, dont la plaque téléphonique
constitue l'armature . Le réglage, à la fois mobile et stable,
était très difficile à obtenir . Dans les dispositifs
combinés, la production de l'appel exigeait toujours de l'adresse
et un certain apprentissage . Cela se conçoit, du reste, si nous
disons que l'amplitude des vibrations de la plaque n'atteint guère
que de 1/200 millimètre . Cette difficulté a été
complètement surmontée par M. Gustave Trouvé, qui
a réalisé le téléphone avertisseur en lui
adaptant son interrupteur, bien connu, de ses explorateurs .
Emploi de l'appareil.
Les téléphones (supposons en deux), étant placés
avec la pile dans le même circuit, le poste qui veut avertir tourne
lentement son aiguille de T vers A, en arrêtant immédiatement
la rotation dès que l'appareil chante. Le poste appelé,
averti par le bruit de son appareil, qui chante à l'unisson du
premier, fait osciller de droite à gauche son aiguille, ce qui
a pour effet d'établir des intermittences dans le chant des téléphones
qui était tout à l'heure régulier et monotone . A
ce nouveau signal, les deux postes remettent, chacun de leur côté,
l'aiguille sur la lettre T ( correspondance téléphonique
), et la conversation est échangée à la manière
ordinaire . En résumé, voici les principaux avantages de
ce système :
1 ° Extrême simplicité, dépense insignifiante
et conservation complète de toutes les qualités du téléphone.
Cet avertisseur qui peut leur être appliqué à tous,
permet de les placer immédiate ment dans les meilleures conditions
de réglage.
2° Avertissement très bruyant, avec deux éléments
pour des résistances de 100 à 110 kilomètres, les
bobines de deux téléphones entrant déjà pour
90 à 95 kilomètres dans cette résistance. La portée
et le bruit croissent jusqu'à une certaine limite avec le nombre
des éléments employés, ce dernier au point de devenir
insupportable .
3º Contrairement aux autres systèmes d'avertisseurs, le bruit
à l'arrivée est de même intensité qu'au départ.
Il sert encore de moyen de contrôle, puisque le système ne
peut fonctionner que si la ligne est intacte .
4° On peut placer un certain nombre d'instruments sur la même
ligne, qui rendront tous simultanément, avec la plus grande fidélité,
la note de celui qui commandera l'appel, malgré le plus grand désaccord
possible dans la tension des membranes; mais ces tensions différentes
suffiront, au besoin, pour distinguer les postes entre eux, ainsi que
cela se produit, par la hauteur du son ou par la différence des
timbres, avec les sonnettes d'appel .
Ces avantages le recommandaient tout particulièrement à
l'armée, à laquelle il rend des services signalés
.Il prend alors la place des montres télégraphiques du système
de télégraphie de M.G. Trouvé, dont nous avons donné
la description au chapitre télégraphe.
Il pourrait également remplacer, sur les lignes ferrées
simples, les signaux à cloches qui, avec une installation plus
coû touse, ne peuvent pas rendre des services aussi complets.
Lorsqu'il s'agit d'utiliser des téléphones existant déjà,
dont la construction tout à fait exceptionnelle ne permet pas,
ainsi que leur mauvais état de conservation, de leur appliquer
avantageusement l'avertisseur du capitaine Perrodon, M. Gustave Trouvé
emploie un avertisseur indépendant que nous allons décrire
. Le petit trembleur libre qu'il a appliqué comme avertisseur téléphonique
en l'intercalant dans le circuit de la pile et des téléphones,
n'est autre que le trembleur spécial de son appareil explorateur
destiné à la recherche des projectiles enfermés dans
les plaies par armes à feu, appareil bien connu par les nombreux
services qu'il a rendus et qu'il rend constamment à la chirurgie.
Ce petit trembleur, de grandeur naturelle dans notre figure 230, est renfermé
dans une boite à doubles glaces transparentes, ressemblant à
une toute petile montre et sert aussi de commutateur, car l'axe entrainé
par l'aiguille est muni de cames à cet effet. La position perpendiculaire
de l'aiguille, par rapport à l'armature de l'électro-aimant,
représentée dans le dessin, correspond à l'avertissement,
c'est- à -dire que la pile, le trembleur et les téléphones
se trouvent dans le même circuit. La position oblique de l'aiguille,
soit à droite, soit à gauche, établit seulement la
correspondance téléphonique en supprimant la pile du circuit
.
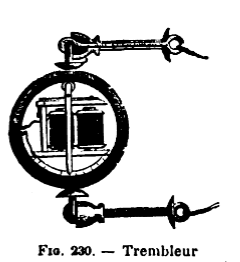
La disposition élégante de ce trembleur avertisseur ne conviendrait
pas aux usages domestiques et à l'armée ; aussi M. Gustave
Trouvé n'a-t- il pas hésité un instant à sacrifier
la grâce à la solidité et à la sûreté
des effets. Il a donc renfermé son petit électro-trembleur,
non plus dans une boîte de montre à doubles glaces transparentes,
mais bien dans une minuscule auge rectangulaire en caoutchouc durci ou
ébonite, de 3 à 4 centimètres de longueur sur 1 centimètre
et demi de largeur et d'épaisseur (fig .231 ) .
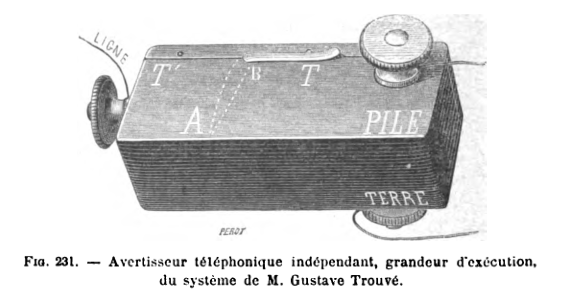
Cette auge étant complètement étanche,
l'électro-trembleur, en dehors des chocs violents qu'il peut supporter
sans avaries, vu son faible poids, se trouve aussi préservé
des autres causes per turbatrices qui pourraient l'influencer, comme,
par exemple, les intempéries de l'atmosphère, la chaleur,
l'humidité, la pous siere, etc. Il pourrait même être
exposé à l'eau sans avoir à subir de détérioration
.
L'avertissement est aussi bruyant au téléphone de départ
qu'à celui de l'arrivée ou de réception, comme dans
celui du capitaine Perrodon, réalisé par M.Gustave Trouvé,
malgré de grandes difficultés d'exécution . Cet avertisseur
indépendant a, suivant nous, une supériorité sur
l'autre en ce qu'il met la pile au repos pendant la correspondance, qu'il
ne nécessite absolument aucun changement aux téléphones
que l'on possède déjà, et, qu'en outre, il ne demande
ni le réglage de ces téléphones, ni le passage du
courant dans un sens déterminé et qu'il s'adapte immédiatement
à n'importe quel système de téléphone connu
.
Les trois boutons (fig .231 ), ou serre- fils, sont destinés à
le placer dans le circuit téléphonique, la ligne et la terre
. L'aiguille B, dans la position T qu'elle occupe, se trouve sur la correspondance
téléphonique, sans la pile dans le circuit; il en serait
de même dans la position T ; tandis que, l'aiguille ramenée
en A qui signifie avertisseur, le trembleur serait mis en action par le
courant de la pile qui franchirait alors la ligne, les téléphones
et ferait son retour par la terre . Tous les téléphones
mis en ligne rendraient, dans ces conditions, un son rauque, plus ou moins
élevé, mais correspondant exactement au nombre des vibrations
de l'électro-trembleur. Le son croît aussi en intensité
avec le nombre des éléments employés.
Dans la question des téléphones, M. Gustave Trouvé
ne devait pas s'en tenir à ces applications élevées,
mais d'un caractère spécial ; et peu de temps après
nous le voyons se consacrer à la téléphonie domestique,
si nous pouvons employer cette expression .
C'est donc dans cette sphère d'action que nous nous proposons maintenant
d'étudier ces appareils, en les considérant comme des auxiliaires
utiles et précieux des autres instruments d'électricité
destinés aux usages journaliers. Nous empruntons l'explication
qu'en a donnée M.Hospitalier, dans un numéro de la Nature,
journal si attrayant et si répandu et toujours le premier à
porter à la connaissance du public les plus récentes découvertes
: Nous irons, comme toujours, du simple au composé, et nous supposerons
tout d'abord que les communications se font dans l'intérieur des
habitations mèmes, entre les différentes pièces d'un
bureau, d'un atelier, d'une usine, ou les différents étages
d'une maison .
La première question qui se pose est le choix d'un système.
Auquel donner la préférence ? A notre avis, lorsque les
distances ne sont pas très grandes, au dessous de 100 mètres,
par exemple, pour fixer les idées, il est préférable
d'employer les téléphones magnétiques, dont l'appareil
Graham Bell est le type .
On y trouve à la fois simplicité, économie de prix
d'achat et d'ins tallation .
Plus loin nous étudierons les téléphones à
pile, qui produisent certainement des effets plus intenses, mais coûtent
plus cher et demandent plus de soin et de surveillance . Nous supposerons
donc que nous ayons fixé notre choix sur un système magnétique.
On sait que la puissance des sons transmis par ce système est très
faible ; il importe donc, pour établir une communication entre
deux postes, d'avertir préalablement le poste récepteur
; ce qu'on fait ordinairement à l'aide d'une sonnerie d'appel .
Son installation la plus simple est celle que nous connaissons pour relier
une maison de campagne à la loge du gardien placée à
l'entrée de la propriété . Elle est constituée
par une sonnelte à tirante ordinaire, dans laquelle les équerres
de renvoi sont isolées . Le fil de fer qui agit sur la sonnette
sert de conducteur aux téléphones magnétiques, le
retour s'effectuant par la terre . L'installation représente ainsi
le maximum de simplicité et d'économie .
En général, il faut que chaque poste
puisse appeler l'autre .
Une communication téléphonique complète comprendra
donc finalement à chaque poste : un téléphone transmetteur
pouvant servir de récepteur, ou mieux une paire de téléphones,
un bouton d'appel, une sonnerie d'appel et une pile .
Tous ces appareils peuvent être groupes de différentes façons
présentant chacune des avantages et des inconvénients .
Le choix à faire entre ces divers groupements ou montages dépend
des exigences spéciales à l'installation projetée
.
Si la communication téléphonique doit être mise entre
les mains de beucoup le monde c'est le cas par exemple d'une communication
entre un locataire à un étage élevé et le
concierge dont la loge est souvent occupée par des voisins, des
parents, des amis peu expérimentés on doit rechercher avant
tout la simplicité d'installation. Dans ce cas, il faut absolument
supprimer tout commutateur qu'on oublie trop souvent de manoeuvrer, en
mettant un nombre de fils suffisant quatre au maximum, ou trois en prenant
les conduites d'eau ou de gaz comme fils de retour, ainsi que nous allons
l'indiquer. Dans l'espèce, il suffit du bouton d'appel et du téléphone
pour établir la communication complète sans erreur possible.
L'emploi du triple fil, avec retour par les tuyaux d'eau ou de gaz, présente
même un autre avantage, celui de n'exiger qu'une seule pile pour
suffire aux deux postes. Il est alors commode de prendre, soit la pile
établie chez le concierge pour desservir les sonneries de la maison,
soit la pile établie chez le particulier pour son usage personnel
. C'est le second cas que représente la figure 232.
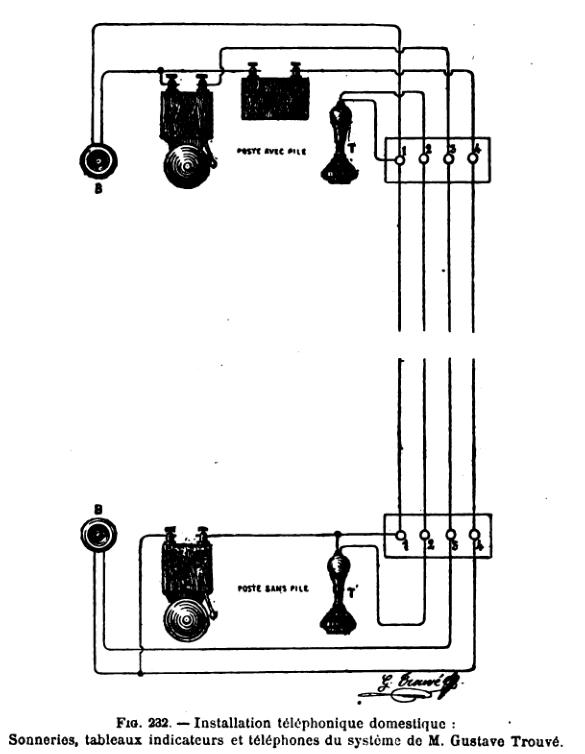
La pile établie chez le concierge peut avoir d'ailleurs beaucoup
d'autres emplois, car elle sert, au premier à actionner les sonneries
et un tableau indicateur, et les sonneries ordinaires du locataire du
second, qui, abonné au système téléphonique
de la ville, a son téléphone installé dans l'antichainbre
. Le locataire du troisième, en correspondance permanente avec
le concierge, épargne bien des étages à ses visiteurs
en cas d'absence, et congédie facilement les importuns, avantages
qui méritent d'être pris en sérieuse considération
.
En jetant un coup d'æil sur le diagramme ( fig 232 ), il est facile
de suivre les communications des différents appareils entre eux
: boutons, sonneries, télé phones, piles et fils de ligne
. Pour éviter toute erreur, il est commode d'attacher d'abord les
quatre fils à quatre bornes numérotées sur une planchette,
à chaque étage, et d'établir ensuite les liaisons
en partant de ces quatre bornes . La borne et le fil numéro 4 peuvent
être remplacés par les conduites d'eau ou de gaz . Dans le
diagramme de la figure 232 nous avons supposé les appareils disposés
à la suite les uns des autres pour bien montrer les communications
qu'on peut suivre facilement. En pratique, on les place où on peut,
en utilisant les boutons, sonneries, téléphones dont on
dispose . Lorsqu'on veut faire quelques concessions à l'élégance,
il est commode de disposer tous les appareils sur une planchette, et il
existe un certain nombre de postes téléphoniques dans lesquels
toutes les combinaisons sont réalisées à l'avance
; il suffit d'attacher les fils de ligne de pile et des téléphones
aux bornes marquées sur la planchette pour que l'installation soit
terminée.
L'un des plus simples est le poste du modèle de M.Gustave Trouvé
(fig.233 ) .
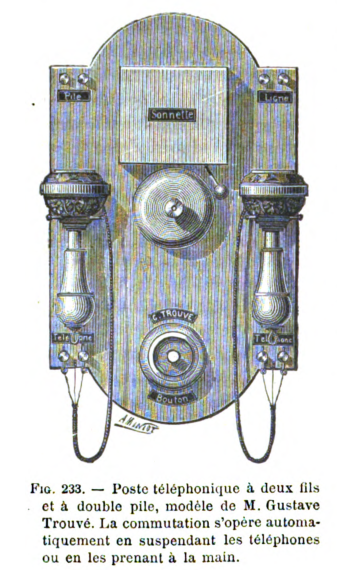
La planchette porte le bouton d'appel, la sonnerie et une paire de téléphones
Trouvé, genre Bell, avec vis de réglage se mouvant sur un
cadran gradué pour bien fixer la distance de l'aimant à
la plaque.
Le système ne comporte que deux fils de ligne ; mais il demande
une pile à chaque poste pour actionner les sonneries .
La commutation se fait automatiquement en décrochant les téléphones,
lorsque le poste appelant entend la réponse du poste appelé
.
Cette disposition est simple . Toutefois elle exige que les téléphones
soient remis avec soin dans les lyres de suspension, une fois la conversation
terminée, ce que les personnes négligentes, avec lesquelles
mal heureusement il faut compter, ne font pas toujours. Chaque fois que
la ligne n'est pas trop longue, il faut préférer le triple
fil qui dispense de l'emploi de tout commutateur automatique ou non .
Lorsque les distances deviennent un peu grandes, le prix d'un fil supplé
mentaire joue un rôle de plus en plus important. Il y a alors lieu
de se demander véritablement s'il vaut mieux satisfaire aux exigences
de l'économie ou à celles de la simplicité. C'est
là une question de pure appréciation.
Les conducteurs téléphoniques placés à l'intérieur
des maisons peuvent être de même nature et de même gros
seur que les fils des sonneries ordi naires . Il convient de les distinguer
pendant la pose en les choisissant de Sonnette couleurs différentes
. Lorsque les fils sont extérieurs on les prend recouverts d'une
double couche de gutta - percha . Le diamètre du fil de cuivre
nu est de 1 millimètre et de 3 millimètres envi ron lorsqu'il
est recouvert .
La nature des téléphones joue peu de rôle lorsque
les distances sont petites .
Les téléphones de Bell, à main, modèle ordinaire,
conviennent parfaitement leur prix varie de 8 francs à 50 francs
la paire, suivant le fini du travail et les soins apportés aux
détails de la construction, Dans notre installation ( fig.232),
nous employons comme transmetteur un appareil Gower,
et un téléphone modèle Trouvé, comme récepeur
. Le système est à trois fils, avec retour par les conduites
de gaz. Les quatre téléphones - un récepteur Bell
et un transmetteur Gower à chaque poste sont disposés en
tension sur le circuit fermé formé par les fils 1 et 2 .
On conçoit que les montages de postes téléphoniques
simples puissent varier beaucoup suivant le nombre de tils qu'on désire
placer et les combinai sons à réaliser . On demande quelquefois
que les deux sonneries fonctionnent ensemble pour établir un contrôle,
d'autres fois un des postes ne doit jamais appeler, pour un domestique,
par exemple, etc. ce sont là des modifications de montage ou des
simplifications qu'on trouve aisément avec un peu de réflexion
.Mais M.Gustave Trouvé a encore voulu éviter ce petit inconvénient
aux personnes qui posent elles-mêmes leur téléphone.
C'est ainsi qu'il a réuni tous les organes sur une planchette (fig
233), en établissant à l'avance les connexions électriques
. On n'a plus qu'à réunir les fils de la pile et de la ligne
aux endroits indiqués.


 Téléphones G. Trouvé
Téléphones G. Trouvé
Très prisé par les collectionneurs de téléphones
lorsque l'on y trouve la marque Eurêka.
LES MICROPHONES.
Nous abordons maintenant la microphonie. Par l'intercalation d'un contact
libre, particulièrement d'un contact de charbon, dans le circuit
d'un système téléphonique, on obtient une transformation
parfaite des ondes sonores en courants électriques, et, par suite,
une transmission téléphonique d'un genre tout particulier.
Depuis l'année 1876, la révélation de ce fait tout
spécial et inobservé jusqu'alors, fut employé avec
avantage par plusieurs inventeurs pour les usages de la téléphonie.
Mais, ce n'est qu'en 1878 que le professeur D.E. Hughes,
savant américain vivant à Londres, inventeur du télégraphe
imprimeur, rassembla divers phénomènes déjà
connus, mais épars et stériles, et découvrit que
certaines matières dissemblables, c'est - à - dire non homogènes,
pouvaient, par leur intercalation dans le circuit d'une batterie, produire,
à l'aide des vibrations sonores, des courants ondulatoires électriques.
Il démontra que l'on pouvait ainsi augmenter non seulement la force
des sons et des paroles, mais surtout celle de bruits presque entièrement
imperceptibles par eux-mêmes, de façon à les entendre
à une grande distance, en se servant d'un téléphone
Bell introduit dans le circuit.
Hughes pensa avec raison qu'un appareil combiné d'après
ce système était appelé à jouer, par rapport
à l'ouïe, un rôle analogue à celui du microscope
par rapport à la vue. Il lui donna en conséquence le nom
de microphone, dont l'étymologie est grecque et veut dire petit
son.
On peut donner à cet instrument des formes innombrables, des constructions
variées et des combinaisons multiples.
C'est le 9 mai 1878 que Hughes fit présenter sa découverte
à la Société Royale de Londres par le professeur
Huxley. Un mois après, le 8 juin, il remit à la Société
de physique un rapport dans lequel il exposa le principe essentiel du
microphone, qu'il faisait reposer sur la présence, dans un circuit,
d'un conducteur dont la résistance subit des variations exactement
conformes à celles des vibrations sonores. Il indiqua, comme conducteurs
propres à cet usage, de la poudre, de la limaille, enfin des conducteurs
à forme plate et soumis à une pression de contact excessivement
faible qui, si l'on veut obtenir l'effet maximum, doit elle-même
être réglée d'après l'intensité du son
à reproduire. Sous cette faible pression, les sons deviennent hauts
et clairs, et, si celle - ci augmente, ils s'affaiblissent et cessent
peu à peu. C'est pour cette raison que le microphone est plus applicable
à la transmission des secousses mécaniques qui lui parviennent
distinctement qu'à une simple excitation des ondes de l'air qui
transmettent les sons à l'ouïe. Aussi entend-on beaucoup plus
distinctement une tabatière à musique ou le tic-tac d'une
montre placée directement sur une partie de l'appareil, que si
l'on approche l'un de ces objets de l'instrument sans établir de
contact avec lui. C'est pour cela, chose curieuse mais tout à fait
normale, qu'une mouche courant sur l'appareil, produit un bruit qui peut
être entendu dans un téléphone.
M. G. Trouvé a créé, sur le principe de Hughes, plusieurs
variétés de microphones dont les formes changent suivant
les usages auxquels ils sont destinés. La forme la plus simple,
à laquelle M. Gustave Trouvé s'est attaché, est la
forme cylindrique.
Son appareil ressemble à une petite lanterne sourde, dont la bougie
est remplacée par un crayon de charbon. Cette disposition rend
le système d'une extrême sen sibilité et en fait un
appareil de poche qui n'a rien à craindre sous le rapport de la
solidité ; le charbon étant entièrement préservé
lorsque la porte se trouve fermée. Outre qu'on peut, sans danger
aucun, le transporter partout, il se prête à merveille à
toutes les expériences. La montre peut se placer sous ou sur le
microphone, à volonté. Les insectes s'y trouvent emprisonnés
directement ; aussi entend- on tous leurs ébats.
Ce microphone, placé au milieu d'un appartement, en révèle
tous les secrets. La voix est admirablement transmise à un appa
reil récepteur (téléphone), même lorsque l'on
parle à 25 mètres et plus du microphone. Une mouche placée
dans l'intérieur semble, dans le téléphone, faire
des efforts inouïs pour en sortir. C'est maintenant qu'on peut entendre,
de Marseille, une mouche voler sur les Tours de Notre -Dame!
Comme le microphone de Hughes, il agit par les variations de courants
qui résultent des modifications dans les points de contacts du
charbon faisant partie du circuit électrique.
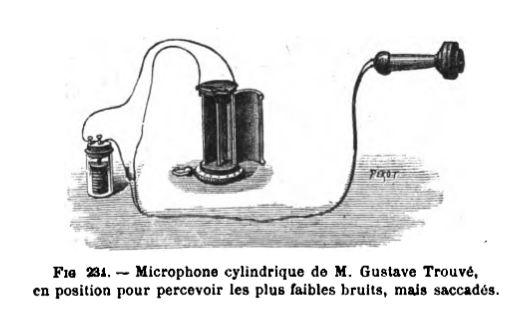
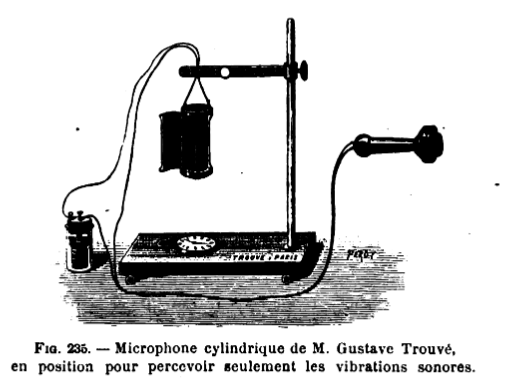
Dans le microphone de M. Trouvé, le cylindre sert de caisse de
résonnance qui concentre toutes les vibrations sur le cylindre
de charbon artificiel placé au centre ; de là, son extrême
sensibilité. Disposé comme l'indique la figure 234, il transmettrait
non seulement le tic-tac de la montre, mais encore, simultanément,
tous les bruits produits aux alentours ; la voix, le bruit des pas, en
position pour percevoir seulement les vibrations sonores. un frôlement
quelconque, qui ne seraient pas entendus directement par l'oreille.
Il en est autrement si on le suspend par ses cordons à une potence
( fig.235).
Dans ces conditions l'on entend à peine le bruit de la montre,
ainsi que les bruits de frottement légers ; mais, par contre, les
vibrations sonores sont seules transmises et acquièrent une netteté
vraiment admirable. Le timbre de la voix est aussi parfait qu'avec deux
téléphones ordinaires. La sensibilité de cet appareil
est maximum lorsqu'il occupe la position verticale comme dans la figure
234. Au contraire, il devient de moins en moins sensible jusqu'à
la position horizontale. Ces différents degrés de sensibilité
s'obtiennent (fig.235) avec la plus grande facilité en faisant
varier la longueur d'un des fils de suspension, sans toucher à
l'autre, de façon à lui faire prendre toutes les positions.
Placé sur une sorte de petite planchette en équerre, main
tenue appliquée par une ceinture élastique dans le voisinage
du ceur et des poumons, il révèle les bruits normaux ou
morbides, dont ces organes sont le siège.
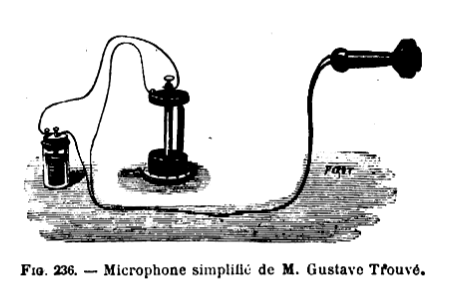
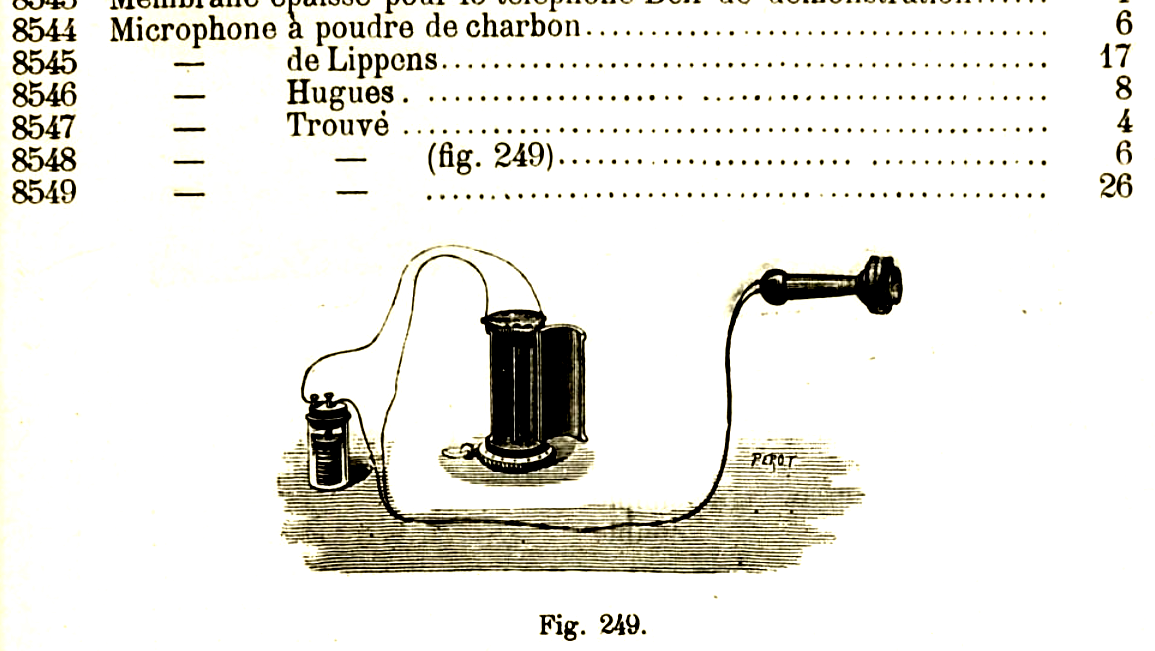
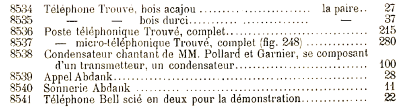 Les prix.
Les prix.
La figure 236 représente un autre modèle du microphone de
M.Gustave Trouvé.
L'auteur est arrivé là à une grande simplicité
et à un extrême bon marché. Ce microphone atteint
la plus simple expression d'un appareil de ce genre.
Il est composé d'un pied à tige supportant un disque qui,
avec le pied, maintient verticalement un crayon de charbon artificiel.
Le disque peut tourner autour de la tige pour permettre le réglage,
en donnant toutes les obliquités au crayon de charbon. Désirant
soustraire le microphone aux causes d'erreurs extrinsèques auxquelles
cet appare il est trop fréquemment soumis, M.Gustave Trouvé
s'est spécialement appliqué un peu plus tard à ces
recherches avec la collaboration de M. H.de Boyer. L'appareil qu'ils ont
construit et employé et dont nous donnons le dessin (fig.237),
constitue une véritable chambre.
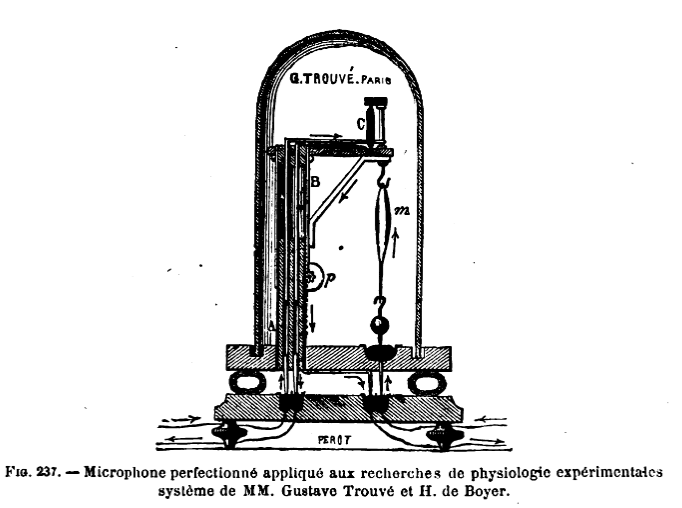
A, Tube fixé au socle supérieur.
B, Tube portant la potence et le microphone C.
Ce tube est monté à frot tement dur sur le tube A, et s'abaisse
ou s'élève à volonté au moyen d'une crémaillère
et d'un pignon p.
C, Microphone très sensible.
m, Muscle en expérience ; il porte suspendu à son extrémité
une petite boule munie d'un crochet et d'une pointe en platine qui plonge
dans un godet de mercure.
Les flèches situées à gauche du dessin indiquent
le sens du courant microphonique ; celles de droite, le sens du courant
excitateur microphonique dans laquelle des expériences, physiologiques
ou autres, pourront être effectuées dans des conditions déterminées
et capables d'être modifiées au gré des expérimentateurs.
On voit qu'il consiste essentiellement en deux circuits électriques
isolés l'un de l'autre ; dans le cas des expériences de
physiologie musculaire que MM. Trouvé et de Boyer ont communiquées
à la - Société de biologie, le 17 janvier 1880, l'un
de ces circuits était excitateur du muscle, l'autre communiquait
nécessairement avec le téléphone.
Les contacts de ces circuits se font tous au mercure, et le modèle
de microphone employé dans ces derniers essais était vertical
; il suffira, du reste, d'un coup d'ail sur la figure et la légende
explicative pour nous dispenser d'entrer dans le détail de cet
appareil. Ayant complètement soustrait le microphone à l'influence
des causes autres que les chocs mécaniques, MM. Trouvé et
de Boyer ont constaté que le travail du muscle ne donne pas lieu
à un choc mécanique, qu'il agit par ondulations lorsque
le muscle est libre de se contracter sans effort et sans résistance.
Des dispositions nouvelles permettront d'expérimenter sur les vibrations
moléculaires qui peuvent se produire dans le muscle.
L'instrument de MM. Trouvé et de Boyer se distingue surtout par
les conditions expérimentales toutes particulières dans
les quelles ces observateurs placent le muscle au cours de leurs recherches
: il nous semble du reste que la disposition de l'appareil permettra de
l'appliquer à d'autres déterminations physiologiques ; c'est,
croyons -nous, le but du travail entrepris et pour suivi par ces deux
chercheurs, qui ont voulu doter la physiologie expérimentale d'un
appareil parfait. M.Gustave Trouvé avait d'ailleurs présenté
le 15 juillet 1877, à la Société de Biologie de Paris,
un appareil destiné à donner aux élèves une
idée du mode de contraction musculaire, et dont nous empruntons
la description à la Gazette des Hôpitaux du 17 juillet 1877.
---- DU MODE DE CONTRACTION MUSCULAIRE ----
M. Oaimus présente, à la Société de biologie
(séance du 6 juillet 1877), au nom de M.Trouvé, un appareil
électrique destiné à mettre en évidence le
mode de contraction musculaire.
M.Trouvé, frappé des effets considérables que produisait
sur ses muscles un faible courant électrique, a pensé que
là devait résider un des principaux récepteurs de
la force électro -motrice. Ce fut dans ce sens qu'il dirigca ses
expériences dont le résultat fut la construction d'un instrument
répondant à toutes les fonctions du muscle.
M. Trouvé a assimilé les molécules actives du muscle
à de petits électro aimants s'attirant par leurs pôles
contraires. Il est facile de comprendre de suite le travail produit par
un pareil mécanisme.
L'effort exercé par deus électro-aimants, multiplié
par la surface de section, donne bien l'idée du travail - produit
par le système, et l'amplitude du mouvement, mais ne peut rendre
compte des effets considérables observés sur le muscle.
Aussi M. Trouvé, continuant son étude, acquit la preuve
qu'il fallait nécessairement totaliser chaque effort individuel
des électro-aimants, car ce total devait donner mathématique
ment la résultante de la puissance totale du système, et
par cela niême, une plus haute idée de l'énergie du
muscle.
Quel pouvait être maintenant le mécanisme pouvant totaliser
les efforts ? M.Trouvé, se rappelant ce jeu des enfants, appelé
grenouillette, qui consiste dans des parallelogrammes articulés
faisant mouvoir des soldats, construisit un appareil qui se composé
d'une série d'électro-aimants s'attirant entre eux par leurs
pôles contraires, et réunis par des paraliélogrammes
articulés qui en totalisent les efforts.
Sans oser préjuger, en aucune façon, de la forme du muscle
et sans prétendre en rappeler tous les effets, ce petit appareil
en explique cependant presque toutes les propriétés, et
permet, dès maintenant, de formuler la théorie suivante
: La puissance d'un muscle est la résultante de toutes les attractions
molé culaires partielles.

Ce petit appareil explique, d'une façon très satisfaisante,
la contraction totale d'un muscle, par l'électrisation localisée
(méthode de Duehenne, de Boulogne) sans avoir recours à
des actions reflexes ou à la propagation de l'ébranlement
moléculaire. Il permet encore d'expliquer la persistance de la
contraction musculaire dans ses effets par la persistance du magnétisme.
Transmetteur microphonique Trouvé - Dunand.
- Le transmetteur Trouvé - Dunand présente des avantages
importants dans la téléphonie domestique.
Il se compose de deux plaques métalliques A, A', réunies
par un cadre en bois formant avec elles une boite hermétiquement
382 fermée, dans laquelle le système microphonique est à
l'abri de la poussière et de l'air.
Aux centres internes des plaques métalliques vibrantes étaient
collées primitivement deux petites pastilles de charbon soutenant
par pression un charbon B en forme d'olive, un peu plus long que la distance
qui les sépare. M. G. Trouvé a remplacé les plaques
métalliques par deux plaques A, A'de charbon ( fig 239 ), ce qui
évite l'adjonction des pas tilles. L'olive centrale est prise en
son milieu par un collier de fil de laiton tendu diametralement et dont
l'une des extrémités est reliée à un bouton
C, l'autre étant fixée au cadre.
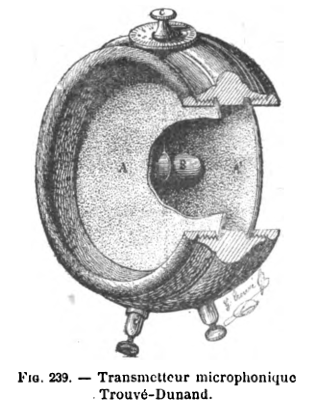
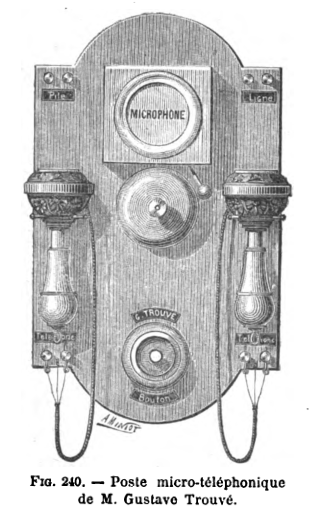
Selon que l'on tourne plus ou moins le bouton, le fil est plus ou moins
tordu et appuie le crayon B plus ou moins fortement contre les faces internes
des plaques. La communication électro-microphonique entre les deux
plaques A, A ' se trouve donc établie par l'intermédiaire
du charbon olivaire B. L'index du bouton C se meut sur un cercle gradué,
permettant de régler l'appareil avec précision en tenant
compte de l'intensité des sons transmis. Une personne peut chanter
sur chacune des plaques A, A' et l'appareil rendra le duo avec fidélité
et netteté, sans pitié pour l'insuffisance musicale si fréquente
des expérimentateurs. Le fonctionnement de ce microphone rentre
dans le cas général.
Il peut actionner un récepteur téléphonique, soit
directement, sans l'intermédiaire d'une bobine d'induction, soit
indirecte ment, à l'aide de cette bobine.
Quant au poste micro-téléphonique, représenté
figure 240, il réunit sur une seule planchette tous les organes
de transmission et de réception de la parole ; c'est un avantage
très grand pour les amateurs qui n'ont nullement à se préoccuper
des communications électriques pour établir les relations
entre tous les organes constituant le poste.
Deux paires de serre-fils, dont les rôles sont inscrits sur la planchette,
reçoivent d'un côté les fils de ligne, de l'autre
les fils de la pile.
Le microphone du système Trouvé -Dunand est fixé
sur la boite même de la sonnerie d'avertissement.
Le bouton d'appel occupe la partie inférieure de la planchette
tandis que les deux téléphones en bois durci et à
réglage de précision, du modèle de M. Trouvé,
occupent les côtés du poste.
La commutation se fait au tomatiquement en décrochant ou en suspendant
les téléphones.
Le poste est très condensé, et le genre du microphone adopté
donne une grande amplitude à la voix, sans jamais produire de crachements
ni le bruit de friture Poste micro -téléphonique assez familier
aux postes téléphoniques munis d'un micro phone trop sensible.
Ici la sensibilité du microphone Trouvé Dunand est ce que
l'on veut ; il suffit de donner plus au moins de torsion au fil métallique
qui supporte le petit crayon de charbon établissant la communication
électro -microphonique entre les deux membranes.
Brevet
Trouvé 123108. B. de 15 ans, 9 mars ; Système de téléphone
transmetteur.
Brevet
Trouvé 123277. B. de 15 ans, 18 mars ; Perfectionnements
dans les téléphones.
Brevet Trouvé138903. B. de 15 ans, 2 octobre; Système
d’appareil avertisseur pour téléphones.
Le 24 avril 1888, lors d’une séance de la Société d’Odontologie de Paris consacrée aux applications de l’électricité à l’Art Dentaire, Gustave Trouvé occupe une place centrale. Il présente tout d’abord une nouvelle pile au bichromate de potassium avec six éléments dans un coffret de transport en ébonite de 3 kg : pile remarquablement fiable, simple et économique.
LES PILES DE M. GUSTAVE TROUVÉ.
Le père de la pile électrique, le lecteur s'en souvient,
c'est l'illustre physicien italien Volta (1745-1827),
qui a donné la théorie du contact.
Mais, depuis ce temps, les piles ont bien changé ! Elles sont devenues
presque innombrables et, chose à noter, la théorie primitive
a été abandonnée, après des luttes mémorables,
pour une nouvelle théorie.
C'est qu'en effet, tout en reposant sur des faits irrefutables, elle n'était
pas complète parce qu'elle ne tenait pas compte, comme le dit très
bien le docteur Bardet, dans son excellent Traité d'électricité
médicale, de tous les faits qui donnent naissance au courant. La
nouvelle théorie est connue sous le nom de théorie chimique.
Elle a été définitivement établie, principalement
par les travaux de Faraday, Grothus, César Becquerel. On ait que
la théorie de Volta repose sur le contact zinc et du cuivre, qui
constituent les couples de sa pile.
L'expérience prouve, en effet, que toutes les fois que deux métaux
différents sont mis en contact, ils se trouvent posséder
chacun un potentiel différent, le cuivre prenant une tension négative,
le zinc devenant positif, et une production d'électricité
résulte du contact de ces métaux hétérogènes.
La théorie chimique de la pile a été imaginée
par Grothus, en prenant un couple formé de deux lames de zinc et
de cuivre réunies extérieurement par un fil métallique
plongeant dans une solution étendue d'acide sulfurique. Il se produit
deux phéno mènes corrélatifs, qui sont : une combinaison
chimique et une mise en liberté d'électricité.
Il y a production dans l'intérieur de la pile ainsi constituée
et enfermée dans un vase, d'un véritable flux ou courant
de fluide, se dirigeant du zinc au cuivre, et allant du cuivre au zinc
à l'extérieur. Ceci établi, il ne s'agis sait plus
que d'exiger d'une pile, pour en avoir un service excel lent, les trois
qualités suivantes : simplicité, constance, grande intensité.
Une foule d'inventeurs se sont jetés dans ces recherches, et sont
parvenus à des résultats très divers. Aujourd'hui
l'expérience acquise demande qu'on renonce aux piles à deux
liquides, pour aboutir à une réelle simplicité, car
avec le vase poreux, elles sont une cause de complication et de gêne.
De plus, la différence de densité entre les deux liquides
produit toujours des effets d'endos mose et d'exosmose à travers
le vase poreux. Ce sont des effets qui usent en peu de temps la pile,
même au repos.
C'est à cette cause notamment qu'il faut attribuer l'usure rapide
du modèle classique de Bunsen qui, ayant ou non fonctionné,
est, au bout de huit à dix heures, tout à fait hors de service.
Aujourd'hui, parmi les piles énergiques à un seul liquide,
une seule réunit la simplicité à une force électro-motrice
élevée et à une grande intensité, c'est celle
au bichromate de potasse, sans que ses promoteurs soient parvenus à
lui donner de la constance, car elle s'affaiblit aussitôt qu'elle
est en action, et arrive même en très peu de temps à
ne plus donner du tout de courant.
M. Gustave Trouvé a découvert le moyen de lui fournir une
constance grandement suffisante pour les usages domestiques et médicaux,
tout en lui conservant sa simplicité et son intensité primitives.
Voici la modification qu'il a imaginée et qui est très ingénieuse.
On sait que le bichromate de potasse se dissout dans l'eau froide, dans
la proportion d'environ 100 grammes pour 1 litre, c'est- à -dire
au dixième en poids. Si on dissout ce sel à chaud, l'eau
en prend une plus forte proportion ; mais il se produit un grave inconvénient.
Une fois le liquide refroidi, le sel se dépose et forme des cristallisations
tellement adhérentes aux parois des vases, qu'il les déforme
toujours et les brise souvent. De plus, quand la pile au bichromate de
potasse a fonctionné pendant un certain temps, il se forme de l'alun
de chrome qui, à son tour, cristallise avec les mêmes inconvénients
et encrasse les charbons, qui sont à la fin recouverts d'une gaîne
tout à fait nuisible au fonctionnement. M. Gustave Trouvé
a imaginé de modifier ainsi la préparation du liquide chargé
de donner de la constance à la pile.
Il jette dans de l'eau du bichromate de potasse réduit en poudre
( 125 à 150 grammes pour 1 litre ), il ajoute ensuite, en versant
lentement et en mince filet, et en agitant constamment le liquide, jusqu'à
450 grammes d'acide sulfurique par litre, soit un quart en volume. Le
mélange liquide s'échauffe peu à peu, et le bichromate
de potasse, une fois dissous, demeure limpide et ne dépose pas
par la cristallisation en se refroidissant. Pendant la fonction et même
après épuisement complet, cette solution de bichromate de
potasse acidulé ne laisse pas se former des cristaux d'alun de
chrome.
On n'en trouve aucune trace, même après plusieurs mois, si
on a eu le soin d'éviter l'évaporation.
Le résultat est très important et ouvre des horizons nouveaux
à l'étude des mélanges et des combinaisons des liquides.
On dirait, dans le cas présent, que ce liquide a été
fait tout d'une pièce, et qu'on se trouve en présence d'une
solution nettement définie.
Il y a là, sans aucun doute, un maximum de saturation atteint une
fois pour toutes, une sorte de point précis où, la sursaturation
étant produite, il ne peut y avoir aucune oscillation ni en deçà
ni au delà. Le résultat est d'autant plus remarquable et
précieux, qu'il devient inutile de constituer un réservoir
d'acide ou de sel de chrome, comme dans la pile de Daniell, qui emmagasine
le sel de cuivre, car le bichromate de potasse ajouté après
le mélange ne se dissout plus dans le liquide déjà
acidulé. Les proportions indiquées plus haut sont définies
et constituent un liquide normal incapable de recevoir d'autres mélanges
étrangers. La constance de cette pile est donc absolument assurée
par ce fait seul, qui frappera suffisamment l'esprit, que le liquide se
trouve sursaturé. En effet, tant que le bichromate qui est en excès,
et pour ainsi dire mis en réserve, n'est pas épuisé,
la constance dure et ne cesse qu'au moment où tout rentre dans
les conditions ordinaires des piles au bichromate de potasse à
solution non sursaturée.
La préparation spéciale, imaginée par M. Gustave
Trouvé, ne pouvait que renforcer la puissance de cette pile, puissance
due aux indications de Poggendorff, qui, en réalisant le premier
le liquide au bichromate, a découvert la combinaison qui donne
la force électro-motrice la plus considérable.
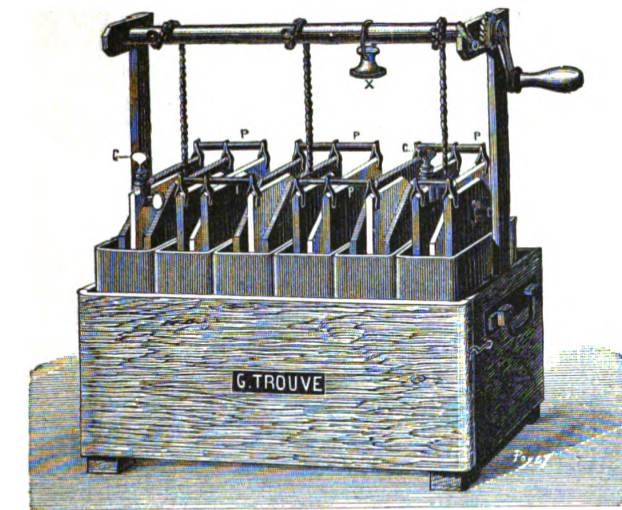
Fig. 26. — Pile de M. Gustave Trouvé, constante et à
grand débit, avec auge et treuil perfectionné, et munie
de pinces élastiques et mobiles, pour établir la relation
des éléments entre eux.
Quant à la simplicité, elle s'explique d'elle-même;
elle découle de la constitution de la pile qui, étant à
un liquide unique, ne peut pas être moins com pliquée. Cependant
le probleme n'était pas encore entièrement résolu.
Il restait une dernière difficulté, celle de la mise en
service ou de la manipulation de la pile. Si on laisse les zincs et les
charbons séjourner dans le liquide excitateur, la pile s'épuise,
même à circuit ouvert et sans fonctionner. Si on ne sort
que le zinc seulement, comme dans la pile-bouteille, par exemple, le charbon,
demeurant toujours dans le liquide, ne tarde pas å se saturer, à
s'encrasser, c'est- à-dire à être couvert de cristaux
d'alun de chrome.
M. Gustave Trouvé a eu soin de parer à ces deux inconvénients
graves en montant sur sa pile un treuil particulier qui, au moyen d'une
manivelle, relève les charbons et les zincs et empêche ainsi
tout contact inutile entre le liquide et les éléments. Le
mécanisme de ce treuil a encore été perfectionné
par un petit arrêt en bois que l'on peut voir en X dans la figure
26 et qui est destiné à empêcher les éléments
de remonter trop haut et de sortir des vases.
M. Georges Dary, dans une excellente brochure sur la Navigation électrique,
a donné une description fort détaillée et très
claire de cette pile nouvelle, á auge et å treuil, qui s'est
répanduo rapidement dans les cabinets de physique.
Nous lui empruntons les détails explicatifs suivants sur toutes
les parties qui la cons tituent.
Elle se compose :
1 ° D'une auge en bois de chêne, munie d'autant de cuves en
ébonite (caoutchouc durci ) qu'il y a d'éléments,
et surmontée d'un treuil, avec rochet, encliquetage et point d'arrêt
automatique.
2° D'un nombre d'éléments variant de 6 à 12,
mais plus généralement de 6, pour en faciliter le maniement.
3° Du liquide excitateur : acide sulfurique et bichromate de potasse,
dans les proportions que nous avons indiquées plus haut.
L'auge a été construite d'une façon ingénieuse,
afin de pouvoir, au moyen du treuil, plonger à volonté les
éléments dans le liquide ou les en faire sortir complètement.
De cette manière, il est facile de varier la production d'électricité
suivant le plus ou moins d'immersion, et de la faire cesser en élevant
les éléments au - dessus du liquide, sans que ceux- ci sortent
complètement des cuves. L'arrêt de bois, auquel nous avons
fait allusion, remplit cet office. En le supprimant, ou bien en le poussant
de côté, à droite ou à gauche, la hauteur du
treuil permet alors de rendre les éléments indépendants,
et on peut vider ou remplir avec aisance les cuves.
La face antérieure de l'auge est munie d'une charnière qui
lui permet de s'abattre et de faire sortir les vases sans déranger
les éléments.
Il est alors facile de les nettoyer et de les remplir à moitié
avec du liquide neuf. Il est utile aussi de faire tremper de temps en
temps les charbons dans de l'eau ordinaire un peu chaude, afin d'en revivifier
les surfaces.
Les éléments sont formés d'une lame de zinc et de
deux charbons cuivrés galvaniquement dans leur partie supérieure,
comme on peut le voir dans la figure 27. Ce cuivrage a pour but de consolider
les charbons, matière toujours un peu fria ble, et de diminuer
considéra blement la résistance du cicuit extérieur
de la pile, en augmentant ainsi la conductibilité du charbon.
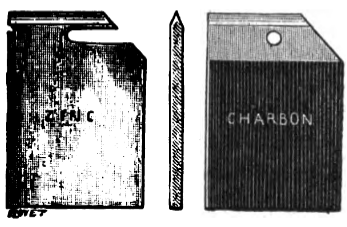
FIG. 27. Éléments de la pile de M. Gustave Trouvé
dont les charbons sont cuivrés à la partie supérieure.
Le zinc des éléments ( fig. 27 ) est amalgamé dans
toute toute la masse, et il présente supérieure une encoche,
qui sert à le fixer à l'axe métallique isolé
et recouvert d'une chemise en caoutchouc, sur lequel repose tout le système.
Cette encoche permet de déplacer très rapidement les zincs,
soit pour les amalgamer, soit pour tout autre motif. Enfin les contacts
sont établis par des pinces mobiles d'un modèle fort ingénieux,
spécial encore à M. Gustave Trouvé, et déjà
employées, bien longtemps avant, pour sa pile galvano-caustique,
dont nous allons parler plus loin.
Il faut veiller à ce que les zincs soient toujours amalgamés
avec soin.
Cette opération peut se faire facilement, car ils sont placés
à cheval sur l'axe qui les supporte, au moyen d'une fente transversale
pratiquée dans leur partie supérieure. Il n'y a donc qu'à
desserrer les écrous qui maintiennent tout le système et
qui sont placés aux deux extrémités. L'amalgame des
zincs s'effectue très facilement dans une assiette contenant de
l'eau acidulée au 1/20° environ et un peu de mercure que l'on
étale sur les zincs en les frictionnant énergiquement avec
une brosse. Si l'on veut se dispenser de cette opération un peu
laborieuse, on se contente d'immerger les zincs dans une solution de mercure,
dans de l'eau régale, suivant la formule que voici : Acide chlorhydrique
: 750 grammes et Acide azotique : 250grammes.
Dans le mélange, on fait dissoudre à chaud 200 grammes de
mercure, puis on ajoute 1000 grammes d'acide chlorhydrique. L'immersion
du zinc ne doit pas durer plus d'une seconde. Telle est l'énergie
du liquide, que ce temps suffit pour amalgamer et décaper l'élément,
quelque sale qu'il puisse être.
La batterie de la pile à treuil est composée couramment
de six éléments.
Elle donne un courant de grande intensité et sert à exciter
les moteurs de M. Gustave Trouvé ; mais elle peut, avec ·
les mêmes avantages, être utilisée à animer
les grandes bobines d'induction, les lampes à incandescence, etc.
Elle est indispensable dans les cabinets de physique où elle s'est,
du reste, prompte ment répandue.
M. d'Arsonval, qui a fait faire de grands progrès aux applications
de l'électricité, à la physiologie expérimentale,
et qui est un des meilleurs élèves de Claude Bernard, a
trouvé, après de nombreuses expériences avec cette
pile, que la force électro-motrice était en moyenne de 2
volts par élément, et la résistance de 0 ohm 0016.
L'intensité est considérable en court circuit; elle peut
atteindre centaine d'ampères.
En débit normal, les constantes sont, pour la force électro-motrice
de chaque couple, de 1 volt, 9 et 0 ohm 08 pour la résistance.
Dans ces conditions, on obtient d'une batterie de six éléments
un courant constant de 20 à 25 ampères et de 11 à
12 volts pendantplusieurs heures.
C'est un beau résultat, comme on le voit, et dont on peut modérer
à volonté les effets par l'immersion plus ou moins prononcée
des éléments dans leur solution.
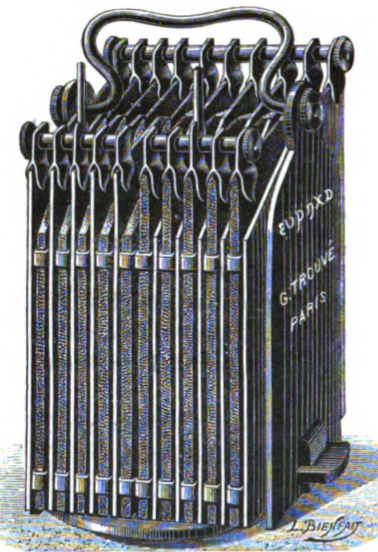 Fig.28. – Pile ou batterie portative à grande surface de M.
Gustave Trouvé.
Fig.28. – Pile ou batterie portative à grande surface de M.
Gustave Trouvé.
Pour l'usage spécial de la galvanocaustique thermique, M. Gustave
Trouvé a rassemblé, sous la forme portative et sous un très
petit volume (fig. 28), dix éléments de sa pile au bichro
mate, occupant environ 2 décimètres cubes. Cette pile, si
connue et si appréciée du monde médical, est celle
qui, jusqu'à ce jour, fournit, sous le volume le plus réduit,
la plus grande somme d'énergie et le minimum de résistance
intérieure. Son poids est d'environ 5 kilogrammes, et, malgré
son exiguïté, elle a donné, en court circuit, à
M. d'Arsonval, au Collège de France, 118 ampères, 4 volts,
avec une résistance de O ohm, 0010. La partie immergéo représente
un cube de 0 m,12 de côté.
Elle (est composée de 10 charbons et 10 zincs.
La cage de cette pile à grande surface est formée simplement
par trois plaques d'ébonite. L'une sert de base et les deux autres
constituent les montants. Le tout est maintenu, à la partie supérieure,
par la poignée même. L'écartement des éléments,
zinc et charbon, est obtenu facilement au moyen de jarretières
de caoutchouc élastique que l'on place spécialement en haut
et en bas des charbons. Ces jarretières ou bracelets, que l'on
obtient en sectionnant un tube de caoutchouc souple, servent encore de
coussins en cas de chocs violents, et évitent la rupture des charbons.
Dans cette pile, comme dans celle à auge et à treuil, les
mêmes contacts mobiles à pinces sont employés, et
ils offrent, comme nous l'avons vu, le grand avan tage de se placer et
déplacer instantanément pour être nettoyés
et faciliter l'amalgame des zincs.
De plus, ils servent å relier, suivant les cas, les éléments
en quantité ou en tension.
Une batterie de six éléments, soumise à des essais
au Collège de France, sur un moteur de M. Gustave Trouvé,
ayant un poids de 3 kilogrammes 300 grammes, a développé
au frein un effort mécanique de 3 kilogrammètres 75 par
seconde, ce qui est très remarquable pour un appareil d'un volume
aussi minime.
En passant, n'hésitons pas à rappeler que le kilogrammétre
est l'unité de force équivalente à l'effort nécessaire
pour elever, en une seconde de temps, un poids de 1 kilogramme à
1 mètre de hauteur. D'après une autre série d'expériences,
entreprises par le même savant dans le même établissement,
avec des moteurs d'une force d'un demi-cheval et d'un poids de 8 kilogrammes,
et d'une force d'un cheval et d'un poids de 16 kilogrammes, le rendement
obtenu a été de 60 à 65 pour 100, pour un nombre
d'éléments variant de 24 à 48, et à une vitesse
moyenne de 2400 tours par minute, ainsi qu'il résulte de l'examen
du tableau qui se trouve en tête de la page suivante.
Il va de soi qu'en augmentant les dimensions du moteur Trouvé,
et en même temps la puissance de la pile électrique, on obtient
un rendement mécanique supérieur. Ce rendement est d'autant
plus élevé que le moteur est plus puissant. Il peut alors
atteindre 90 et 92 pour 100.
LES PILES AU BICHROMATE DE POTASSE DE M.G. TROUVÉ
Résultats d'expériences faites par M. Hospitalier
sur doux batterios de six éléments ( Note présentée
à la Société française de physique le 20 avril
1883 ). « Chaque batterie de six éléments se compose
( fig 26 ) d'une auge en chêne garnie de six cuvettes rectangulaires
en ébonite qui contiennent le liquide de chaque élément.
Les zincs et les charbons, reliés entre eux par des pinces mobiles,
sont montés sur un treuil qui permetde faire varier à volonté
leur immersion dans le liquide et de régler le débit, en
plongeant plus ou moins les éléments, c'est-à dire
en faisant varier la résistance intérieure de la batterie
et sa surface.
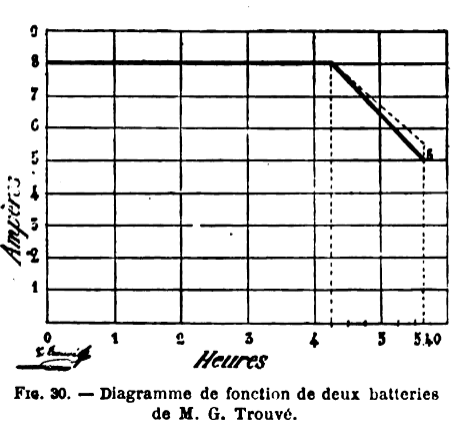 fig 30 Diagramme de fonction
de deux batteries active de M G Trouvé.
fig 30 Diagramme de fonction
de deux batteries active de M G Trouvé.
Enfin, un arrêt en bois empêche les éléments
de sortir complètement des cuves ; en supprimant cet arrêt,
en le poussant de côté, la hauteur du treuil permet de les
rendre absolument indépendants, de manière å vider
ou à remplir les cuves en ébonite. La face antérieure
de l'auge est munie, à cet effet, d'une charnière, qui permet
dès lors de l'ouvrir et de sortir les cuvettes sans déranger
les éléments Les éléments sont formés
d'une lame de zinc et de deux charbons cuivrés, galvaniquement
à leur partie supérieure. Le zinc présente une encoche
qui sert à le fixer à l'axe métallique recouvert
de caoutchouc qui supporte les éléments.Cette disposition
permet de déplacer très rapidement les zincs pour les amalgamer
ou les remplacer.
La composition du liquide pour une batterie de six éléments
est la suivante : kilogrammes :
Eau............................................ 8,0
Bichromate de potasse pulvérisé. 1,2
Acide sulfurique..........................3,6
Total........................................ 12,8
La solution renferme donc 150 grammes de bichromate par litre d'eau au
lieu de 100 grammes, comme dans la solution de Poggendorff.
Pour un débit plus rapide, M.Trouvé augmente encore la quantité
de bichromate et dit parvenir à faire dissoudre 200 et jusqu'à
250 grammes de bichromate de potasse par litre d'eau.
Voici comment M. Trouvé prépare la solution : Il jette dans
de l'eau du bichromate de potasse en poudre, à raison de 150 grammes
de ce sel par litre d'eau ; après avoir agité, il ajoute
en versant en mince filet et très lentement jusqu'à 450
grammes d'acide sulfurique par litre, soit un quart en volume, en continuant
d'agiter ; le mélange liquide s'échauffe peu et le bichromate,
une fois dissous, reste limpide et ne dépose pas par cristallisation
en se refroidissant. La préparation demande de huit à dix
minutes.
Il faut avoir bien soin de ne pas faire usage d'un agitateur en bois qui
serait rapidement carbonisé en épuisant inutilement une
partie de la solution.
Le poids moyen d'une batterie de 6 éléments se répartit
ainsi en kilogrammes.
Six zincs..................... 7,680
Douze charbons...........5,400
Six cuvettes en ébonite.1,620
Contacts......................0,600
Boite en chène..............3,000
Montants en fer............2,300
Liquide......................12.800
Poids total................ 33,400
Soit 67 kilogrammes environ par deux batteries.
RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES
Les 12 éléments montés en tension ont été
déchargés sur 6 lampes Swan en dérivation.
Le débit a été réglé, en manæuvrant
le treuil de chaque batterie, de manière à maintenir un
courant constant de 8 ampères pendant quatre heures un quart. Au
moment de l'immersion, le coup de fouet, dû à la grande force
électromotrice initiale de chaque élément, a fourni
un courant de 12 ampères, bien que les zincs ne fussent plongés
que de 2 centimètres environ.
Après quelques minutes, le courant est revenu à son intensité
normale de 8 ampères.
Un léger échauffement du liquide a ensuite provoqué
une légère augmentation du débit, qui est redevenu
normal quinze minutes après la mise en marche.
La pile a fonc tionné dans ces conditions pendant une heure et
demie sans qu'on ait dû abaisser les zincs. A partir de ce moment,
on a compensé l'affaiblissement du débit en augmentant graduelle
ment la surface immergée. Les variations n'ont jamais dépassé
un demi-ampère et le courant moyen a été très
soigneusement maintenu à 8 ampères pendant quatre heures
un quart (fig.30), temps après lequel les zincs se trouvaient complètement
im mergés et plongeaient de 15 centimètres environ dans
chaque élément. A partir de ce moment, la décroissance
a été très régulière et l'expérience
arrêtée en soulevant les zincs et les retirant complètement
du liquide lorsque le courant a atteint 5 ampères.
La décharge se divise donc en deux phases :
1° phase. – Débit maintenu constant à 8 ampères
pendant quatre heures un quart.
2° phase. — Débit régulièrement décroissant
de 8 à 5 ampères pendant une heure et vingt- cinq minutes.
1 ° Phase constante.
- Différence de potentiel aux bornes des lampes. 14,15 volts.
,................................................. des batteries. 16,70
Intensité du courant............................................
8 ampères.
Débit, par seconde, dans le circuit extérieur....... 133,6
watts.
,.......................................................................
13,5 kilogrammètres.
Durée de la phase constante.............................. 15 300,00
secondes.
Quantité d'électricité fournie.............................122
400,00 coulombs.
Energie disponible dans le circuit extérieur..........206 550,00
kilogrammètres.
2° Phase décroissante.
Pendant cette seconde phase, le courant moyen a été de 6,53
ampères pendant une heure vingt-cinq minutes ou 5100 se condes,
et l'énergie électrique moyenne disponible dans le circuit
extérieur de 9 kilogrammètres par seconde.
Travail total.
Lorsqu'on totalise les deux phases qui représentent le débit
réel dans les conditions de l'expérience, on trouve les
résultats suivants : Quantité totale d'électricité
fournie.
Energie totale disponible. 456 900,00
coulombs...................... 253 350,00 kilogrammètres.
Le cheval-heure étant égal à 270 000 kilogrammètres,
ces chiffres montrent que les deux batteries ont fourni ensemble 0,96
de cheval-heure, soit sensiblement un demi-cheval -heure par batterie
de 6 éléments.
Cinq batteries de 6 éléments, soit 30 éléments
en tension, suffiraient donc pour alimenter une lampe à arc brûlant
des charbons de 9 millimètres de diamètre ; avec un courant
de 7 ampères et 40 volts de différence de potentiel aux
bornes de la lampe, pendant plus de cinq heures.
Consommation du zinc.
- Les zincs pesés avant et après l'expérience ont
indiqué une consommation de :
Pour la première batterie. 751
Pour la seconde............ 712 grammes.
Total............................ 1463.
Soit en moyenne 122 grammes par élément.
La consommation minima a été de 103 grammes et la consommation
maxima de 133 grammes.
La consommation théo rique, déduite de la quantité
d'électricité et des équivalents électro-chimiques,
est de 53 grammes par élément ou 636 gram mes pour les deux
batteries.
Il résulte de ces expériences que deux batteries Trouvé
de 6 éléments chacune, chargées à neuf, représentent
une énergie électrique disponible de 1 cheval-heure, ou
270 0000 kilogram mètres, sous un poids qui ne dépasse pas
67 kilogrammes (1 ).
( 1 ) « Il importe de faire remarquer ici qu'aucune disposition
n'a été prise au point de vue de la légèreté,
et qu'il serait facile de réduire ce poids à 50 kilo grammes.
Ce chiffre est inférieur à ce que les accumulateurs ont
pu fournir jusqu'à présent sous le même poids.»
Depuis lors, M.G. Trouvé, pour des expériences de navigation
aérienne répétées, a considérablement
réduit leur poids, en s'arrêtant au strict nécessaire.C'est
ainsi qu'il est arrivé à construire des batteries de 12
à 15 kilos par cheral heure. C'est un beau résultat.
La consommation est représentée par les chiffres suivants
:
Zinc..............................1463
Bichromate de potasse. 2400
Acide sulfurique......... 7200 grammes.
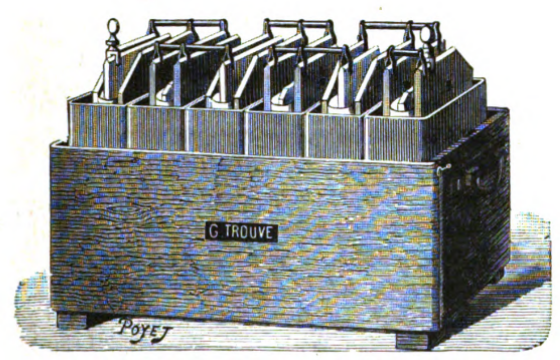
FIG 31, Pile à faible débit, modèle à vase
poreux et à deux liquides, de M. Gustave Trouvé
Ces chiffres permettent de calculer facilement quel est le prix du cheval-heure
d'énergie électrique disponible, lorsqu'on se place dans
les conditions moyennes de débit dont les résultats sont
consignés ci- dessus.
M.G. Trouvé dispose également cette pile pour fonctionner
à deux liquides et à petit débit (fig.31 ).
Dans ce cas elle est munie de vases poreux dans lesquels plongent les
zincs.
La composition des solutions qui l'alimentent est consignée au
tableau nº 3.
Les figures 32, 33, 34 et 35 font voir le détail de la construction
de la pile humide qui a été si commodément substituée
à la pile liquide, dans bien des cas, notamment dans les appareils
électro-médicaux et de télégraphie militaire
de notre infatigable inventeur.
Cette pile est une pile Daniell modifiée ; elle présente
le grand avantage de fonctionner sans liquide, ou du moins sans liquide
libre pouvant se renverser ou fuir des vases qui le contiennent.
Les électrodes zinc ct cuivre, de forme circulaire, sont séparés
par de nombreuses rondelles de papier buvard ( fig 32).
La moitié de cette colonne de papier, celle qui est contiguë
au cuivre, est fortement imprégnée de sulfate de cuivre,
par une immersion dans une solution concentrée et bouillante de
ce sel. La moitié supérieure voisine du zinc est faiblement
imprégnée de sulfate de zinc par immersion dans une solution
étendue et froide. L'ensemble est monté sur une tige centrale
en cuivre rouge, soudée à l'électrode inférieur,
également en cuivre.
Cette tige, isolée latérale ment par une gaine de caoutchouc,
traverse toutes les rondelles de papier ainsi que l'électrode supérieure
en zinc, pour venir se suspendre au centre d'un disque d'ardoise ou de
caoutchouc durci, servant de couvercle au récipient de verre qui
renferme le couple.
La tige centrale, filetée à sa partie supérieure,
constitue le pôle positif du couple. Une tige latérale, émergeant
pareillement du couvercle, est en communication avec l'électrode
zinc. C'est le pôle négatif.
Si l'on dessèche la pile, les deux électrodes se trouvent
isolés l'un de l'autre, et l'appareil, inerte quoique chargé,
conserve indéfiniment sa provision de matières actives.
Par une simple apparition à l'air, le papier et les sels qu'il
contient s'humectent, le sulfate de zinc surtout, et la pile peut fonctionner.
Sa résistance est alors très grande.
Si on veut la mettre franchement en activité, il suffit de la tremper
dans l'eau, puis de la laisser égoutter dans sa position normale
avant de la replacer dans son récipient. Le papier buvard reste
imprégné des sulfates dissous, et la pile, quoique no conte
nant pas de liquide libre, peut fournir un courant d'intensité
suffisant pour les besoins de l'horlogerie électrique ou de la
télégraphie. C'est sous cette forme qu'elle est employée
avec avantage à l'Observatoire de Paris, depuis de longues années,
pour l'enregistrement des phénomènes météorologiques.
Enfermée dans un vase de verre, comme le montre le dessin, la pile
garde longtemps son eau d'imbibition. Elle est très constante et
sa durée est fort grande parce que les sels ne peuvent se mélanger
comme dans les couples à liquides libres. C'est seulement à
la surface que les deux sulfates de cuivre et de zinc pourraient progresser
l'un vers l'autre, véhi culés par l'humidité ambiante.
Mais M. Gustave Trouvé a prévu cet inconvénient,
et il y a paré en disposant les papiers par disques de douze rondelles
chacun et de deux diamètres, alter nativement différents,
de sorte que la géné ratrice de la colonne spongieuse est
une ligne brisée, infran chissable pour les sels voyageurs.
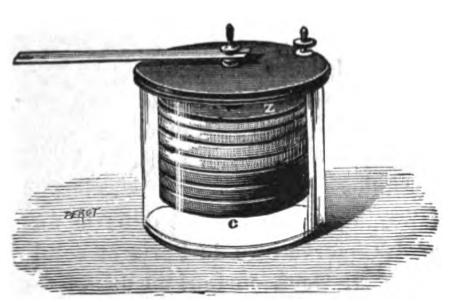
FIG 32 — Pile humide enfermée dans un vase de verre, système
de M.Gustave Trouvé.
Quand il s'agit d'une pile de plusieurs couples, il n'est pas nécessaire
que chacun d'eux ait un récipient.
On en met un certain nombre dans la même boîte et on les fixe
au couvercle commun, en prenant les dispositions convenables pour les
cou plages et les isolements.
Ce dispositif de M. Gustave Trouvé, qui empêche radicalement
la diffusion du sulfate de cuivre du côté zinc, si onéreuse
dans les diverses formes de la pile Daniell, est facilement applicable
å quelques autres combinaisons voltaïques primaires ou secon
daires. Voici le tableau des données de constructions relatives
au modèle de la figure 32 :
Diamètre des électrodes 5 centimètres.
Distance entre les électrodes 9 centimètres.
Cet espace est rempli par 12 disques.
Les disques sont composés chacun de 25 papiers.
Soit en tout 300.
Poids du sulfate de cuivre occlus ( SO‘Cu, 5HO ). 300 grammes.
Poids du sulfate de zinc occlus ( SO'Zn, 7HO ). 20 grammes.
On peut assurer que 300 grammes de sulfate de cuivre correspondraient
théoriquement à une émission totale de 235,000 coulombs
; mais la pile est pratiquement épuisée avant d'avoir fourni
cette quantité. Son débit étant faible, elle peut
travailler conti nuellement pendant plusieurs mois ; en service intermittent,
on l'a vue fonctionnner deux années de suite. Le papier dure aussi
longtemps que l'électrode zinc. On le remplace en même temps
que lui. Il va de soi qu'en allongeant la pile on accroit à la
fois sa capacité de travail et sa résistance ; mais, on
l'élargissant, on n'accroît que sa capacité et l'on
diminue sa résistance. La résistance est plus grande que
celle des piles à liquides libres, de dimensions correspondantes.
Cette pile humide s'est propagée rapidement dans la forme que nous
venons de décrire.
L'Observatoire de Paris et celui de Cordoba, ce dernier dirigé
par M. Beuf, en font un usage cons tant dans les appareils d'enregistrement.
Niaudet, dans son Traité élémentaire
des piles, justement apprécié et très recherché,
ne craint point de dire que, sous cette forme, la pile au sulfate de cuivre
atteint une constance remarquable et qu'elle doit être considérée
comme la plus constante des piles connues.
Telle était aussi l'opinion de M. A. Bréguet,
jeune savant des plus compétents et trop tôt enlevé
à la science.
Voici comment il s'exprime à ce sujet dans un remarquable article
sur l'Unification de l'heure dans les grandes villes par le moyen de l'électricité,
paru dans le Génie civil du 1er novembre 1880.
Après avoir passé en revue toutes les difficultés
inhérentes au transmetteur, aux contacts å opérer
et aux transmissions électriques, M.A. Breguet en arrive à
celles que présentent les piles.
« Dans le nouveau transmetteur, les contacts sont au nombre de
trois et fonctionnent parallèlement. C'est donc un tiers du courant
principal qui traverse chacun d'eux, et par là l'influence oxydante
se trouve de beaucoup diminuée. La pile fonctionne donc douze heures
sur vingt - quatre, ce qui est considérable, et ce qui constituait
une nouvelle difficulté à vaincre, la plupart des piles
ne résistant pas à un travail aussi prolongé, sans
nécessiter un entretien minu tieux et fréquent.
Après quelques recherches ce fut à la pile humide au sulfale
de cuivre que l'on s'arrêta, et les résultats qu'on put en
obtenir furent tout à fait inespérés. Cetle pile,
inventée par M. Trouvé, est une forme particulière
de celle de Daniell ; mais au lieu de contenir des dissolutions complètement
liquides de sulfates de cuivre et de zinc, elle les retient dans les pores
de rondelles de papier buvard.
Les transports causés par les électrolyses secondaires se
trouvent alors contrariés et il s'ensuit une régularité
presque absolue de l'intensité du courant.
M.Gustave Trouvé l'a répandue à un très grand
nombre d'exemplaires, en trois ou quatre formats, pour l'horlogerie, les
usages médicaux et la télégraphie militaire. Dans
ce dernier cas, son application devait faire progresser le télégraphe
portatif.
La pile de ce genre, construite spécialement dans ce but, est composée
de trois boites superposées (fig.33), dont chacune contient trois
éléments.
Ces boites sont faites en caoutchouc durci. Le couvercle auquel sont attachés
les trois éléments est en ardoise. Avec ces neuf éléments,
on peut faire fonctionner le parleur à plusieurs kilomètres
de distance.
Cette pile militaire, on le conçoit facilement, peut être
maniée, sans précaution aucune, inclinée sur le côté,
ou même mise à l'envers, dans les voitures de transport,
sans aucun inconvénient.
On peut l'appliquer également à tous les appareils d'avertissement
ou autres qui pour ront fonctionner dans les trains de chemins de fer
et, en général, partout où la pile devra être
utilisée.
 FIG 33 Pile
militaire de M. Gustave Trouvé.
FIG 33 Pile
militaire de M. Gustave Trouvé.
A côté de ce premier modèle de pile humide, M. Gustave
Trouvé en a construit une autre forme plus simple et dont voici
la description.
Ici, chaque couple se compose uniquement d'un tube de verre ( fig.34),
rempli de rondelles de papier buvard imprégnées comme nous
avons dit, et de deux disques, l'un de cuivre, l'autre de zinc, placés
aux deux bouts de la colonne de papier.
Le tube est fermé à chacune de ses extrémités
par un bouchon de liège que traverse un fil de cuivre soudé
à la rondelle correspondante Les dimensions de ces couples sont
variables. Ils peuvent avoir couramment 1 centimètre de diamètre
intérieur et 10 centimètres de longueur.
Fabriqués en quantité, ils pourraient revenir à la
modique somme de 25 centimes l'un. De cette façon, il serait possible,
dans un espace restreint, de superposer un grand nombre de ces couples,
pour former une pile de haute tension, très bien isolée,
constante, durable, d'un prix très modique et d'une inappréciable
valeur pour l'étude et l'étalonnage des appa reils de mesure.
La meilleure manière de la monter consiste à suspendre verticalement
les éléments à des cadres horizontaux.
Pour la commodité du transport et de l'usage, M. Gustave Trouvé
a eu l'idée de les caser par groupes dans des boîtes maniables.
La figure 35 représente une pile humide de 500 couples ainsi combinée.
La caisse a 80 centimètres de longueur sur 20 de largeur.
On sait tout l'intérêt que présentent les batteries
de tension pour l'étude de l'électricité à
haut potentiel.
Malheureusement le montage d'une pile d'un nombre considérable
de couples est si coûteux, l'isolement en est si difficile, que
peu de physiciens ont pu jusqu'à présent s'offrir une batterie
de plusieurs milliers de volts. On cite cependant M. Gassiot avec ses
couples zinc, platine, eau, et M. Warren de la Rue, mort en 1886, avec
ses piles montée en colonne, au chlorure d'argent.
La célèbre batterie sesystème de M. Gustave Trouvé
de 800 couples, avec laquelle M. Gaston Planté exécuta
ses magnifiques expériences, ne peut pas entrer ici en ligne de
compte, car elle donne des effets de quantité qui ne pourraient
être obtenus avec les piles très résistantes de M.
Gustave Trouvé.
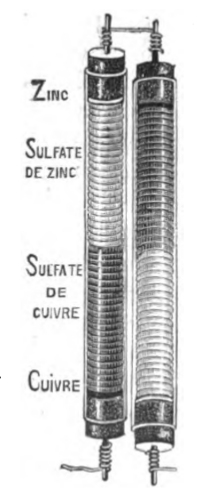 Fig 34 Pile
humide montée en colonne système de M. Gustave Trouvé.
Fig 34 Pile
humide montée en colonne système de M. Gustave Trouvé.
Mais, grâce aux couples tubulaires, nous pensons
avec M.Emile Reynier que les hauts potentiels pourraient être étudiés
commo dément et recevoir des applications pratiques. C'est à
ce point de vue particulier que la pile humide, dans sa forme la plus
simple et la plus économique, est appelée à donner
de l'imprévu. Nous ne saurions trop insister sur le dispositif
fondamental de la pile humide qui fait que les deux liquides restent séparés
beaucoup mieux qu'ils ne le sont par les vases poreux. Avec ce système,
l'usure du sulfate de cuivre ne se produit plus guère que par suite
du passage du courant. En d'autres termes, dans cette combinaison, il
n'y a presque pas de travail intérieur perdu. Or, on sait que cette
perte est le plus grand défaut de la pile Daniell. Le disque de
cuivre est maintenu au centre par une tige isolée des rondelles
de papier et du zinc.
Elle dépasse la table d'ardoise qui surmonte l'élément
et qui sert de couvercle au vase de verre ou d'ébonite dans lequel
l'élément est à l'abri des courants d'air et de la
poussière.Le bord du vase est rodé et l'ardoise bien dressée,
de sorte que tout se trouve dans une capacité hermétiquement
close et par conséquent à l'abri de l'évaporation.
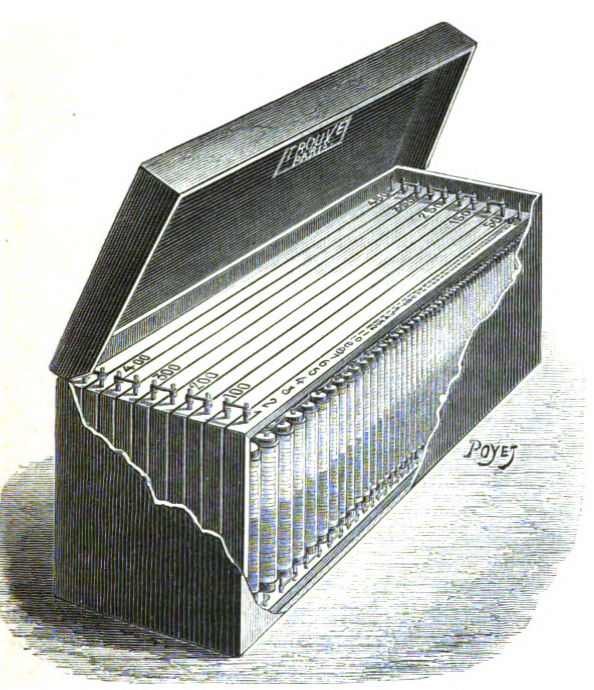
Fig 35 Pile humide de 500 couples. Système de M.
Gustave Trouvé pour l'étalonnage et le contrôle des
appareils de mesure.
Ainsi constitué, l'élément peut fonctionner pendant
plus d'une année, sans qu'on ait à s'en occuper en aucune
façon. Cependant, il va sans dire qu'au bout d'un certain laps
de temps, plus ou moins long et variable avec l'activité du travail
qu'on demande à la pile, elle finit par s'épuiser. Le sulfate
de cuivre se réduit, et le courant, après s'être
peu à peu affaibli, devient insensible.
Il faut alors recharger l'élément. C'est une opération
facile et qui consiste à tremper dans une solution chauffée
et saturée de sulfate de cuivre la partie inférieure de
l'élément. On prépare cette solution dans une cuvette
de cuivre faite exprès ; elle s'élève jusqu'à
un niveau marqué.
Le couvercle de l'élément porte sur le bord de la cuvette, de telle sorte que le papier s'imbibe jusqu'à la hauteur voulue, sans qu'on ait à la chercher.
Quant au sulfate de zinc, il se forme constamment par l'action de la
pile ; il n'y a donc jamais, à en remettre. Mais le zinc lui même
s'use et, au bout d'un certain temps, devra être remplacé.
On profite de ce moment pour renouveler le papier. Le cuivre, au contraire, débarrassé du cuivre pulvérulent déposé
par l'action du courant, sert indéfiniment. Tel est l'élément
humide, du nom que lui a donné M. Gustave Trouvé.
Cette dénomination est rigoureusement exacte, tandis que le nom
de pile sèche, qui a cours dans l'enseignement classique, n'est
pas justifié, appliqué aux piles de Zamboni, qui n'agissent
réellement que grâce à l'humidité qu'elles
absorbent.
L'élément humide de M. Gustave Trouvé possède
la même force électromo trice que l'élément
Daniell, dont il ne diffère que par la forme.
Sa résistance varie avec le diamètre des rondelles de cuivre
et de zinc et avec l'épaisseur de la pile de papier intermédiaire.
Pour un diamètre donné des disques métalliques,
on ne pourrait pas diminuer par trop la quantité de papier sans
faire perdre à la pile les qualités de durée qui
font l'un de ses principaux mérites. Par contre, à mesure
que l'épaisseur du papier est augmentée, la durée
possible du service actif est accrue, en même temps que la résistance.
La pile humide de M. Gustave Trouvé présente tous les avantages
connus de la pile Daniell, notamment la dépolarisation complète
de l'électrode, et par suite une grande constance. Mais on peut
même ajouter que, sous cette forme, la constance prend un caractère
inaccoutumé. En effet, avec la forme ordinaire, on remarque que
la force électromotrice est absolument invariable, tandis que
la résistance intérieure oscille d'une manière conti
nuelle, surtout quand le courant est interrompu et rétabli. Chaque
fois qu'on mesure à nouveau la résistance intérieure
d'une pile de Daniell, on trouve une valeur différente, et cependant
ces valeurs changeantes conduisent à une valeur unique de la force
électro motrice. Ce phénomène s'explique par les
variations perpétuelles de la composition du liquide. On a fait
à ce sujet l'expérience suivante.
On laisse le soir une pile fermée sur un galvanometre approprié, en notant au préalable 89 la déviation de l'aiguille.
Le lendemain matin, on retrouve la même déviation.
De cette observation on est amené à conclure que, pendant
douze heures de circuit fermé, la force électromotrice et
la résistance intérieure de la pile n'ont pas varié.
Si, alors, on ouvre le circuit, ne fût-ce qu'une seconde, et qu'on
le referme aussitôt, on trouve une nouvelle déviation ; et
si l'on prend les mesures, on constate que la résistance intérieure
a changé et a seule changé. Quelle que soit la cause de
ces variations subites, il faut admettre qu'elles s'opposent à
une constance absolue du courant que peut fournir la pile.
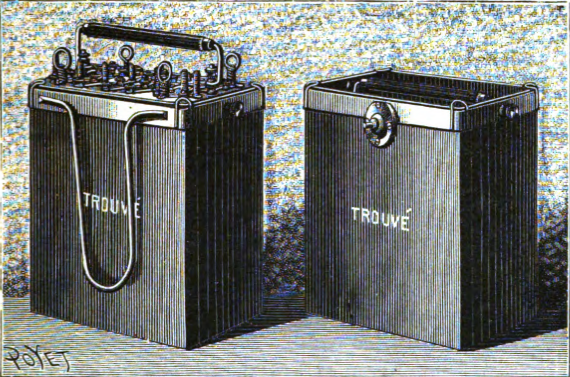
Fig 36 et 37 Batterie universelle automatique de M. Gustave Trouve, représentée
en fonction et au repos.
Dans la forme donnée par M. Gustave Trouvé, la pile ne présente
pas, du moins au même degré, les variations de résis
tance, et surtout ces variations ne sont pas aussi subites. Mais le principal
avantage de la disposition nouvelle, c'est la suppression du travail intérieur
de la pile quand le circuit est ouvert. On peut dire, en résumé,
d'une pile de Daniell, qui ne fournit pas de courant, qu'elle est un cheval
à l'écurie, c'est-à-dire qu'elle con somme sans
produire. C'est là son inconvénient principal.
Il n'existe plus dans la pile humide, parce que les liquides ne peuvent
s'y mêler que très difficilement. Nous ajouterons que c'est
la seule disposition connue qui permette de donner à la pile une
résistance intérieure quelconque, mais voulue.
Un des côtés très intéressants de l'esprit
inventif de M. Gustave Trouvé consiste dans la recherche de la
simplification appliquée aux appareils pour aider à leur
transport et à rendre leur maniement plus facile. C'est ainsi qu'il
a donné une forme peu encombrante au générateur d'électricité
destiné aux expé riences de laboratoire.
La batterie universelle automatique qu'il a créée, dans
ce but, et que les figures 28 et 29 présentent en fonction et au
repos, pèse à peine 3 kilogrammes. Elle est peu encombrante,
et malgré son poids relative ment faible, elle permet d'opérer
avec une grande sûreté et de mettre en jeu les appa reils
destinés à l'étude des ferments et à la micrographie.
M. Gustave Trouvé ne s'en est pas tenu là. Pour animer ses
bijoux, il lui fallait rendre l'électricité portative et
toute individuelle, en mettre la source même dans la poche de chaque
personne. Il y est parvenu par l'inven tion de sa pile à renversement,
à laquelle il a donné diverses formes réduites et
qu'on nomme, selon les cas, pile - étui ou pile de gousset (fig.38).
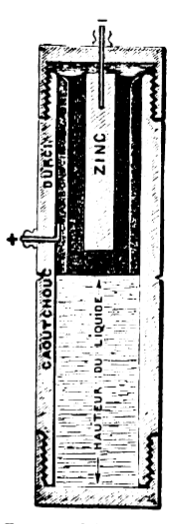 Fig.38.
Pile hermétique à renversement de M. Gustave Trouvé
Fig.38.
Pile hermétique à renversement de M. Gustave Trouvé
Cette pile est formée d'un couple zinc et charbon ou d'un couple
zinc et platine. Le charbon, dans le premier cas, le zinc dans le second, est fixé au couvercle de l'étui.
Le liquide, composé d'une solution saturée de sulfate acide
de mercure, remplit la moitié inférieure du fond. Tant que
l'étui conserve sa position ordinaire, le sommet entique à
ment, de M. Gustave haut, le fond en bas, l'élément ne
plonge pas Trouvé ( grandeur dans le liquide ; il n'y a ni dégagement
d'élec d'exécution ). tricité, ni usure du zinc,
ni dépense par consé quent. Mais dès que l'étui
est renversé, ou placé horizontalement, le courant nait
et se continue tant que le zinc n'est pas usé et que le sulfate
de mercure n'est pas épuisé.
C'est le courant fourni par un ou plusieurs éléments de
cette pile minuscule, cachés dans un gousset de gilet ou le pli
d'une robe, que M. Gustave Trouvé fait circuler tour à tour
dans une foule de petits appareils ou bijoux pour les animer et leur faire
causer d'agréables surprises. La pile de poche est un peu plus
forte que la pile de gousset.
Les piles 39 et 40 sont en tout semblables, elles ne diffèrent
que par le volume et le nombre des éléments.
La pile 39 est composée de deux couples et la pile 40 de trois
couples de charbon et zinc, ou d'un plus grand nombre, suivant les foyers
lumineux à obtenir, plongeant dans la solution sursaturée
au bichromate de potasse modifiée.
Comme nous venons de le dire, les deux piles ne different entre elles
que par le nombre de couples, et la description suivante s'applique aux
deux : une auge en ébonite à trois compartiments contient
la solution qui la remplit aux deux tiers.
Le couvercle B qui porte les éléments D, D, est en caoutchouc
durci ou ébonite. Il constitue, avec une feuille de caoutchouc
souple C, une fermeture étanche à la manière des
soupapes de sûreté des machines à vapeur, pressé
qu'il est sur les auges par les deux bracelets E, E ' en caoutchouc très
élastique.
Pour plus de sécurité, le tout est introduit dans une enveloppe
simple ou double F, G, en caoutchouc durci, mince et léger,
dans laquelle ou dans lesquelles se produi raient de légers suintements, si parfois la pile était soumise à unedanse trop désordonnée.
Comme on le voit, la sécurité est com plète, sous
ce rapport surtout.
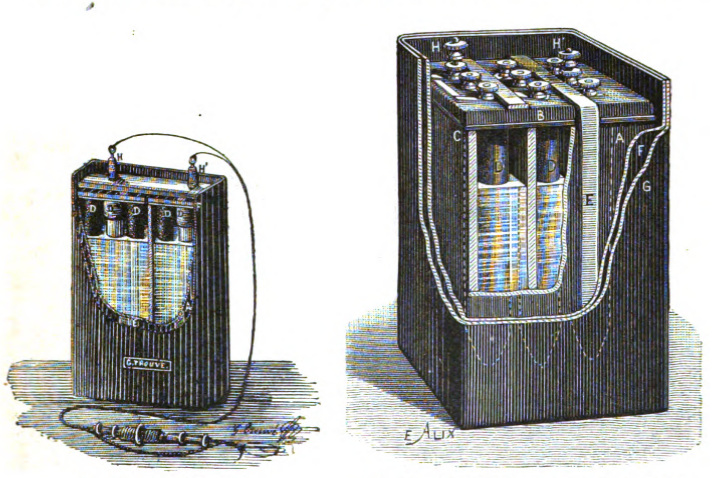
FIG. 39. — Pile de poche de M. Gustave Trouvé de deux éléments.
FIG. 40. Vue intérieure de la pile de poche de M. Gustave Trouvé
de trois éléments.
Les deux boutons H, H ' reçoivent les fils conducteurs qui se
rendent aux bijoux ou aux objets qu'il faut illuminer. Un petit commutateur
placé tantôt sur le couvercle de la pile, tantôt sur
le trajet des cordons, permet d'éclairer à volonté
les bijoux dont on est muni.
En A est représenté le corps d'ensemble de la pile constituant
les auges. La durée de l'éclairage varie naturellement suivant
le vo lume de la pile et proportionnellement à sa capacité, c'est- à dire de trente - cinq à quarante minutes pour
la pile de poche donnée de grandeur naturelle (fig.39), et de
une heure environ pour le modèle plus volumineux, et qui peut
se loger encore facilement dans la poche de derrière d'un paletot
ou dans celle d'un pardessus.
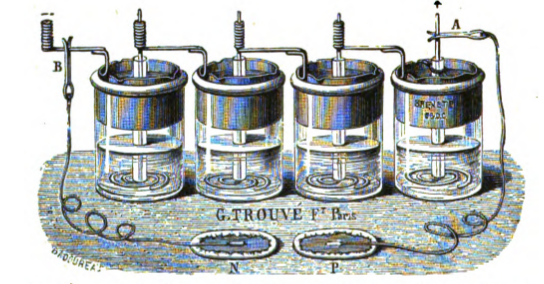
FIG 41 Pile au cuivre de Callaud, modifiée par M. Gustave Trouvé.
Lorsque les effets à obtenir sont de courte durée, comme
au théâtre, les piles de M. Gustave Trouvé peuvent
alimenter jusqu'à huit foyers. M. Gustave Trouvé en a mis
jusqu'à vingt- quatre sur la même personne, qui produisaient
des effets éblouissants.
On peut s'amuser plusieurs heures, en n'usant pas la pile d'un seul trait
; d'autant plus qu'il est facile de s'échapper un instant pour
renouveler le liquide de la pile, qui reprend alors toute son action.
Les petits accumulateurs de M. Gustave Trouvé permettent bien l'éclairement
de ses bijoux, mais ils ne présentent pas les mêmes avantages
que les piles ci- dessus, c'est-à - dire de pouvoir se rechanger
sur place. Quand l'énergie electrique emmagasinée est épuisée, c'est fini. A capacité égale, ils sont du reste plus
lourds. M. Gustave Trouvé a porté encore son esprit inventif
sur la pile de Callaud, dans un but humanitaire. La disposition qu'il
a imaginée pour les besoins de l'électrothérapie
lui a permis de constituer un appareil, le plus simple et le plus économique
qu'il soit possible d'imaginer. En voici la description. Au fond du vase
de verre plonge un fil de cuivre tourné en spirale plusieurs fois
et émergeant du liquide par son bout droit que l'on isole en le
faisant passer dans un tube également en verre (fig. 41 ). De cette
manière la spirale sert seule de lame positive.
Le zinc est circulaire et maintenu par des rabattements de métal
à la partie supérieure du vase, dans lequel il ne s'enfonce
que de quelques centimètres. Des cristaux de sulfate de cuivre
sont déposés dans le fond au préalable et l'on remplit
d'eau. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, le liquide à
la partie inférieure est saturé de sel de cuivre, tandis
que la partie supé rieure est saturée de sulfate de zinc.
Au point de vue théorique, la différence de densité
des deux solutions semble suffisante pour empêcher leur mélange.
Il n'en est cependant pas tout à fait ainsi dans la pratique,
et il faut éviter avec soin toute manæuvre pouvant amener
le mélange des deux solutions.
Par conséquent, ces éléments ne peuvent constituer
que des appareils absolument à demeure.
Ces petits inconvénients sont largement rachetés par la
constance du courant, la modicité du prix et la simplicité
de la construction.
Un système très rudimentaire et très solide de contacts
permet d'accoupler rapidement et économiquement les éléments.
Un fil de cuivre coudé deux fois à angle droit est soudé
au zinc et tourné en ressort à boudin par son extrémité
libre. On engage dans le ressort à frottement dur le bout du fil
de cuivre positif de la pile suivante et tous les éléments
peu vent être ainsi accouplés en tension. Réunis dans
une boite appropriée, ils forment une batterie très économique
utilisée en électricité médicale...
L’ÉLECTRICITÉ AU SERVICE DE LA MÉDECINE
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, les physiciens
qui étudiaient les phénomènes électriques
avaient eu l’idée d’appliquer leurs connaissances
à la médecine. Tout naturellement, Trouvé s’intéressa
lui aussi à ce domaine. Il fabriqua des appareils d’électrothérapie
de différentes tailles. L’un de ses modèles était
portatif, alimenté par une pile compacte, le tout rangé
dans une mallette. Par ailleurs, afin que les médecins puissent
utiliser le plus efficacement possible ses nombreuses inventions dans
le domaine médical,
Trouvé rédigea un Manuel d’électrologie médicale
publié en 1893.
Trouvé mit au point une électro-fraise à l’usage
des dentistes ainsi que plusieurs modèles de lampes frontales (fig.
16) en collaboration avec
le docteur Hélot.
Trouvé fabriqua également du matériel à l’usage
des chirurgiens comme une scie électrique. Par ailleurs, il remplaça
l’ivoire – facilement dégradée
par échauffement – par une résine dans les appareils
de cautérisation à anse de platine. Il construisit des polyscopes,
appareils permettant d’explorer les cavités du corps : un
filament de platine chauffé ou plus tard une ampoule de petite
taille était introduit dans la cavité et en éclairait
l’intérieur.
Afin de prévenir tout échauffement des tissus, le fil (puis
la lampe) était relié à un rhéostat qui permettait
de moduler la luminosité. Trouvé poursuivit ses travaux
dans ce domaine d’exploration médicale : en effet, avant que
la radiographie ne soit utilisée par les chirurgiens, Trouvé
fabriqua un explorateur-extracteur. Cet appareil permettait de localiser
un projectile métallique et de l’extraire. Une sonde constituée
de deux pointes isolées était reliée à un
trembleur. La sonde était infiltrée dans la plaie ; dès
qu’elle touchait un objet métallique, le circuit électrique
était fermé et le trembleur se déclenchait. Si elle
touchait un os, rien ne se produisait. Cet instrument fit partie des trousses
chirurgicales réglementaires des régiments et des équipages
de la Marine.
Trouvé poussa son intérêt de l’exploration physiologique
à la géologie.
S’inspirant du polyscope, il adjoignit une lunette et une lampe à
un périscope, ce qui permettait d’observer in situ les couches
géologiques traversées par un forage,
,..
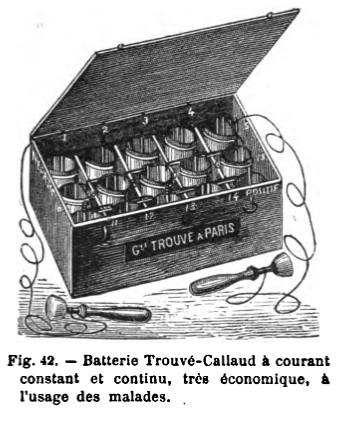
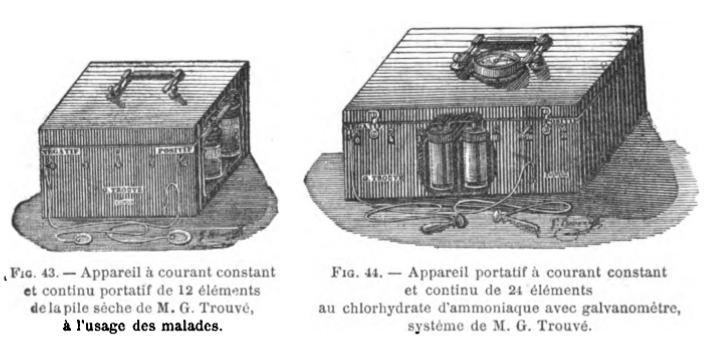
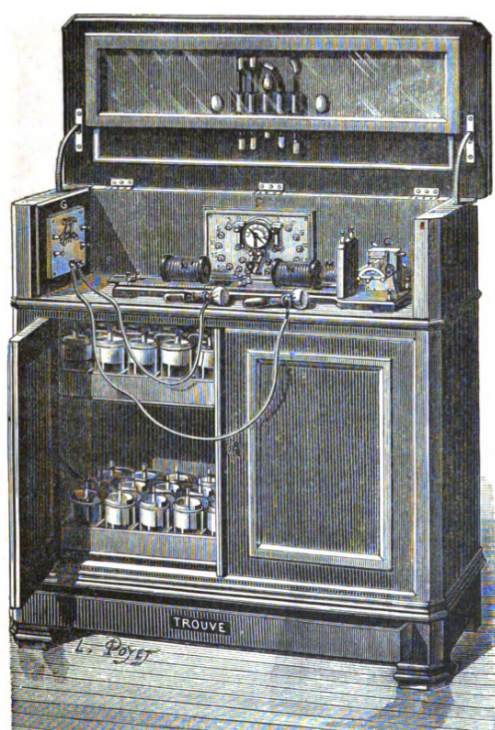
ET L’ÉLECTRICITÉ ILLUMINA LES SPECTACLES
Trouvé élargit son champ de créativité à
des applications artistiques. Il fabriqua des bijoux électriques
comme un oiseau qui battait des ailes quand on retournait la pile à
renversement miniature qui l’alimentait, ou encore un lapin qui tapait
sur une cloche. Il proposa des costumes de danseuses parés de pierreries
électriques. Pour animer une représentation de Faust, il
eut l’idée de faire jaillir des étincelles chaque fois
que les épées se croisaient et de faire s’illuminer
les armures dès qu’elles étaient touchées. On
utilisa ses inventions dans des spectacles à Paris, mais aussi
à Londres, Berlin ou Valparaiso.
Trouvé aimait le spectaculaire. Il fabriqua également des
fontaines lumineuses automatiques à feux multicolores changeants.
Après la réalisation de modèles de salon puis d’un
modèle monumental réalisé au château de Craygynos,
il proposa même de construire un modèle de 250 m de haut,
pouvant prendre appui sur la Tour Eiffel pour l’exposition de 1900.
Mais ce projet, trop ambitieux, ne fut pas retenu. Et ce furent des réalisations
plus modestes comme sa lampe électrique universelle de sûreté,
portative et automatique, qui eurent le plus de succès. Cette dernière
fut utilisée par les allumeurs de réverbères, par
la compagnie du gaz, par les pompiers de Paris et par ceux de New York.
C’est l’ancêtre de notre lampe de poche. Spécialiste
reconnu de l’éclairage, on fit régulièrement
appel à lui. Ainsi conçut-il un système d’éclairage
unique qui permit de photographier au mieux les bijoux de la couronne
française. En effet, l’État avait besoin de liquidités
et était contraint de vendre18 de ces bijoux en 1887. Il fabriqua
également un système d’éclairage sous-marin
utilisé lorsque le Canal de Suez fut percé (1859-1869).
En outre, Trouvé innova pour faciliter l’enseignement des
sciences expérimentales. Par exemple, il fabriqua une génératrice
de démonstration et un ensemble d’accessoires, le tout spécialement
adapté pour les expériences d’électricité.
Il conçut des appareils de projection adaptés aux corps
opaques.
Enfin, répondant à la demande de scientifiques, il proposa
des éclairages électriques de laboratoire pour observer
les corps en suspension et pour faire des dissections par transparence.
CHIMIE, MÉCANIQUE ET PROPRIÉTÉS DES GAZ
La chimie ne lui était pas non plus étrangère et
il perfectionna les systèmes d’éclairage à acétylène.
Mais ce fut Blériot qui tira profit de cette invention en fabriquant
et en commercialisant des lanternes pour automobiles et motocyclettes.
Tout l’intéressait et abandonnant momentanément l’électricité,
il s’adonna à la mécanique qu’il maîtrisait
grâce à sa formation d’horloger. Il mit notamment au
point un procédé de fabrication d’hélices. Auparavant
délicate et réservée à des personnes très
expérimentées, cette fabrication devint alors accessible
à une main-d’œuvre moins qualifiée.
Enfin une dernière preuve de son imagination débordante.
Après la catastrophe du ballon Le Zénith lors de laquelle
deux des trois passagers trouvèrent la mort à 7000 m d’altitude,
Trouvé imagina très précisément un scaphandre
à oxygène équipé de soupapes et de manomètres,
spécialement adapté à l’exploration aérienne.
Sa proposition ne fut pas testée et il fallut encore quelques décennies
pour qu’un système respiratoire soit réellement fabriqué
pour l’aviation.
Lors de ses recherches, Trouvé collabora avec des
confrères ou des médecins.
On peut citer le docteur Hélot pour la réalisation
de la lampe frontale – ou photophore –, Foucault pour
le gyroscope électrique, Caillaud pour un modèle d’alimentation
d’appareils d’électrothérapie, Dunand avec
qui il améliora le microphone, et les frères Tissandier
pour l’aérostat électrique.
Sa méthode de travail était empirique mais résolument
scientifique ; Trouvé ne fut certainement pas un inventeur-bricoleur.
En effet, face à un problème technique, il recherchait de
nouveaux procédés basés sur ses connaissances d’ingénieur
et étudiait précisément les caractéristiques
de ses instruments. Il sut justifier ses choix aussi bien par des mesures
que par des calculs.
Il s’attachait résolument au côté pratique de
ses inventions ou de ses améliorations : l’une de ses demandes
de brevets en fait d’ailleurs mention puisqu’il y est précisé
« un moteur et ses applications ».
Cet article ne peut éviter l’écueil de présenter
une longue énumération, cependant il est important de montrer
la diversité et la grande richesse de travaux de Gustave Trouvé.
Les inventions ne sont pas classées par ordre chronologique mais
selon leurs différents domaines.
Les phénomènes électriques avaient
été largement observés depuis le XVIIIe siècle,
et les études théoriques de l’électricité
étaient en cours d’élaboration. Trouvé put exploiter
pleinement sa créativité et son savoir-faire dans le domaine
des applications pratiques de l’électricité alors en
développement.
Les inventions de Trouvé ne furent pas toutes à destinée
pacifique. En effet, il lui arriva de concevoir un fusil dont la mise
à feu de la cartouche était provoquée par un fil
porté instantanément à incandescence lorsque la gâchette
fermait le circuit électrique.
Sans générateurs ni moteurs, l’électricité
n’aurait pas pu passer du statut de curiosité à celui
d’application pratique pour la vie courante. Trouvé s’intéressa
à la question en permettant des avancées dans le domaine
des moteurs à courant continu et des piles.
Trouvé conçut plusieurs types de moteurs, suivant ses besoins.
Par exemple, pour équiper une maquette de dirigeable, il fabriqua
un moteur miniature très léger avec des bobines en aluminium.
Les procédés de fabrication des aimants étant mieux
appréhendés, Trouvé eut l’occasion d’effectuer
des tests sur le choix des aciers, ou la technique de trempe.
Tout ceci lui permit en 1880,d’améliorer un moteur à
bobine Siemens dont le rendement était faible étant donné
l’annulation de la répulsion entre l’aimant et la bobine
pendant une partie de la rotation. Pour ce faire, il façonna les
faces polaires de la bobine en « limaçon ». En outre,
il remplaça les aimants par un électroaimant en fer à
cheval. Ainsi le rendement de ce moteur était-il nettement supérieur
au moteur Siemens initial.
Un moteur de ce type fait partie de la collection du lycée Sophie
Germain de Paris 4.
Il est d’ailleurs urgent de prendre conscience qu’il faut classer,
conserver, valoriser les collections des établissements scolaires
qui possèdent un patrimoine scientifique important.
Trouvé se spécialisa dans les petits moteurs sur-mesure
en ajoutant par exemple un moteur électrique au gyroscope de Foucault,
en réalisant un moteur pour un jouet monté sur un socle
en ivoire, ou encore en motorisant des machines à coudre. Ses travaux
ne se limitèrent pas à la mise au point de nouveaux modèles.
En effet, il étudia scientifiquement les rendements des moteurs,
construisant même plusieurs modèles de «dynamomètres
» pour en mesurer les caractéristiques.
En 1880, avec le moteur Siemens amélioré,
qu'il alimente avec un accumulateur récemment développé
par Starley il le monte sur un tricycle anglais de marque Coventry, inventant
ainsi le premier véhicule électrique au monde. Bien qu'il
l'ait été testé avec succès le 19 avril 1881
dans la rue de Valois dans le centre de Paris, Gustave Trouvé n'arrive
pas à le faire breveter. Il adapte donc rapidement son moteur à
accumulateurs à la propulsion maritime.
Pour faciliter le transport du système de propulsion maritime entre
son atelier et la Seine, Gustave Trouvé le rend portatif et amovible,
inventant ainsi le moteur de hors-bord.
Le 26 mai 1881, le prototype de 5 m de long construit par Trouvé
et baptisé « Le Téléphone »
atteint une vitesse de 1 m/s (3,6 km/h) vers l'amont et 2,5 m/s (9 km/h)
vers l'aval.
Gustave Trouvé expose son bateau (mais pas son tricycle) et ses
instruments électro-médicaux à l'Exposition internationale
d'Électricité de Paris et reçoit peu de temps après
la Légion d'honneur.
Trouvé s’intéressa également
à la production d’électricité. Il perfectionna
régulièrement les modèles de piles en fonction des
appareils à alimenter. Ainsi proposait-il un large éventail
de générateurs opérationnels. Il modifia la pile
au bichromate inventée par Johann Christian Poggendorff en 1842,
en créant un modèle dit « pile à treuil ».
L’intensité délivrée par ce générateur
était modulée en plongeant plus ou moins les électrodes
de zinc dans l’électrolyte. Les études que mena Trouvé
sur les performances de ces piles, montrèrent qu’elles pouvaient
délivrer jusqu’à 8 A pendant quatre heures.
Quant à la pile compacte, comme son nom l’indique, elle fournissait
un maximum d’énergie pour une compacité maximale ;
elle servit à alimenter les appareils d’électrothérapie
que Trouvé commercialisait.
La pile à renversement ne fonctionnait que lorsqu’on la retournait.
La solution de sulfate de mercure située ici dans le bas du récipient,
entrait alors au contact des électrodes de carbone et de zinc.
Elle était utilisée pour alimenter les détecteurs
de métaux en médecine ou pour alimenter des bijoux lumineux.
Le dernier exemple présenté est celui de la pile humide
basée sur le principe de la pile Daniell. Pour éviter les
fuites fréquentes de la pile liquide, Trouvé intercala des
disques de papier buvard imbibés d’électrolyte entre
deux disques de cuivre et de zinc. Il exposa son modèle lors de
l’Exposition universelle de 1878, ce qui attira l’attention
du jury de l’Exposition.
Dix ans plus tard, Carl Gassner poursuivit dans cette voie et gélifia
l’électrolyte grâce à de l’agaragar ; la
première pile sèche était née.
Trouvé ne se limita pas aux moteurs ni aux piles. Il fabriqua bien
d’autres appareils électriques comme des appareils de mesure
– notamment des galvanomètres – et des compteurs.
En 1887, Trouvé, qui fabrique sous sa propre marque Eureka
(en grec = j'ai trouvé), met au point son auxanoscope, un projecteur
électrique de diapositives destiné à être utilisé
par des enseignants itinérants (1887).
Les nouveaux moyens de transport inventés par Trouvé
suscitèrent beaucoup de critiques positives en son temps.
La collaboration Trouvé-frères Tissandier, célèbres
aérostiers, se révéla fructueuse. En effet, ils construisirent
une maquette de dirigeable dont l’enveloppe, longue de 3,50 m, était
gonflée au dihydrogène. Cette maquette était propulsée
par un moteur miniature de 220 g alimenté par un accumulateur Planté
de 1,3 kg. L’hélice tournait à la vitesse de 6,5 tours
à la seconde et pouvait propulser le dirigeable à la vitesse
de 7 km/h. Son autonomie atteignait 40 minutes. Cette maquette fut présentée
lors de l’Exposition internationale d’électricité
de 1881.
Deux autres modèles méritent notre attention : tout d’abord,
l’Aviateur, une maquette à ailes battantes actionnée
par un dispositif à air comprimé construite en 1870 ; puis
un autre modèle lui aussi à ailes battantes propulsée
par une série de cartouches construit 21 ans plus tard.
Trouvé était proche de Gustave Ponton d’Amécourt
qui réalisa en 1863 la première maquette d’hélicoptère
à vapeur. Trouvé montra qu’un moteur relié par
des fils à une pile restée au sol, pouvait entrainer une
hélice, et s’élever. Le concept d’hélicoptère
électrique était né.
Après l’échec du canot électrique de Jacobi1
sur la Néva en 1838, Trouvé étudia le problème
dans son ensemble. Il conçut une embarcation complète, pour
laquelle il mit au point un moteur, une pile et un système de gouvernail.
Par ailleurs, il remplaça la roue à aubes de Jacobi par
une hélice beaucoup plus performante. Il utilisa deux piles à
treuil contenant 1,2 kg de bichromate de potassium et 8 L d’acide
sulfurique, pour une masse totale de 24 kg. Ces piles permettaient de
modifier la vitesse du canot.
Le compte-rendu de visite de La Société des Ingénieurs
Civils précisait : « Le canot peut contenir 3 voyageurs dont
on peut estimer le poids à 240 kg. Soit un poids total de 350 kg.
Dans ces conditions, les expériences faites sur la Seine les 26,
27 et 28 mai en présence d’un grand nombre de notabilités
scientifiques, ont montré que la vitesse a été de
1 m 50 par seconde à la remonte et de 2 m 50 à la descente.
La disposition générale du bateau est la suivante : les
piles sont au milieu, le moteur à l’arrière sur le
gouvernail lui même ; il est relié à l’hélice
par une chaîne de Vaucanson. » Le moteur de type Siemens modifié
était fixé sur le gouvernail. Le bateau hors-bord était
inventé.
Afin de mettre en valeur cette invention si originale, le canot électrique
de Trouvé fut présenté dans un bassin de 18 m de
diamètre entourant la maquette du phare électrique, juste
à l’entrée de l’Exposition internationale d’électricité
de 1881.
Toujours en 1881, son tricycle électrique étonna. En fait,
Trouvé motorisa un tricycle anglais dissymétrique de marque
Coventry, probablement le modèle Rotary. Les essais concluants
furent rapportés dans le Journal universel d’électricité
publié en 1881 : « Un moteur de 5 kg alimenté par
6 piles secondaires de Planté, placé le 8 avril dernier
sur un tricycle dont le poids y compris le cavalier et “ les piles
” était de 160 kg, l’entraîna à une vitesse
de 12 km/h ».
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle,
les physiciens qui étudiaient les phénomènes électriques
avaient eu l’idée d’appliquer leurs connaissances à
la médecine. Tout naturellement, Trouvé s’intéressa
lui aussi à ce domaine.
Il fabriqua des appareils d’électrothérapie de différentes
tailles. L’un de ses modèles était portatif, alimenté
par une pile compacte, le tout rangé
dans une mallette. Par ailleurs, afin que les médecins puissent
utiliser le plus efficacement possible ses nombreuses inventions dans
le domaine médical, Trouvé rédigea un Manuel d’électrologie
médicale publié en 1893.
Trouvé mit au point une électro-fraise à l’usage
des dentistes ainsi que plusieurs modèles de lampes frontales en
collaboration avec le docteur Hélot.
Trouvé fabriqua également du matériel à l’usage
des chirurgiens comme une scie électrique. Par ailleurs, il remplaça
l’ivoire – facilement dégradée
par échauffement – par une résine dans les appareils
de cautérisation à anse de platine.
Il construisit des polyscopes, appareils permettant d’explorer les
cavités du corps : un filament de platine chauffé ou plus
tard une ampoule de petite taille était introduit dans la cavité
et en éclairait l’intérieur.
Afin de prévenir tout échauffement des tissus, le fil (puis
la lampe) était relié à un rhéostat qui permettait
de moduler la luminosité. Trouvé poursuivit ses travaux
dans ce domaine d’exploration médicale : en effet, avant que
la radiographie ne soit utilisée par les chirurgiens,
Trouvé fabriqua un explorateur extracteur. Cet appareil permettait
de localiser un projectile métallique et de l’extraire. Une
sonde constituée de deux pointes isolées était reliée
à un trembleur. La sonde était infiltrée dans la
plaie ; dès qu’elle touchait un objet métallique, le
circuit électrique était fermé et le trembleur se
déclenchait. Si elle touchait un os, rien ne se produisait. Cet
instrument fit partie des trousses chirurgicales réglementaires
des régiments et des équipages de la Marine.
Trouvé poussa son intérêt de l’exploration physiologique
à la géologie.
S’inspirant du polyscope, il adjoignit une lunette et une lampe à
un périscope, ce qui permettait d’observer in situ les couches
géologiques traversées par un forage.
Trouvé élargit son champ de créativité à
des applications artistiques.
Il fabriqua des bijoux électriques comme un oiseau qui battait
des ailes quand on retournait la pile à renversement miniature
qui l’alimentait, ou encore un lapin qui tapait sur une cloche. Il
proposa des costumes de danseuses parés de pierreries électriques.
Pour animer une représentation de Faust, il eut l’idée
de faire jaillir des étincelles chaque fois que les épées
se croisaient et de faire s’illuminer les armures dès qu’elles
étaient touchées. On utilisa ses inventions dans des spectacles
à Paris, mais aussi à Londres, Berlin ou Valparaiso.
Trouvé aimait le spectaculaire. Il fabriqua également des
fontaines lumineuses automatiques à feux multicolores changeants.
Après la réalisation de modèles de salon puis d’un
modèle monumental réalisé au château de Craygynos,
il proposa même de construire un modèle de 250 m de haut,
pouvant prendre appui sur la Tour Eiffel pour l’exposition de 1900.
Mais ce projet, trop ambitieux, ne fut pas retenu. Et ce furent des réalisations
plus modestes comme sa lampe électrique universelle de sûreté,
portative et automatique, qui eurent le plus de succès. Cette dernière
fut utilisée par les allumeurs de réverbères,par
la compagnie du gaz, par les pompiers de Paris et par ceux de New York.
C’est l’ancêtre de notre lampe de poche. Spécialiste
reconnu del’éclairage, on fit régulièrement
appel à lui. Ainsi conçut-il un système d’éclairage
unique qui permit de photographier au mieux les bijoux de la couronne
française. En effet, l’État avait besoin de liquidités
et était contraint de vendre ces bijoux en 1887. Il fabriqua également
un système d’éclairage sous-marin utilisé lorsque
le Canal de Suez fut percé (1859-1869).
En outre, Trouvé innova pour faciliter l’enseignement des
sciences expérimentales. Par exemple, il fabriqua une génératrice
de démonstration et un ensemble d’accessoires, le tout spécialement
adapté pour les expériences d’électricité.
Il conçut des appareils de projection adaptés aux corps
opaques.
Enfin, répondant à la demande de scientifiques, il proposa
des éclairages électriques de laboratoire pour observer
les corps en suspension et pour faire des dissections par transparence.
La chimie ne lui était pas non plus étrangère
et il perfectionna les systèmes d’éclairage à
acétylène. Mais ce fut Blériot qui tira profit de
cette invention en fabriquant et en commercialisant des lanternes pour
automobiles et motocyclettes.
Tout l’intéressait et abandonnant momentanément l’électricité,
il s’adonna à la mécanique qu’il maîtrisait
grâce à sa formation d’horloger. Il mit notamment au
point un procédé de fabrication d’hélices. Auparavant
délicate et réservée à des personnes très
expérimentées, cette fabrication
devint alors accessible à une main-d’œuvre moins qualifiée.
Enfin une dernière preuve de son imagination débordante.
Après la catastrophe du ballon Le Zénith lors de laquelle
deux des trois passagers trouvèrent la mort à 7000 m d’altitude,
Trouvé imagina très précisément un scaphandre
à oxygène équipé de soupapes et de manomètres,
spécialement adapté à l’exploration aérienne.
Sa proposition ne fut pas testée et il fallut encore quelques décennies
pour qu’un système respiratoire soit réellement fabriqué
pour l’aviation.
En 1902, Gustave Trouvé travaille sur sa dernière
innovation, un petit appareil portable qui utilise la lumière ultra-violette
pour traiter les maladies de la peau, le prototype de la PUVA-thérapie,
lorsqu'il se coupe accidentellement le pouce et l'index. Négligeant
sa plaie, une septicémie se déclare qui nécessite
des amputations à l'hôpital Saint-Louis de Paris.
L'inventeur meurt le 27 juillet 1902 à l'hôpital Saint-Louis
dans le 10e arrondissement de Paris, âgé de 63 ans.
Un notaire est chargé de liquider son atelier et ses biens personnels.
Gustave Trouvé n'ayant pas d'héritier déclaré
ni personne capable d’entretenir, la carrière de cet inventeur
sombre totalement dans l’oubli.
Lorsque la concession de sa tombe dans le cimetière de sa ville
natale de La Haye-Descartes arrive à échéance, les
restes de Gustave Trouvé sont jetés dans la fosse commune.
Trouvé jouissait d’une grande renommée
auprès de ses confrères ainsi que du grand public.
En effet, il avait reçu de nombreuses récompenses et distinctions
de la part de sociétés savantes. Les jurys d’exposition
(universelle, internationale d’électricité) ne manquèrent
jamais de mettre en avant ses découvertes. Par ailleurs, Trouvé
avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur
en 1881. Les applications de l’électricité qu’il
avait mises au point lui avaient valu la reconnaissance appuyée
de ses pairs.
De nombreux articles de journaux et de revues scientifiques décrivaient
ses inventions originales. Cette collaboration avec les journalistes lui
offrit d’ailleurs un moyen publicitaire favorable à la modeste
commercialisation de ses trouvailles.
Sa notoriété et son inventivité tout azimut expliquent
pourquoi Georges Barral le choisit comme inventeur-modèle pour
illustrer le nouvel esprit scientifique associé à l’Exposition
universelle de 1889. Georges Barral proposa Gustave Trouvé parce
que ce dernier savait fort bien appliquer recherches et théories
aux besoins du quotidien. Plus tard, L’Histoire de l’électricité
de 1881 à 1918 consacra trois de ses cent gravures aux inventions
de Trouvé ; y étaient représen tés la lampe
frontale, le moteur Siemens modifié et le canot électrique.
Cependant des critiques ne manquèrent pas. Par exemple, un article
du Journal universel d’électricité, publié juste
après la modification apportée au moteur Siemens, précisait
qu’« Il est regrettable de voir certaines personnes lancer
à chaque instant l’immortel eurêka d’Archimède
pour avoir changé une vis ou apporté une modification plus
ou moins excentrique aux inventions d un contemporain. »
En 2001, Georges Ribeill compara les inventions de Trouvé à
« un grand bazar électrique qui rassemblait beaucoup d’objets
fonctionnellement voués à des destins variables »
et il ajouta même que « le bazar électrique de Trouvé
tient du magasin magique d’accessoires et décors électriques,
une sorte de caverne d’Ali-Baba où, du futile au sérieux,
il a accumulé en somme les trouvailles dont il voulait saturer
notre civilisation ».
Laissons de côté les propos polémiques et revenons
sur les destins variables de ses inventions, car en cela M. Ribeill a
raison. Autant certaines de ses inventions (lampe de poche, projecteur
d’images) font partie de notre quotidien, autant d’autres n’ont
pas connu le succès escompté. On peut citer son tricycle
électrique, précurseur de la voiture électrique qui
aujourd’hui encore n’en est qu’au début de sa carrière
commerciale, le dirigeable électrique qui reste une curiosité
et les bateaux électriques qui, malgré leur développement,
ne représentent encore qu’une faible part du marché.
Les rayons X ont avantageusement remplacé l’explorateur-extracteur.
L’électrothérapie médicale reste limitée.
Ses travaux précurseurs de l’endoscopie ont été
spoliés et son nom volontairement oublié par ses successeurs.
Ainsi, comme bien des inventeurs, Trouvé plongea dans l’anonymat
et aujourd’hui peu de gens connaissent l’importance de ses découvertes.
Il faut être conscient que le cas de Trouvé est bien loin
d’être isolé. En effet, combien d’inventeurs géniaux,
renommés à leur époque ne sont pas passés
à la postérité ? Car, pour rester dans la mémoire
collective, il ne suffit pas d’être exceptionnellement doué,
il faut également faire la publicité de ses découvertes.
Le 19 Avril 1881, Gustave Trouvé fait circuler
à Paris, rue de Valois un tricycle doté de batteries et
d'un moteur électrique.