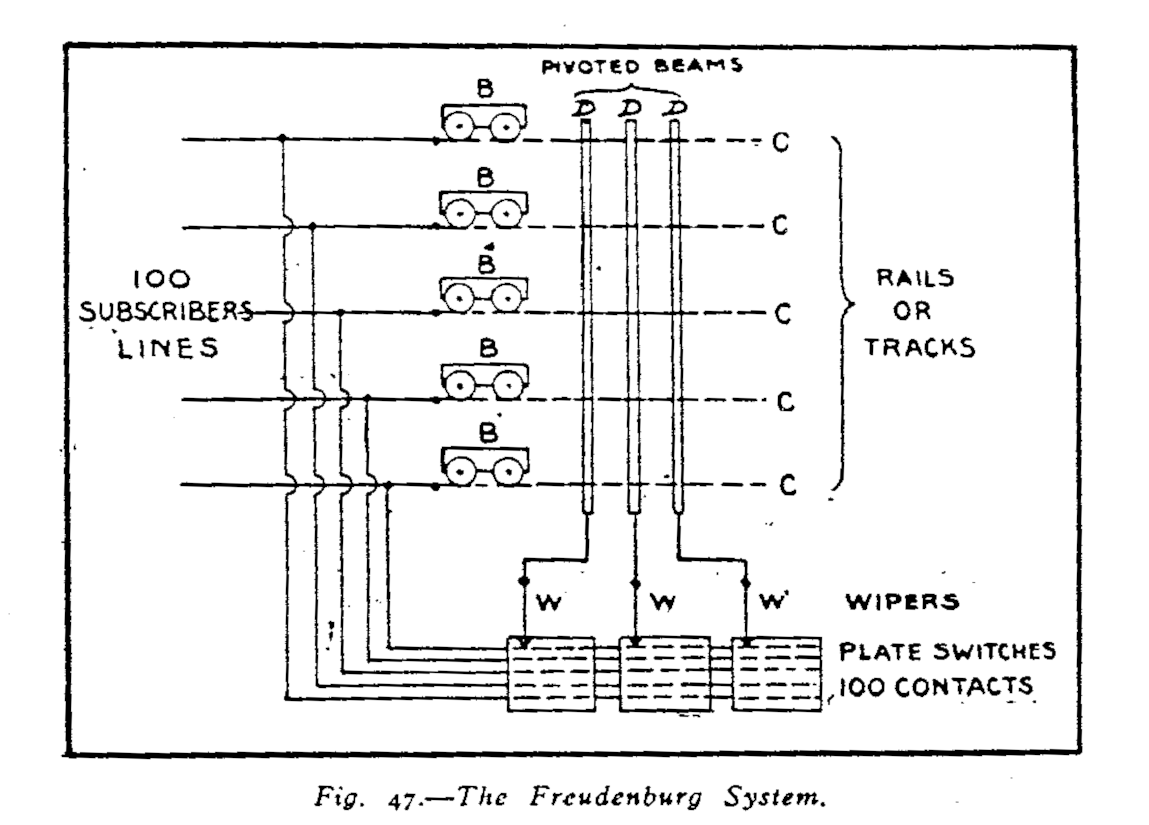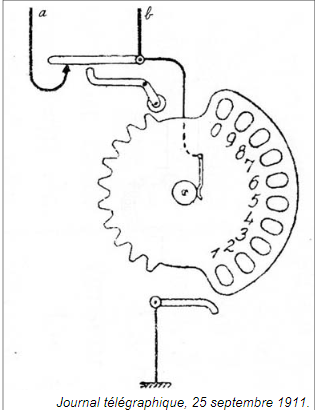1896-1905 Evolutions
du système Strowger
Sommaire des sujets abordés :
- Premier système
de lignes téléphoniques à circuits multiples
- La Compagnie des centraux téléphoniques
automatiques
- Le réseau d'Augusta
- Organisation de l'entreprise
- Le réseau à 1 000
lignes
- Le réseau de New Bedford
- Le réseau de Fall River
- Le réseau de Chicago
- Résumé des événements
jusqu'en 1902
- Le réseau de Dayton
- Le réseau de Grand Rapids
- Le réseau multi-bureaux
de Los Angeles
- Le réseau de Battle Creek
- Dispositions des salles de commutation
- Commutateur de ligne Keith
- Le bureau auxiliaire
- Lignes partagées
- South Bend et Common Battery
- Répéteurs de lignes
à circuits multiples.
1896 Nous sommes maintenant arrivés
à une étape très intéressante du développement
de la commutation automatique, car, à l'été 1896,
les ingénieurs de la société Strowger ont commencé
à travailler sur un principe entièrement nouveau, jamais
testé auparavant.
L'idée consistait à utiliser
des commutateurs primaires et secondaires, au lieu de tenter
de créer un commutateur de capacité suffisante pour desservir
toutes les lignes du central.
Après les idées présentées par J.
W. McDonough (Fig 44), c'est J.
G Smith en 1889 qui a fait le premier la proposition formulée
ainsi : « Supposons que chaque ensemble de contacts
(dans la rangée circulaire), au lieu de mener à l'appareil
du central téléphonique d'un abonné et, par ce
dernier, au circuit de l'abonné, mène à un autre
ensemble d'une capacité de 100 ensembles de contacts, et que
chacun de ces derniers ensembles mène à l'appareil du
central téléphonique d'un abonné et, par ce dernier,
au circuit de l'abonné. On constatera immédiatement que
la capacité du système est multipliée par 100.
Ainsi, avec de petits ensembles pouvant accueillir 100 ensembles de
contacts seulement, pas moins de 10 000 abonnés pourraient
être hébergés dans un seul central téléphonique. »
La figure 45 présente le schéma d'agencement de la
jonction proposée.
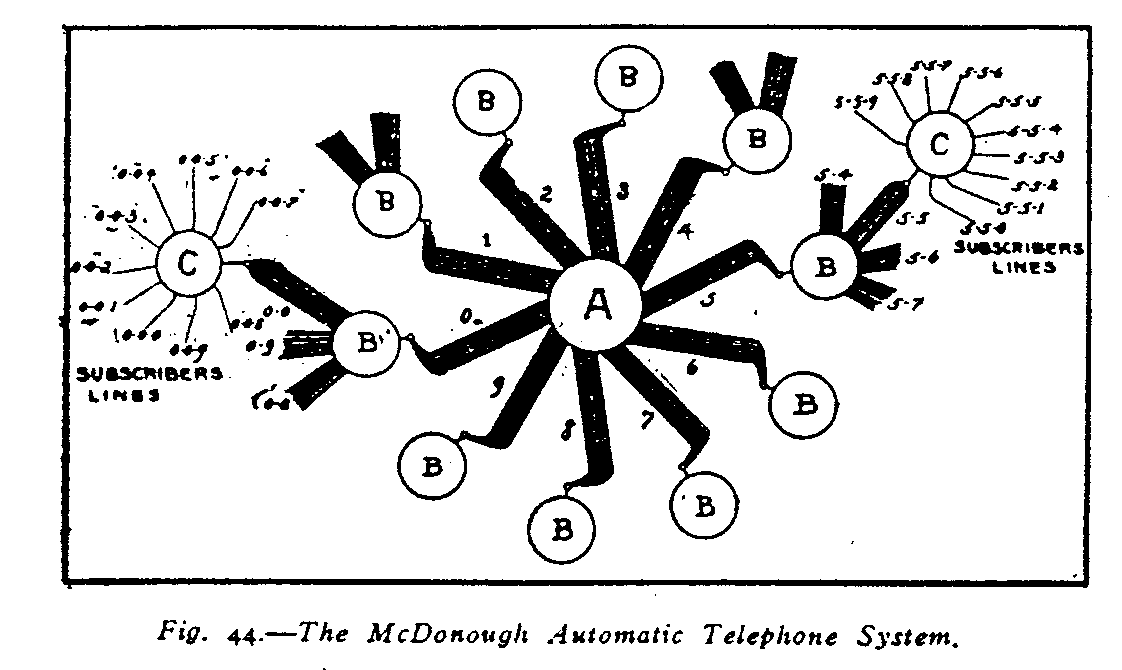
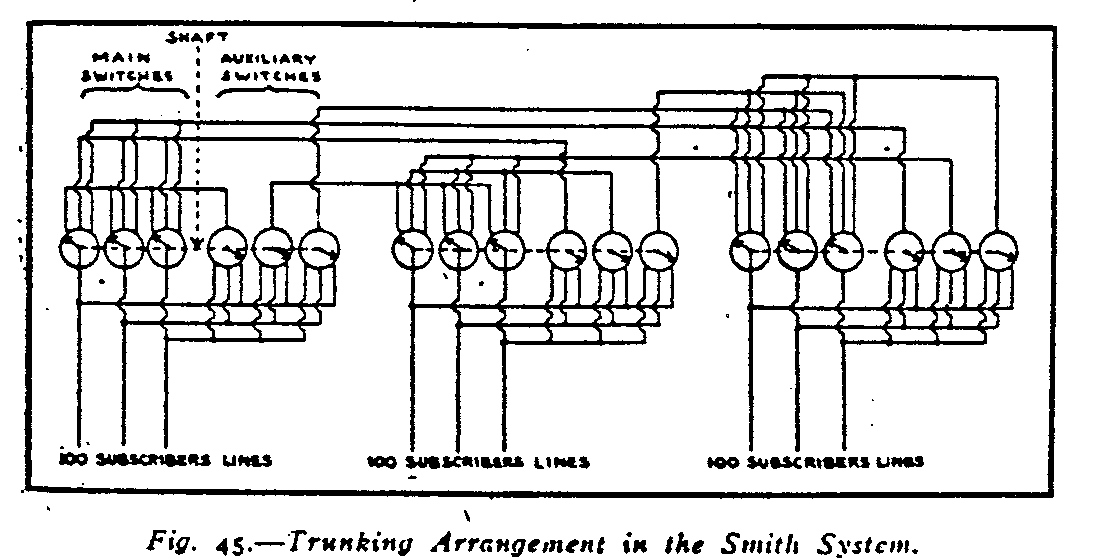
Seules trois lignes d'abonné et commutateurs principaux sont
représentés dans chaque groupe, où il est supposé
y en avoir 100. De plus, les trois groupes sont considérés
comme représentant 100 groupes. S'il y a 100 groupes de 100 lignes
chacun, cela nécessitera 100 commutateurs auxiliaires et 100
commutateurs principaux par groupe, soit un total de 20 000 commutateurs
dans un tableau de 10 000 lignes. De plus, il n'y a qu'une seule
ligne principale entre chaque groupe, de sorte qu'une seule personne
à la fois peut communiquer d'un groupe à un autre. On
appellerait cela 1 % de lignes principales. Il aurait pu obtenir
10 % de lignes principales dans un tableau de 1 000 lignes
en utilisant la sélection automatique d'une ligne non occupée,
comme le permettait son précédent système télégraphique
(brevet n° 81 247, déposé le 2 novembre 1889),
principe qu'il appliqua à cette époque à la sélection
des lignes à péage entre les villes.
Au lieu de confier entièrement les contacts des commutateurs
principaux à des commutateurs auxiliaires, J.
G Smith a proposé le plan illustré à la
figure 46 pour les petits centraux.
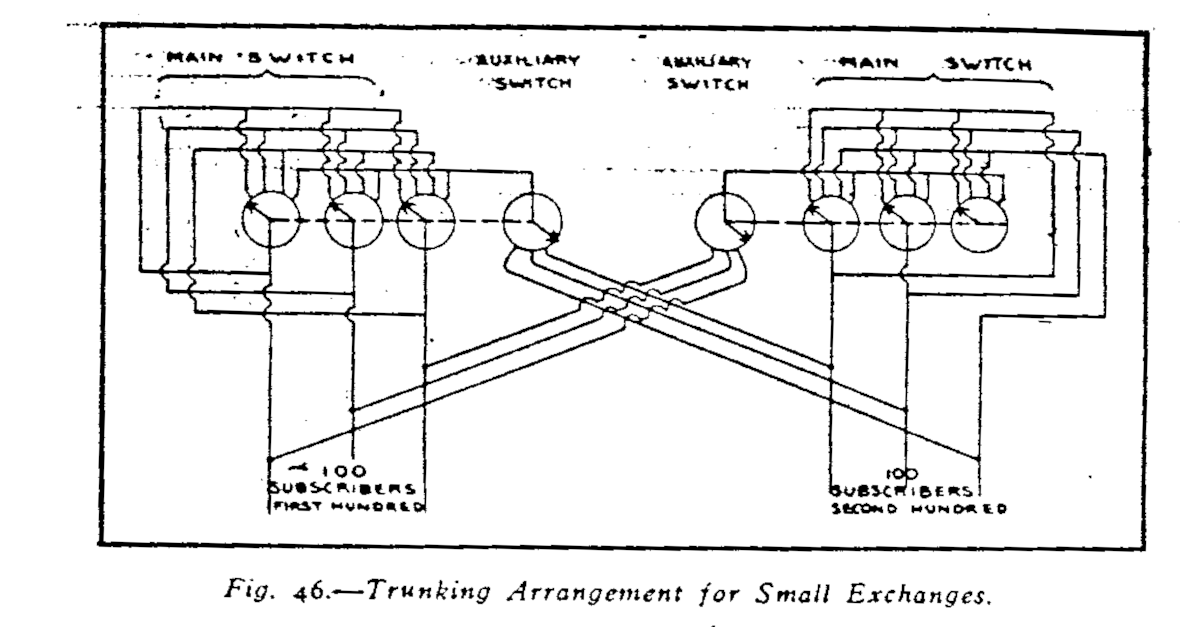
Selon ce plan, les commutateurs principaux contiendront les contacts
des lignes de leur propre groupe, ainsi qu'un jeu de contacts menant
à un commutateur auxiliaire reliant les cent autres. On obtient
ainsi 50 % de jonctions au sein du groupe, mais seulement 1 % entre
les groupes.
Le système Moîse Freudenberg,
dont le brevet a été déposé le 10 janvier
1896 (fig. 47, A), reposait sur ce système. Il devait y avoir
une plaque contenant autant de bornes que de lignes d'abonnés,
auxquelles elles étaient connectées. Sur cette plaque,
un curseur était adapté pour se déplacer par impulsions
séparées d'aimants dans différentes directions.
Comme prévu initialement, chaque abonné du système
Freudenberg devait disposer d'un de ces commutateurs à plaque.
Constatant le gaspillage d'appareils, il a adapté le schéma
de la figure pour permettre à chaque abonné d'utiliser
n'importe quel commutateur et de réduire le nombre de commutateurs
à celui nécessaire pour gérer le trafic.
Les inventeurs prétendaient pouvoir utiliser
des mouvements dans deux directions, ainsi que des mouvements radiaux
et rotatifs. Cette forme de plaque plate, avec les deux mouvements à
angle droit, rappelle beaucoup le système des frères Erickson,
mis au point en 1893, avant de rejoindre la société Strowger.
(Voir brevet n° 616,714.)
sommaire
Premier trunking système
Au cours de l'été 1896, A. E. Keith, John et
Charles J. Erickson ont commencé à travailler sur
une nouvelle approche : concevoir un tableau de 1000 lignes sans
commutateur de ligne.
Ils y sont parvenus grâce à un plan général
très similaire à celui de J. G
Smith, bien que la forme du commutateur utilisé soit
différente.
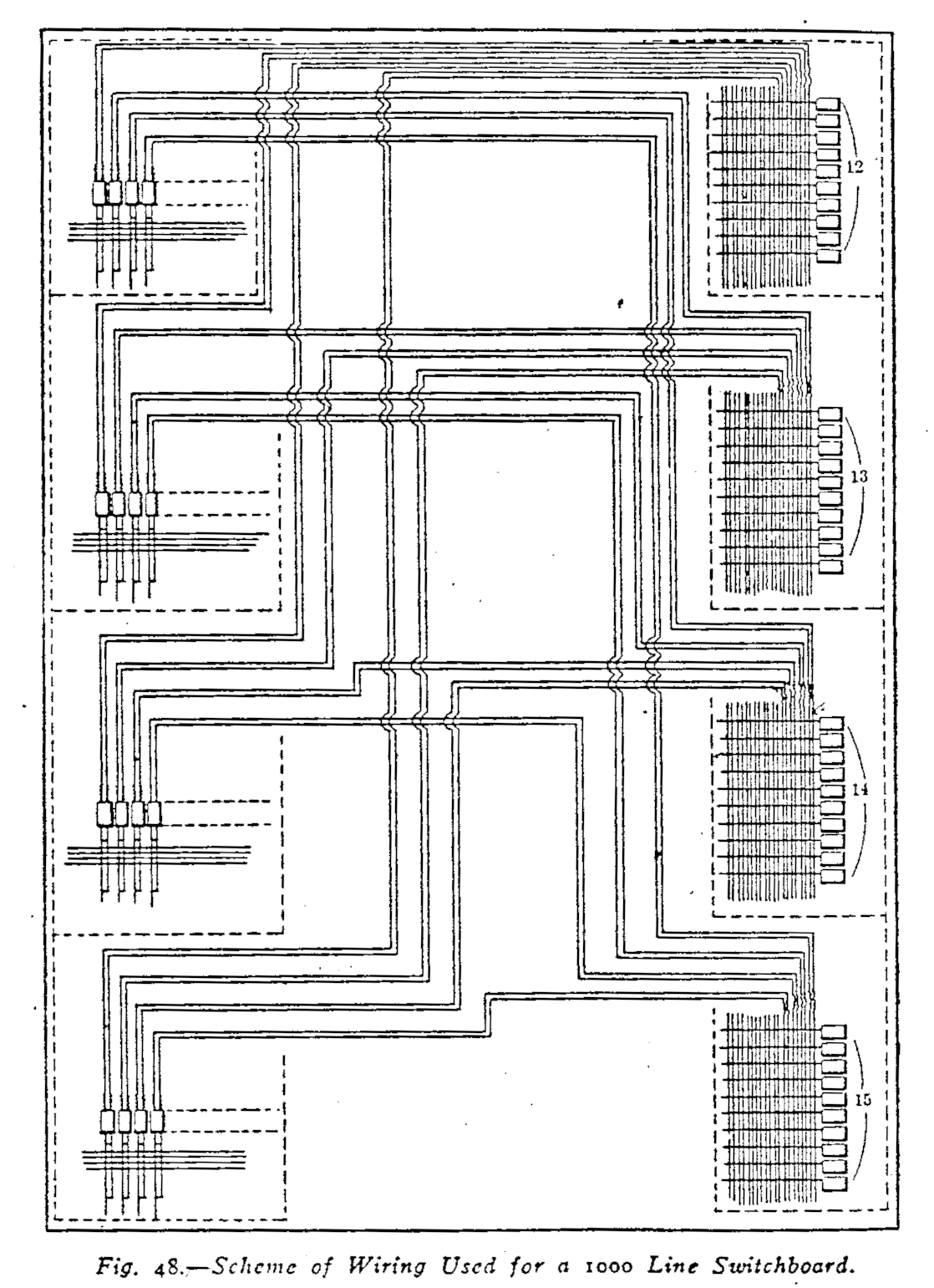 La figure 48 montre le schéma de câblage.
La figure 48 montre le schéma de câblage.
Les commutateurs illustrés à gauche sont du même
type de connecteur que ceux utilisés à Michigan City,
dans l'Indiana, et ailleurs, avec le système "the plaster
of paris bank"de Paris ou "plan de câblage" si
peut traduire ainsi.
À droite, numérotés 12, 13, 14 et 15, se trouvent
des groupes de « sélecteurs ». Ce sont
des commutateurs spéciaux, à 10 positions verticales,
mais avec un seul bouton rotatif. Il y en a un pour chaque abonné
et une seule ligne principale d'un groupe à l'autre. Ainsi, la
ligne de tout abonné aboutit au central téléphonique
à deux endroits : d'abord, dans l'un des sélecteurs
de droite, qui permet d'appeler n'importe quel groupe et ligne de ce
groupe, et ensuite, dans la rangée d'un des connecteurs de gauche,
par laquelle les appels provenant d'autres lignes peuvent lui parvenir.
Les sélecteurs sont regroupés par groupe de 10 et par
groupes de 30. Les connecteurs sont regroupés en 10 groupes de
100 commutateurs chacun. La figure 49 montre le sélecteur, vues
de face et de côté. La rangée, telle qu'illustrée,
est constituée de fils comme ceux d'une cithare ou d'un piano,
mais elle a été dessinée ainsi uniquement pour
des raisons de commodité. La rangée en plâtre devait
être utilisée. B' est l'aimant vertical, F' l'aimant rotatif.
PM est l'aimant privé. Les trois aimants sont reliés en
permanence à la batterie. 39L' et 35L' sont les racleurs de ligne,
tandis que L' est l'aimant privé. Les deux racleurs de ligne
sont reliés aux deux ressorts 29 et 30 qui forment l'interrupteur
latéral. Normalement, les racleurs ne sont pas reliés
aux lignes.
Bien que la figure 49 illustre la conception générale
du sélecteur, le schéma simplifié de la figure
49 facilite l'explication de son fonctionnement. Certains mouvements
mécaniques doivent également être expliqués,
car ils ne sont pas clairement représentés sur le dessin
du Bureau d'études, figure 49.
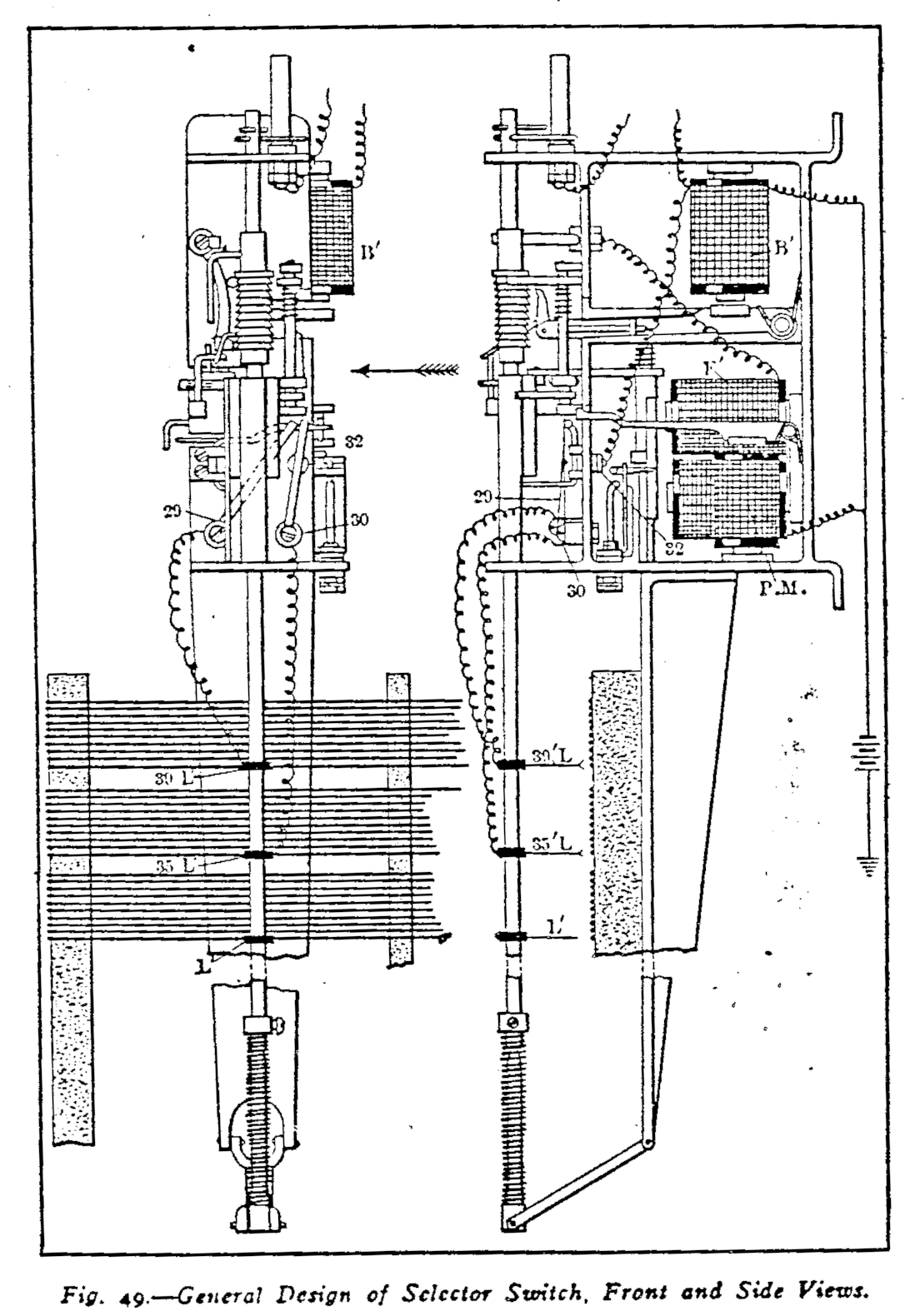
L'aimant vertical B', en plus de soulever l'arbre du racleur, actionne
un contact 100 qui relie l'aimant rotatif au châssis.
Un crochet en saillie vers le bas, situé sur le levier, maintient
les crans éloignés des cylindres à cliquet. Les
crans sont libérés dès le premier mouvement ascendant
de l'aimant. L'aimant rotatif, en plus de faire tourner l'arbre, actionne
un interrupteur 101 qui maintient normalement l'aimant privé
L' au sol, mais peut le commuter sur l'aimant privé PM. L'interrupteur
latéral, 29 et JO, est sous tension, ce qui tend à fermer
les contacts 31 et J2, qui conduisent aux lignes. Les ressorts 29 et
30 sont reliés mécaniquement à l'arbre et à
l'aimant rotatif par des moyens dont la représentation claire
ne peut être obtenue qu'en exagérant les dimensions de
certaines parties. 104 est un nombre isolant relié au levier
105. Les quatre leviers 105, 100, 107 et 108 sont représentés
ici comme d'un seul tenant, pivotant au centre. En réalité,
un levier beaucoup plus simple assure cette fonction. Sous l'effet de
la tension transmise par les ressorts 29 et 30, 106 se déplacerait
vers la droite sans l'ergot 109 sur l'arbre. Lorsque l'aimant rotatif
remonte, un doigt G' empêche 107 de bouger et permet à
105 de fermer l'interrupteur latéral.
Si l'aimant privé est tiré vers le haut, son levier I0
empêche le mouvement de 108 et empêche également
le fonctionnement de l'interrupteur latéral.
La partie supérieure de l'arbre est équipée d'un
fil coudé III conçu pour entrer en contact avec le ressort
II2 lors du premier mouvement ascendant et pour rompre ce contact lors
du premier mouvement rotatif. Sa fonction est de connecter l'aimant
rotatif F' à la ligne au moment opportun.
Le fonctionnement est le suivant : les chiffres des centaines arrivent
sur la ligne verticale, actionnant l'aimant vertical qui fait monter
l'arbre et libère les crans lors du premier mouvement. Le mouvement
ascendant de l'arbre amène le fil coudé III en contact
avec le ressort II2. Les chiffres des dizaines sont ensuite tirés,
passant par-dessus la ligne rotative et actionnant l'aimant rotatif.
À la première impulsion, l'aimant rotatif tire l'arbre
d'un cran, écartant la patte 109 du levier I06. Mais le levier
G de l'aimant rotatif empêche le commutateur latéral de
fonctionner tant que l'arbre n'a pas suffisamment tourné pour
rompre le contact. L'aimant rotatif retombe alors et permet au commutateur
latéral de connecter les curseurs aux lignes. Tout cela se produit
entre les impulsions, de sorte que seule la première impulsion
rotative est perdue, toutes les autres étant transmises à
l'aimant vertical du connecteur, ce qui l'amplifie. Les impulsions des
unités arrivent par le fil vertical, mais, en raison de la transposition
des fils en X, elles parviennent à l'aimant rotatif du connecteur.
Il est à noter que le premier chiffre des dizaines est utilisé
pour la commutation via le sélecteur, c'est-à-dire pour
la rotation en un seul pas. Ainsi, une dizaine serait perdue pour chaque
centaine, et si un abonné appelait le 354, il déplacerait
en réalité les curseurs du connecteur de la troisième
centaine vers le haut et autour de 44.
Les contacts privés de la banque P sont multipliés par
le groupe de sélecteurs auquel une ligne est également
multipliée. Lorsqu'une ligne est occupée, le contact privé
correspondant est mis à la masse par le curseur privé
de l'interrupteur qui utilise la ligne. Si un autre sélecteur
tente d'accéder à la même ligne, voici ce qui se
produit : lorsque l'impulsion rotative arrive sur la ligne, elle
soulève l'aimant rotatif et fait tourner les curseurs en contact
avec la banque. Mais dès que le curseur privé L' heurte
le contact de masse, le levier 103 étant fermé, l'aimant
privé PM se soulève et s'accroche à l'extrémité
du levier 108. Lorsque l'aimant rotatif se relâche, 105 peut reculer
légèrement, mais pas suffisamment pour actionner l'interrupteur
latéral, laissant la ligne intacte. Les autres impulsions ne
feraient aucun mal. Pour sortir de cette situation, l'abonné
raccrochait simplement, comme d'habitude. Ceci mettait à la terre
le relais vertical, puis le relais rotatif, puis libérait le
relais vertical, puis le relais rotatif. Une fois le relais vertical
mis à la terre, le contact 100 reliant l'aimant du relais rotatif
à la ligne était fermé. La mise à la terre
du relais rotatif tirait l'aimant du relais rotatif vers le haut, libérant
ainsi les crans, poussant un levier sous un crochet situé sur
le levier du relais vertical. Lorsque le relais vertical était
relâché, ce crochet descendait par-dessus le levier des
crans, les verrouillant ainsi hors des dents du cliquet. Le relâchement
du relais rotatif laissait l'arbre tourner et revenait à la normale.
La ligne normale, par laquelle les appels entrants vers tout abonné
sont reçus, passe par l'interrupteur d'arrêt K" situé
en haut de l'arbre. Si la ligne appelée est occupée après
un appel, cet interrupteur s'ouvrira et l'abonné appelant remarquera
que sa sonnerie sonne ouverte, comme c'était le cas pour les
appels effectués par des magnétos en série et des
générateurs manuels.
La Société
du Central Téléphonique Automatique
À l'automne 1897, Almon B. Strowger, le fondateur du système,
quitta le Central Téléphonique Automatique Strowger et
se rendit en Floride pour se refaire une santé, qui déclinait
depuis un certain temps.
Le 28 janvier 1897, la Société du
Central Téléphonique Automatique, Ltd., de Washington,
D.C., fut créée pour exploiter le secteur du téléphone
automatique. Auparavant, elle portait le nom de « Drawbaugh
Telephone & Electric Appliance Company, Ltd., de Baltimore,
Maryland et Londres, Angleterre ». Le colonel T. W. Tyrer,
de Washington, D.C., en était le surintendant général
et l'âme dirigeante. Il avait pour associés John Bauernschmidt,
vice-président, et Joshua Horner, tous deux de Baltimore. Cette
société avait pour objectif de vendre les appareils fabriqués
par la société Strowger et, à cette fin, elle a
conclu des accords avec cette dernière à la date susmentionnée.
L'Automatic Telephone Exchange Company
devait agir en tant qu'agent aux États-Unis pour le central téléphonique
automatique Strowger. Elle devait verser une redevance de 3 $ par an
« pour chaque commutateur et équipement, tant que
ce commutateur et ce dispositif auxiliaire seraient en service »,
et installer 3 000 commutateurs la première année,
puis 2 000 supplémentaires chaque année pendant 10
ans. Les redevances différées devaient être de 6 %.
Le système
d'Augusta
En février 1897, la société Strowger commença
l'installation du dernier standard décrit à Augusta, en
Géorgie. À notre connaissance, il s'agissait du premier
tableau de distribution à être mis en service public, bien
qu'il ne disposât pas de la fonction de sélection automatique
de ligne principale, car il n'y avait qu'une seule ligne principale
par groupe.
L'utilisation de commutateurs primaires et secondaires doit être
soigneusement distinguée de la sélection automatique d'une
ligne principale non occupée. Les deux ne sont pas nécessairement
identiques, bien que, lorsque la sélection automatique de ligne
principale est utilisée, il faille utiliser deux ou plusieurs
jeux de commutateurs. Or, comme on le verra facilement, le principe
des commutateurs primaires et secondaires est peu pratique si l'on se
limite à une seule ligne principale par groupe.
L'usine d'Augusta fut achevée en mars 1897 et présentait
de nombreux points intéressants, outre la disposition des commutateurs.
Il n'y avait pas de cordons de curseur sur les sélecteurs ni
sur les commutateurs primaires. La rotation des curseurs vers la banque
est illustrée à la figure 51.
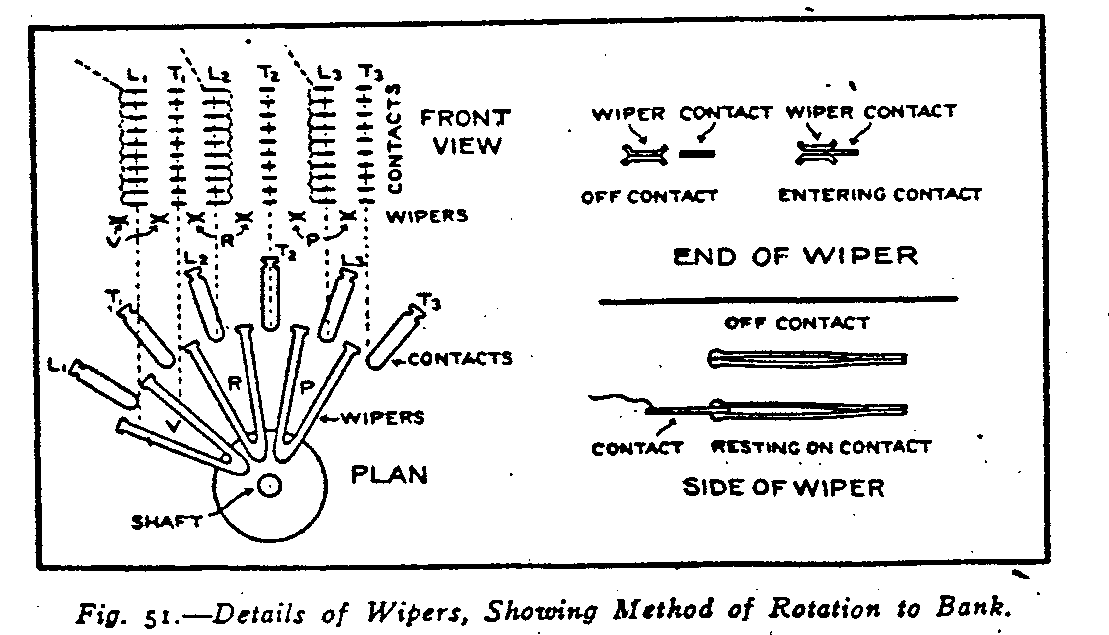
Les contacts de la batterie étaient disposés en trois
groupes, chaque groupe étant composé de deux rangées
verticales de contacts. Tous les contacts de la rangée de gauche
(L) étaient reliés entre eux et connectés à
la ligne verticale du commutateur auquel la batterie appartient. Le
contact de droite (T) de chaque batterie était relié à
la ligne verticale menant à un connecteur d'un groupe de commutateurs
donné. Les rangées verticales du milieu (L et T) étaient
également réservées à la ligne rotative
et aux lignes principales, et les rangées de droite (L et T)
aux lignes privées. Les curseurs étaient en forme de U
et, en position normale, reposaient à l'emplacement indiqué
sur la vue de face. Si l'arbre était soulevé et tourné
d'un cran, tous les curseurs occupaient la rangée de contacts
la plus basse. Dans cette position, le curseur vertical V connectait
les deux contacts inférieurs des rangées L et T, projetant
ainsi la ligne verticale de l'abonné en connexion avec le tronc
vertical du premier groupe de commutateurs. Le curseur rotatif R connectait
également la ligne rotative au tronc rotatif en connectant les
deux contacts inférieurs des rangées L et T, tandis que
le curseur privé P faisait de même pour la ligne privée.
Les curseurs étaient constitués de deux ressorts, comme
le montre la partie détaillée de la figure 51, qui présente
des vues de face et de côté avec le curseur en contact
et hors contact. Lors du déplacement vertical pour atteindre
le niveau souhaité, les extrémités des curseurs
se trouvaient entre les rangées verticales, sans les toucher,
comme le montre le plan.
Le cadran utilisé était très similaire à
celui inventé et développé au printemps et à
l'été 1886, et couvert par le brevet US
597 062.

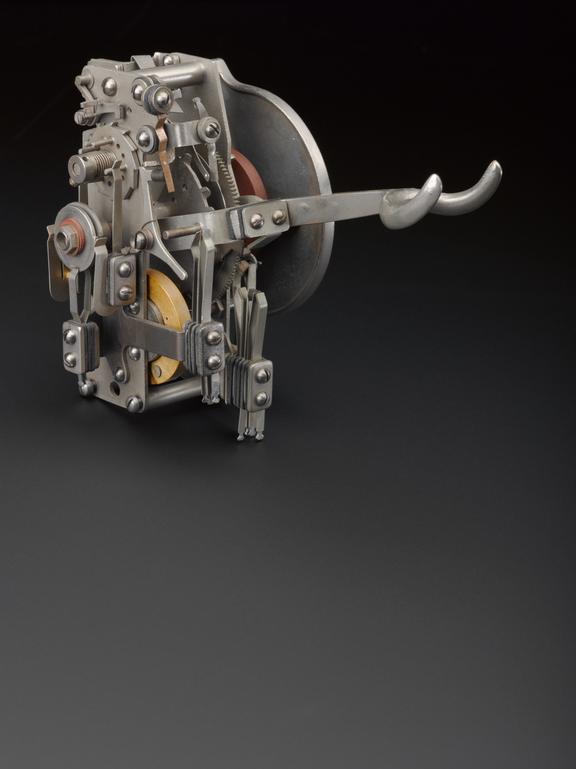 |
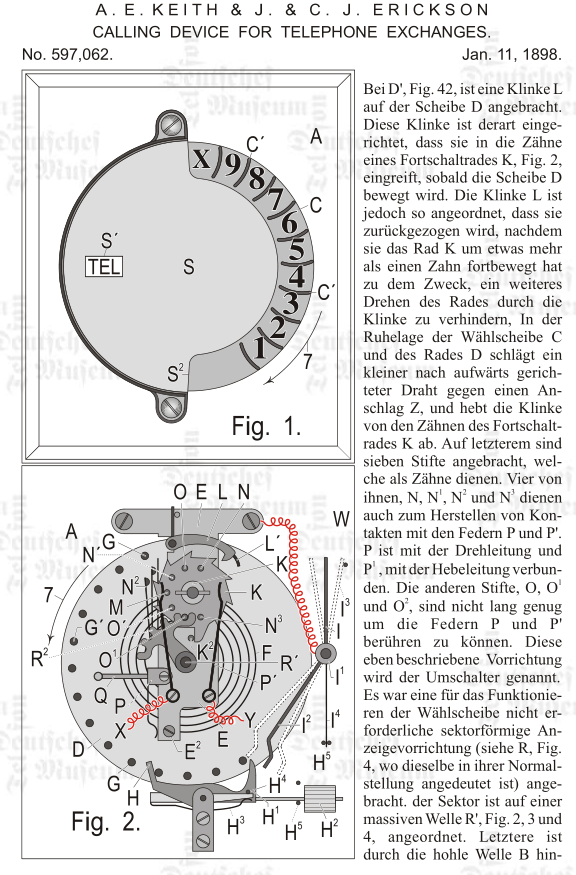
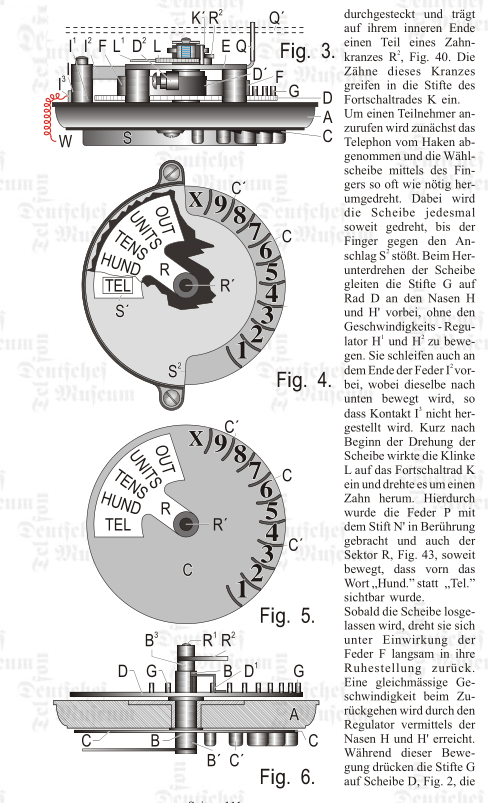
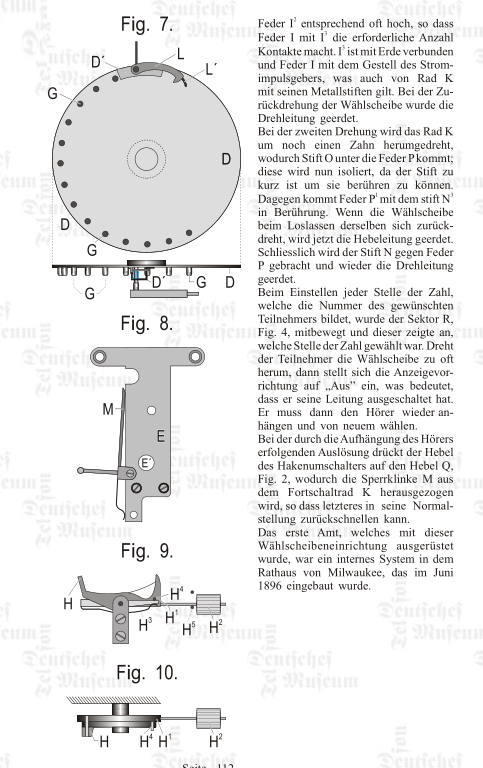
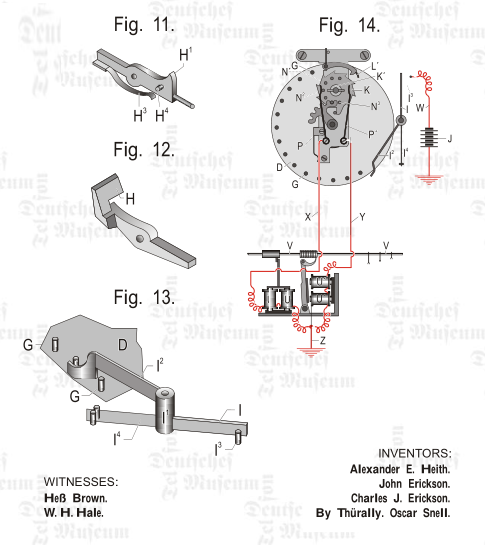
Le régulateur de vitesse était un dispositif
centrifuge, contrairement à l'échappement à ancre
lestée précédent. Il fonctionnait plus silencieusement
et offrait une meilleure régulation. Le cadran, portant les ergots,
était fixé à son axe par un emmanchement conique,
maintenu par une vis à métaux au centre de l'extrémité
de l'axe. Le cadran était isolé de l'axe par une couche
de fibre afin d'éviter tout risque de choc. Le frottement de
ce cône n'était pas suffisant pour empêcher le cadran
de glisser, ce qui risquait de fausser les chiffres. Pour remédier
à ce défaut, l'extrémité conique de l'axe
était recouverte de gomme-laque et de papier, puis le cadran
était replacé par-dessus. Cela empêchait le glissement,
mais rendait le retrait des cadrans plus difficile.
La connexion de terre n'était pas reliée en permanence
au mécanisme de l'émetteur, mais à un ressort isolé,
comme illustré à la figure 52. W représente la
roue en étoile, qui porte un levier isolé à son
extrémité.
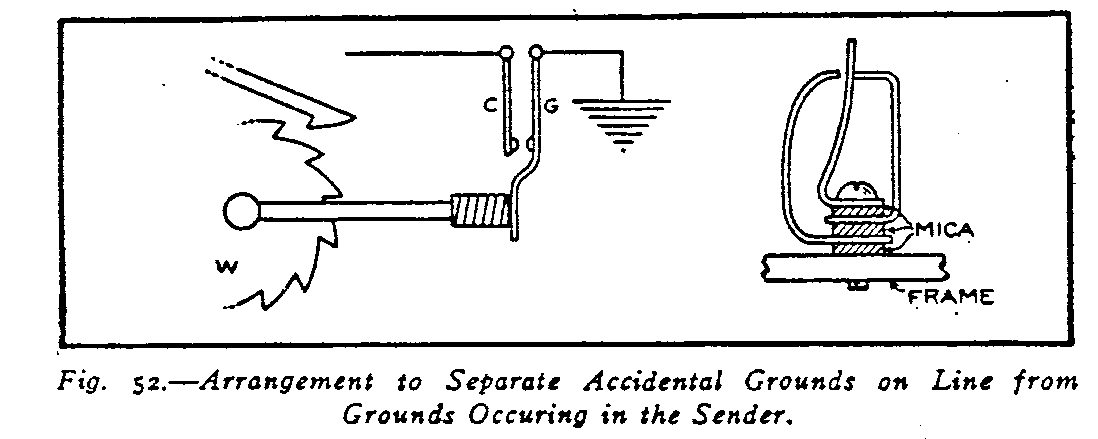
Lorsque l'émetteur est en position normale, le récepteur
étant raccroché, cette extrémité isolée
s'appuie contre le ressort de terre et le maintient à l'écart
des circuits. Mais le premier mouvement du cadran tire la roue en étoile
vers la gauche et permet au ressort de terre A de toucher le ressort
C. Cette disposition visait à séparer les mises à
la terre accidentelles sur les lignes de celles se produisant dans l'émetteur.
Si une ligne se comportait comme si elle était mise à
la terre, mais uniquement pendant un appel, elle était presque
certainement présente dans l'appareil de l'abonné. Pour
la mise à la terre, le système ne dépendait pas
de la terre, mais utilisait un retour commun. Comme les aimants, chacun
d'une résistance de r6 ohms, étaient directement sur la
ligne, le courant de ligne devait être relativement important.
Dans le cas des lignes les plus longues, il fallait jusqu'à 6
volts pour forcer le courant requis (1 ampère) à traverser
la résistance. Cette tension étant trop élevée
pour les lignes plus courtes, des prises étaient prélevées
sur la batterie en différents points, ce qui produisait trois
tensions au-delà du maximum. Même cette régulation
n'était pas suffisamment précise, et on a dû recourir
à l'insertion d'une résistance supplémentaire dans
chacune des lignes les plus courtes afin de les égaliser avec
les lignes les plus longues de leur groupe de tension.
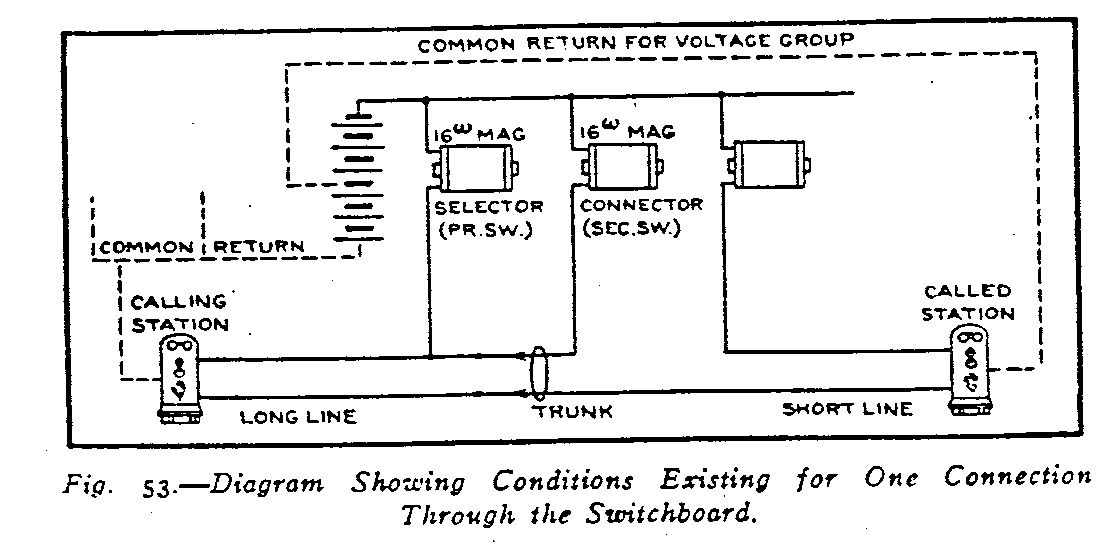
La figure 53 illustre les conditions d'une connexion via le tableau.
Chaque ligne d'abonné semblait métallique, et ce, du poste
au bureau.
Mais, dans le tableau, un côté de chaque ligne était
relié à la batterie négative par un aimant. L'autre
côté était relié au commutateur sans connexion
et fournissait une connexion directe à la ligne appelée.
Cette disposition provoquait une diaphonie, mais comme les utilisateurs
du téléphone n'avaient pas été habitués
au silence d'un circuit métallique transparent, aucune insatisfaction
notable n'a été constatée. La disposition des fils
de retour communs est également indiquée par des lignes
brisées. Il arrivait parfois que deux de ces lignes d'alimentation
de retour communes se croisent, ce qui déchargeait la partie
de la batterie située entre elles. Une batterie de stockage «
américaine » a été utilisée, ce qui
constitue, à notre connaissance, le premier central automatique
public utilisant une batterie secondaire.
Comme on pouvait s'y attendre, le courant élevé régnait.
Les interrupteurs provoquaient des problèmes en provoquant des
arcs électriques au point de fermeture de l'émetteur du
poste. Parfois, la chaleur était suffisamment forte pour déformer
un ressort. Les téléphones ne possédaient pas de
contacts en platine, mais les interrupteurs en étaient équipés.
De ce fait, des problèmes de contact encrassés survenaient
dans les circuits de conversation et de sonnerie, qui ne pouvaient être
chargés par le système automatique. Lorsque du platine
était utilisé dans les interrupteurs, il était
soudé par roulage, et non riveté comme c'est le cas actuellement.
Certaines lignes allant à Summerville mesuraient 48 ou 6,5 km
de long, et on utilisait des aimants spéciaux de 70 à
50 ohms. Ces aimants plus sensibles devaient être utilisés,
car il était déconseillé de dépasser 96
volts. En novembre 1877, une ligne fut posée jusqu'aux écluses
du canal, à 11 km environ. Un retour par la terre fut utilisé.
Comme il était impossible de faire fonctionner les aimants sur
cette ligne, des relais furent installés pour les faire fonctionner
sur un circuit local. Il s'agit de l'un des premiers cas, sinon le premier,
d'utilisation de relais de ligne sur un tableau automatique en usage
public. La construction mécanique des interrupteurs était
assez rudimentaire. Des soudures servaient à relier certaines
pièces là où une pièce solide aurait dû
être réalisée. L'interrupteur latéral rudimentaire,
qui commandait l'essuie-glace privé, était simplement
la combinaison d'un ressort vertical mobile entre deux ressorts fixes,
tous maintenus par une vis et isolés l'un de l'autre par des
bagues et des plaques de mica.
(Voir schéma de droite, Fig. 52.) L'isolant en mica utilisé
pour séparer les ressorts se dégradait souvent. Cela était
probablement dû à l'utilisation d'acide lors de la soudure
des ressorts. Dans d'autres pièces, on utilisait de la fibre
non traitée, ce qui posait problème en absorbant l'humidité.
Ce problème est désormais évité en la faisant
bouillir dans de la paraffine et de la cire d'abeille et en évitant
d'utiliser de la fibre pour les grandes pièces. Comme les cadres
des interrupteurs formaient un côté du circuit, ils étaient
tous isolés les uns des autres et du cadre de support.
Certains travailleurs sur la carte ont affirmé que, dans certains
cas, les bobines magnétiques étaient défectueuses
par électrolyse, car les fils présentaient un aspect corrodé.
Mais cela est sans doute dû à l'utilisation d'acide pour
la soudure, car il est bien connu que de tels résultats sont
très susceptibles d'en résulter. Le frottement des axes,
parfois si important qu'il les empêchait de retomber lors du déclenchement,
causait des problèmes.
La capacité totale de cette carte était de 900 lignes,
mais seulement 400 furent installées. L'équipement fut
ensuite porté à 600.
Ce commutateur est particulièrement remarquable car il
s'agissait de la première installation publique de la première
tentative réussie des ingénieurs de Strowger pour s'éloigner
du principe de l'interrupteur unique.
Les tableaux manuels avaient été développés
sur le principe de l'interrupteur multiple.
Ce système permet à l'opérateur qui répond
à un appel d'accéder aux terminaux du central et de sélectionner
la ligne appelée. Si l'on remplace l'opérateur humain
par un commutateur doté du nombre approprié de curseurs
et que l'on place la rangée de contacts à la place des
prises multiples, on obtient le type de commutateur automatique utilisé
jusqu'alors.
L'ancêtre du standard multiple manuel était le tableau
de transfert, dans lequel l'opérateur qui répondait à
un appel le redirigeait vers l'emplacement du standard où se
trouvait la ligne appelée. Relativement économique, il
était lent à utiliser, car l'action concertée de
deux opérateurs était nécessaire pour fermer le
circuit. Si l'on remplace l'opérateur qui répond par un
sélecteur, capable de sélectionner le groupe souhaité,
et que l'on place le commutateur de connexion, capable de sélectionner
la ligne de ce groupe, on retrouve l'idée qui sous-tend le tableau
Augusta.
Comme le tableau de transfert, il est moins coûteux. Contrairement
au le tableau de transfert, il est tout aussi rapide que les anciens
systèmes à commutateur unique.
La raison réside dans la rapidité uniforme des actions
mécaniques et électriques, qui ne sont pas soumises aux
délais variables qui assaillent les êtres humains. Le sélecteur
automatique obtiendra une ligne dans un certain délai ou ne l'obtiendra
pas du tout.
Il n'y a aucune possibilité de deviner après un délai
raisonnable.
En mars 1897, M. B. G. Dunham commença à travailler
pour les spécialistes de l'automatisme à Augusta, en Géorgie.
M. Dunham était originaire de l'Iowa et avait suivi un cours
de génie électrique à l'Iowa State College d'Ames.
La carte Augusta a démontré que le principe de la jonction
est le bon pour les automates.
Le problème suivant était de savoir comment obtenir
plus d'une jonction pour chaque centaine.
Il serait facile de doter le sélecteur de plusieurs contacts
par rangée, chaque contact représentant une ligne principale,
toutes les jonctions d'un niveau donné aboutissant à la
même centaine. Chacune de ces jonctions se terminerait par un
commutateur de connexion.
Si, en remontant un sélecteur jusqu'à la centaine souhaitée
et en le tournant d'un cran, la première jonction s'avérait
occupée, les curseurs du commutateur pouvaient être tournés
d'un cran, puis d'un autre, et ainsi de suite jusqu'à obtenir
une jonction non occupée. Bien que cela paraisse simple, le problème
s'est avéré complexe.
L'un des principes de conception automatique désormais clairement
établis est que l'abonné ne doit pas être tenu d'effectuer
des opérations nécessitant une quelconque connaissance
du système : le système doit être conçu
de manière à ce que toute personne puisse l'utiliser correctement
dès le premier essai, après avoir lu des instructions
simples. Ce principe limitait la sélection d'une ligne non occupée
aux moyens disponibles par l'utilisation normale du cadran et, bien
sûr, il était évident que l'abonné On ne
pouvait pas faire appel à eux pour aider consciemment à
son fonctionnement.
Le 1er juin 1897, les ingénieurs de la société
Strowger firent leurs premières expériences avec un moyen
de sélection de ligne non occupée.
Ils proposèrent d'insérer un « 0 »
dans chaque nombre juste après le chiffre des centaines.
Ainsi, le nombre 243 apparaîtrait dans le répertoire sous
la forme « 2048 ». Le chiffre des centaines servait
à élever les curseurs du sélecteur au niveau approprié
correspondant au chiffre des centaines. Le chiffre « 0 »
servait à donner des impulsions rotatives à l'arbre du
sélecteur. Dès l'atteinte du premier tronc non occupé,
le courant était coupé, de sorte que les impulsions restantes
ne causaient aucun dommage. Les deux derniers chiffres servaient à
actionner le connecteur de la même manière que sur la carte
Augusta.
Organisation
de l'entreprise
Les contrats préliminaires de janvier 1897 entre le central téléphonique
automatique Strowger et l'Automatic Telephone Exchange Company furent
suivis d'un autre contrat signé le 10 août 1897.
L'ancienne société se consacra alors plus activement que
jamais au développement et, à l'automne 1897 et au printemps
1898, elle constitua plusieurs panneaux d'exposition permettant de démontrer
le système et de générer des contrats.
L'un d'eux était équipé de plusieurs lignes inter-groupes,
la sélection de la ligne non occupée se faisant selon
le schéma « 0 » décrit précédemment.
Une autre solution avait été envisagée pour garantir
cette sélection, mais jugée peu pratique : le courant
de la batterie interrompue serait fourni par une machine au central,
au lieu d'être assuré par la touche supplémentaire
du cadran.
Mais en raison de la nécessité de faire fonctionner l'interrupteur
en permanence, cette solution fut jugée peu pratique. L'un des
panneaux exposés avait des aimants pontés.
Le 27 janvier 1898, un contrat fut signé entre la société
Strowger et l'Automatic Telephone Exchange
Company, portant sur la fabrication par la première et
l'exploitation des centraux par la seconde.
Le 12 mars 1898, M. A. E. Keith entreprit un voyage en Europe concernant
des redevances étrangères. Il emmena avec lui quelques
panneaux d'exposition et en présenta le fonctionnement à
Londres.
En juin 1895, un tableau de 400 lignes fut installé à
Washington, New York, remplaçant celui de 200 lignes installé
en mai 1890.
Au début de ses projets d'exploitation, l'Automatic Telephone
Exchange Company de Washington, DC, fut rattachée à son
territoire des États-Unis.
Le 1er octobre 1898, un contrat fut attribué à la New
England Automatic Telephone Exchange Company pour l'exploitation du
système Strowbridge en Angleterre.
Le 16 décembre, un contrat similaire fut attribué à
la Pacificic Automatic Telephone Exchange Company.
1898
Le système Strowger à 1 000 lignes
Novembre et décembre 1898 furent consacrés par
la société Strowger à la refonte du système
à 1 000 lignes.
Le commutateur, cet accessoire essentiel du sélecteur et du connecteur
modernes, fut introduit à cette époque. Il répondait
au besoin de regrouper les opérations auxiliaires en un seul
groupe compact, contrôlé avec certitude par un seul aimant.
Nous avons déjà vu ses débuts.
Un autre changement important était la commutation
des deux fils de ligne au lieu d'un seul comme auparavant. Les principaux
conducteurs (vertical et rotatif) étaient toujours allumés,
mais pontés. Le circuit de communication était donc parfaitement
opérationnel.
Le relais était utilisé pour la déconnexion. La
batterie était divisée en trois parties : 100 contacts
pour les lignes privées, 100 pour les lignes verticales et 100
pour les lignes rotatives. Comme nombre de ces caractéristiques
apparaîtront dans la nouvelle barbe de Bedford, elles ne seront
pas décrites plus en détail ici.
Pour régler certains différends survenus entre les deux
sociétés (société
Strowger et Automatic Telephone Exchange
Company), un autre contrat fut signé le 1er janvier 1899.
Dans ce contrat, la question des redevances était réglée.
Mais les deux sociétés ne semblaient pas pouvoir faire
des affaires de manière mutuellement satisfaisante, car la société
de Washington intenta une action en justice contre la société
Strowger.
Le procès de la société de Washington fut réglé
à l'amiable par des accords conclus le 11 juin. 1899, par lequel
l'Automatic Telephone Exchange Company
devait gérer l'ensemble de l'activité, y compris la fabrication.
La société Strowger accepta
de céder l'ensemble de ses activités et de sa correspondance
à la société Ashington et lui accorda une option
sur les brevets étrangers, tout en conservant le droit d'utiliser
des commutateurs automatiques dans le comté de Cook, en Illinois.
L'Automatic Telephone Exchange Company rejeta sa plainte et assuma la
responsabilité du procès Strowger.
Conformément à ce qui précède, le 21 juin
1899, la société Ashington prit en charge l'usine de Chicago.
La société Strowger, ayant obtenu un contrat pour une
carte destinée à Berlin, en Allemagne, passa l'été
1899 à la construction d'une carte de 400 lignes pour honorer
la commande. En août et septembre, la carte fut expédiée.
Elle était équipée d'une liaison automatique selon
le schéma « 0 ».
En octobre, M. E. A. Mellinger et R. R. Landon commencèrent l'installation
du tableau, qui fut mis en service en mai 1899. Ce tableau fonctionna
jusqu'en 1903, date à laquelle il fut remplacé par un
tableau plus grand de type ultérieur.
En octobre 1899, M. B. G. Dunham, qui travaillait à Augusta,
en Géorgie, à l'usine automatique de l'Augusta Telephone
& Electric Company, commença à travailler pour l'Automatic
Telephone Exchange Company.
Les ingénieurs de la société Strowger continuèrent
à travailler sur le problème de la sélection automatique
des lignes non occupées, ce qui était alors une nécessité
absolue.
En novembre 1899, ils produisirent un sélecteur performant doté
d'un sélecteur rotatif, évitant ainsi l'insertion du « 0 »
dans le numéro. Un petit central fut construit et mis en service
dans les bureaux de l'entreprise en novembre 1899.
Le 11 décembre 1900, l'Automatic Telephone Exchange Company a
transféré son usine à Baltimore, dans le Maryland,
constatant qu'il n'était pas possible de travailler à
distance de manière satisfaisante.
Mais finalement, la société de Washington a abandonné
la lutte et a tout revendu à la société Strowger.
Cela a eu lieu les 5 et 9 juin 1900. L'usine a été transférée
à Chicago le 10 juin.
Durant son existence, l'Automatic Telephone Exchange Company avait installé
des centraux intérieurs à Washington, D.C., à la
Maison Blanche, au Bureau des études géodésiques,
au Times Building et au Bliss Building, ainsi qu'à Yuma, en Arizona.
En décembre 1900, l'entreprise a fait faillite et a été
placée sous séquestre.
En 1900, la société Strowger commença à
fabriquer ses propres émetteurs améliorés.
M. B. G. Dunham, qui avait été muté de la société
de Washington au moment du règlement final, quitta cette dernière
à la fin du mois d'août 1900 pour occuper un poste à
l'usine automatique d'Augusta, en Géorgie.
Le système
de New Bedford à 10 000 lignes
L'année 1900 est marquée par la production du standard
téléphonique pour New Bedford. Mass., qui intégrait
pour la première fois dans un central public le principe de la
répartition automatique des lignes.
Il avait une capacité maximale de 10 000 lignes et
utilisait des premiers sélecteurs, des seconds sélecteurs
et des connecteurs. Cependant, seuls quatre mille étaient installés,
chacun ayant 900 lignes.
L'émetteur du poste ( cadran) est illustré aux figures
54, 55 et 56.
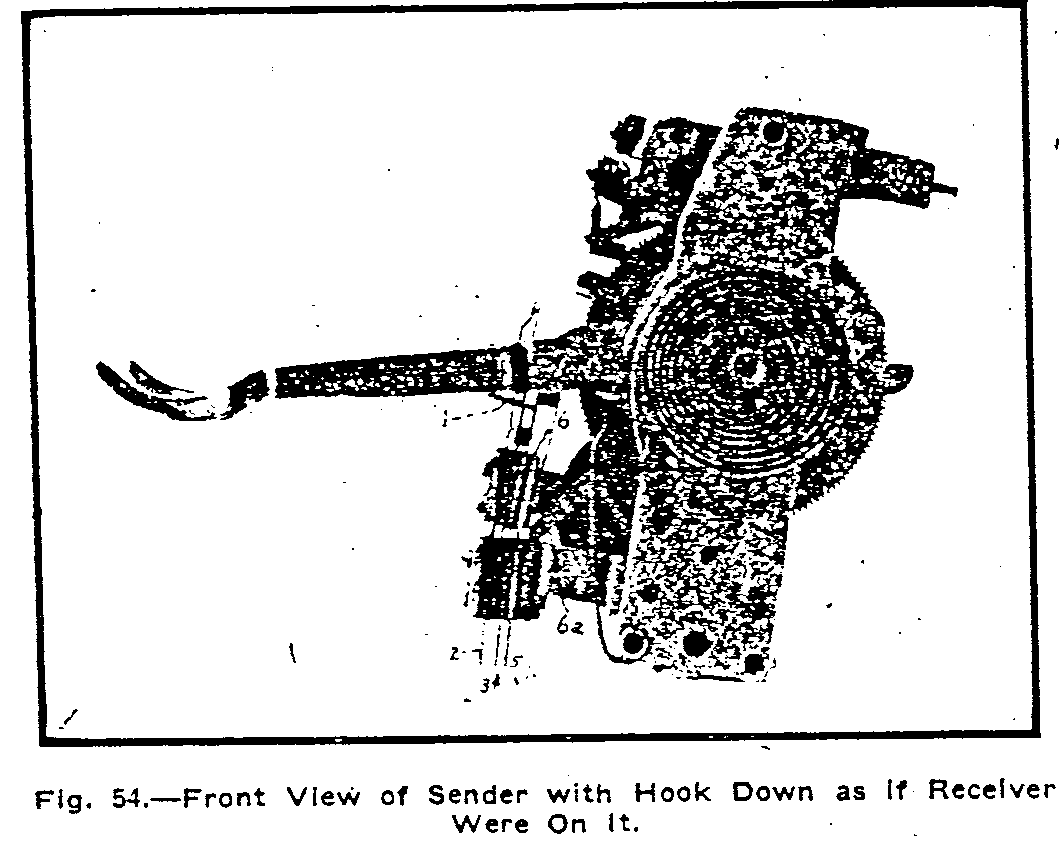
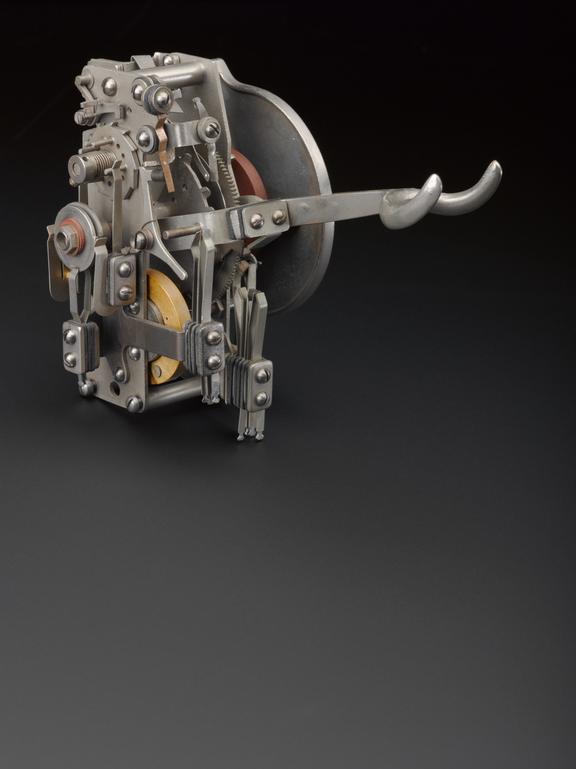
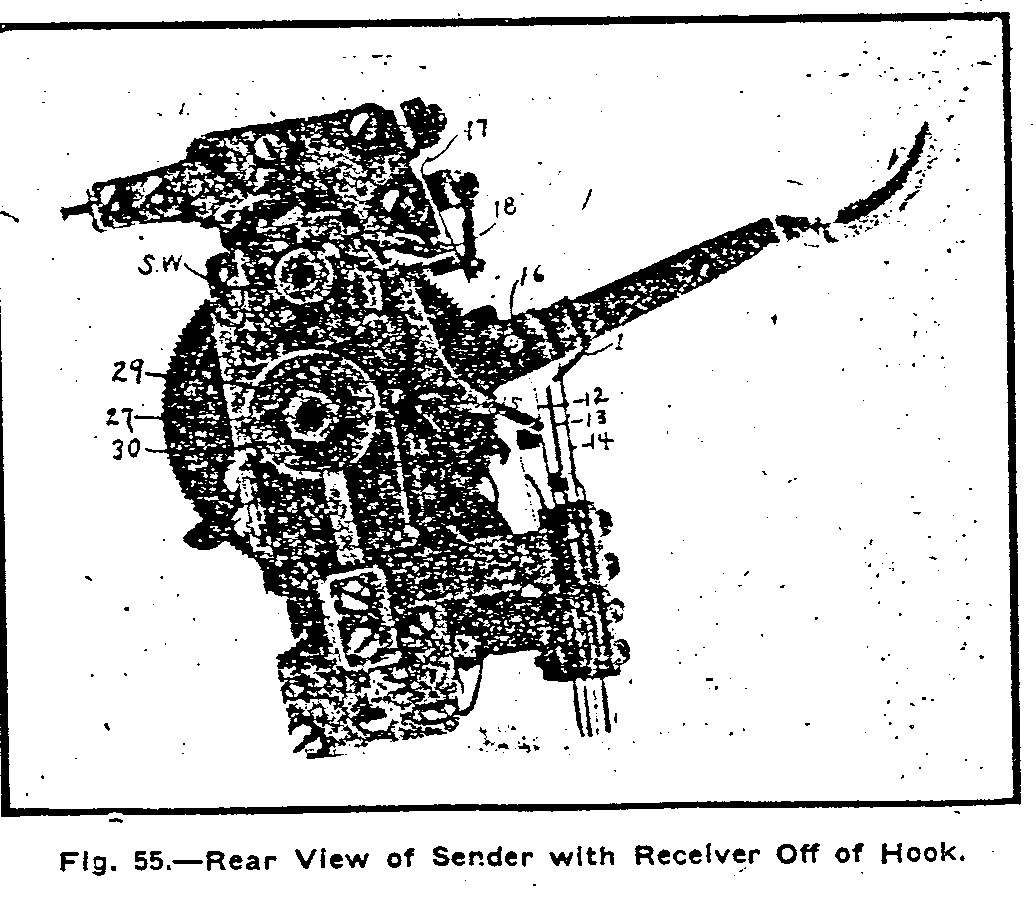
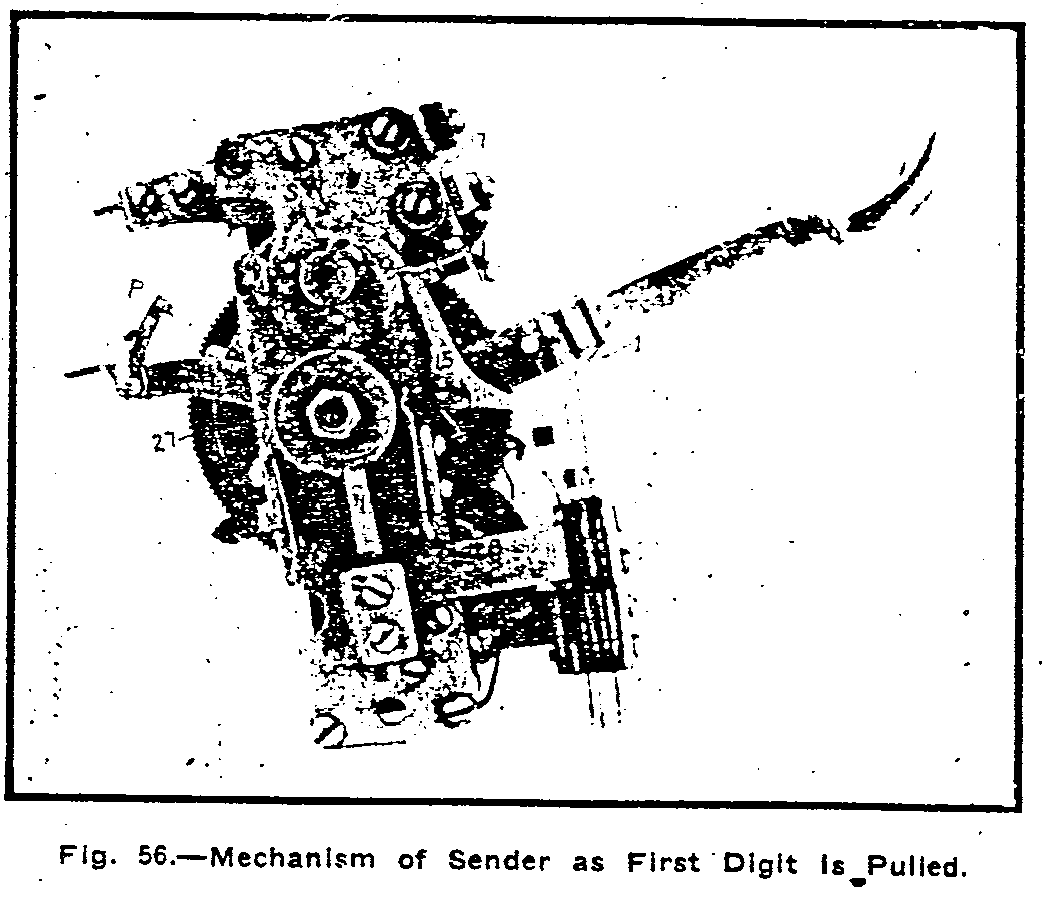
La figure 54 est une vue de face, levier abaissé, comme si le
récepteur était accroché.
Le cadran a été retiré, mais le cône sur
lequel il s'insère est visible au centre du ressort spiral. Les
ressorts des crochets sont les numéros 2, 3, 4, 5 et 6. La pièce
1, en contact avec 4, est isolée de la partie exposée
du crochet, mais connectée électriquement au châssis.
La pièce 6a, connectée à 6, s'étend vers
l'axe du cadran, de sorte qu'en position normale, une goupille de la
roue dentée du cadran repose contre elle.
La figure 55 montre l'arrière de l'émetteur, crochet relevé ;
12, 13 et 14 sont les ressorts de déclenchement ; 15 est
le cran de la roue étoilée, S. W., et 16 est la goupille
du levier à crochet, qui actionne le déclenchement de
la roue étoilée et des ressorts. Juste à gauche
des ressorts de déclenchement, une partie du régulateur
est visible.
L'inverseur, 29 et 30, est constitué de deux disques montés
sur l'axe du cadran, mais isolés de celui-ci et l'un de l'autre.
Chacun a la moitié de son bord découpé de sorte
qu'en position de repos, le ressort 28 repose sur 29 et 27 sur 30. Mais
lorsque le cadran est tourné en tirant sur un chiffre, les deux
contacts du ressort sont inversé, 28 reposant sur le bord de
30, et 27 sur 29.
Le ressort 31 est en contact permanent avec le disque 29. Un ressort
32 est en contact permanent avec le disque 30, mais, comme sur la photo,
il est masqué par le ressort 31.
La figure 56 montre le mécanisme en train de tirer le premier
doigt. Le bras portant le cliquet P est fixé rigidement à
l'arbre du distributeur. Le cliquet agit sur la roue étoilée
S, la déplaçant d'un cran à chaque traction. Le
récepteur est représenté en action.
La terre est reliée au ressort 17. Lorsque le
crochet est abaissé et avant que le premier chiffre ne soit tiré
(Fig. 56), le cliquet 15 repose sur une dent de l'étoile S.W.,
comme illustré. La tête isolée du cliquet 15 éloigne
le ressort de terre 17 du contact 18, ce dernier constituant la connexion
de terre commune à tout le câblage de l'instrument. Mais
lorsque le premier chiffre est tiré (Fig. 56), le cliquet retombe,
permettant au ressort de terre de toucher le contact 18.
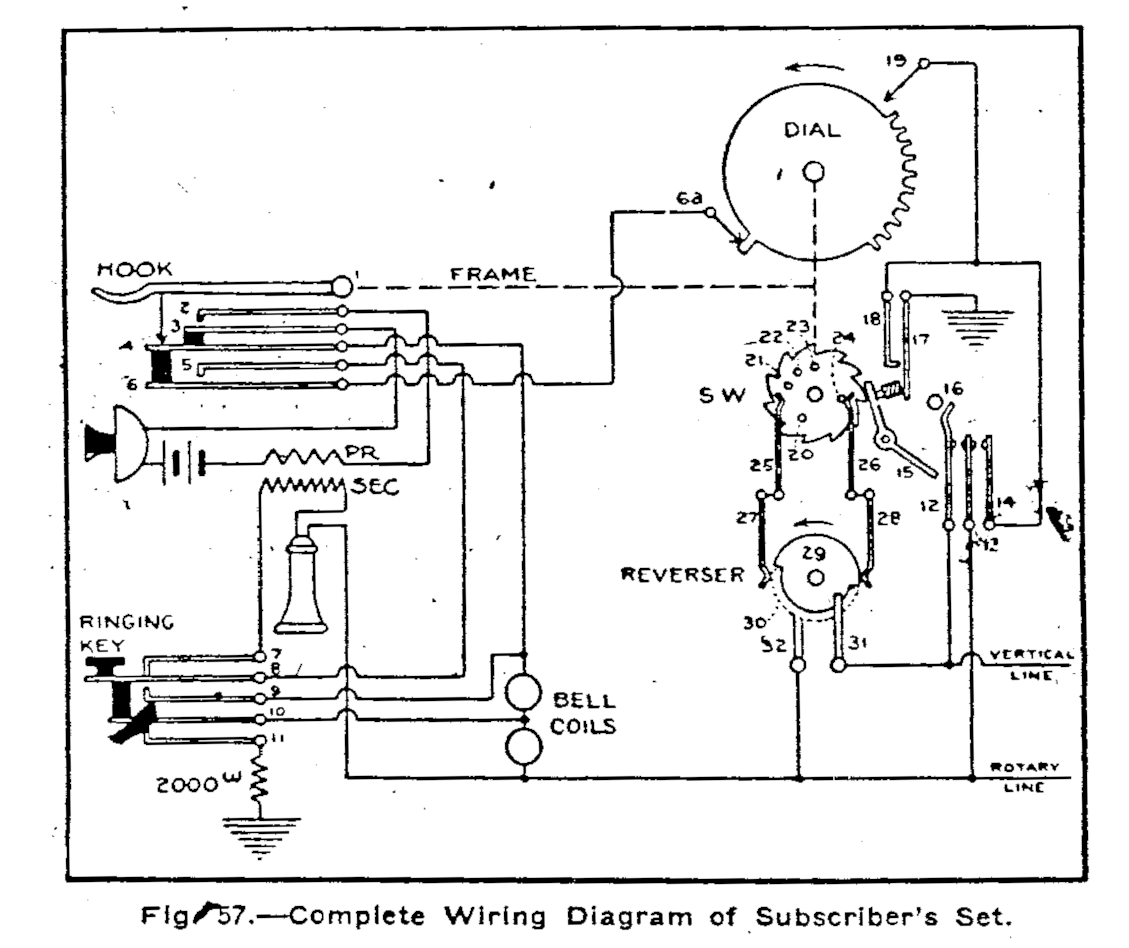
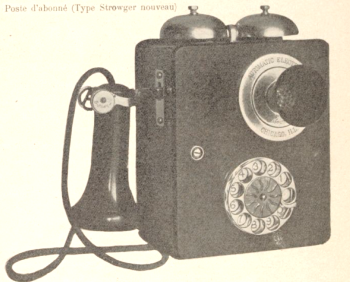
Le câblage complet du poste est illustré à la Fig.
57, toutes les pièces étant numérotées conformément
aux trois illustrations précédentes.
Le poste vocal se compose d'un circuit primaire de batterie local, avec
émetteur, batterie et primaire de bobine d'induction reliés
aux ressorts 2 et 3 du crochet. Circuit secondaire, composé du
récepteur et du secondaire de la bobine d'induction, relié
à la ligne rotative par le ressort 7 de la touche de sonnerie.
Ce dernier est normalement en contact avec le ressort 8, qui est relié
au ressort 5 du crochet. La sonnerie est connectée à la
ligne rotative par le ressort 4 du crochet, qui est normalement relié
au cadre par le contact 1, puis revient à la ligne verticale
par la broche 24, le ressort 26, le ressort 28, le disque 29 et le ressort
31. La ligne rotative est donc la borne commune aux circuits de sonnerie
et de récepteur, tandis que la ligne verticale est commutée
de la sonnerie au récepteur par le crochet.
Pour émettre un appel, le récepteur est décroché,
ce qui met la sonnerie hors circuit et le récepteur sous tension.
Le circuit du récepteur est complété jusqu'à
la verticale par le chemin suivant : 7, 8, 5, 6, 6 a, cadran, cadre,
étoile, 24, 2G, 28, 29 ; 31, jusqu'à la verticale.
Lorsque le cadran tourne sur le premier chiffre, le contact 6a est rompu,
déconnectant les lignes verticale et rotative. Le ressort 19
du talon denté du cadran n'est pas en contact lors de ce mouvement.
L'inverseur 29 étant situé sur l'axe du cadran, il se
déplace également vers la gauche du même angle.
Simultanément, le cliquet P (Fig. 55, 56, 57) s'enfonce dans
une encoche, mettant à la masse 18 et retirant également
la broche 24 du ressort 26, ce qui amène la broche 21 à
toucher le ressort 25. Lorsque le cadran revient en arrière,
dans le sens inverse de la flèche, le ressort 19 établit
une série de contacts reliant la ligne verticale à la
masse sur le trajet du cadran au cadre, S. W., 21, 25, 27, 29, 31, jusqu'à
la ligne verticale.
Juste avant la dernière impulsion, l'inverseur 29 modifie la
connexion afin d'amener l'impulsion sur la ligne rotative.
Les deuxième et troisième chiffres sont
tirés de la même manière, les impulsions provenant
respectivement des broches 22 et 23 du cadran.
Chaque traction sur le cadran fait tourner la roue étoilée
d'un cran. En tirant sur le quatrième chiffre, la roue étoilée
est tirée de sorte que la broche 23 est dégagée
du ressort 25 et que la broche 20 repose sous le ressort 26. La série
d'impulsions passe alors par la ligne de rotation, aboutissant à
une seule impulsion verticale. La raison de ce phénomène
sera expliquée lors de la commutation des interrupteurs au centre.
Pour sonner, on appuie sur la touche de sonnerie. Cela connecte la sonnerie
à la ligne et met son centre à la terre via 2000 ohms,
coupant ainsi le récepteur. Pour libérer le récepteur,
il suffit de suspendre le récepteur au crochet, ce qui fait descendre
la broche 16. Ceci ferme momentanément les trois ressorts 12,
13 et 14, court-circuitant et mettant à la terre les lignes verticales
et rotatives. La broche 16 appuie également sur le cran 15' de
la roue en étoile, lui permettant de revenir à sa position
initiale par la force du ressort 17, hors contact 18, libérant
ainsi l'appareil de la terre.
En résumé, les fonctions de l'émetteur sont les
suivantes :
1. Commutation des circuits de conversation et de sonnerie comme dans
tout téléphone local à batterie. 2. En actionnant
le cadran, déconnectez le circuit du récepteur et mettez
les lignes à la terre selon le code suivant :
Premier chiffre, ligne V - - - - - - - - Ligne R -
Deuxième chiffre, ligne V - - - - - - Ligne R -
Troisième chiffre, ligne V - - - - ~ - - Ligne R -
Quatrième chiffre, ligne R - - - - - Ligne V -
Pour sonner, branchez la sonnette sur la ligne au lieu du récepteur
et reliez le centre de ses enroulements à la terre sous 2 000 ohms.
· Pour libérer le récepteur, mettez à la
terre les lignes verticale et rotative, puis réinitialisez la
roue en étoile.
Le premier sélecteur de New Bedford est illustré
sur le schéma de la figure 58.
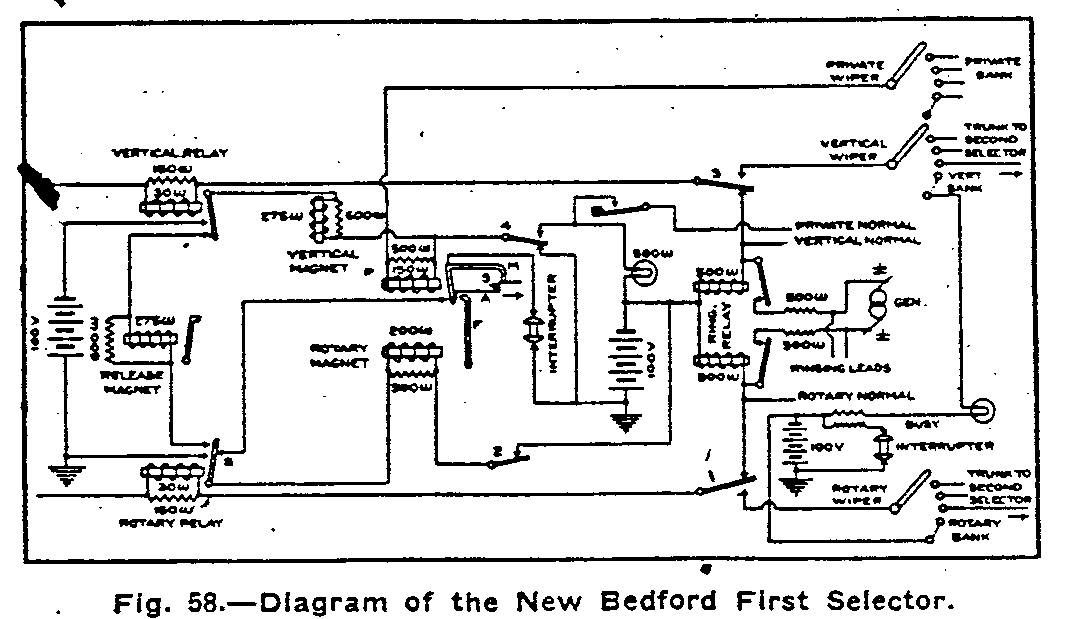
Deux relais, un vertical et un rotatif, sont placés en série
avec la ligne de l'abonné. Ils sont de faible résistance
(30 ohms) et shuntés par une résistance non inductive
de 150 ohms afin de permettre le passage du courant de conversation
avec une impédance aussi faible que possible. Chacun est normalement
alimenté par la batterie via l'un des deux relais de sonnerie
de 500 ohms. Le relais vertical contrôle le flux de courant à
travers l'aimant vertical, ce dernier ayant pour fonction de soulever
l'arbre d'essuie-glace portant les essuie-glaces privés, verticaux
et rotatifs. Le relais rotatif contrôle l'aimant rotatif, dont
la fonction est de faire tourner l'arbre d'essuie-glace. Les deux relais
de ligne comportent chacun un contact auxiliaire menant à l'aimant
de déclenchement.
Si les relais de ligne (vertical et rotatif) sont actionnés simultanément,
l'aimant de déclenchement est excité, ce qui libère
les crans verticaux et rotatifs du cylindre à cliquet.
L'interrupteur latéral est composé de quatre éléments,
numérotés 1, 2, 3 et 4. Dans la machine, les quatre éléments
sont montés de manière compacte au même endroit,
bien que, sur le schéma, ils soient séparés pour
simplifier le dessin des circuits. Chacun est représenté
dans sa position initiale. « S » représente
l'extrémité du levier de l'interrupteur latéral
et repose dans l'angle du ressort A, fixé à l'armature
de l'aimant P. Un ressort tend à déplacer le levier de
l'interrupteur latéral S vers la droite, comme indiqué
par la flèche, et, s'il était autorisé à
se déplacer, il commuterait tous les éléments en
deuxième position. L'aimant est relié au curseur, ainsi
qu'au ressort 4 de l'interrupteur latéral, de sorte qu'il est
normalement mis à la masse. « F4 » est
un doigt partant de l'armature du corps rotatif et réglé
de telle sorte que, lorsque ce dernier est alimenté, il appuie
sur l'armature de l'aimant.
L'interrupteur est maintenu en fonctionnement par un petit moteur. L'interrupteur
de coupure est actionné par un doigt sur le curseur. L'arbre,
de sorte que lorsque l'arbre est abaissé en position normale,
le contact est ouvert. Une seule impulsion vers le haut est nécessaire
pour fermer ce contact. Les normales verticale et rotative sont les
lignes des rangées de connecteurs par lesquelles les appels arrivent
sur cette ligne. Le contacteur privé occupe un contact dans la
rangée privée du commutateur de connecteur et sa position
correspond aux normales verticale et rotative.
Lors d'un appel, le premier chiffre est envoyé en mettant à
la terre la ligne verticale plusieurs fois, suivi d'une impulsion sur
le contacteur rotatif. Le mécanisme pour y parvenir a été
décrit précédemment. Les impulsions verticales
excitent le relais vertical, qui à son tour relève l'aimant
vertical, élevant ainsi les curseurs au niveau souhaité.
L'interrupteur hors tension place la batterie sur la normale privée,
empêchant ainsi d'autres personnes d'appeler cette ligne. L'impulsion
rotative actionne l'aimant rotatif une fois, ce qui fait tourner les
curseurs jusqu'à la première ligne principale du niveau
où ils se trouvent. En même temps Le doigt F de l'aimant
rotatif actionne l'armature de l'aimant privé, faisant passer
l'interrupteur latéral en deuxième position. Cela entraîne
plusieurs changements. Aux positions 1 et 3, il coupe les relais de
sonnerie de 500 ohms et les lignes normales, et connecte les lignes
verticales et rotatives directement aux essuie-glaces. À 2, il
coupe l'alimentation de l'aimant rotatif. À 4, il commute l'aimant
privé de la masse au négatif de la batterie via une lampe
de 500 ohms. Ce dernier place le contact privé correspondant
à la ligne principale occupée en état d'occupation,
de sorte qu'aucun autre sélecteur ne puisse s'y arrêter.
La batterie négative est l'état d'occupation. Si les premières
lignes principales avaient été occupées, la procédure
aurait été la suivante : l'impulsion rotative aurait
fait tourner les contacts jusqu'à ce qu'ils établissent
le premier contact, le contacteur de l'aimant rotatif F, appuyant également
sur l'armature de l'aimant privé. Ceci force S, le levier de
l'interrupteur latéral, à glisser sur l'épaulement
du ressort ?-1 et à heurter la pièce solide M, ce qui
l'empêche d'avancer. Ce léger mouvement n'est pas suffisant
pour affecter les éléments de l'interrupteur. Le contact
C est également fermé. Étant donné que le
tronc de tir est occupé, son contact d'impression sera «
actif » avec une batterie négative, et l'aimant privé
sera verrouillé. Lorsque le relais rotatif retombe après
l'impulsion unique, le contact B ferme le circuit de l'aimant rotatif.
L'interrupteur envoie alors un courant pulsé à l'aimant
rotatif, ce qui provoque le déplacement des curseurs. À
chaque impulsion, le doigt de l'armature rotative maintient l'armature
de l'aimant privé, tandis que le curseur privé glisse
d'un contact à l'autre. Entre les impulsions, le courant dans
l'aimant privé le maintient, empêchant ainsi le commutateur
latéral de fonctionner. Mais lorsqu'une ligne non occupée
est finalement trouvée, son contact privé est vide. L'aimant
privé n'a donc plus rien pour le retenir. La structure retombe,
coupant le contact C et permettant au commutateur latéral de
passer en deuxième position.
L'appel est alors dirigé vers un second sélecteur, illustré
à la figure 59.
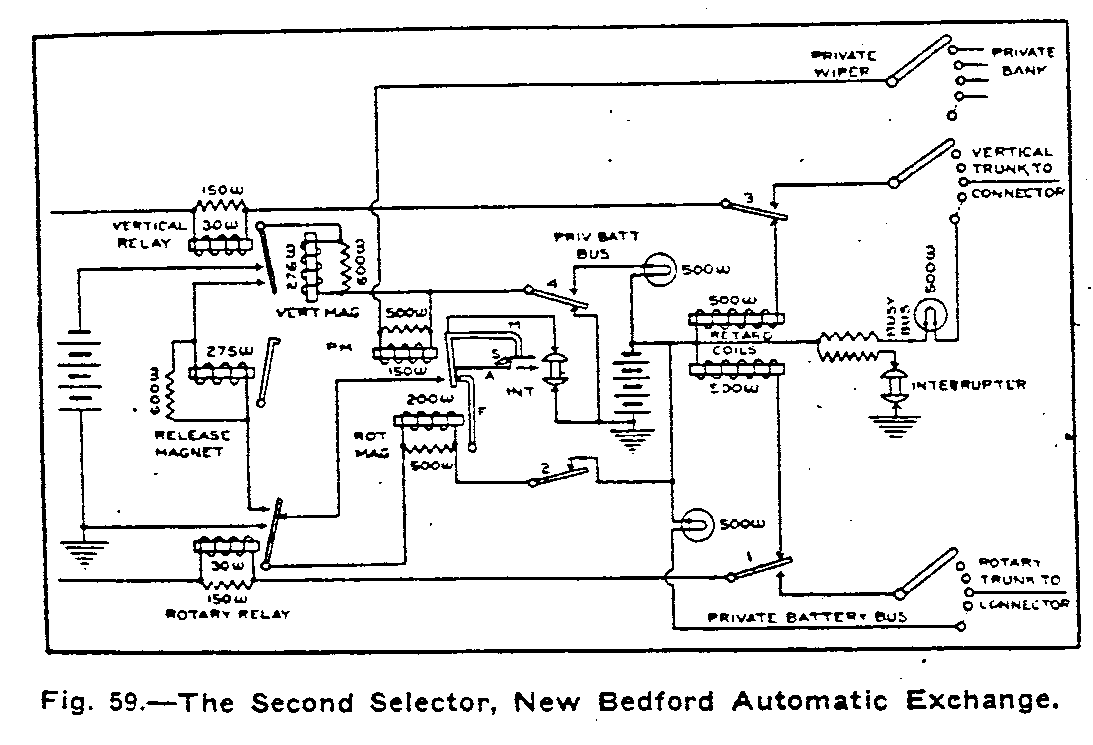
Il est identique au premier sélecteur, à la différence
que les relais de sonnerie de 500 ohms sont Remplacé par des
bobines de retard de 500 ohms, il n'y a ni lignes normales ni interrupteur.
Le connecteur (Fig. 60) diffère quelque peu des sélecteurs
en ce qu'il ne permet pas de sélectionner le tronc, les pas verticaux
et rotatifs correspondant aux deux derniers chiffres du numéro
d'appel. L'aimant rotatif est dépourvu de doigt.
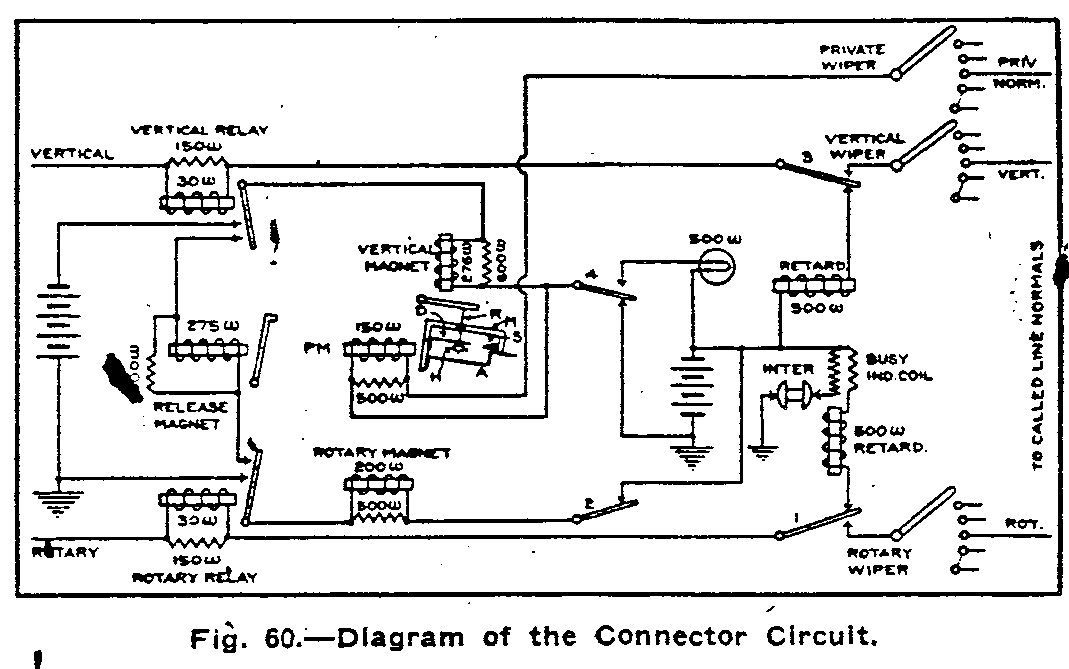
Une petite tige (R) est fixée à l'armature de l'aimant
vertical. Elle traverse un trou dans le bras plein (M) de l'armature
de l'aimant vertical et le ressort léger (D) se termine par une
tête réglable (H). L'armature de l'aimant privé
est maintenue en position normale, à proximité de l'aimant.
Une came à ressort, située sur l'arbre du racleur, empêche
l'armature de s'éloigner de l'aimant privé tant que l'arbre
n'a pas tourné d'au moins un cran. Une seconde came est disposée
pour repousser le cliquet de l'aimant vertical hors du cylindre à
cliquet lorsque l'arbre a tourné d'un cran. ou plus.
Le fonctionnement est le suivant : les impulsions pour le chiffre
des dizaines arrivent sur la ligne verticale et soulèvent l’axe
du curseur.
La came mentionnée ci-dessus empêche toute perturbation
de l’aimant privé. L’impulsion rotative unique déplace
l’axe d’un cran sans que les curseurs n’engagent de contact.
Les impulsions des unités arrivent sur la ligne rotative et font
tourner les curseurs jusqu’au contact souhaité à
ce niveau. La dernière impulsion arrive sur la ligne verticale,
alimentant une fois le relais vertical et l’aimant. La deuxième
came mentionnée ci-dessus empêche l’arbre d’agir,
mais, par l’intermédiaire de la tige R, elle tire sur le
ressort D et soulève la pièce solide M, permettant ainsi
à l’interrupteur latéral de basculer en deuxième
position.
Le commutateur latéral relie ainsi les lignes verticale et rotative
à la ligne appelée et effectue les mêmes commutations
que pour les sélecteurs.
La station appelante voit alors ses lignes prolongées jusqu'au
premier sélecteur de la station appelée, arrivant à
ce point par les lignes normales. Il ne reste donc plus que les deux
relais de sonnerie de 500 ohms du premier sélecteur de la station
appelée. Pour déclencher, il suffit d'appuyer sur la touche
de sonnerie de la station appelante. Comme décrit précédemment,
cela connecte la sonnerie à la ligne (à la place du récepteur)
et met à la terre le milieu des bobines de la sonnerie sous une
tension d'environ 2000 ohms.
Le schéma complet est illustré à la figure 61.
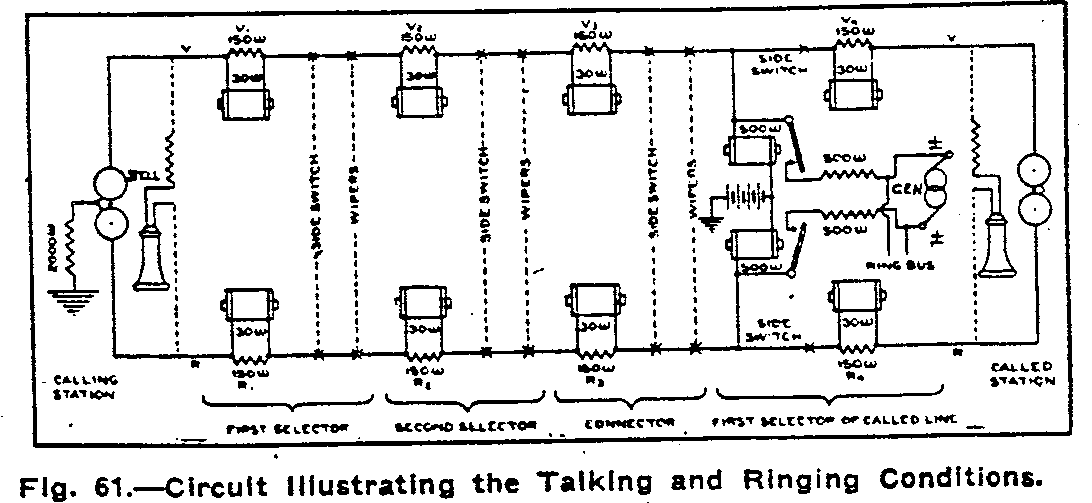
Comme on le verra clairement, le courant circule alors depuis la batterie,
à travers les relais de sonnerie, tous les relais de ligne, les
deux bobines de la sonnerie et vers la terre sous une tension d'environ
000 ohms. Cela permettrait de relever tous les relais de ligne, V, V,
etc. (relais verticaux) et R1, R, etc. (relais rotatifs), sans l'effet
limitant de la résistance de 2 000 ohms. Comme les relais
de ligne sont bobinés à 30 ohms chacun et équipés
d'un shunt non inductif de 150 ohms, ils ne sont pas aussi sensibles
que les relais de sonnerie, qui sont de 500 ohms. Par conséquent,
ces derniers
seuls relèvent, connectant le courant de sonnerie à la
ligne.
Une particularité de la sonnerie est que cela fait sonner les
sonneries des deux postes. D'une certaine manière, cela semblait
être une bonne fonctionnalité, car cela permettait à
l'abonné appelant de savoir que quelque chose se passait en appuyant
sur le bouton de sonnerie. Ce circuit de sonnerie a été
inventé par M. T. G. Martin, alors de la société
Strowger. Comme la plupart des systèmes où la dépendance
est mise sur L'action marginale des relais nécessitait un réglage
très précis pour assurer le bon fonctionnement des commutateurs.
L'action du connecteur, si la ligne appelée est occupée,
sera illustrée à nouveau à la figure 60. Imaginons
que les mouvements verticaux et rotatifs soient terminés, les
curseurs reposant sur la ligne appelée et sa ligne privée,
et nous sommes prêts pour la dernière impulsion unique
arrivant sur la ligne verticale.
La ligne appelée étant occupée, son contact privé,
sur lequel repose le contacteur privé 9ttr, sera relié
à la batterie négative.
L'interrupteur latéral 4 relie notre aimant privé à
la masse, ce qui ferme le circuit et permet au courant de la batterie
de circuler à travers ce dernier, verrouillant son armature à
l'emplacement indiqué. Lorsque l'impulsion verticale finale arrive,
elle active l'aimant vertical et tire sur le ressort D. Cependant, grâce
au courant de verrouillage, l'aimant privé ne bouge pas et les
leviers des interrupteurs latéraux 1 et 3 restent en position
normale, comme indiqué sur la figure. De cette façon,
la ligne appelée ne peut être perturbée. En attendant
la réponse des postes appelés, l'abonné appelant
entend la tonalité d'occupation, transmise par les deux bobines
de retard de 500 ohms.
Le circuit de conversation d'une connexion établie est illustré
à la figure 61, qui a servi à illustrer le système
de sonnerie. On constate que huit relais de ligne sont en série,
quatre de chaque côté du circuit. Chacun est shunté
par une résistance non inductive de 150 ohms, ce qui le rend
moins problématique pour la transmission. Pourtant, il semble
que ce soit déjà assez problématique. Deux relais
de 500 ohms sont pontés sur la ligne, la batterie étant
reliée au centre et à la terre. Cela représente
une résistance hautement inductive de 1 000 ohms, ce qui
est tout à fait acceptable et de bonne facture. Il y a quatorze
contacts entre les deux abonnés, en ne comptant que ceux des
interrupteurs. Six d'entre eux sont des contacts de balayage, ce qui
peut être très efficace, car ils sont des contacts de balayage
et peuvent avoir une pression suffisante pour couper la poussière
ordinaire. Les huit contacts restants se trouvent dans les différents
interrupteurs latéraux et, s'ils sont en platine, comme c'était
le cas, ils peuvent faire du bon travail, mais pas aussi bien que les
interrupteurs latéraux modernes, avec leurs contacts de balayage.
Lors de la déconnexion, les lignes verticales et rotatives étaient
momentanément mises à la terre par les ressorts des crochets
du poste d'appel. Cette action a été décrite en
détail. Comme il s'agit d'une mise à la terre à
résistance nulle, tous les relais illustrés à la
figure 1 seront relevés. Comme indiqué lors de la description
du premier sélecteur, cela activera l'aimant de déclenchement
de chaque interrupteur, ramenant toutes les machines à leur position
normale. Un dispositif mécanique réarme également
l'interrupteur latéral par le mouvement rotatif de l'arbre. Ce
système partageait de nombreuses caractéristiques avec
les automatiques modernes. Il marqua le début du succès
moderne, bien qu'encore très imparfait. Deux points peuvent être
mentionnés, plus ou moins abandonnés. Chaque aimant de
l'interrupteur était shunté par une certaine résistance
non inductive. Cela visait à réduire, voire à supprimer,
l'étincelle excessive aux contacts du relais qui alimentait cet
aimant. La tension de la batterie utilisée pour le fonctionnement
du système était de cent volts.
En se référant à nouveau à la figure 58,
il convient d'attirer l'attention sur le test d'occupation câblé
aux derniers contacts du premier groupe de sélecteurs.
Si toutes les lignes étaient occupées, les essuie-glaces
seraient acheminés vers ce dernier point, où le signal
d'occupation avertirait l'abonné. De plus, le claquement de ce
commutateur attirerait l'attention de l'opérateur sur un problème.
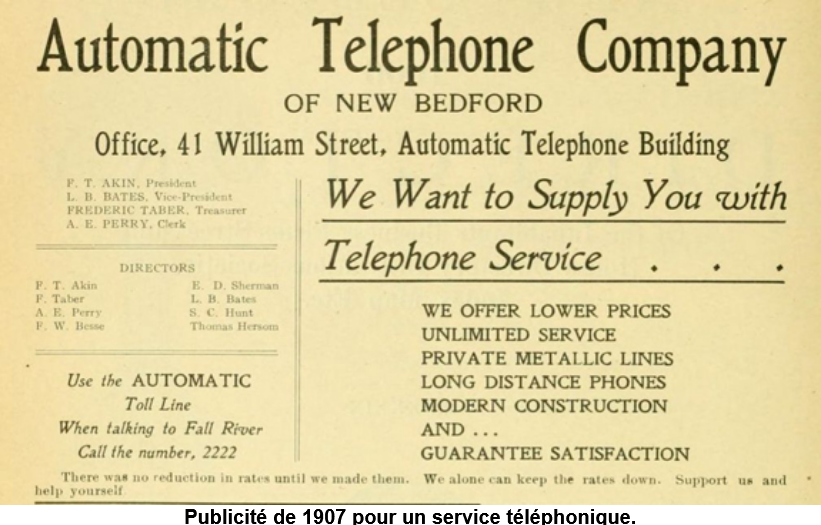
Les services téléphoniques automatiques et Bell étaient
en concurrence dans la même ville. (Photo publicitaire)
Le réseau
de Fall River
Le panneau de New Bedford fut installé par M. T. G. Martin. Les
travaux commencèrent en octobre et s'achevèrent en décembre
1900.
Au printemps 1901, l'actuelle Automatic Electric
Company fut créée pour se consacrer à la
fabrication et à la vente d'appareils téléphoniques
automatiques. La Strowger Automatic Telephone
Exchange cessa ses activités, détenant simplement
les brevets d'exploitation de l'Automatic Electric Company.
Le personnel de cette dernière était le suivant :
Président : C. D. Simpson ; vice-président et
directeur général : J. Harris ; secrétaire
et trésorier : A. G. Wheeler, Jr. ; Surintendant général,
A. E. Keith ; ingénieurs, A. E. Keith, T. G. Martin, John
Erickson, Charles Erickson et E. C. Dickenson.
La nouvelle organisation, libérée des contraintes commerciales
qui avaient harcelé l'ancienne entreprise, démarra avec
de bonnes chances de succès.
En juin 1901, un standard automatique fut installé à
Fall River, dans le Massachusetts.
Il s'agissait d'un standard à 10 000 lignes et suivait de
près les lignes du standard de New Bedford. Cependant, certaines
améliorations notables furent mentionnées en détail,
car elles firent de Fall River le point de départ du système
véritablement moderne.
L'émetteur de la sous-station possédait le même
mécanisme d'envoi de signaux et fonctionnait selon le même
code pour les lignes verticales et rotatives : les trois premiers
chiffres consistaient en une série d'impulsions sur la ligne
verticale, suivies d'une sur la ligne rotative. Le dernier chiffre a
été inversé, la série d'impulsions passant
par le commutateur rotatif et se terminant par un sur la ligne verticale.
Le système de sonnerie a été amélioré
de sorte qu'il ne nécessite que la mise à la terre de
la ligne verticale pour actionner le relais de sonnerie, sans résistance.
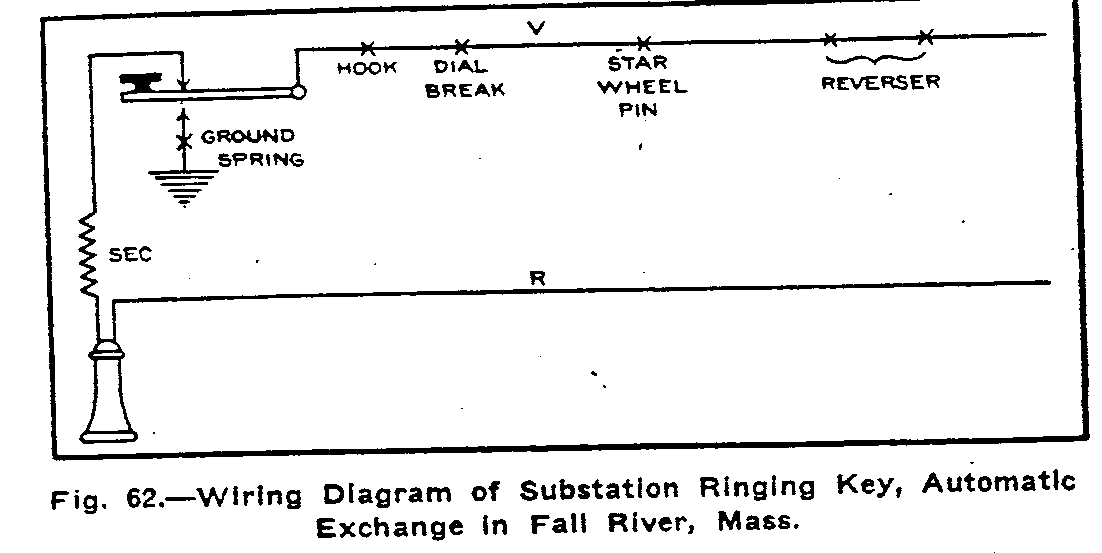
Le câblage de la touche de sonnerie est illustré à
la figure 62 ; les autres détails du poste ont été
omis, car ils sont identiques à ceux du système de New
Bedford décrit précédemment.
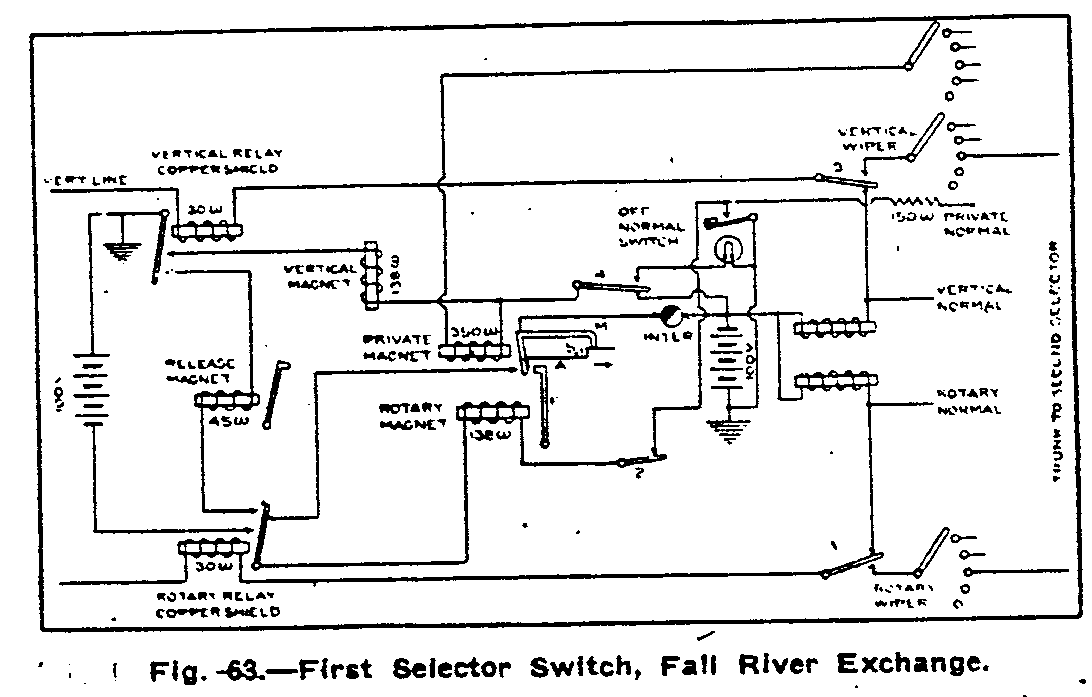
Le premier sélecteur est illustré à la figure 63
et diffère de celui de New Bedford sur plusieurs points.
Dans le premier sélecteur de Fall River, illustré ici,
le schéma de connexion général de l'alimentation
par batterie, de l'aimant vertical, de l'aimant rotatif, de l'aimant
privé et du déclencheur est inchangé. Cependant,
au lieu de shunter chaque relais ou aimant avec une résistance
non inductive, un fin tube de cuivre a été glissé
sur le fer et la bobine de travail a été enroulée
dessus. Ce blindage en cuivre produisait l'effet d'un court-circuit
secondaire dans un transformateur et absorbait une grande partie de
l'énergie magnétique, ce qui aurait produit de très
mauvaises étincelles au niveau des contacts qui le contrôlaient.
Les relais de ligne étaient bobinés à 30 ohms avec
du fil n° 29, tandis que les aimants verticaux et rotatifs étaient
bobinés à 138 ohms avec du fil n° 33. L'aimant privé
était bobiné à 350 ohms avec du fil n° 36 et
l'aimant de déclenchement avec du fil n° 30 pour une résistance
de 45 ohms.
L'aimant rotatif n'avait normalement aucun circuit.
Ainsi, si la ligne rotative touchait accidentellement le sol, cela ne
ferait que déclencher le relais rotatif, sans actionner l'essuie-glace.
L'interrupteur de mise hors service, qui se ferme lorsque l'arbre de
l'essuie-glace a fait un pas vers le haut, fermait le circuit de l'aimant
rotatif.
L'état occupé du groupe privé a été
mis à la masse, au lieu du négatif de la batterie comme
auparavant. Il a donc fallu connecter l'aimant privé via l'interrupteur
latéral 4 au négatif de la batterie tout en recherchant
une ligne principale non occupée. Cela a également pour
effet de placer l'interrupteur sur le négatif de la batterie
au lieu de la masse.
Aucun test d'occupation n'a été effectué sur les
derniers contacts du groupe, car il a été constaté
qu'il était très rare que toutes les lignes principales
soient occupées.
Les normales verticales et rotatives arrivaient aux contacts intérieurs
des interrupteurs latéraux 1 et 3, comme auparavant, mais il
n'y avait pas de relais de sonnerie, leur rôle étant pris
en charge par un relais sur le connecteur. Si l'abonné appelé
le souhaitait, il pouvait se déconnecter de la ligne appelante
en utilisant simplement son cadran pour appeler quelqu'un d'autre. Ce
faisant, il laissait la ligne appelante sur les deux bobines de retard
de 500 ohms, par lesquelles cette ligne pouvait se libérer. Dans
le deuxième sélecteur, le circuit de l'aimant rotatif
était fermé par l'interrupteur d'arrêt normal et
un contact arrière sur le relais vertical, comme dans le connecteur
(Fig. 64). Ceci permet d'empêcher l'aimant d'être alimenté
lors du relâchement.
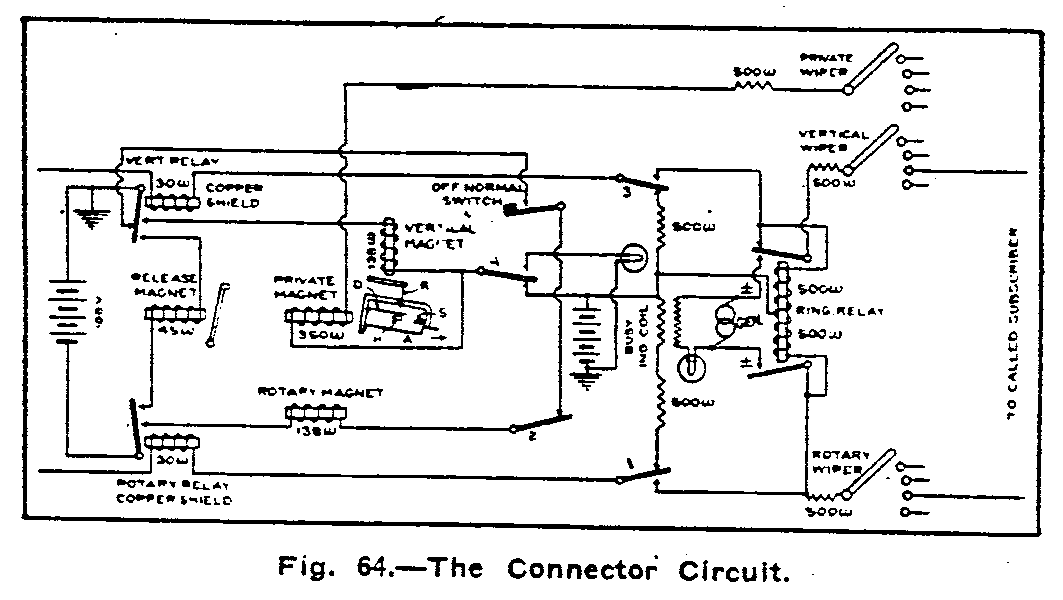
Le connecteur (Fig. 64) a été grandement amélioré
par l'introduction du relais de sonnerie, comme illustré.
Lors des mouvements verticaux et rotatifs, les lignes étaient
alimentées par deux résistances de 500 ohms et les contacts
des interrupteurs latéraux 1 et 3. Lorsque l'interrupteur latéral
était enclenché en deuxième position (de la même
manière que sur le tableau de New Bedford), les résistances
de 500 ohms étaient coupées et remplacées par les
deux enroulements du relais de sonnerie. Lorsque la touche de sonnerie
du poste de sonnerie était enfoncée, la ligne était
ouverte et le fil vertical était mis à la terre. Le courant
provenait alors de la batterie et traversait tous les relais verticaux
et la bobine en V du relais de sonnerie. La remontée des relais
verticaux n'avait aucun effet. L'excitation du relais de sonnerie coupait
la ligne verticale et connectait la dynamo de sonnerie à la ligne
appelée. Ainsi, seule la cloche du poste appelé sonnait.
Tous les problèmes de réglages marginaux des relais de
ligne étaient évités. Lors du déclenchement,
les lignes verticales et rotatives étaient connectées
directement à la terre du poste, activant simultanément
tous les relais verticaux et rotatifs. Bien que cette action ait fait
passer du courant par le relais de sonnerie, ce dernier n'était
pas excité, les bobines étant connectées en différentiel.
Le fonctionnement du test de tonalité d'occupation sur la ligne
appelée est clairement illustré sur le schéma (Fig.
64) et est resté pratiquement inchangé, si ce n'est que
le générateur de sonnerie fournissait la tonalité
par l'intermédiaire de la bobine d'induction. Une particularité
mérite d'être soulignée : si la ligne appelée
était occupée, l'aimant privé, trouvant la terre
sur le contact privé, était excité par le courant
résultant. Bien que les curseurs soient posés sur la ligne
appelée, l'interrupteur latéral empêchait tout contact
avec celle-ci. En revanche, si l'abonné appelant attendait que
la ligne appelée soit débranchée, il pouvait appuyer
sur la touche de sonnerie et obtenir la connexion sans autre manipulation
du cadran. Puisque la clé de sonnerie mettait à la terre
la ligne verticale, elle tirait le relais vertical et l'aimant vertical.
Le cliquet de l'aimant vertical ne pouvait pas agir sur l'arbre de l'aimant
vertical à cause d'une came, mais son armature pouvait tirer
sur la tige R et, grâce au ressort D, soulever le levier rigide
M de l'armature de l'aimant privé.
En laissant l'extrémité du levier de l'interrupteur latéral,
S, glisser vers la droite comme indiqué par la flèche,
déplaçant ainsi tous les éléments de l'interrupteur
latéral, 1, 2, 3 et 4. En maintenant la touche de sonnerie enfoncée,
le relais de sonnerie est activé.
Le schéma de câblage du central entre les commutateurs
est illustré à la figure 65.
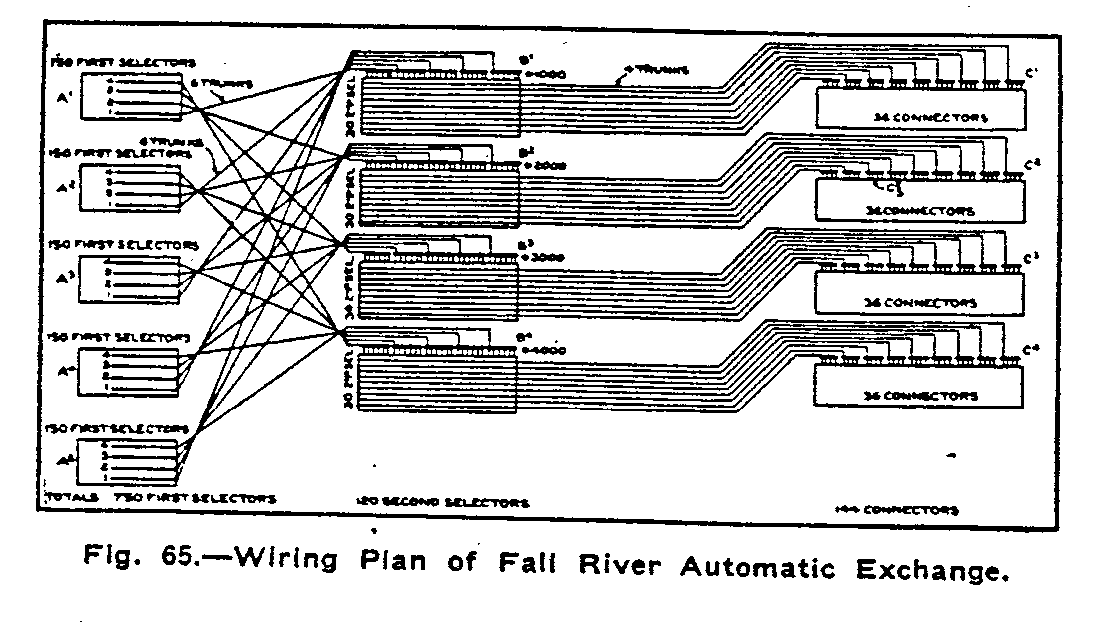
Les premiers sélecteurs étaient regroupés en cinq
groupes de 150 commutateurs chacun, soit un total de 750 lignes desservies.
Quatre milliers étaient fournis : 1 000, 2 000,
3 000 et 4 000, représentés par quatre groupes
de seconds sélecteurs, chacun contenant 30 commutateurs. Chaque
groupe était subdivisé en cinq groupes de six seconds
sélecteurs chacun. Chaque groupe de six desservait l'un des groupes
de premiers sélecteurs : A', A', A'. Ainsi, pour chaque
premier sélecteur de A', seuls les premier, deuxième,
troisième et quatrième éléments de sa banque
étaient câblés ; les autres étaient
hors service. Chaque niveau opérationnel comportait six lignes
principales, et chaque groupe de six lignes principales reliait un groupe
de six seconds sélecteurs du millier correspondant (B', B', B').
Chacune des lignes principales se terminait en groupes B par un second
sélecteur particulier. La banque de chaque second sélecteur
comportait neuf niveaux câblés, chaque niveau comportant
quatre lignes principales. Chaque groupe de quatre lignes principales
était relié au groupe de connecteurs approprié
du millier auquel il appartenait : chaque millier comportait neuf
groupes de quatre connecteurs 3G. Chaque ligne principale d'un groupe
de quatre lignes principales se terminait par un connecteur particulier
d'un groupe de quatre lignes principales. Les banques de ces quatre
connecteurs étaient multipliées vers les lignes des mêmes
abonnés, de sorte qu'un abonné appelant pouvait joindre
la station souhaitée dans ce groupe de manière identique
sur n'importe laquelle des quatre lignes principales.
Le fonctionnement était le suivant :
Supposons qu'un abonné en A' souhaite appeler le numéro
2348. Lors de la première action sur le cadran, son premier sélecteur
en A' se positionne au deuxième niveau et tourne automatiquement
jusqu'à ce qu'il trouve une ligne non occupée vers B'.
Il est ainsi connecté à l'un des seconds sélecteurs
du sous-groupe E'. L'actionnement du cadran pour le deuxième
chiffre fait monter les curseurs du second sélecteur au troisième
niveau et les fait tourner automatiquement jusqu'à ce qu'un contact
soit établi avec une ligne non occupée vers le groupe
C'.
La troisième action sur le cadran fait monter le connecteur au
quatrième niveau et la dernière action fait tourner les
curseurs jusqu'au huitième contact de ce niveau.
Une caractéristique intéressante du tableau de Fall River
était la connexion entre les systèmes automatique et manuel,
bien qu'elle n'ait pas été réalisée simultanément.
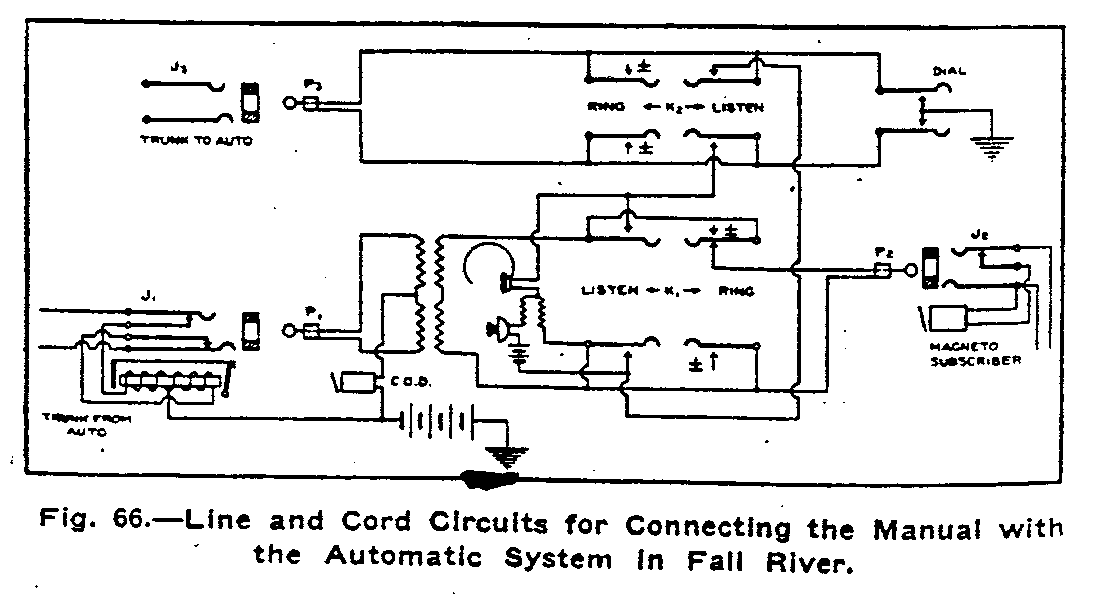
La figure 66 présente les éléments essentiels des
circuits de ligne et de cordon. J est la prise de ligne, avec une dérivation,
pour l'abonné magnéto.
La ligne est câblée de la manière habituelle pour
la prise trois points utilisée. Les appels locaux entre abonnés
magnéto étaient établis sur les circuits de cordon
magnéto habituels, si bien connus qu'il n'est pas nécessaire
de les décrire ici. Le cordon spécial pour connecter les
abonnés automatiques à ceux dont les lignes aboutissaient
au tableau manuel comportait deux fiches, P et P. La première
était connectée directement à une extrémité
d'une bobine répétitive, dont le centre était relié
à la batterie par l'intermédiaire de la dérivation
de dérivation, l'autre extrémité de la batterie
étant mise à la terre. L'autre extrémité
de la bobine répétitive était connectée
à P, par l'intermédiaire des touches d'écoute et
de sonnerie, K, et était conçue pour être insérée
dans la prise magnéto I. Un cordon spécial était
fourni pour actionner le commutateur automatique. Le cadran, représenté
par ses deux ressorts et sa masse, était relié à
la prise P par l'intermédiaire de la touche d'écoute et
de sonnerie K.
La ligne est câblée de la manière
habituelle pour la prise trois points utilisée. Les appels locaux
entre abonnés magnéto étaient établis sur
les circuits de cordon magnéto habituels, si bien connus qu'il
n'est pas nécessaire de les décrire ici. Le cordon spécial
permettant de connecter les abonnés automatiques à ceux
dont les lignes aboutissaient au tableau manuel comportait deux fiches,
P et P. La première était connectée directement
à une extrémité d'une bobine répétitive,
dont le centre était relié à la batterie par l'intermédiaire
de la dérivation de dérivation, l'autre extrémité
de la batterie étant mise à la terre. L'autre extrémité
de la bobine répétitive était connectée
à P, par l'intermédiaire des touches d'écoute et
de sonnerie, K, et était conçue pour être insérée
dans la prise magnéto I. Un cordon spécial était
fourni pour actionner le commutateur automatique. Le cadran, indiqué
par ses deux ressorts et sa masse, était relié à
la touche d'écoute et de sonnerie, K, à la prise P.
Le fonctionnement était le suivant : supposons qu’un
abonné en A' souhaite appeler le numéro 2348. Lors de
la première action sur le cadran, son premier sélecteur
en A' se positionne au deuxième niveau et tourne automatiquement
jusqu’à ce qu’il trouve une ligne non occupée
vers B'. Il est ainsi connecté à l’un des seconds
sélecteurs du sous-groupe E'. L’actionnement du cadran pour
le deuxième chiffre fait monter les curseurs du second sélecteur
au troisième niveau et les fait tourner automatiquement jusqu’à
ce qu’un contact soit établi avec une ligne non occupée
vers le groupe C'.
La troisième action sur le cadran fait monter le connecteur au
quatrième niveau et la dernière action fait tourner les
curseurs jusqu’au huitième contact de ce niveau.
Une caractéristique intéressante du tableau de Fall River
était la connexion entre les systèmes automatique et manuel,
bien qu’elle n’ait pas été réalisée
simultanément.
Le poste téléphonique de l'opératrice présentait
la particularité d'utiliser un contact à clé pour
fermer le circuit primaire. Il était donc nécessaire de
connecter un côté de tous les circuits de câbles
au point J.f, ce qui, on le soupçonne, avait tendance à
produire de la diaphonie. Les lignes principales entrantes du central
automatique étaient terminées par des prises et des dérivations,
comme en J. La prise était de type quatre points, de sorte que
l'insertion de la fiche coupait complètement la dérivation.
La dérivation comportait au centre de son enroulement une prise
connectée à la batterie. Les lignes principales destinées
aux communications unidirectionnelles vers le central automatique étaient
terminées par des prises comme I..
Lorsqu'un appel provenait du standard automatique, le courant de sonnerie
du connecteur dérivait la dérivation associée à
I. L'opératrice, voyant la dérivation, répondait
par la prise P. Après avoir obtenu le numéro, à
l'aide de la touche K, elle se connectait à la ligne appelée
J et sonnait. Une fois la conversation terminée, l'abonné
automatique raccrochait, mettant ainsi à la terre les deux extrémités
de la ligne. Le courant circulait alors dans les deux quarts de la bobine
répétitive et dans la chute de déconnexion, donnant
ainsi à l'opératrice manuelle le signal de déconnexion
au moment même où les interrupteurs automatiques étaient
relâchés. Un appel d'un abonné souhaitant se connecter
au système automatique était reçu par un cordon
magnéto ordinaire. Lorsqu'elle constatait que le tableau automatique
était requis, l'opératrice débrancherait son téléphone
du cordon, le laissant branché sur la prise T. Elle insérait
la fiche spéciale P dans la ligne de départ J et composerait
le numéro souhaité. La sonnerie se faisait avec la touche
K, le courant de sonnerie n'étant pas suffisant pour actionner
les relais des commutateurs. La fiche spéciale était ensuite
débranchée et la connexion établie avec le cordon
magnéto. Une fois la conversation terminée, l'abonné
magnéto raccrochait et raccrochait, éliminant ainsi la
prise de déconnexion. L'opératrice manuelle déconnectait
la connexion et la raccrochait en appuyant sur une touche spéciale
qui mettait à la terre les deux extrémités de la
ligne, selon les besoins.
sommaire
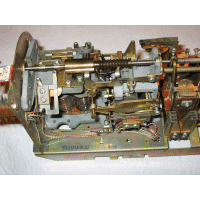
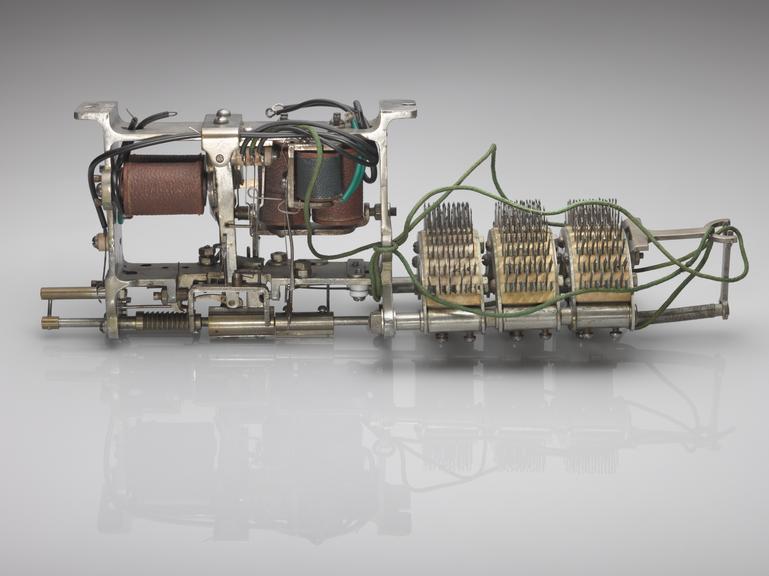 .
Document cours en
pdf
.
Document cours en
pdf
Commutyateur
Strowger original de Keith du Science Museum de Londres, vers 1898
1902
Le réseau de Chicago
Après la construction du Fall River Board, l'installation importante
suivante se fit à Chicago, dans l'Illinois. L'Illinois Tunnel
Company avait obtenu
une concession pour la construction de passages souterrains pour les
lignes téléphoniques.
Le choix se porta sur un équipement automatique pour le central.
Il était prévu de desservir uniquement le quartier d'affaires
du centre-ville, connu sous le nom de « Loop »,
délimité par les rues Lake et Van Buren, ainsi que par
les avenues Wabash et Fifth.
L'installation du standard téléphonique débuta
le 20 décembre 1902. Des commutateurs pour 10 000 lignes
furent installés, constituant ainsi le plus grand autocommutateur
automatique jamais installé à cette date, en février
1902.
À Chicago, une exigence particulière rendit le travail
des automaticiens plus difficile qu'à New Bedford ou à
Fall River. La Chicago Telephone Co. offrait au public et exploitait
avec succès un service tarifé sur un bon standard manuel
à batterie standard. De toute évidence, aucun système
à tarif fixe ne pouvait convenir ici. Les automaticiens devaient
également compter leurs factures. Mais avec leur énergie
habituelle, ils s'étaient attaqués au problème
et avaient mis au point un système répondant à
leurs besoins.
Nous aborderons d'abord le fonctionnement normal et ses caractéristiques,
en abordant les points particuliers au fur et à mesure qu'ils
se présenteront. L'émetteur du poste (cadran), avec son
crochet et ses ressorts de déclenchement, est représenté
en position normale sur la figure 67.
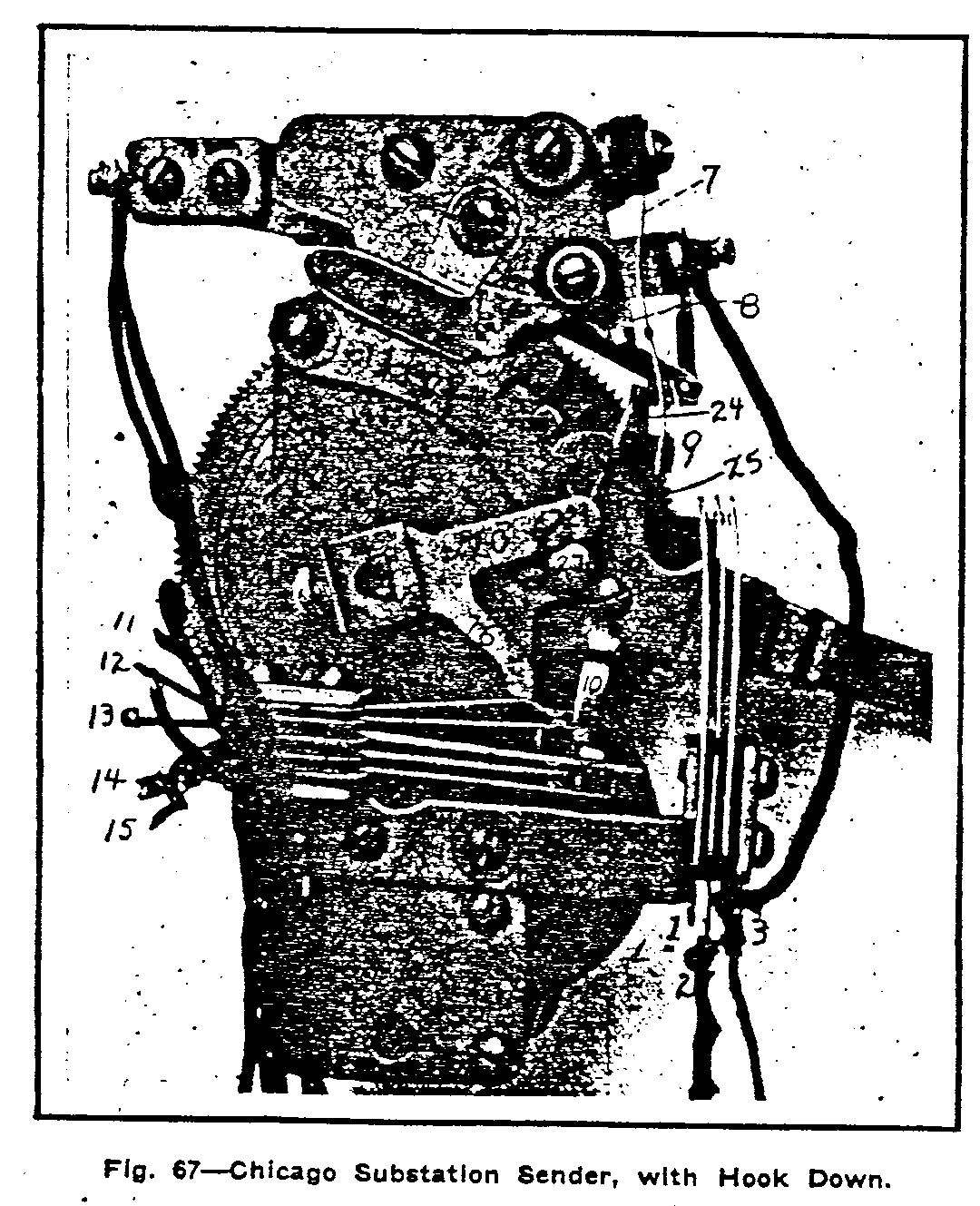
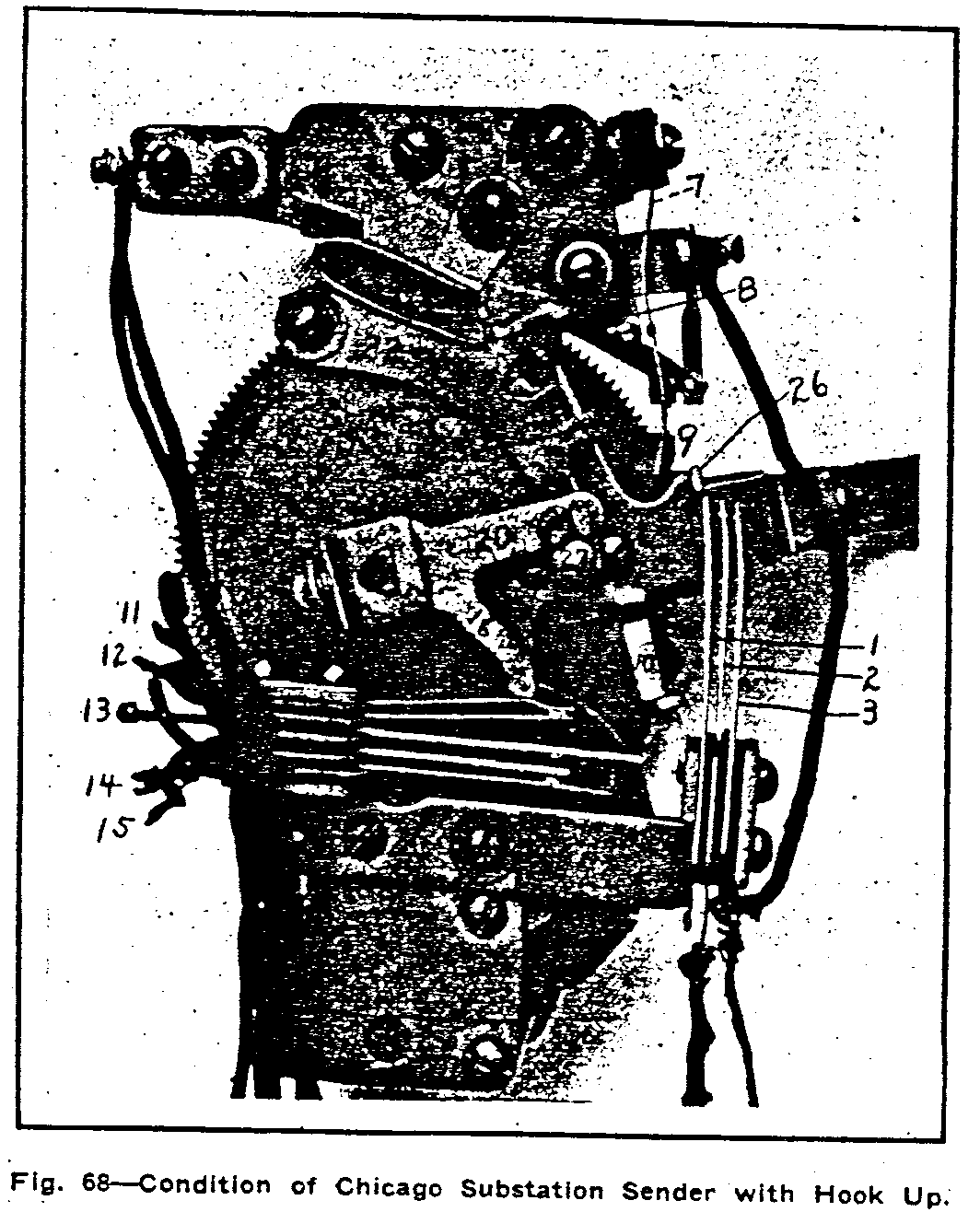
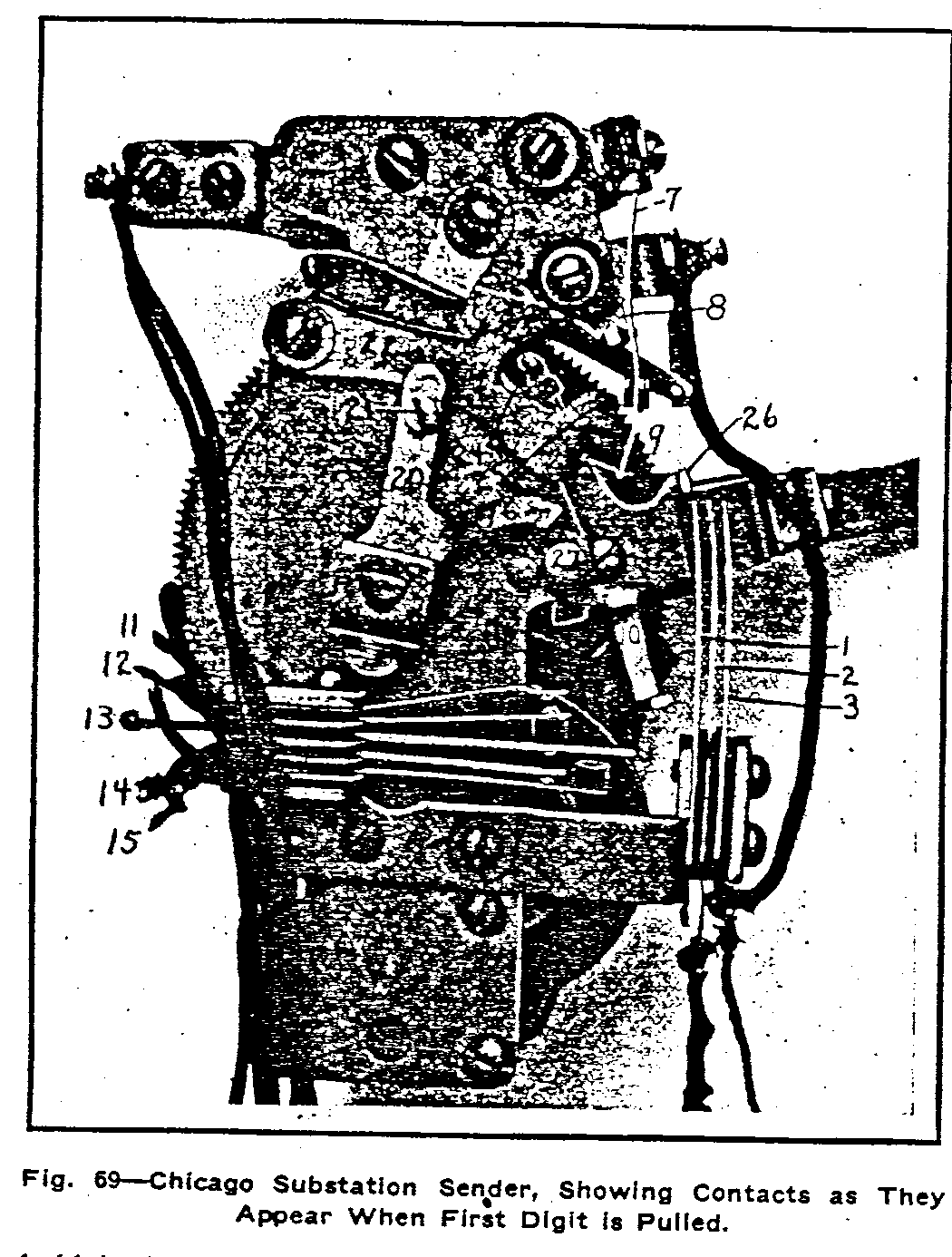
Une partie du levier du crochet est représentée à
droite. Il est isolé du cadre.
Cinq ressorts de crochet sont représentés en 11, 12, 13,
14 et 15. Le ressort 11 est relié en permanence au châssis
et porte la ligne verticale. L'ergot 10, situé sur la partie
du levier du crochet reliée au châssis, actionne le long
ressort 13 qui, grâce à l'isolation en caoutchouc, actionne
également les ressorts 12 et 15, en haut et en bas. Le bras incurvé
16, fixé à l'axe du cadran, repose normalement sur le
ressort 11 et sert de butée à ce dernier. Le levier droit
20 est réalisé d'une seule pièce avec le levier
16 et porte un axe 21 dont seule la tête de vis est visible, l'axe
étant situé à l'arrière du levier. La force
du ressort du cadran fait reposer le levier 20 contre la butée
27. Le levier de forme irrégulière 22 est pressé
vers le bas par un ressort. L'extrémité inférieure
de la broche 22 verrouille la goupille 21 du levier 20, empêchant
ainsi la rotation du cadran jusqu'à ce que le récepteur
soit décroché. Ce verrouillage du cadran constituait une
étape supplémentaire dans le processus visant à
rendre l'émetteur automatique infaillible.
Le ressort de masse (7) est maintenu en contact avec la masse de l'instrument
(8) par l'isolant (9) reposant sur la broche 25, l'extrémité
du levier 22. La force du ressort du cadran maintient le levier 20 contre
la masse.
Lorsque le récepteur est décroché, le levier se
lève, comme illustré à la figure 68.
L'ergot 24 du levier pousse sur une broche 23, soulevant le levier 22
de forme irrégulière, ce qui déverrouille le cadran.
On remarque que les ressorts 11 et 12 se sont fermés, tout comme
les ressorts 14 et 15. Lorsque le cadran est tourné en tirant
sur le premier chiffre, 69, plusieurs changements se produisent. Le
levier incurvé 16 s'est détaché du ressort 11,
permettant à ce dernier de rompre sa connexion avec 12, coupant
ainsi la connexion entre la verticale et le moteur rotatif via le dispositif
de communication. La goupille 21 du levier 20 a soulevé le levier
22, de sorte que son extrémité 25 ne maintient plus le
ressort de masse 7. Cela permet à 7 d'entrer en contact avec
8, mettant à la terre le fil de terre de l'instrument local qui
alimente les ressorts d'impulsion, le bouton de sonnerie et les ressorts
de déclenchement. Les deux ressorts d'impulsion ne sont pas clairement
visibles. Les ressorts de déclenchement se trouvent à
droite : 1 est le ressort vertical, 2 le ressort rotatif et 3 la
masse de l'instrument local ... sur le ressort 1, rapprochant momentanément
les trois ressorts.
Lors de la remontée, l'ergot 26 écarte le ressort 1 du
support et ils n'établissent plus de contact. En raccrochant,
l'ergot 24 repousse le ressort de masse 7 vers la droite et laisse l'œillet
22 s'y glisser pour le maintenir. L'appareil est ainsi remis dans l'état
de la figure 67.
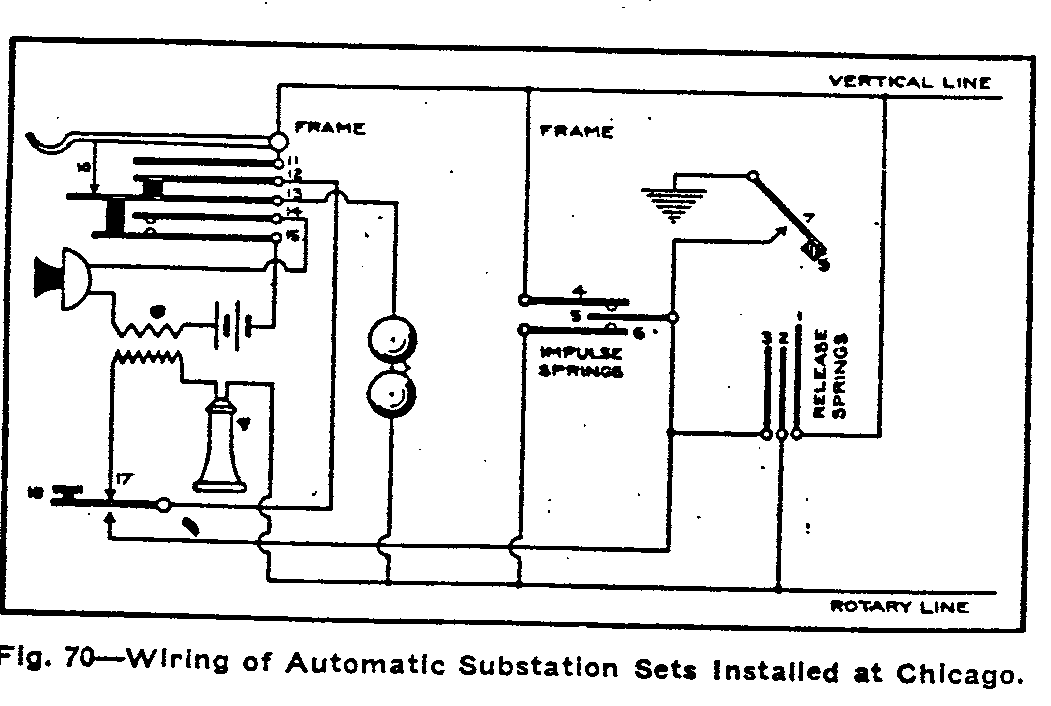
La figure 70 montre le câblage du poste. La ligne rotative
est le retour commun des circuits de sonnerie et de communication de
l'appareil, la sonnerie et le récepteur y étant reliés
en permanence.
Lorsque le récepteur est raccroché, seule la sonnerie
est connectée à la ligne.
Lorsque le récepteur est connecté, le récepteur
et le secondaire de la bobine d'induction sont connectés à
la ligne à la place de la sonnerie.
Le circuit de batterie local de l'émetteur est également
fermé par les ressorts 14 et 15. Lors de la rotation du cadran,
le levier 16 se détache du ressort 11, séparant les lignes
verticale et rotative, tandis que les ressorts 4 et 6 sont mis à
la masse conformément au code. Ce code est simple et est identique
pour tous les chiffres : il consiste en une série d'impulsions
sur la ligne verticale, suivies d'une impulsion sur la ligne rotative.
Ainsi, l'ancien inverseur et la roue en étoile ont été
supprimés. Pour sonner, on appuie sur le ressort 18 du bouton
de sonnerie, mettant à la masse uniquement la ligne verticale.
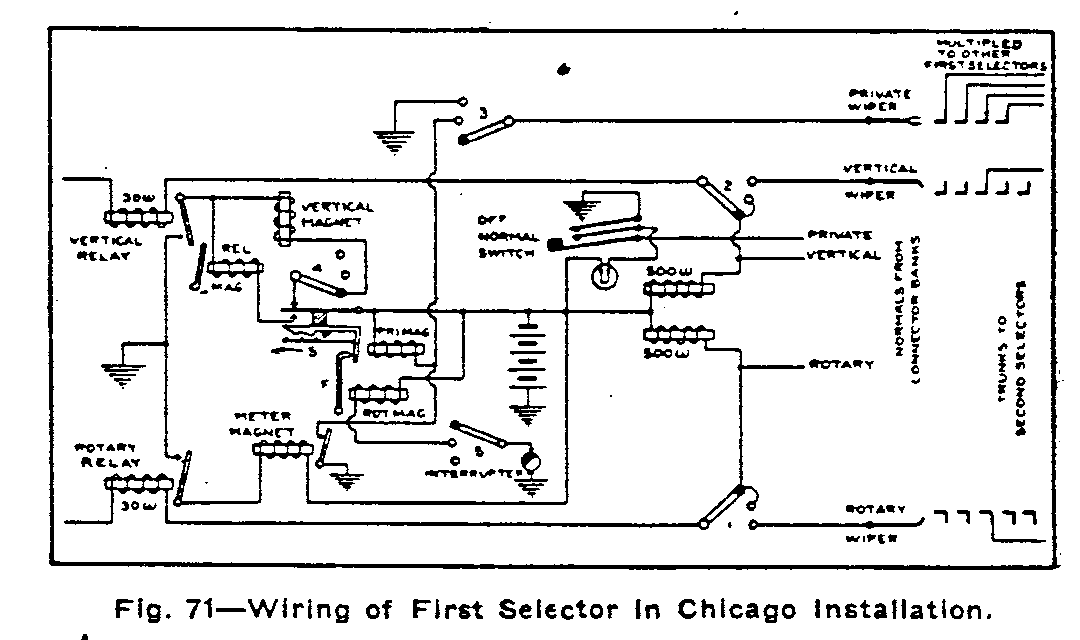
Le premier sélecteur est illustré. Fig. 71. À gauche
se trouvent les lignes verticale et rotative provenant du poste. Chacune
passe par un relais de ligne de 30 ohms, un levier de commutation latéral
et une bobine de retard de 1 500 ohms vers la borne négative
de la batterie, dont la borne positive est mise à la terre. La
tension avoisinait les 55 volts. Le relais vertical commande l'aimant
vertical ou, si l'aimant principal est excité, l'aimant de déclenchement.
Le relais rotatif commande directement l'aimant du compteur. L'aimant
du compteur agit sur un registre de messages mécanique, ou compteur,
fixé au châssis du sélecteur. L'aimant du compteur
porte un contact permettant de mettre à la terre l'aimant principal
et donc de le faire fonctionner. Le relais rotatif commande donc les
deux aimants simultanément. L'aimant rotatif possède un
doigt qui touche l'armature de l'aimant principal, de sorte que le premier
actionne le second. Les interruptions pour l'aimant principal sont générées
par À partir d'un ensemble de ressorts actionnés par un
moteur qui tourne en permanence.
Les différents éléments de l'interrupteur latéral
sont numérotés 1, 2, 3, 4 et 5 et sont représentés
dans leur position initiale. Dans la machine, ils sont assemblés
mécaniquement, se déplaçant tous ensemble et sont
commandés par l'extrémité d'un levier, S, situé
dans les ressorts de l'aimant principal. Un ressort tend à déplacer
le levier S de l'interrupteur latéral dans le sens de la flèche,
ce qui déplace tous les éléments vers les deuxième
et troisième positions. Si l'aimant principal est excité,
S glisse devant une dent du ressort inférieur, mais est bloqué
par la dent du bras supérieur avant d'avoir atteint la distance
nécessaire pour actionner les contacts de l'interrupteur. Lorsque
l'aimant principal est relâché, S glisse vers la gauche
jusqu'à la deuxième dent du ressort inférieur,
amenant ainsi chaque élément vers sa deuxième position.
Cette action du dispositif de commutation auxiliaire, par laquelle le
fait de relâcher l'aimant privé au lieu de le tirer vers
le haut actionne l'interrupteur latéral, doit être gardée
à l'esprit, car elle apparaît dans tous les interrupteurs
ultérieurs de la gamme Strowger, et il n'est pas nécessaire
de la décrire à nouveau.
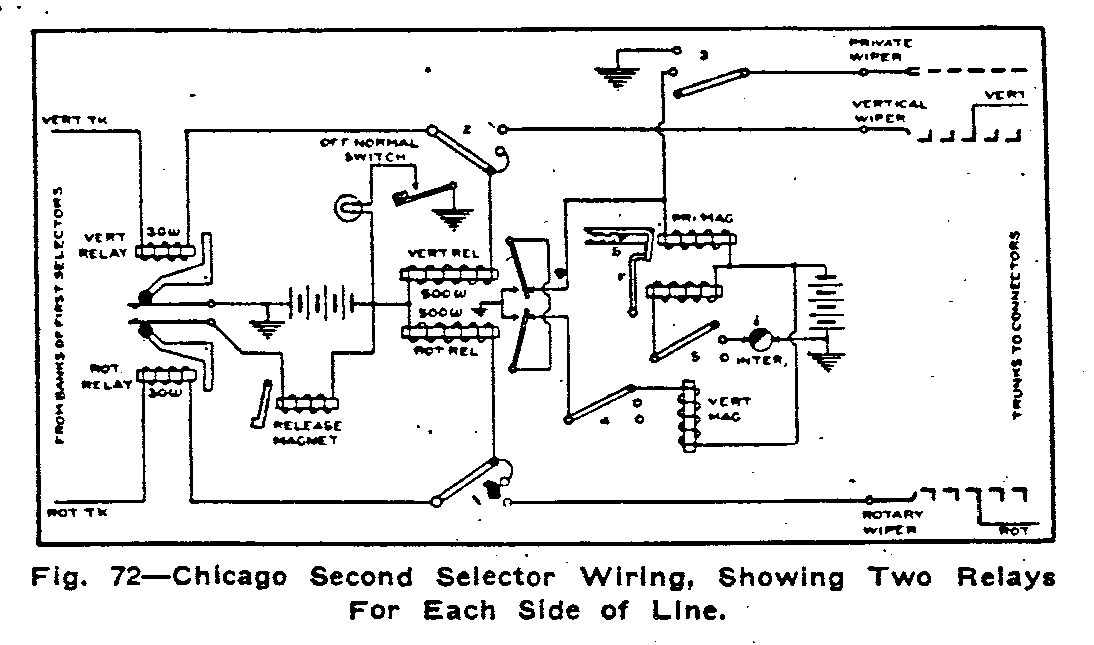 La figure
72 présente le deuxième sélecteur avec quelques
nouvelles fonctionnalités.
La figure
72 présente le deuxième sélecteur avec quelques
nouvelles fonctionnalités.
Il comprend deux relais de ligne verticaux et deux relais rotatifs,
se distinguant par leurs résistances respectives de 30 et 500
ohms. Les relais de 30 ohms sont montés mécaniquement
ensemble, chacun doté d'un seul ressort. Leur actionnement simultané
est nécessaire pour les rapprocher, aucun des deux relais ne
déplaçant son ressort suffisamment pour toucher l'autre.
Ceci permet d'actionner l'aimant de déclenchement.
Les relais de 500 ohms sont chargés de piloter le mécanisme
de sélection. Le relais vertical de 500 ohms commande l'aimant
vertical. Le relais rotatif de 500 ohms commande l'aimant privé.
Le circuit commandé par chaque relais passe par le contact arrière
de l'autre relais, de sorte que si les deux relais sont actionnés
simultanément, rien ne sera affecté.
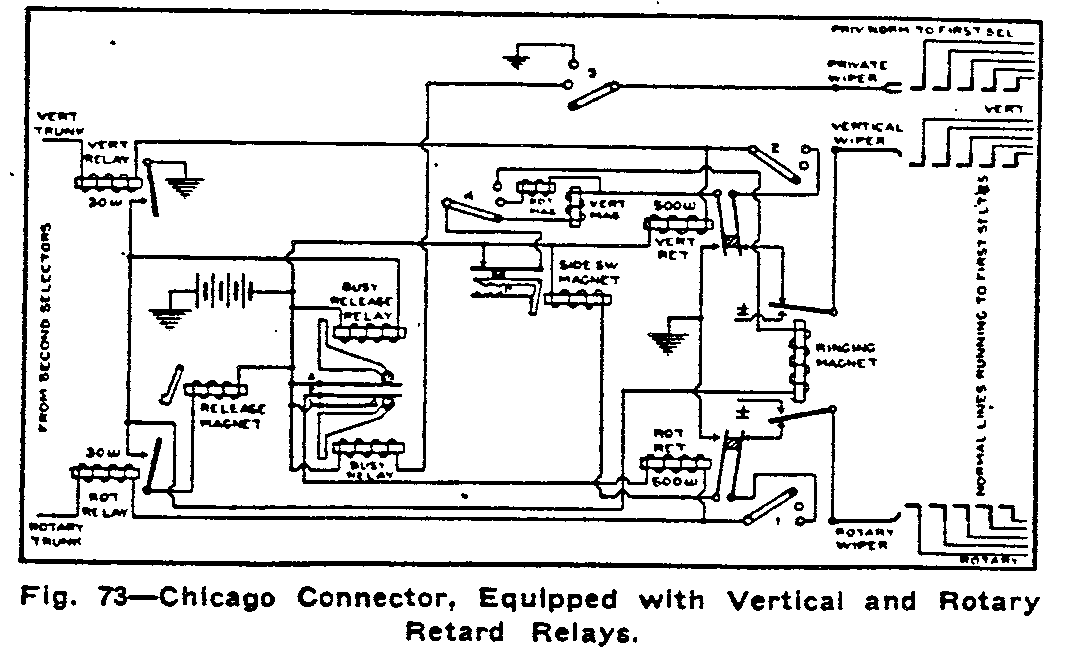
Le connecteur est illustré à la figure
73. Là encore, les relais verticaux et rotatifs de 30 ohms ne
remplissent pas leurs fonctions habituelles, leur rôle étant
délégué à d'autres relais de 500 ohms chacun,
en série avec eux. On les appelle respectivement retardateurs
verticaux et retardateurs rotatifs. La ligne verticale est connectée
en permanence à la batterie, mais la ligne rotative, après
avoir traversé le relais rotatif et le retardateur rotatif, passe
par un contact du relais d'occupation pour se connecter à la
batterie. Le retardateur vertical coupe la ligne verticale et met à
la terre les aimants verticaux et rotatifs. Le retardateur rotatif coupe
la ligne rotative et met à la terre l'aimant de l'interrupteur
latéral. Ce dernier est identique à l'aimant privé
des interrupteurs précédents, sauf qu'il ne se trouve
pas dans le circuit d'alimentation du curseur privé, cette fonction
étant ici assurée par le relais d'occupation.
Le levier n° 4 de l'interrupteur latéral sert de distributeur
de batterie aux aimants verticaux et rotatifs et à l'aimant de
sonnerie. En plus d'actionner l'interrupteur latéral, l'aimant
de l'interrupteur latéral coupe la batterie de l'interrupteur
latéral 4 lorsque cela est nécessaire. Le relais d'occupation
et le relais de libération d'occupation ont une relation mécanique
similaire à celle des relais verticaux et rotatifs du deuxième
sélecteur.
Si le relais de libération d'occupation est actionné,
le ressort A se déplace d'un peu plus de la moitié vers
le ressort B. Le relais d'occupation doit être mis sous tension
simultanément pour les rapprocher.
Comme expliqué précédemment, le code des signaux
envoyés par l'émetteur de la sous-station consiste en
une série d'impulsions sur la ligne verticale, suivie d'une sur
la ligne rotative. Ceci est répété pour chaque
chiffre. La première série est gérée par
le premier sélecteur (Fig. 71). Le relais vertical met à
la terre l'aimant vertical, déplaçant le curseur jusqu'au
niveau souhaité. Une seule impulsion sur la ligne rotative actionne
le relais rotatif, qui actionne à la fois l'aimant du compteur
et l'aimant privé. Ce dernier amène les leviers de l'interrupteur
latéral en deuxième position, ou position médiane.
Les leviers 1 et 2 n'effectuent aucun changement. Le levier 3 relie
l'aimant privé à la batterie, via l'aimant privé,
pour servir de palpeur pour les lignes non occupées. Le levier
4 coupe l'aimant vertical, tandis que le levier 5 relie l'interrupteur
(masse) à l'aimant rotatif.
Le premier mouvement de l'aimant rotatif, tout en faisant tourner les
racleurs en contact avec la première ligne, pousse l'armature
de l'aimant privé contre sa pièce polaire. Si la première
ligne est occupée, il y aura une masse sur son contact privé,
et l'aimant privé sera maintenu par le courant résultant.
Mais en frappant la première ligne non occupée, le racleur
privé ne trouve pas de masse, l'aimant privé se libère,
ramenant l'interrupteur latéral en troisième position
et coupant le courant de l'aimant rotatif. Les leviers 1 et 2 relient
les lignes rotatives et verticales aux lignes principales menant au
deuxième sélecteur, tandis que le levier 3 déconnecte
l'aimant privé du curseur privé, le mettant à la
terre pour le protéger des autres premiers sélecteurs
qui pourraient tenter d'accéder à la même ligne
principale. Le premier mouvement ascendant de l'axe du curseur ferme
l'interrupteur de coupure de ligne, mettant ainsi à la terre
le curseur privé, de sorte que les appels entrants vers cet abonné
reçoivent un signal d'occupation.
La deuxième série d'impulsions affecte le deuxième
sélecteur. Fig. 72.
Comme indiqué précédemment, les relais verticaux
et rotatifs de 30 ohms n'ont aucun rôle dans la sélection,
servant uniquement au déclenchement. Ils seront donc négligés
lors de notre appel.
Lorsque la série d'impulsions est transmise sur la ligne verticale,
le relais vertical de 500 ohms met à la terre l'aimant vertical,
amenant l'axe du curseur au niveau approprié. L'impulsion unique
sur le commutateur rotatif soulève le relais rotatif de 500 ohms,
ce qui amène l'aimant privé à déplacer l'interrupteur
latéral en deuxième position. Aucun changement n'est effectué
aux leviers 1 et 2. En 3, l'aimant privé est connecté
à l'aimant privé pour servir de palpeur, comme dans le
premier sélecteur. Le levier 4 déconnecte l'aimant vertical,
tandis que le levier 5 connecte l'interrupteur à l'aimant rotatif.
Le test et la sélection d'une ligne non occupée sont identiques
à ceux du premier sélecteur.
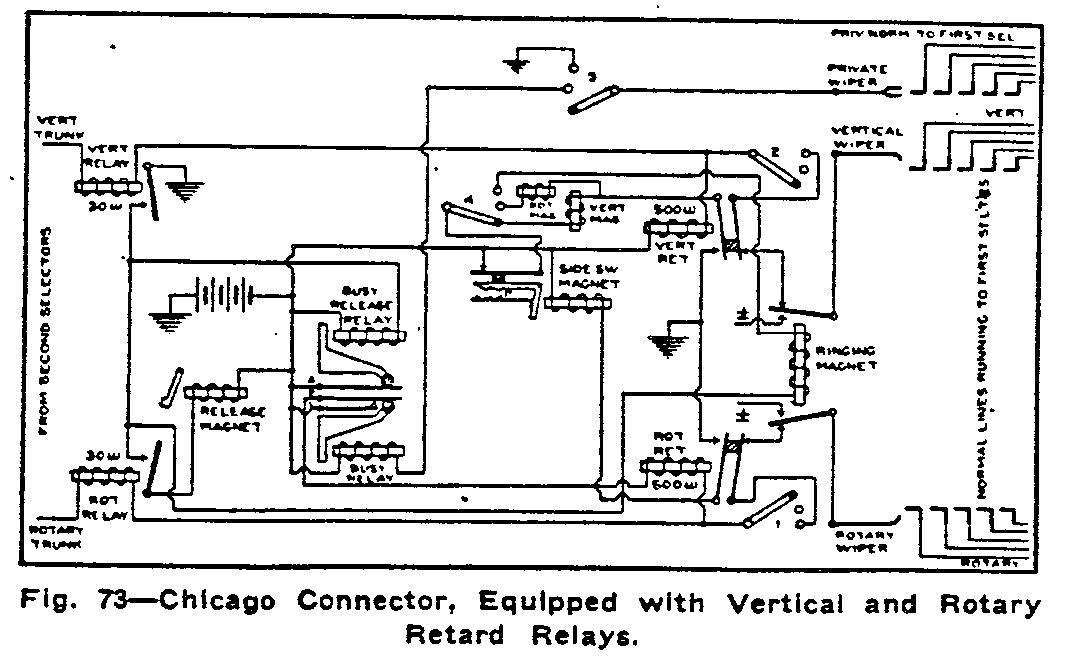
Le connecteur (Fig. 73) prend en charge les deux derniers chiffres,
les dizaines et les unités. Le relais vertical actionne le relais
de libération d'occupation, mais si son homologue, le relais
d'occupation, n'est pas excité, rien ne se produit, car le ressort
A ne peut pas toucher B. Lors de son accélération, le
relais vertical ne peut pas affecter l'aimant de sonnerie, bien qu'il
y soit connecté, car son circuit est ouvert au niveau du levier
de l'interrupteur latéral 4. À la réception de
la série d'impulsions verticales correspondant au chiffre des
dizaines, le retardateur vertical met à la terre l'aimant vertical
un certain nombre de fois, ce qui fait monter l'axe du balai. La mise
à la terre suivante sur le commutateur rotatif excite le retardateur
rotatif, ce qui fait passer l'aimant de l'interrupteur latéral
en deuxième position.
Au levier 1, cette action connecte la tonalité d'occupation à
la ligne rotative, mais comme l'abonné n'écoute pas, elle
est sans effet pratique. Le levier 2 n'entraîne aucun changement.
Le levier 3 connecte le curseur privé à la batterie via
le relais d'occupation, de sorte que si la ligne appelée est
occupée, elle sera protégée. Le levier 4 déplace
la batterie de la verticale vers l'aimant rotatif.
La série d'impulsions des unités actionne le retardateur
vertical, mettant à la terre l'aimant rotatif et tournant vers
la ligne appelée. La dernière impulsion sur la ligne rotative
tire le retardateur rotatif vers le haut, ce qui amène l'aimant
du commutateur latéral à le ramener à sa dernière
position. Aux leviers 2 et 1, cette action connecte les lignes verticale
et rotative aux curseurs correspondants, qui reposent sur la ligne appelée.
Au niveau du curseur privé, il est commuté depuis le relais
d'occupation et connecté à la terre, rendant la ligne
occupée par rapport aux autres lignes. Au 4, la batterie est
commutée de la rotative vers l'aimant de sonnerie. En appuyant
sur le bouton de sonnerie du poste, la ligne verticale est mise à
la terre, ce qui active à la fois le relais vertical et le retardateur
vertical. Ce dernier n'a aucun effet. Le relais vertical met alors à
la terre l'aimant de sonnerie, qui projette un courant alternatif sur
la ligne appelée, coupant la ligne située derrière
lui, comme avec la touche de sonnerie manuelle. Si la ligne appelée
est occupée, l'effet est le suivant : supposons que nous soyons
à ce stade de la sélection de l'emplacement où
les curseurs, sous l'influence des impulsions verticales, tournent pour
trouver la ligne appelée. L'interrupteur latéral est en
deuxième position, ou position médiane, de sorte que la
batterie est connectée au curseur privé via le relais
d'occupation. La ligne appelée, étant occupée,
aura la terre sur son contact privé. À cet endroit, notre
relais d'occupation sera activé, coupant la batterie de la ligne
rotative. La série d'impulsions verticales est suivie d'une impulsion
sur le bouton rotatif, mais comme la batterie est coupée, cette
dernière impulsion ne se produit pas, car le circuit n'est pas
complet. L'interrupteur latéral est donc laissé en position
médiane.
L'abonné appelant, ignorant ce fait, appuie sur le bouton d'appel,
mettant à la terre la ligne verticale. Le relais vertical est
remonté, actionnant le relais de libération d'occupation.
Lorsque le relais d'occupation est alimenté par la terre sur
l'essuie-glace privé, le ressort A touche le ressort B, remettant
la batterie sur la ligne rotative ; mais cela ne bouge rien. Le
retardateur vertical, remontant, actionne l'aimant rotatif, déplaçant
les essuie-glaces de la ligne occupée vers le numéro supérieur.
Ensuite, tout en attendant la réponse de l'abonné appelé,
l'abonné appelant entend la tonalité d'occupation via
le contact central du commutateur latéral 1.
Si la ligne sur laquelle les essuie-glaces ont été connectés
est également occupée, le relais d'occupation reste alimenté,
ce qui coupe la ligne rotative. Cela empêcherait la libération,
sans le relais de libération d'occupation. Lorsque l'abonné
appelant infructueux met à la terre les deux lignes pour libérer,
le relais vertical relève le relais de libération occupé,
rétablissant ainsi la batterie de la ligne rotative. Cette dernière
étant à la terre à cet instant au poste, le relais
rotatif se relève, actionnant l'aimant de libération,
ce qui permet à l'axe du balai de revenir à sa position
initiale. L'interrupteur latéral est également réinitialisé
automatiquement par l'aimant de libération.
Le déclenchement normal s'effectue à partir d'une ligne
non occupée, l'interrupteur latéral étant en troisième
position. Il suffit alors que les relais verticaux et rotatifs soient
activés : le premier alimente la masse, le second la relie
à l'aimant de déclenchement. Simultanément, le
retardateur vertical s'active et sonnerait la ligne appelée si
le retardateur rotatif n'activait pas l'aimant de l'interrupteur latéral,
coupant ainsi la batterie du levier 4. Dans les premier et deuxième
sélecteurs, seuls les relais verticaux et rotatifs de 30 ohms
restent sur la ligne et le déclenchement doit s'effectuer par
leur intermédiaire. L'action mécanique mutuelle des relais
verticaux et rotatifs de 30 ohms du deuxième sélecteur
a déjà été décrite. Dans le premier
sélecteur (Fig. 71), le relais rotatif actionne l'aimant
privé. Ce dernier commute la batterie de l'aimant vertical à
l'aimant de déclenchement. Lorsque le relais vertical de 30 ohms
est également alimenté, l'aimant de déclenchement
est mis à la terre par son contact.
Pour faciliter le comptage des messages, dans le système de Chicago,
un compteur était fixé à chaque premier sélecteur.
Il est illustré en détail aux figures 74, 75 et 76.
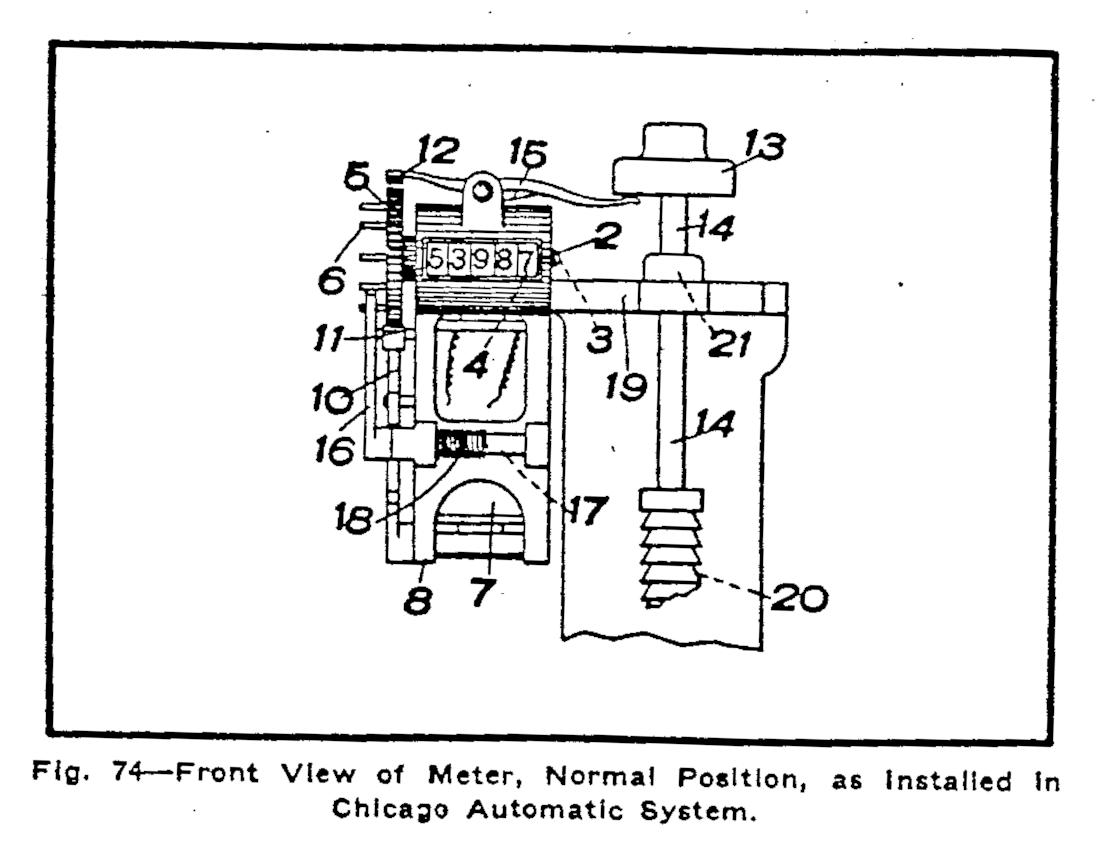
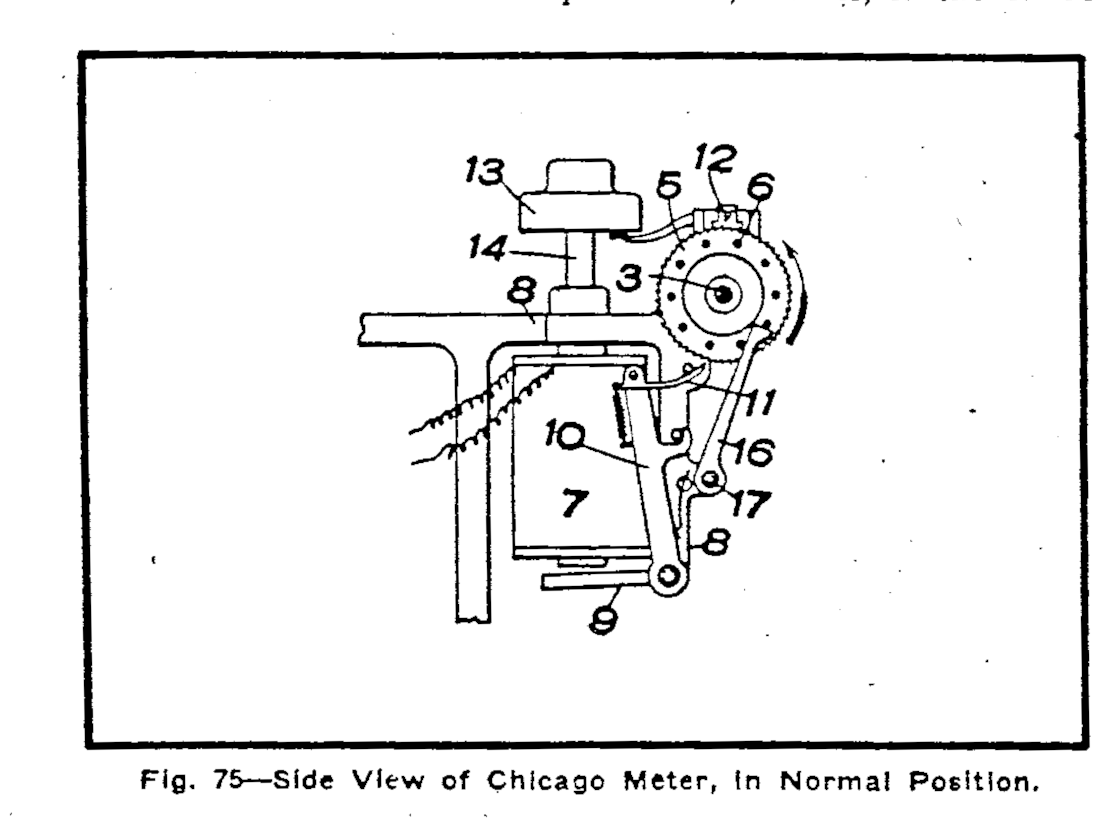
La figure 74 est une vue de face montrant le mécanisme en position
normale. La figure 75 montre le côté gauche, normal, tandis
que la figure 76 montre le côté gauche pendant l'émission
d'un appel.
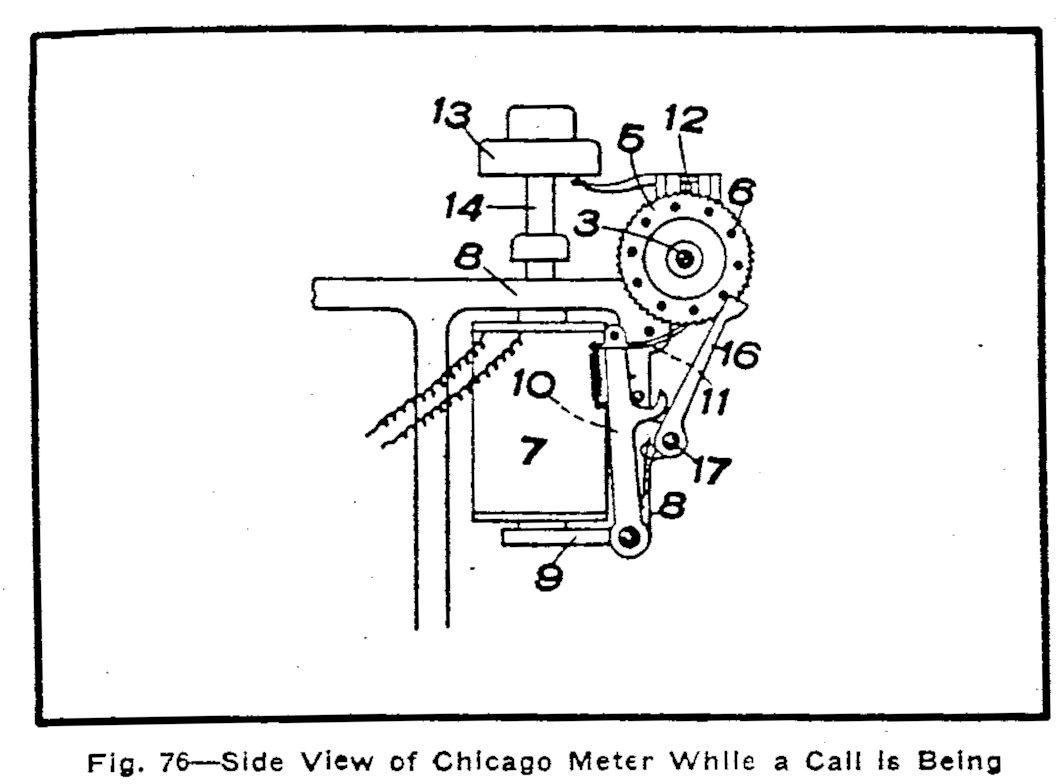
Le compteur, ou registre de messages proprement dit, est constitué
d'un ensemble classique de roues et de cylindres, disposés de
telle sorte que dix tours de l'un sont nécessaires pour entraîner
un tour du suivant. Ce mécanisme ne fait pas partie du registre
de messages, développé par l'inventeur John Erickson,
et n'a rien à voir avec les principes décrits ci-dessous.
À l'extrémité du registre proprement
dit est montée une roue dentée 5. Sur le côté
de la roue se trouvent dix broches 6, chacune représentant un
appel terminé. L'aimant du compteur 7 possède une armature
9 à laquelle est fixé un levier 10 portant un cliquet
11. Ce cliquet est normalement hors de contact avec le bord de la roue
5, mais il est adapté pour la déplacer d'un cran lorsque
l'aimant est excité une fois. Un cliquet 12 est adapté
pour engager les dents de la roue 5 et est maintenu en contact par le
ressort 15. Mais lorsque le premier sélecteur est en position
relâchée ou initiale, la tête de torsion 13 de l'arbre
d'essuie-glace 14 ; appuie sur le levier et soulève 12 de la
roue 5. Un cran 16 est monté sur un arbre 17 avec un ressort
18, disposé de manière à ce que le cran 16 appuie
contre les axes 6 de la roue 5.
Sur la figure 75, le cran est normal et appuie sur l'axe à sa
gauche. Cela tend à faire tourner la roue vers l'arrière,
dans le sens opposé à la flèche, mais la goupille
située juste au-dessus du cran appuie sur l'extrémité
de 16.
Sur la figure 76, la roue est tournée vers l'avant presque suffisamment
pour que le cran 16 tombe sous l'axe. Il lui manque un cran pour ce
faire.
Dans cette position, la pression exercée par le cran sur l'axe
tend à le forcer vers la gauche et à faire tourner la
roue vers l'arrière. Si l'aimant 7 est relâché et
que le cran 12 est soulevé, le cran 16 poussera vers la gauche
et fera tourner la roue vers l'arrière jusqu'à la position
illustrée à la figure 75.
En se référant à la figure 71, on constate que
l'aimant du compteur est fermement relié à la ligne rotative,
où toutes les impulsions sur cette ligne l'alimenteront. Dans
le système 10 000, l'appel terminé comporte cinq
impulsions, une pour chaque chiffre et une pour le relâchement.
Il y a donc cinq dents sur la roue 5 (figure 75) pour chaque axe 6.
Cela représente 50 dents sur toute la roue. En se référant
au connecteur (Fig. 73), on remarque que lorsqu'une ligne occupée
est sélectionnée, le relais d'occupation coupe la batterie
de la ligne rotative. Une seule impulsion rotative est alors perdue,
n'en laissant que quatre. Le registre des messages est basé sur
cette différence. En cas d'appel terminé, c'est-à-dire
si la ligne appelée n'est pas occupée, les cinq impulsions
rotatives déplacent la roue 5 (Fig. 75) de cinq crans, de sorte
que le cran 16 tombe sous la goupille de passage 6, bloquant le compteur
avec l'appel ajouté. En revanche, si la ligne appelée
est occupée, l'aimant du compteur 7 ne reçoit que quatre
impulsions au total. Lors de la dernière des quatre impulsions,
l'impulsion de relâchement, il prend la position de la figure
76. Lorsque cette dernière impulsion cesse, l'arbre d'essuie-glace
14, en chute, presse sa tête de torsion 13 contre le levier du
cran 12, le dégageant des dents de la roue 5.
La pression du cran 16 vers la gauche fait alors tourner la roue vers
l'arrière jusqu'au numéro précédemment enregistré.
En pratique manuelle, il était d'usage de ne pas facturer les
appels si le poste appelé ne répondait pas. Autrement
dit, l'opérateur téléphonique s'engageait à
mettre l'abonné en communication avec le numéro souhaité.
Le système automatique ne pouvait pas aller aussi loin à
ce moment-là, mais, comme indiqué ci-dessus, aucun frais
n'était facturé pour les appels lorsque la ligne appelée
était occupée.
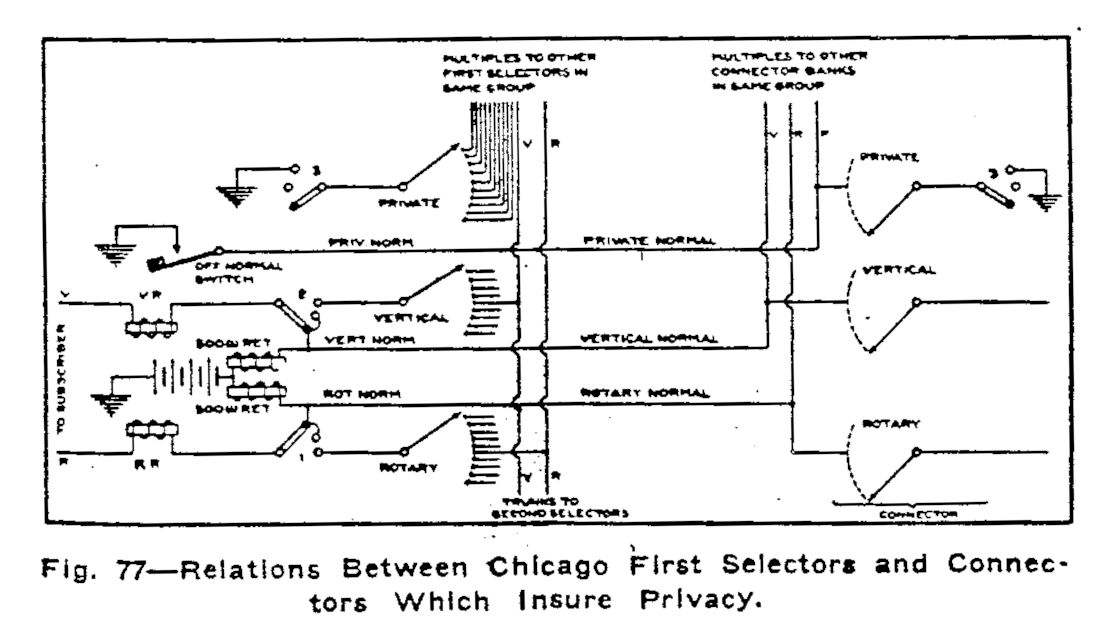
La figure 77 illustre les relations entre les premiers sélecteurs
et les connecteurs garantissant la confidentialité.
À gauche, le schéma montre certaines parties d'un premier
sélecteur. Ce premier sélecteur fait partie d'un groupe,
et leurs rangées sont toutes démultipliées. Les
fils de la rangée privée aboutissent au groupe, reliant
simplement les rangées. Les lignes verticales et rotatives mènent
à d'autres groupes, où elles aboutissent à des
seconds sélecteurs. Lorsqu'une ligne est occupée, le fil
privé correspondant est mis à la terre par le levier de
l'interrupteur latéral 3 en troisième position, et le
curseur privé reposant sur ce contact. Ainsi, tout autre abonné
du groupe trouvera une terre sur le contact privé qui lui est
démultiplié et sera protégé contre toute
interférence. Parallèlement, l'interrupteur de coupure
met à la terre le contact normal privé, provenant du groupe
de connecteurs de droite. Ce groupe est chargé de gérer
tous les appels entrants vers les abonnés dont les premiers sélecteurs
sont à gauche. À partir du premier sélecteur illustré,
les normales verticale et rotative sont reliées aux connecteurs
et sont multipliées aux points correspondants de tous les groupes
de ce groupe. La normale privée est également multipliée
aux contacts correspondants de chaque groupe de connecteurs. Si la ligne
de gauche est occupée suite à un appel, sa masse provient
du commutateur de coupure. Si elle est occupée suite à
un appel via un connecteur de droite, sa masse provient du curseur privé
du connecteur par lequel l'appel est arrivé, car le levier de
l'interrupteur latéral 3 est déplacé vers le point
de masse.
La figure 77 montre également comment l'abonné
appelé peut quitter temporairement l'abonné appelant et
revenir.
Supposons que quelqu'un ait appelé l'abonné dont le premier
sélecteur est représenté. Le connecteur de droite
a effectué le mouvement nécessaire, de sorte que la connexion
est établie grâce aux leviers latéraux 1 et 2 du
premier sélecteur. Pendant que l'abonné appelant attend,
l'abonné appelé de gauche peut déplacer son cadran,
actionnant le premier sélecteur comme s'il n'était pas
connecté, et passer l'appel souhaité. Les leviers 1 et
2 coupent simplement la communication de l'abonné appelant, le
laissant avec la batterie alimentée par les bobines de retardement,
afin qu'il puisse la relâcher s'il se lasse d'attendre. Lorsque
le premier sélecteur est relâché, les leviers 1
et 2 reconnectent l'abonné en attente s'il est toujours présent.
Cette fonctionnalité était considérée comme
très utile. Elle permettait également de se défaire
d'une personne importune au téléphone. L'Illinois Tunnel
Company souhaitait des aménagements spéciaux pour plusieurs
lignes desservant certains de ses bureaux, pour ses besoins professionnels.
Les appels vers ces numéros devaient être gratuits et la
première ligne libre devait être sélectionnée.
Pour répondre à cette demande, un connecteur spécial
a été conçu : le connecteur à sélection
automatique.
Un troisième sélecteur, construit comme un deuxième
sélecteur, aurait pu être utilisé à cette
fin, sans le test d'occupation et la sonnerie. En comparant ce connecteur
spécial avec le connecteur standard (Fig. 73), on remarque les
modifications suivantes : l'aimant rotatif a été
prélevé au milieu de l'interrupteur latéral 4,
relié en permanence à la batterie et doté de son
propre levier latéral 5. Son point central est mis à la
terre. L'aimant rotatif possède son propre ressort interrupteur,
coupant son propre circuit, un peu comme une sonnette de porte classique.
De plus, le doigt F, qui reliait l'armature de l'aimant de l'interrupteur
latéral, a été remplacé, comme dans un sélecteur.
Le fil reliant le milieu du levier latéral 3 au relais d'occupation
est coupé de ce dernier et branché sur l'aimant de l'interrupteur
latéral. Pour appeler l'un des téléphones de l'opérateur
ainsi équipés, il ne fallait que trois chiffres, de sorte
qu'il n'y avait que quatre impulsions rotatives pour l'appel final,
sans aucun enregistrement sur le compteur. Il ne reste plus qu'un seul
chiffre pour agir sur le connecteur. La série d'impulsions verticales
soulève l'axe du balai jusqu'au niveau souhaité. La dernière
impulsion sur le levier rotatif soulève le retardateur rotatif
de 500 ohms, activant et libérant l'aimant de l'interrupteur
latéral. Lorsque l'interrupteur latéral s'enclenche en
deuxième position, le levier 5 met l'aimant rotatif en vibration.
La première pression sur ce dernier presse le doigt F contre
l'armature de l'aimant de l'interrupteur latéral, préparant
l'interrupteur latéral à s'enclencher en troisième
position lorsqu'un point privé non relié à la terre
est atteint. L'aimant rotatif s'arrête alors qu'il est en position
de sélection.
sommaire
Résumé
des événements jusqu'en 1902
Il sera utile, à ce stade, d'examiner certains détails
développés grâce à l'expérience acquise
au fil des ans jusqu'en 1902.
Nous avons vu que les premiers inventeurs ont essayé d'utiliser
des interrupteurs actionnés par des électroaimants, et
que ces aimants moteurs, comme on peut les appeler à juste titre,
étaient placés directement dans la machine. Cette méthode
s'est avérée un échec cuisant. Même le perfectionnement
de l'aimant n'a pas permis d'en faire un succès.
Pour contourner cette difficulté, deux solutions semblaient possibles.
La première consistait à actionner l'interrupteur par
un moteur indépendant et à contrôler ses mouvements
par des aimants, ces derniers ayant une charge très faible.
La seconde consistait à réduire le frottement de l'interrupteur,
à le faire fonctionner par des aimants moteurs sur des circuits
locaux, et à contrôler ces circuits par des relais en ligne.
Le développement de Strowger, qui nous occupe actuellement, suit
cette deuxième ligne d'attaque.
D'autres systèmes, fonctionnent selon le principe de la motorisation
(que nous aborderons plus tard).
Pour distinguer les deux principales classes d'électroaimants,
on utilise les termes « relais » et « aimant ».
Un relais est un électroaimant dont la seule fonction est de
contrôler d'autres circuits, comme le relais vertical, qui commande
l'aimant vertical, ou le relais de sonnerie, qui active le courant de
sonnerie. Un aimant est un appareil qui déplace directement un
appareil, comme l'aimant vertical, qui, par son attraction magnétique,
soulève l'axe de l'essuie-glace, ou l'aimant privé, qui
permet à l'interrupteur latéral de glisser d'un cran à
l'autre, bien que la force motrice provienne d'un ressort. Les aimants
ont généralement une résistance bien inférieure
à celle des relais et nécessitent un courant considérable.
Ces aimants, n'ayant qu'une résistance de 23 ohms et recevant
la pleine tension de la batterie, consommeraient deux ampères
si le courant circulait de manière constante. Mais il est peu
probable qu'un tel courant circule, car ces aimants à faible
résistance sont actionnés par un courant interrompu, qui
n'a probablement pas le temps d'atteindre sa pleine valeur entre Impulsions.
L'aimant doit être rapide et puissant ; le premier pour lui
permettre de suivre les impulsions aussi vite qu'elles arrivent, le
second pour pouvoir déplacer l'appareil rapidement et sûrement.
Pour répondre à ce besoin, on a utilisé une forme
dotée d'un bon circuit magnétique, dont l'entrefer est
aussi petit que possible tout en permettant un mouvement considérable.
L'armature à lame de couteau, telle qu'utilisée actuellement
dans le relais de ligne Western Electric (1908), n'a pas été
un succès, car il y avait trop peu de fer à la lame de
couteau.
L'aimant retenu est en forme de U et comporte deux bobines, une sur
chaque branche. On obtient ainsi un circuit magnétique solide
en fer, sauf au niveau des deux entrefers de l'armature. Le jeu dans
les spires est réduit au minimum, car une légère
perte de jeu est essentielle à une action à grande vitesse.
De plus, le ressort de rappel est appliqué de telle sorte qu'en
position normale, il presse l'armature contre le côté du
palier de pivot, contre lequel il sera pressé par l'excitation
des bobines. La coupure du fort courant requis par cet aimant a produit
un arc électrique destructeur aux contacts du relais de commande.
Ce phénomène a d'abord été atténué
par un shunt non inductif de 150 ohms placé autour de l'enroulement.
Ce phénomène a ensuite été remplacé
par un blindage ou un tube en cuivre sur le noyau. L'utilisation de
contacts en platine s'est avérée impérative. Un
tout nouveau type de relais était également nécessaire.
Les premiers relais commerciaux étaient probablement ceux utilisés
pour le télégraphe. Ils devaient être sensibles,
rapides et ajustables au jour le jour. Leur coût n'est pas limité,
car ils sont utilisés en nombre relativement restreint et ne
représentent qu'une faible part du coût total d'une ligne
télégraphique. Lorsque le système téléphonique
à batterie a commencé à être utilisé,
il a également nécessité des relais, mais d'un
type différent, bien que, pendant un certain temps, le relais
télégraphique ait été mis en service dans
de nombreux endroits. Il n'était pas nécessaire qu'ils
soient rapides. Ils devaient être réglables, mais plutôt
de type à réglage permanent, car les conditions de la
ligne ne devaient pas les affecter autant que le télégraphe.
Mais surtout, les relais téléphoniques à batterie
doivent être aussi bon marché que possible, car leur nombre
peut atteindre des milliers dans un seul bureau. C'est à cette
fin que des relais téléphoniques modernes de différents
types ont été développés. Mais le système
automatique nécessite un autre type de relais, qui se situe en
quelque sorte à mi-chemin entre le télégraphe et
le téléphone. Il doit être rapide et précis,
si possible plus que le relais télégraphique. Ses exigences
de réglage sont les mêmes que celles d'un relais téléphonique
ordinaire. Cependant, il est plus important de limiter son coût,
car il n'y en a pas plus par ligne que dans le relais manuel. Les premiers
inventeurs n'avaient pas saisi la notion de rapidité. Leurs interrupteurs
étaient actionnés par des boutons-poussoirs au poste.
L'utilisateur n'appuyait probablement pas sur les boutons à plus
de quatre impulsions par seconde, une cadence que même un relais
mal conçu pouvait facilement suivre. Il est vite devenu évident
que pour que l'automatique l'emporte, il devait agir plus rapidement.
Les relais ont été améliorés, l'émetteur
automatique (commutateur) a été introduit et la vitesse
des impulsions a été portée de 10 à 20 par
seconde.
La forme générale de l'un des relais les plus anciens
est illustrée à la Fig. 79.
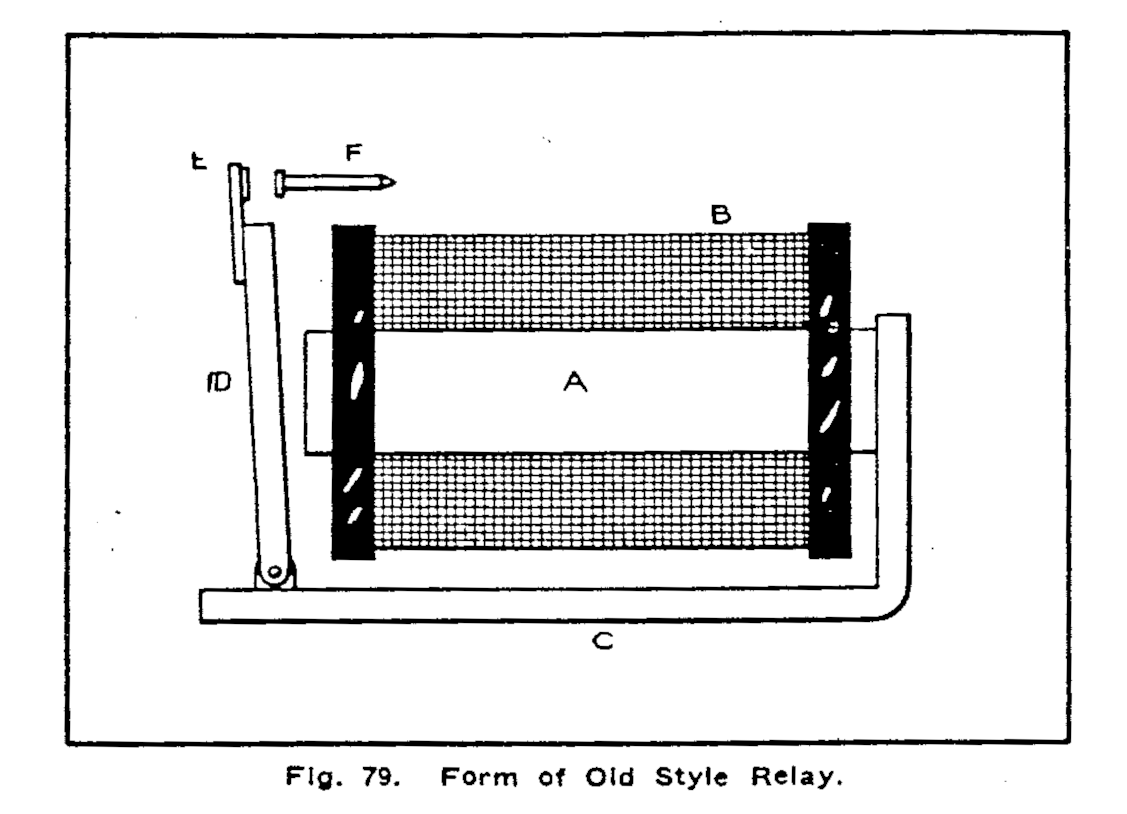
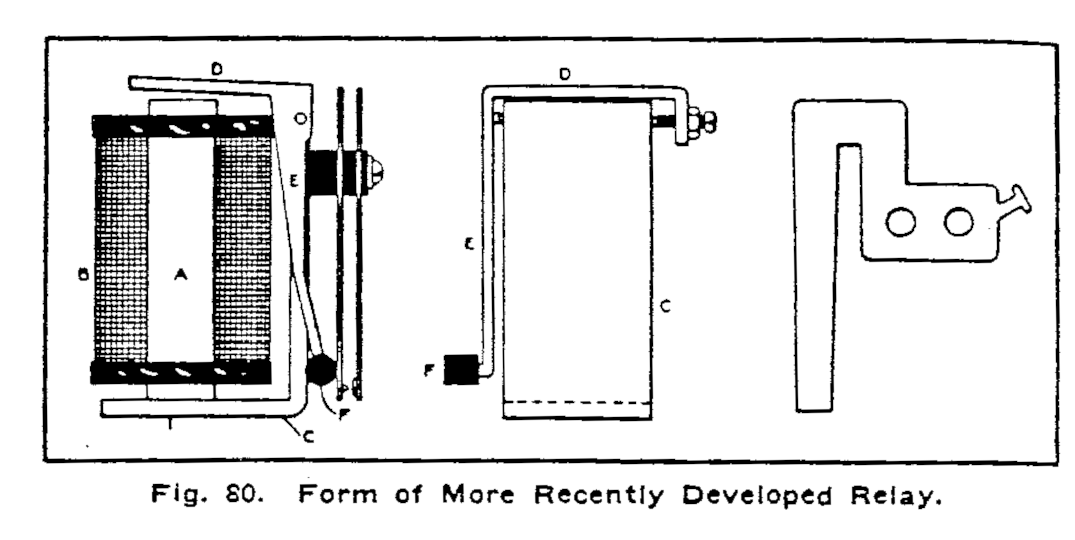
Le noyau, A. porte le fil, B. Une pièce de fer doux, C. forme
le deuxième pôle de l'aimant.
L'armature D pivote à l'extrémité de C. La pièce
massive E est fixée à l'armature et porte le rivet en
platine. S
ous tension, l'armature est tirée vers le pôle du noyau
A jusqu'à ce qu'elle soit stoppée par E qui heurte F,
le contact fixe. Le contact est dépourvu d'élasticité
et les rivets en platine ne glissent pas. Le relais actuel, dont la
forme a été établie vers 1901 ou 1902, est représenté
à la figure 80.
À gauche, une vue de face, au milieu, son côté droit
sans ressorts, et à droite, un seul ressort. A est le noyau sur
lequel est placé l'enroulement B. La branche de retour du circuit
magnétique C porte les pivots de l'armature D. Un long bras E,
supportant un piston isolant F, est fixé à l'armature.
Ce dernier actionne les ressorts montés sur la branche de retour
C. Il convient d'attirer l'attention sur la forme du ressort, à
droite (fig. 80).
Bien que limité verticalement, de sorte qu'un ressort court et
rigide semble être la seule possibilité, sa forme en U
inversé lui confère l'effet et l'élasticité
d'un ressort beaucoup plus long. On constate que l'entrefer entre l'armature
et le pôle est faible, tandis que le mouvement du piston F est
relativement important. Le rapport entre le mouvement du piston et celui
de l'armature est d'environ 2,1/3 pour 1. Il existe également
un très bon chemin pour les lignes de force magnétiques.
Le travail à grande vitesse a mis en évidence que la présence
de quelques spires court-circuitées dans l'enroulement réduit
considérablement la rapidité avec laquelle il suit les
signaux. Ces spires court-circuitées empêchent l'induit
de retomber rapidement et tendent ainsi à concentrer les impulsions.
Il était donc nécessaire d'apporter le plus grand soin
au bobinage, aux tests et à la manipulation des relais et des
aimants pour le fonctionnement automatique. Ces exigences sont bien
plus strictes que pour le fonctionnement manuel.
Les circuits du central automatique étaient à l'origine
protégés par des fusibles, comme dans les autres installations
téléphoniques. Mais la forte tension de l'automatique
a rapidement rendu nécessaire la subdivision de la protection
en unités plus petites.
La bobine de chauffage remplaçait le fusible des interrupteurs,
les spécialistes de l'automatisation concevant et fabriquant
leur propre modèle. Au début, les deux fils de batterie,
la batterie de masse et la batterie principale, étaient protégés,
mais lors de l'installation du Chicago, les bobines de chauffage du
fil de masse furent supprimées, conformément à
la pratique. Chaque interrupteur était équipé de
deux bobines de chauffage, appelées respectivement « principale
externe » et « principale locale ».
La première alimentait la batterie aux lignes verticale et rotative
via les relais de ligne, et était ainsi nommée car son
courant sortait du bureau. La bobine de chauffage principale locale
alimentait tous les autres appareils de l'interrupteur, qui étaient
connectés à des circuits fermés localement. L'interrupteur
individuel pour actionner l'aimant rotatif fut mis en service à
cette époque. Il consistait essentiellement à équiper
l'aimant rotatif d'un contact à ressort qui se rompait lorsque
l'armature était attirée. Ce contact était câblé
en série avec l'enroulement. Une fois connecté à
la batterie, le mouvement vibratoire résultant n'était
pas sans rappeler celui d'une sonnette de porte à batterie ordinaire.
Les conditions étaient plus rigoureuses, car le contact devait
rester fermé jusqu'à ce que l'aimant ait terminé
sa poussée vers l'avant et entraîné les frotteurs
vers leur contact suivant. Il devait ensuite rester ouvert jusqu'à
ce que l'armature soit tirée par son ressort suffisamment loin
pour que son cliquet accroche la dent suivante du cylindre à
cliquet. L'inertie d'un long levier et d'un marteau, comme dans la sonnette
de porte, n'était pas suffisante pour allonger la course. Les
pièces mobiles étaient légères par rapport
aux forces qui les actionnaient, et la course vers l'avant se faisait
contre une résistance variable. Le résultat final était
obtenu en partie par la conception des ressorts et en partie par leur
réglage minutieux. Pour le bon fonctionnement de l'interrupteur,
il est essentiel que tous les mouvements soient effectués dans
un certain ordre. Cet ordre est fixé sur l'interrupteur latéral,
qui est la clé de toute machine moyenne : un aimant de déclenchement
empêche l'interrupteur latéral d'être déplacé
accidentellement de sa position initiale avant la nuit. Les détentes
verticale et rotative sont monoblocs et pivotantes. Une tige reliée
à l'interrupteur latéral est fixée à un
levier situé sur ces détentes. Lorsque l'aimant de déclenchement
est excité, il se soulève et permet à une boucle
à ressort de son armature de se loger sur un ergot du levier
de la détente verticale et rotative. Lorsque l'aimant de déclenchement
retombe, il fait tourner la détente, soulevant les détentes
du cylindre à cliquet, permettant ainsi à l'axe d'essuie-glace
de revenir à sa position initiale. Parallèlement à
la rotation de la détente, il pousse la tige reliant l'interrupteur
latéral, réinitialisant ainsi ce dernier. Au repos, l'aimant
de déclenchement maintient la détente, empêchant
ainsi les détentes ou l'interrupteur latéral de bouger.
Le levier d'armature de l'aimant vertical se trouve juste sous la boucle
à ressort de l'aimant de déclenchement. Lors de son premier
mouvement ascendant, ce levier soulève la boucle à ressort
de l'ergot de la pièce de détente : les détentes
entrent immédiatement en action, mais l'interrupteur latéral
est contrôlé par l'aimant privé, comme décrit
précédemment.
Pour empêcher le contacteur latéral d'atteindre sa troisième
position trop tôt, une grande came ou lame est fixée sur
l'arbre, juste en dessous du cylindre à cliquet. Un ergot du
levier du contacteur latéral fait saillie vers cette longue came.
Une fois l'arbre d'essuie-glace soulevé, l'aimant privé
fait glisser le contacteur latéral en deuxième position.
L'ergot du levier du contacteur latéral repose alors contre la
longue came de l'arbre, et le contacteur latéral ne peut plus
bouger tant que l'arbre n'a pas tourné d'au moins un cran.
Lorsque l'arbre est en position normale, aucun mouvement de rotation
n'est possible. Ceci est assuré par un doigt fixé au sommet
de l'arbre d'essuie-glace, qui descend derrière une cheville
fixe. Cette cheville est juste assez haute pour empêcher le doigt
de bouger, mais ce dernier le libère lorsqu'il est soulevé
d'un cran. La difficulté de fixer des racleurs suffisamment flexibles
dans le petit espace disponible a été résolue comme
le montre la figure 81.
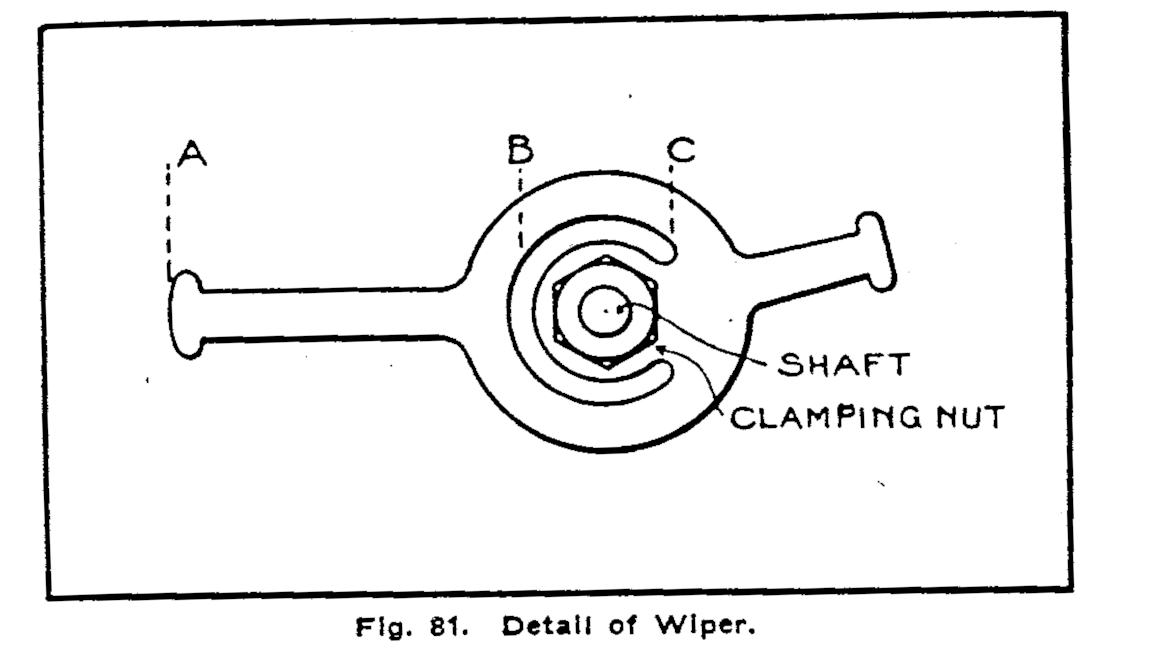
La longueur effective d'un ressort ordinaire s'étendrait de A
à B, mais ce dispositif l'allonge à la distance A-C.
L'interchangeabilité de toutes les pièces a permis de
concevoir l'interrupteur pour un retrait facile du bloc.
Ce dernier était fixé par câble et devait y rester,
car il ne présentait que peu ou pas de problèmes, ni avec
lui ni avec son mécanisme. L'interrupteur proprement dit pouvait
être retiré et remplacé par un nouveau pendant la
réparation de l'ancien, sans perturber le bloc. Ce faisant, et
en garantissant que, dans des conditions d'utilisation normales, les
racleurs s'alignent et se déplacent librement sur les 300 contacts,
ce n'est pas une mince affaire.
À gauche de l'axe du racleur, en face de la partie verticale
du cylindre à cliquet, se trouve un cran fixe, fixé rigidement
au châssis. Son extrémité fait saillie dans un canal
creusé dans les dents sollicitées par l'aimant vertical.
Ce cliquet a pour fonction de supporter le poids de l'arbre en rotation
et d'empêcher tout mouvement descendant d'endommager les racleurs.
Pendant le mouvement ascendant, le poids de l'arbre est maintenu par
le cliquet vertical, solidaire du cliquet rotatif. Lorsque l'aimant
rotatif effectue son premier mouvement, le poids de l'arbre doit être
transféré du cliquet vertical au cliquet fixe mentionné
ci-dessus. Le dispositif suivant vise à réduire au minimum
les frottements.
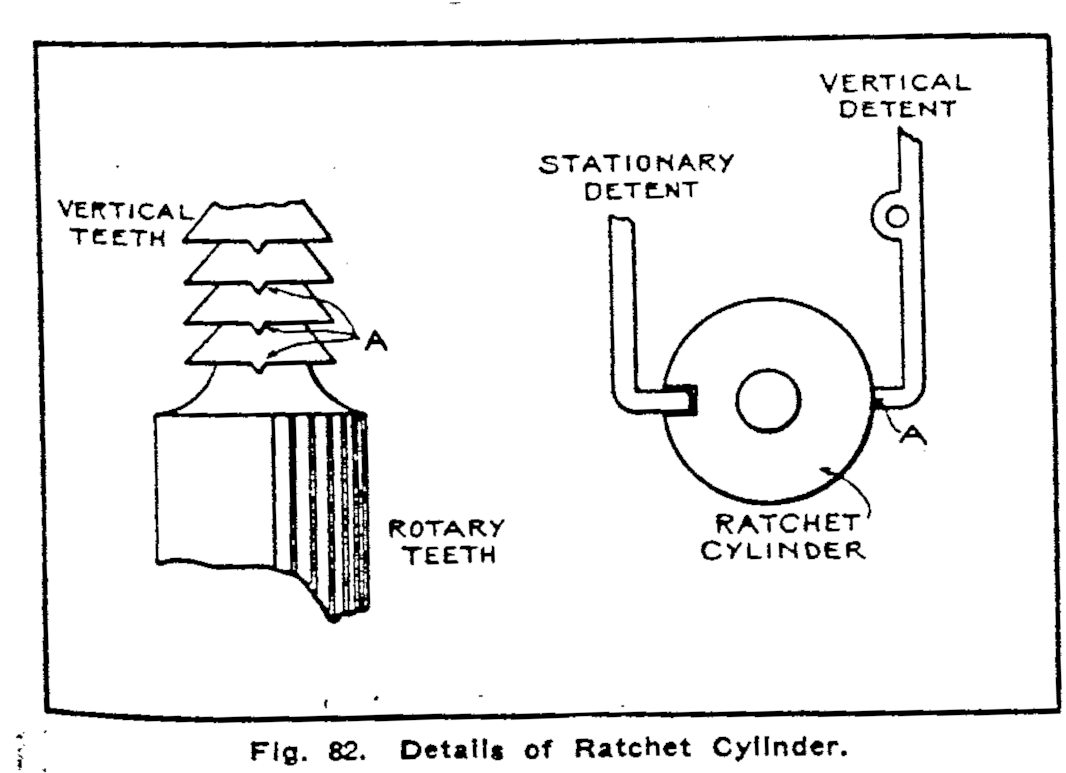
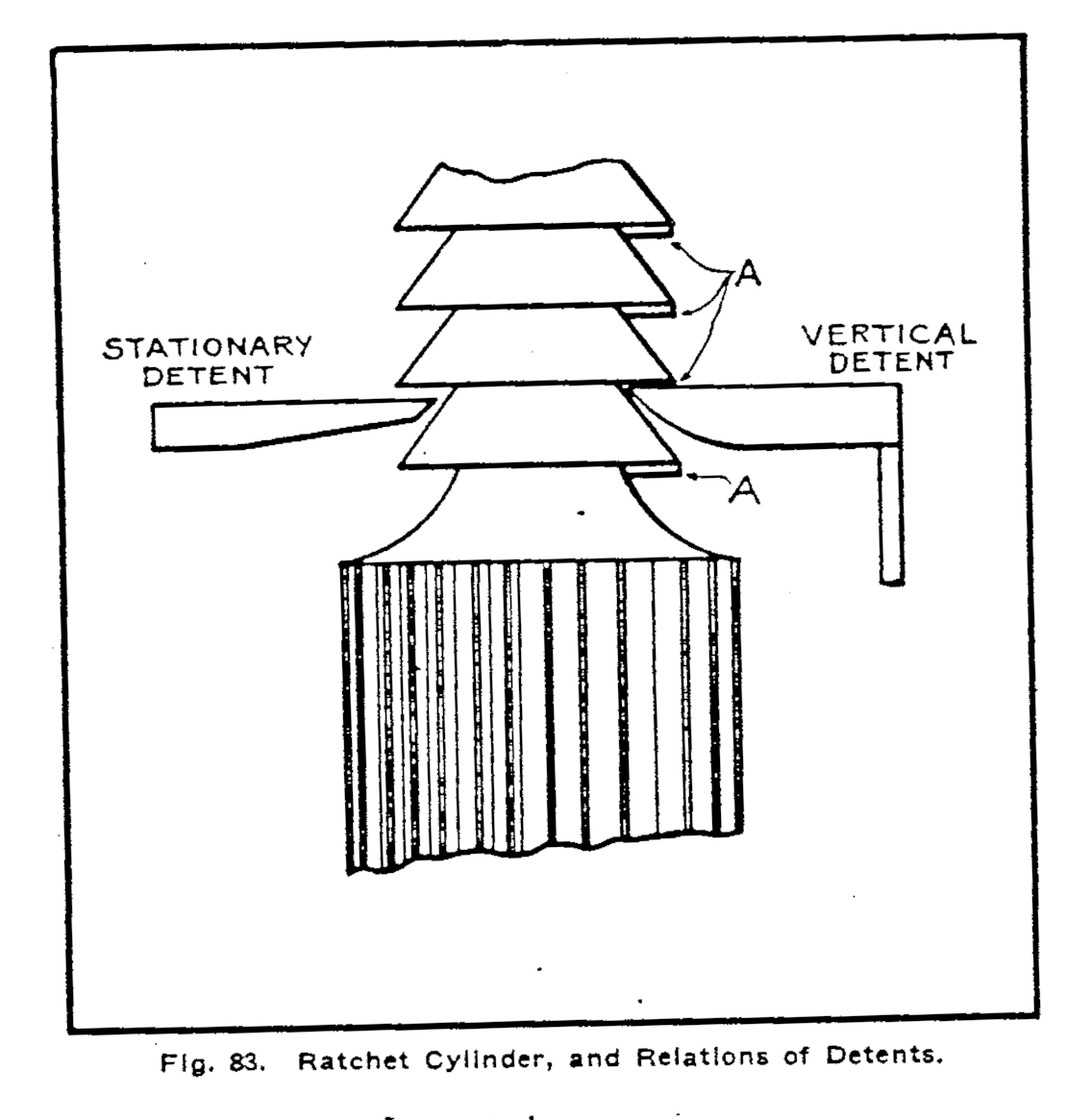
La figure 82, à gauche, montre une partie du cylindre à
cliquet vertical, l'extrémité supérieure de la
partie rotative étant visible en dessous.
Sur chacune des dents (VIII), on peut voir une petite saillie vers le
bas (A). Lors du mouvement ascendant, ces saillies sont alignées
avec le cliquet vertical et, à chaque pas, l'une d'elles repose
sur lui. À droite de la figure 82, on peut voir la relation entre
les crans. Ces petites saillies, A, maintiennent l'arbre un peu plus
haut que nécessaire, de sorte que le bas d'une dent se trouve
légèrement au-dessus du sommet du cran fixe (voir figure
83).
Ainsi, lorsque le mouvement rotatif commence, l'arbre s'abaisse facilement
sur le cran fixe au lieu d'y être forcé.
sommaire
Le système Dayton
Bien que les installations décrites aient été efficaces
du point de vue de la commutation, elles présentaient néanmoins
l'inconvénient d'être des systèmes en série.
En effet, il y avait un relais de 30 ohms de chaque côté
de la ligne, dans chaque commutateur utilisé pour la connexion
complète.
Dans le système 10 000 utilisant des premiers sélecteurs,
des seconds sélecteurs et des connecteurs, cela représentait
six bobines de ce type. Le blindage en cuivre du noyau réduisait
sans doute considérablement l'inductance, mais l'effet sur la
transmission de la parole était très appréciable.
L'étape suivante fut l'adoption d'un système sans relais
en série. Il fut mis au point pendant l'hiver 1902-1903 et installé
à Dayton, dans l'Ohio, constituant ainsi le premier système
automatique de pontage.
En bref, la modification consistait à enrouler les relais de
ligne de chaque commutateur à 500 ohms et à les disposer
de manière à ce que la paire soit pontée en permanence
sur le circuit de communication. Dans ce cas… Ils ne se trouvent
pas sur le trajet du courant de communication, mais forment des fuites
hautement inductives qui ne laissent passer qu'un très faible
courant. ·
Le câblage du poste était identique à celui de Chicago.
Le premier sélecteur est illustré à la figure 84.
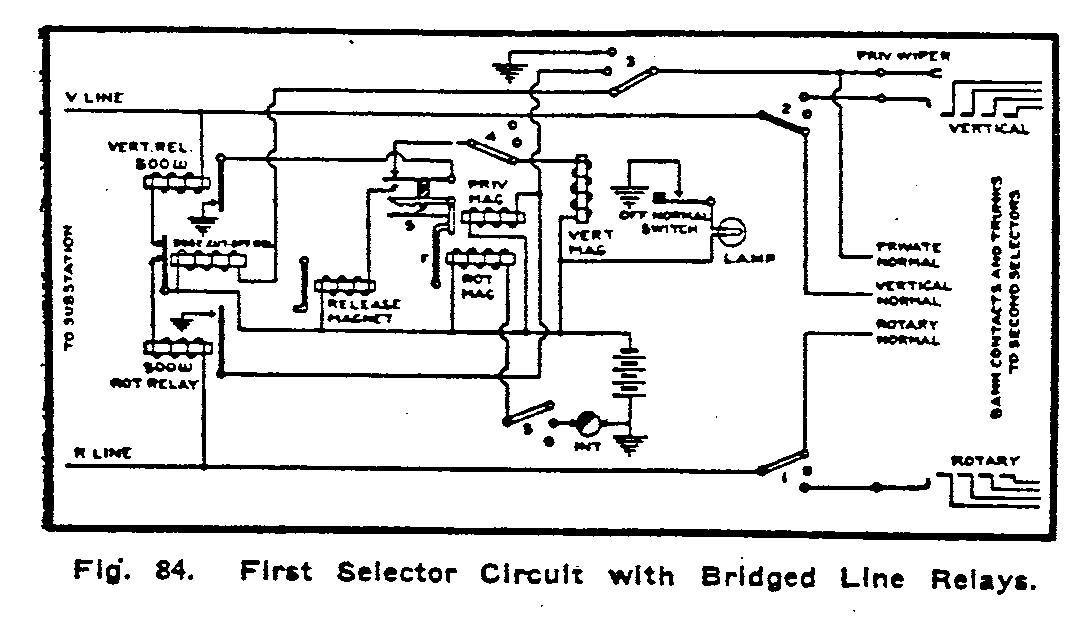
Les relais verticaux et rotatifs sont connectés à la batterie
par les contacts arrière du relais de coupure du pont. Le relais
vertical a pour fonction de mettre à la terre un fil spécifique,
que l'aimant privé peut commuter de l'aimant vertical à
l'aimant de déclenchement. Le relais rotatif commande l'aimant
privé. L'interrupteur de machine a été utilisé.
Au repos, les lignes verticales et rotatives sont connectées,
par les leviers d'interrupteur latéral 2 et 1, aux lignes normales,
par lesquelles sont reçus les appels des autres abonnés.
Ces lignes normales sont coupées par l'interrupteur latéral,
qui coupe également le circuit de communication directement jusqu'aux
essuie-glaces. Le racleur normal privé est branché sur
l'essuie-glace privé, qui est connecté comme d'habitude
au levier n° 3 de l'interrupteur latéral. Le premier contact
est relié au relais de coupure du pont, mais pendant le fonctionnement,
le curseur privé est commuté sur l'aimant privé,
servant de palpeur, puis sur la masse.
Le deuxième sélecteur est illustré à la
figure 85.
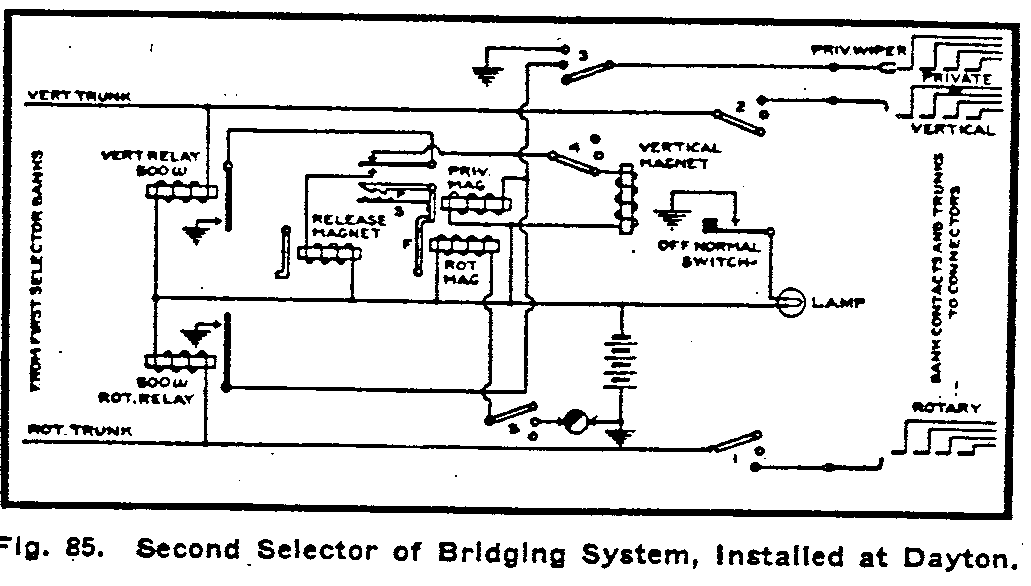
Il diffère du premier sélecteur par les points suivants :
les relais vertical et rotatif sont connectés en permanence à
la batterie, sans relais de coupure. Il n'y a pas de lignes normales.
Le connecteur, illustré à la figure 86, présente
plusieurs points intéressants. Les lignes verticale et rotative
sont chacune équipées d'un condensateur de 2 m.f
(micro farade).
Tout en préservant la continuité de la ligne pour la communication,
la ligne est divisée en deux parties pour la signalisation :
l'extrémité gauche pour l'appelant et l'extrémité
droite pour l'appelé. Les relais verticaux et rotatifs sont commandés
par la première. Le relais de retour et le relais de retour de
signal sont également commandés par l'appelé.
Le relais vertical a pour fonction de mettre à la terre et donc
de faire fonctionner l'un des quatre relais. Si l'aimant principal est
normal, le contact du relais vertical atteint le levier de l'interrupteur
latéral 4 et peut être commuté successivement de
l'aimant vertical à l'aimant rotatif et au relais de sonnerie.
Si l'aimant principal, commandé par le relais rotatif, est relevé,
le relais vertical met à la terre l'aimant de déclenchement
via un autre contact du relais rotatif.
La ligne verticale et le relais sont considérés comme
les éléments transmetteurs d'impulsions, car ils transmettent
tous les signaux qui déterminent le numéro à sélectionner.
Le côté rotatif de la ligne est l'élément
directeur, car une seule impulsion sur celui-ci modifie périodiquement
les activités de la verticale, les amenant à s'appliquer
là où elles font avancer l'appel.
Dans le système 10 000, cinq séries d'impulsions
sont appliquées à la verticale pour sélectionner
et appeler un poste : les milliers, les centaines, les unités
et la sonnerie. La série d'impulsions correspondant aux milliers
est appliquée au premier sélecteur, amenant ses curseurs
au niveau souhaité, après quoi la ligne principale du
groupe des milliers est automatiquement sélectionnée.
Les impulsions des centaines sont utilisées pour des activités
similaires dans le second sélecteur. Les impulsions des dizaines
élèvent les curseurs du connecteur au niveau approprié,
tandis que les unités font tourner ces mêmes curseurs vers
la ligne appelée. La dernière impulsion verticale sonne
le poste appelé.
La fonction de la ligne rotative et des relais est de décaler
les connexions afin de permettre ce fonctionnement aléatoire
de la ligne verticale. Ceci explique que chaque chiffre du numéro
d'appel nécessite une série d'impulsions verticales, suivies
d'une sur la ligne rotative, et constitue l'un des points cardinaux
du système Strowger. Ce système doit être parfaitement
maîtrisé par le débutant.
Le relais rotatif du connecteur possède un contact supplémentaire
qui relie l'aimant de déclenchement au point central du commutateur
latéral n° 3. Cela permet de connecter l'aimant de déclenchement
au curseur privé afin de détecter l'état de la
ligne appelée et, si celle-ci est occupée, de libérer
le connecteur.
Les contacts du relais de sonnerie sont insérés dans la
ligne, à l'arrière des leviers de commutateur latéral
1 et 2. Le relais de déclenchement arrière est connecté
de la batterie à la ligne verticale du côté appelé
du condensateur et occupe une position similaire à celle du relais
vertical. Il commande une prise sur l'aimant de déclenchement.
Le relais de signalisation arrière achemine également
la batterie vers la ligne rotative. Il met à la terre une connexion
provenant d'un contact du relais de décrochage arrière,
ce qui signifie que si les deux sont alimentés simultanément,
le connecteur est décroché. Il relie également
la ligne rotative à la terre du poste appelant via 500 ohms.
Grâce à l'inversion des fils entre le commutateur latéral
et les essuie-glaces, le relais de signalisation arrière est
connecté à la ligne verticale du poste appelé,
et le relais de décrochage arrière à la ligne rotative.
Si l'abonné appelé souhaite s'éloigner d'une personne
importune, il peut le faire en tournant sa molette une fois et en raccrochant.
Cette rotation est nécessaire pour que la terre du poste électrique
se dépose sur le fil de terre local, de sorte que, lorsque le
raccroché s'abaisse, il dispose d'une véritable terre
pour contacter les lignes. L'objectif principal du relais de signalisation
arrière est décrit ci-dessous.
La ligne verticale et le relais sont considérés comme
les éléments transmetteurs d'impulsions, car ils transmettent
tous les signaux qui déterminent le numéro à sélectionner.
Le côté rotatif de la ligne est l'élément
directeur, car une seule impulsion sur celui-ci modifie périodiquement
les activités de la verticale, les amenant à s'appliquer
là où elles font avancer l'appel.
Dans le système 10 000, cinq séries d'impulsions sont
appliquées à la verticale pour sélectionner et
appeler un poste : les milliers, les centaines, les unités et
la sonnerie. La série d'impulsions correspondant aux milliers
est appliquée au premier sélecteur, amenant ses curseurs
au niveau souhaité, après quoi la ligne principale du
groupe des milliers est automatiquement sélectionnée.
Les impulsions des centaines sont utilisées pour des activités
similaires dans le second sélecteur. Les impulsions des dizaines
élèvent les curseurs du connecteur au niveau approprié,
tandis que les unités font tourner ces mêmes curseurs vers
la ligne appelée. La dernière impulsion verticale sonne
le poste appelé.
La fonction de la ligne rotative et des relais est de décaler
les connexions afin de permettre ce fonctionnement aléatoire
de la ligne verticale. Ceci explique que chaque chiffre du numéro
d'appel nécessite une série d'impulsions verticales, suivies
d'une sur la ligne rotative, et constitue l'un des points cardinaux
du système Strowger. Ce système doit être parfaitement
maîtrisé par le débutant.
Le relais rotatif du connecteur possède un contact supplémentaire
qui relie l'aimant de déclenchement au point central du commutateur
latéral n° 3. Cela permet de connecter l'aimant de déclenchement
au curseur privé afin de détecter l'état de la
ligne appelée et, si celle-ci est occupée, de libérer
le connecteur.
Les contacts du relais de sonnerie sont insérés dans la
ligne, à l'arrière des leviers de commutateur latéral
1 et 2. Le relais de déclenchement arrière est connecté
de la batterie à la ligne verticale du côté appelé
du condensateur et occupe une position similaire à celle du relais
vertical. Il commande une prise sur l'aimant de déclenchement.
Le relais de signalisation arrière achemine également
la batterie vers la ligne rotative. Il met à la terre une connexion
provenant d'un contact du relais de décrochage arrière,
ce qui signifie que si les deux sont alimentés simultanément,
le connecteur est décroché. Il relie également
la ligne rotative à la terre du poste appelant via 500 ohms.
Grâce à l'inversion des fils entre le commutateur latéral
et les essuie-glaces, le relais de signalisation arrière est
connecté à la ligne verticale du poste appelé,
et le relais de décrochage arrière à la ligne rotative.
Si l'abonné appelé souhaite s'éloigner d'une personne
importune, il peut le faire en tournant une fois sa molette et en raccrochant.
Cette rotation est nécessaire pour que la terre du poste électrique
descende sur le fil de terre local, de sorte que, lorsque le raccroché
s'abaisse, la terre soit bien en contact avec les lignes. L'objectif
principal du relais de signalisation arrière est indiqué
ci-dessous. Si un abonné automatique souhaite une connexion payante,
il appelle l'opérateur téléphonique par la molette,
le trou « 0 » étant réservé à
cet effet. Ce circuit relie directement l'abonné au panneau de
péage.
Après avoir pris l'appel, l'opérateur demande à
l'abonné de raccrocher et de l'appeler dès que la connexion
sera prête.
Une fois le correspondant connecté et la ligne téléphonique
connectée, l'opérateur appelle l'abonné à
l'aide d'un cadran. La connexion téléphonique parvient
ainsi à l'abonné via le commutateur de connexion. Sous
la direction de l'opérateur, celui-ci tourne son cadran une fois
et engage la conversation. Pour signaler l'appel à l'opérateur,
il peut appuyer sur le bouton de sonnerie.
Le relais de retour (Fig. 86) est alors activé, plaçant
une masse de 500 ohms sur la ligne téléphonique.
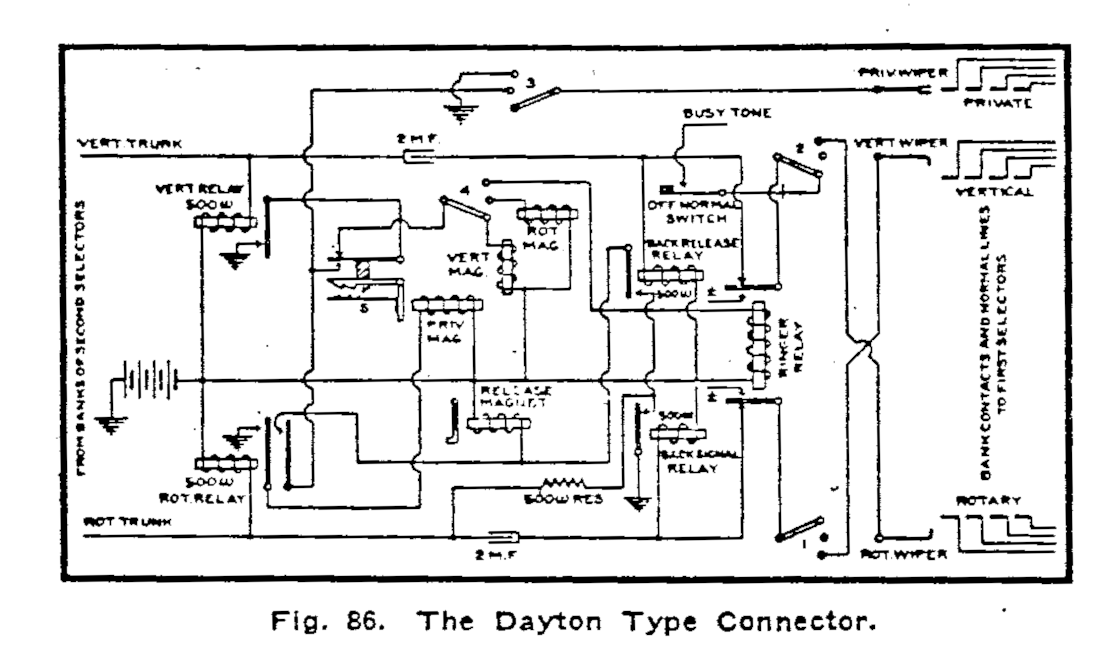
La Fig. 87 présente le schéma de la connexion téléphonique
via tous les commutateurs.
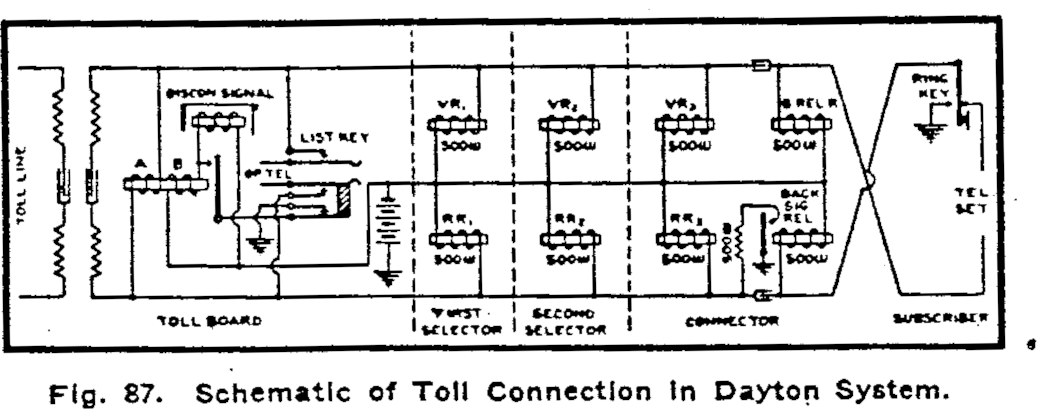
À gauche se trouve la ligne téléphonique, connectée
par une bobine répétitive du circuit du cordon au premier
sélecteur, au deuxième sélecteur et au connecteur,
puis à l'abonné à droite. Lorsqu'il appuie sur
le bouton de sonnerie, le relais de signal de retour se déclenche,
plaçant une masse de 500 ohms sur la ligne rotative. Cela tend
à déclencher tous les relais rotatifs en parallèle.
En raison de la résistance de 500 ohms, ils peuvent ou non fonctionner,
mais s'ils le font, aucun dommage ne sera causé. L'autre voie
passe par l'enroulement A du relais du circuit du cordon jusqu'à
la ligne verticale et par tous les relais verticaux en parallèle
à la batterie. Le relais AB se déclenche, mais les relais
verticaux en parallèle à la batterie, en raison de AB
et de la résistance de 500 ohms. Lorsque le contact du relais
se ferme, l'enroulement B le verrouille et le signal de libération
est simultanément activé. Lorsque l'opérateur écoute,
le contact supplémentaire de sa clé d'écoute déverrouille
le relais et rétablit le signal.
La figure 87 illustre également schématiquement les conditions
prévalant lors d'une conversation. Trois ponts de 1 000
ohms traversent le circuit. Si l'on imagine le tableau de péage
de gauche remplacé par un poste électrique, on constate
qu'au moment du déclenchement, lorsque les lignes verticale et
rotative sont simultanément mises à la terre, les six
relais sont activés simultanément. L'action de déclenchement
de chaque interrupteur est essentiellement la même : le relais
vertical fournit la terre tandis que le relais rotatif, via son aimant
privé, commute cette terre sur l'aimant de déclenchement.
Si la ligne appelée est occupée sur une connexion, le
fonctionnement est le suivant : normalement, la ligne verticale
(figure 86) est connectée via l'interrupteur latéral 2
à l'interrupteur de coupure, qui, dans ce cas, est câblé
sur la tonalité d'occupation. Étant ouverte, grâce
au poids de l'arbre, aucune tonalité d'occupation ne parvient
à la ligne. Les impulsions des dizaines arrivent à la
verticale et, par l'intermédiaire du relais vertical, actionnent
l'aimant vertical, augmentant ainsi la vitesse des essuie-glaces. La
masse suivante sur la ligne rotative fait passer l'interrupteur latéral
en deuxième position, ou position médiane. Aux bornes
1 et 2, cela n'a aucun effet, si ce n'est de couper la tonalité
d'occupation, connectée par l'interrupteur de coupure. En borne
3, cela relie l'essuie-glace privé à un fil qui relie
un contact ouvert du relais rotatif à l'aimant de déclenchement.
En borne 4, cela commute le fil de contact du relais vertical de l'aimant
vertical à l'aimant rotatif.
Les impulsions unitaires sur le fil vertical actionnent alors l'aimant
rotatif, faisant tourner les curseurs vers la ligne appelée.
Si celle-ci est occupée, son contact privé est mis à
la terre. L'impulsion suivante sur le relais rotatif soulève
l'aimant privé afin de déplacer l'interrupteur latéral
vers la troisième position. Au même moment, le deuxième
contact du relais rotatif se ferme, reliant l'aimant de déclenchement
à l'aimant privé. L'aimant de déclenchement soulève
et libère instantanément l'interrupteur, les curseurs
revenant à leur position normale. Les leviers des interrupteurs
latéraux sont également ramenés à la position
indiquée sur la figure. L'abonné, ignorant ce qui se passe,
appuie sur son bouton de sonnerie, ce qui met à la terre la ligne
verticale. L'interrupteur latéral 4 étant de nouveau en
position initiale, l'aimant vertical est actionné, faisant monter
l'axe du curseur d'un ou plusieurs crans. Cela ferme l'interrupteur
de coupure, qui connecte la tonalité d'occupation à la
ligne verticale afin qu'elle soit entendue par l'abonné appelant
en attendant la réponse du poste appelé. Après
avoir raccroché, la libération est la même que pour
une connexion normale.
Dayton utilisait également un connecteur permettant de sélectionner
une ligne parmi plusieurs lignes principales, et le câblage conçu
est illustré à la figure 88.
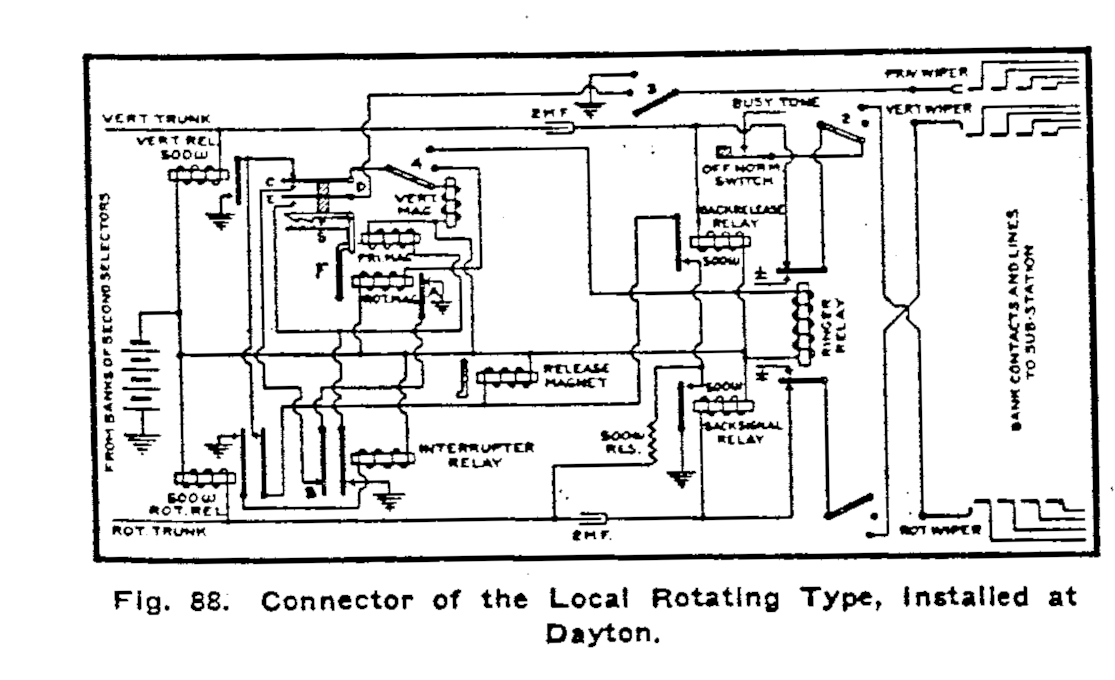
Ses caractéristiques de rotation locale le distinguent sensiblement
du commutateur Chicago. La relation entre le relais vertical, l'aimant
vertical, l'aimant rotatif et le relais de sonnerie est la même
que dans le connecteur Darton standard. Cependant, l'aimant rotatif
est équipé d'un interrupteur individuel, A, non câblé
en permanence dans son propre circuit, mais passant par le contact arrière,
B, du relais interrupteur, et le contact avant, C, de l'aimant privé,
prêt à être connecté au levier 4 de l'interrupteur
latéral. Le relais rotatif commande l'aimant privé, mais
pas directement, car il le fait par l'intermédiaire du relais
interrupteur. Le deuxième contact du relais rotatif relie l'aimant
de déclenchement au contact du relais vertical. Les connexions
et les fonctions du relais de déclenchement arrière et
du relais de signalisation arrière sont les mêmes que sur
un connecteur ordinaire.
Le numéro d'appel de tout central comportant plusieurs lignes
se termine toujours par le chiffre « 1 ». Par
exemple, « 2481 ».
En réalité, plusieurs lignes réseau sont disponibles,
telles que 2481, 2482, 2483, etc. Les chiffres des milliers et des centaines
sont traités comme d'habitude par les premier et deuxième
sélecteurs. Les impulsions des dizaines actionnent le relais
vertical du connecteur spécial (Fig. 88) et, grâce
à l'aimant vertical, élèvent les curseurs au niveau
souhaité. L'impulsion rotative entraîne le relais rotatif,
le relais interrupteur et l'aimant privé, mais le seul résultat
est le déplacement de l'interrupteur latéral vers la position
médiane.
Aux points 1 et 2, rien d'intéressant ne se produit. En 3, le
curseur privé est connecté au ressort D de l'aimant privé.
L'impulsion unité, « un », active le relais
vertical, qui met alors à la masse l'aimant rotatif et fait tourner
les curseurs sur la première ligne. La masse suivante sur la
ligne rotative active le relais interrupteur et l'aimant privé.
Le ressort D de l'aimant privé entre alors en contact avec le
contact E, connectant ainsi l'enroulement de l'aimant principal au curseur
privé. Si la première ligne n'est pas occupée,
le curseur privé est en contact ouvert. Mais s'il est occupé,
il est mis à la masse, de sorte que le courant traverse l'aimant
privé et le maintient en position. Lorsque le relais rotatif
retombe, il laisse le relais interrupteur faire de même. Le contact
B de ce dernier relie alors l'interrupteur rotatif A à l'aimant
rotatif via le contact C de l'aimant privé. L'aimant rotatif
se soulève alors, déplaçant les curseurs sur la
ligne suivante, le doigt F maintenant l'armature de l'aimant privé
tandis que le curseur privé glisse d'un contact à l'autre.
Ayant coupé son propre circuit, l'aimant rotatif retombe pour
accrocher une nouvelle dent du cylindre à cliquet et tourne à
nouveau jusqu'à ce qu'une ligne libre soit trouvée. L'ouverture
du contact privé libre permettra à l'aimant privé
de retomber, ramenant l'interrupteur latéral en troisième
position. Au niveau du levier 4, l'aimant rotatif est coupé et
la rotation est interrompue. La suite est identique à celle d'un
connecteur ordinaire.
Si toutes les lignes sont occupées, les curseurs sont orientés
vers le premier ensemble de contacts suivant. Ces connecteurs rotatifs
locaux spéciaux sont groupés par centaines et leurs rangées
sont multipliées. Si, à un niveau donné, cinq lignes
desservent un abonné, les sixièmes contacts sont connectés
à la tonalité d'occupation. Les contacts privés
correspondants de chaque connecteur sont déconnectés,
de sorte que n'importe quel curseur peut s'arrêter simultanément
sur le sixième point et obtenir la tonalité d'occupation.
La disposition des connecteurs par rapport aux premiers sélecteurs
est illustrée à la figure 89. Ci-dessous, le schéma
d'un premier sélecteur, ne montrant que le câblage et l'appareillage
décrits ci-après.
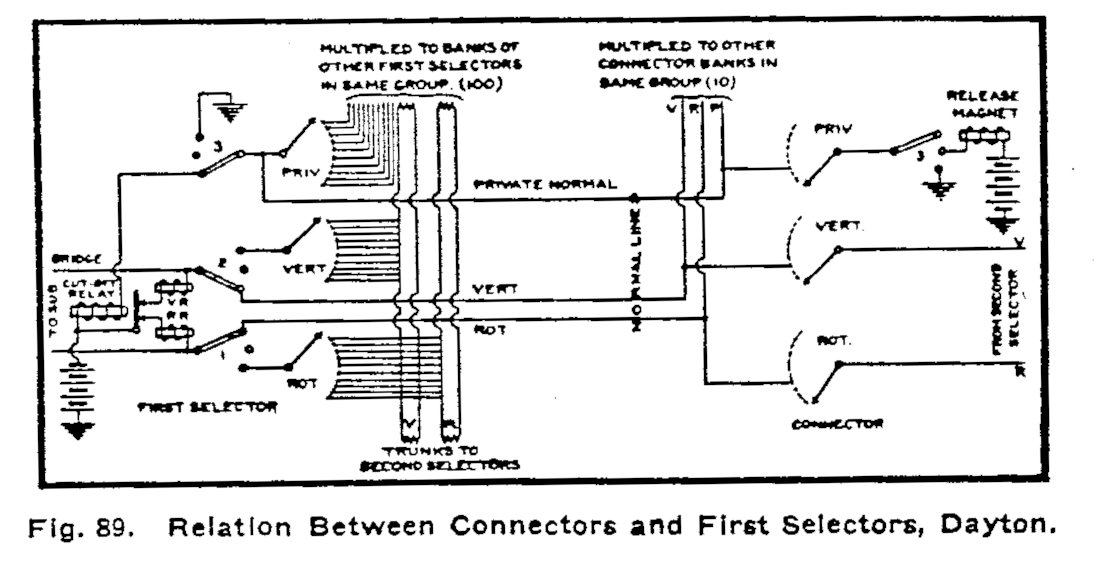
Il s'agit de l'un des 100 premiers sélecteurs, chacun appartenant
à un abonné et utilisé par lui uniquement pour
émettre des appels. Les rangées sont toutes multipliées.
Les fils privés aboutissent au groupe, tandis que les fils verticaux
et rotatifs mènent aux seconds sélecteurs et sont appelés
lignes principales. À droite se trouve le squelette d'un connecteur,
l'un des dix, dont la fonction est de transmettre tous les appels entrants
aux cent abonnés dont les premiers sélecteurs se trouvent
à gauche. De chaque premier sélecteur partent trois lignes
principales : privée, verticale et rotative, qui sont reliées
aux rangées des dix connecteurs de droite. Les lignes principales
verticale et rotative partent des contacts des leviers latéraux
2 et 1, de sorte que lorsque l'abonné passe un appel, elles sont
coupées et empêchent toute interférence. La ligne
principale privée part du curseur privé et partage son
état. Ainsi, lorsque l'abonné lance un appel et trouve
une ligne principale vers un second sélecteur, le commutateur
latéral 3 du premier sélecteur se connecte à son
dernier contact, mettant le curseur privé à la terre.
La ligne normale privée partage cette terre, de sorte que, dans
tous les groupes de connecteurs, les contacts privés correspondant
à cette ligne seront mis à la terre, offrant ainsi une
protection supplémentaire contre les appels entrants.
Lorsqu'un appel est reçu par un abonné, il passe par l'un
des connecteurs de droite. Lors de la connexion, le levier de l'interrupteur
latéral 3 repose sur son contact central pour tester la connexion.
Il est alors actionné sur le troisième point pour obtenir
la terre. Comme la ligne est inoccupée, le levier de l'interrupteur
latéral 3 du premier sélecteur est en position normale,
comme illustré à la figure 89.
Le relais de coupure du pont se déclenche alors, coupant la batterie
des relais verticaux et rotatifs du premier sélecteur. Cela libère
la ligne appelée pour la sonnerie.
sommaire
Le système de
Grand Rapids
Peu après la mise en service de la centrale de Dayton, dans l'Ohio,
le central de Grand Rapids, dans le Michigan, a été installé.
Bien que ne différant pas suffisamment du central de Dayton pour
mériter une description technique, il est plus célèbre,
ayant fait date dans la téléphonie automatique à
travers le monde.
Les termes les plus connus à ce sujet sont sans doute « Fall
River, Massachusetts » et « Grand Rapids, Michigan »,
le premier pour illustrer le succès de la téléphonie
automatique depuis longtemps, le second pour illustrer le progrès
moderne.
Grand Rapids, en particulier, a été une pomme de discorde
entre les deux camps, manuel et automatique, et des déclarations
très contradictoires ont été faites à son
sujet par différentes personnes.
La Citizens' Company, qui l'exploita, a fait preuve d'un grand dynamisme
et d'un esprit d'entreprise, et s'est efforcée de collaborer
avec la Automatic Electric Company pour assurer le succès de
ce système.
Les visiteurs peuvaient en découvrir le fonctionnement tout au
long de l'année, et le central a été dès
le départ considéré comme un modèle et une
fierté pour la ville.
sommaire
Système
de coupure de courant
Lors de l'installation, on a constaté que, dans certains cas,
le déclenchement était difficile, notamment sur les longues
lignes équipées de piquets de terre pour le retour à
la terre.
Cela s'est avéré dû au courant relativement élevé
nécessaire pour actionner simultanément les six relais
de ligne de 500 ohms, le courant de tous passant par un piquet de terre
unique et son contact avec la terre. M. A. E. Keith a suggéré
aux autres ingénieurs de couper tous les relais sauf la dernière
paire, mais le temps manquait pour régler les détails.
Plus tard, cette suggestion a abouti à la production du sélecteur
de "trunk" à déclenchement, intégré
en partie au bureau Sud de Los Angeles, en Californie, devenu depuis
aussi célèbre que Grand Rapids.
L'installation de Los Angeles mérite une attention particulière
pour deux raisons : l'introduction du système de déclenchement
du "trunk" et le fonctionnement interchangeable des commandes
automatique et manuelle dans le même central. Chacune de ces caractéristiques
est très intéressante et leur mise en place a nécessité
une grande expertise technique.
Lors de la création de la Home Telephone Company de Los Angeles,
un standard téléphonique multiple à batterie commune
Kellogg d'une capacité de 18 000 lignes fut acheté.
Comme seulement 7 049 lignes étaient nécessaires
pour répondre aux besoins de l'époque, on estimait que
le tableau suffirait pour l'avenir. Mais deux ans après sa mise
en service, 10 000 lignes étaient déjà en
service, et ce nombre ne cessait de croître.
L'augmentation des coûts liés à l'ajout d'un standard
multiple de 10 000 lignes est un problème majeur, et les
loyers n'étaient pas suffisants pour les ignorer. Il fut donc
décidé de limiter le bureau principal aux téléphones
du quartier des affaires et de desservir le reste de la ville à
partir d'antennes. Pour commencer, le bureau sud, situé à
4,5 kilomètres au sud du bureau principal, fut construit pour
soulager ce dernier d'environ 2 000 lignes. Il était prévu
pour un tableau manuel. Mais l'inspection des centraux de Dayton, dans
l'Ohio, et de Grand Rapids, dans le Michigan, a entraîné
l'abandon du système manuel et la commande d'équipements
automatiques.
Les ingénieurs ont fait preuve de prévoyance en concevant
l'équipement du bureau Sud pour qu'il s'intègre à
un système automatique qui devait couvrir toute la ville, qui
comptait alors (1904) près de 150 000 habitants. Ainsi,
bien que le bureau Sud ne contienne que 2 000 lignes, son équipement
automatique a été conçu sur le plan d'un central
de 100 000 lignes. Tous les numéros de 1 à 9 000
étaient réservés au bureau principal, et de 21 000
à 29 999 étaient réservés pour la capacité
finale du bureau Sud. Les abonnés de ce dernier devaient se sélectionner
automatiquement, tous les numéros commençant par « 2 »,
qui devait désigner le bureau.
Pour appeler un abonné manuel, l'abonné automatique devait
appuyer sur le « 1 » sur son cadran, ce qui le
mettait en communication directe avec l'opératrice « B »
du bureau principal, à qui il communiquait son numéro
oralement. Celle-ci établissait la connexion par une liaison
directe. Pour les appels du manuel vers l'automatique, deux formules
étaient proposées.
Une section de communication devait être installée au bureau
Sud, afin que, pendant les heures de pointe, les appels puissent être
acheminés du bureau principal vers le bureau Sud par des lignes
ordinaires. Les opérateurs « B » de ce
dernier bureau devaient disposer d'une ligne multiple de toutes les
lignes des abonnés du bureau Sud et pouvaient établir
l'appel en s'y connectant directement. La nuit, les opérateurs
« B » du bureau Sud devaient être supprimés
et les numéros appelés automatiquement par des opérateurs
spéciaux au bureau principal. Les travaux du bureau Sud ont commencé
en mai et se sont achevés en juillet 1904.
Nous examinerons d'abord l'équipement nécessaire à
l'établissement des appels locaux au bureau Sud. Comme notre
intérêt se porte naturellement sur le déverrouillage
du "trunk", la figure 90 illustre cette caractéristique
d'une connexion complète.
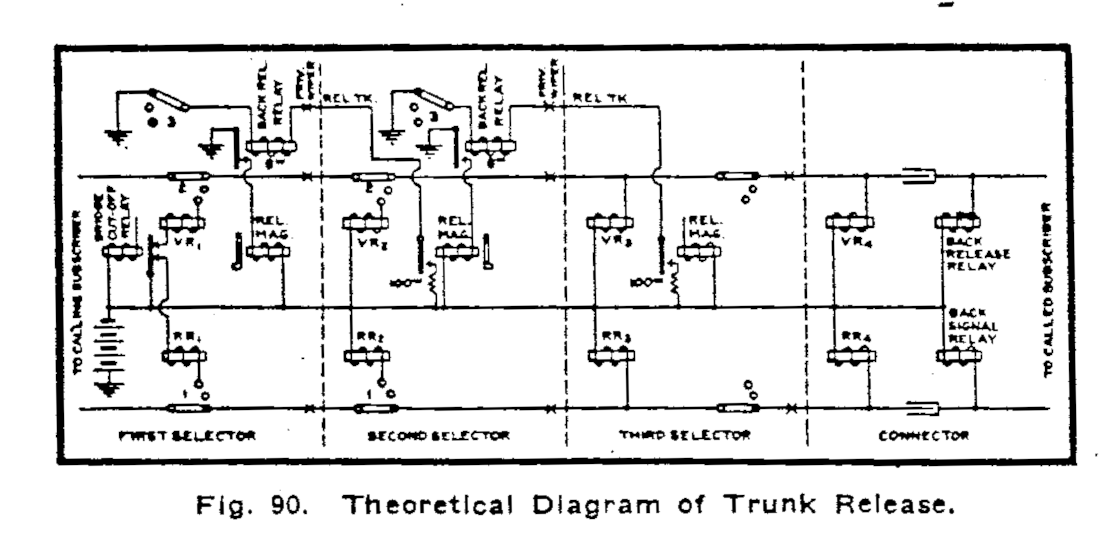
Les fils proviennent du poste d'appel à gauche et passent par
les premier, deuxième et troisième sélecteurs et
le connecteur du poste d'appel à droite. On remarquera que le
contacteur est de type pont classique, de sorte qu'il y a un troisième
fil entre lui et le troisième sélecteur. Il est déverrouillé
par l'action simultanée des boutons verticaux et rotatifs. Le
troisième sélecteur est déverrouillé de
la même manière, de sorte qu'il y a trois ponts sur le
circuit. L'aimant de déclenchement du troisième sélecteur
possède un contact wn1 qui alimente la batterie via une résistance
de 100 ohms jusqu'au relais reliant la batterie au deuxième sélecteur.
Ce dernier passe par la masse du relais de déclenchement arrière
de 8 ohms. Ce relais actionne l'aimant de déclenchement du deuxième
sélecteur. De la même manière, cet aimant possède
un contact qui peut alimenter la batterie via 100 ohms jusqu'au relais
de déclenchement arrière de 8 ohms du premier sélecteur
et déclencher un signal sonore. Le déclenchement s'effectue
de la manière suivante : l'appel, en raccrochant, met temporairement
à la masse les lignes verticale et verticale.
Dans les premier et deuxième sélecteurs, cela n'entraîne
aucune action, car les lignes sont alors libres de tout relais. Dans
le troisième sélecteur et le connecteur, les relais verticaux
et rotatifs se déclenchent simultanément et, à
chaque fois, ils activent l'aimant de déclenchement.
Dans le troisième sélecteur, l'aimant de déclenchement
déclenche non seulement l'interrupteur, mais alimente également
la batterie via le tronc de déclenchement du deuxième
sélecteur, ce qui déclenche le relais de déclenchement
arrière. Ce dernier met à la terre l'aimant de déclenchement
du deuxième sélecteur, libérant ainsi cet interrupteur.
Cet aimant de déclenchement alimente également la batterie
via le tronc de déclenchement du premier sélecteur, actionnant
son relais de déclenchement arrière, qui commande l'aimant
de déclenchement. De cette manière, grâce à
cinq circuits reliés par des relais et des aimants, le déclenchement
est réalisé sans utiliser de relais sur le circuit de
chaque interrupteur. Il est évident que ce principe aurait pu
être poussé plus loin, de sorte que le troisième
sélecteur aurait été déclenché par
un troisième fil provenant du connecteur. Cela n'a pas été
fait, car lors de la conception initiale du système, le déverrouillage
du "trunk" n'était pas terminé. Une fois cela
fait, les premier, deuxième et troisième sélecteurs
ont été remplacés par un troisième fil,
mais modifier le connecteur aurait nécessité des modifications
trop importantes.
La présence du relais de déverrouillage arrière
dans l'essuie-glace privé mérite réflexion. Lorsque
le curseur privé est utilisé comme palpeur pour une ligne
non occupée, le courant provenant de la batterie traverse le
relais de déclenchement de l'aimant privé et le curseur
privé vers la terre. Cela doit remonter l'aimant privé,
mais pas le relais de déclenchement.
Ce dernier a donc été bobiné à une résistance
relativement faible (8 ohms) et rendu peu sensible, tandis que le curseur
privé a été fabriqué à environ 600
ohms.
Une fois la ligne sélectionnée, le relais de déclenchement
arrière se place entre le curseur privé et la terre. Les
autres premiers sélecteurs, en quête de lignes non occupées
au même niveau, font passer leurs curseurs privés sur les
multiples de ce contact, comme illustré à la figure 91.
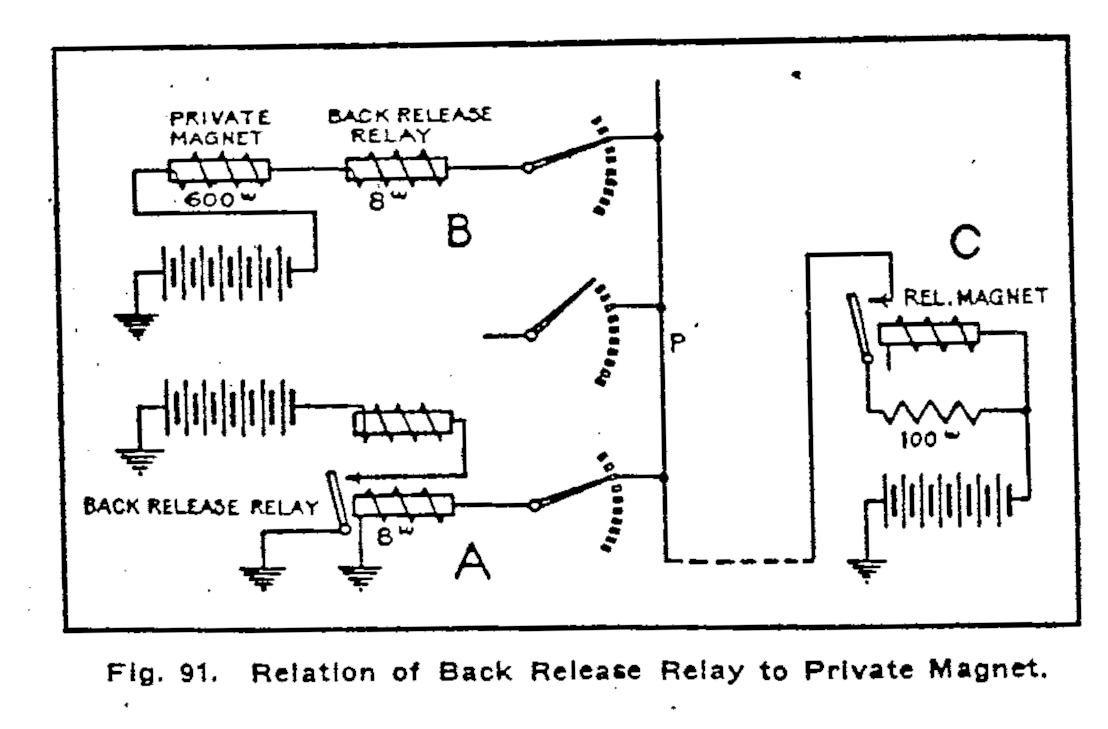
A est un premier sélecteur et occupe la troisième ligne.
Le deuxième sélecteur auquel aboutit cette ligne est C.
Seule la ligne de déclenchement est représentée
et les deux premiers contacts privés de la rangée sont
supposés occupés, c'est-à-dire mis à la
terre. B est la partie privée d'un autre premier sélecteur
qui recherche une ligne non occupée vers le même groupe.
À cet instant, il passe sur le multiple du contact privé
occupé par A. Concernant le palpeur de B, le fil privé
P doit être mis à la terre, de sorte que son aimant privé
reste excité jusqu'à ce que son aimant rotatif fasse passer
les curseurs au contact suivant. Mais entre P et la terre, ce qui le
rend actif, se trouve le relais de 8 ohms. C'est pour éviter
que le courant de test ne le tire vers le haut et ne provoque une libération
prématurée qu'il est de faible résistance et relativement
insensible. En revanche, lorsque l'aimant de libération du deuxième
sélecteur, C, est tiré vers le haut pour la déconnexion,
le relais de libération arrière doit se soulever de manière
fiable. Le courant plus important nécessaire est fourni par la
résistance de 100 ohms.
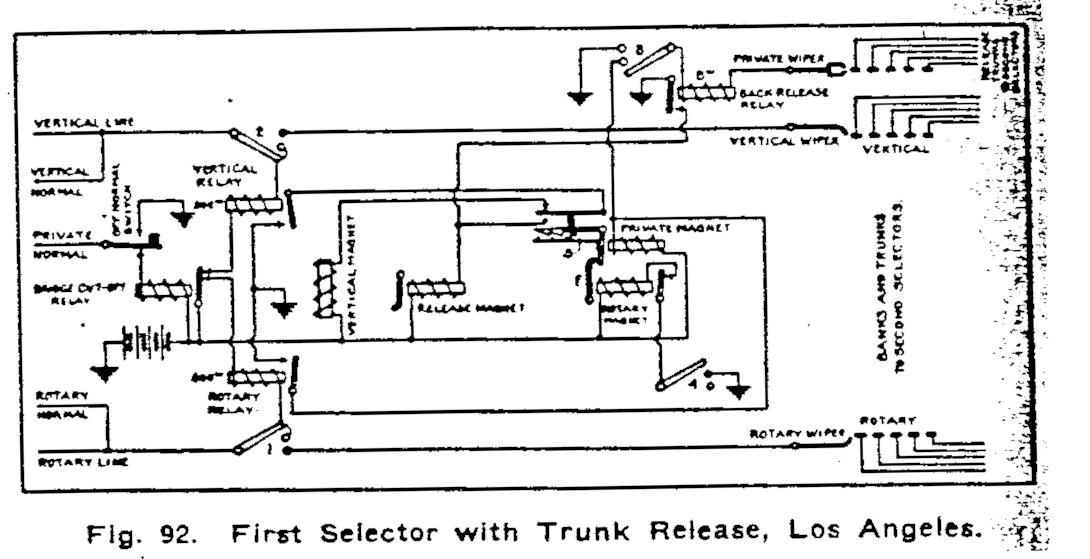
La figure 92 présente le câblage détaillé
du premier sélecteur. Les relais vertical et rotatif sont câblés
à l'interrupteur latéral de manière à être
coupés lorsque l'interrupteur a sélectionné sa
position principale. Le relais rotatif, comme d'habitude, commande l'aimant
privé.
Le relais vertical actionne l'aimant vertical ou, si l'aimant privé
est simultanément alimenté par le relais rotatif, il active
l'aimant de déclenchement. Ce dernier permet de déclencher
l'appel si nécessaire pour déconnecter un appel partiellement
terminé, lorsque l'interrupteur latéral n'a pas réussi
à passer en troisième position. Les relations mutuelles
entre l'interrupteur latéral, l'aimant privé et l'aimant
rotatif ne sont pas détaillées ici, car elles ont été
décrites en détail dans le cadre du système de
Chicago. Le relais de coupure de pont et le relais de coupure de pont
ne fonctionnent pas en liaison avec le commutateur de coupure de pont,
comme sur la carte Dayton, en raison du relais de retour. Le relais
de coupure de pont est acheminé vers le ressort principal de
l'interrupteur de coupure de pont et, via le contact arrière,
est normalement connecté au relais de coupure de pont. Ainsi,
les appels entrants peuvent mettre à la terre le relais de coupure
de pont au niveau du groupe de connecteurs (comme sur la carte Dayton),
activer le relais de coupure de pont et libérer la ligne appelée
pour la sonnerie. Mais si ce premier sélecteur effectue un appel,
le premier mouvement vers le haut de l'arbre actionne l'interrupteur
de coupure de pont, déconnecte le relais de coupure de pont et
met à la terre le relais de coupure de pont, ce qui protège
la ligne des appels entrant par le connecteur. Les normales verticale
et rotative sont reliées en permanence aux lignes verticale et
rotative, de sorte que la terre du relais de coupure de pont constitue
la seule protection contre l'interruption. Cependant, cette protection
s'est avérée suffisante en pratique.
La figure 93 illustre le deuxième exemple. Sélecteur très
similaire au premier sélecteur, à la différence
près qu'il n'y a pas de lignes normales et que l'aimant de déclenchement
possède un contact permettant de connecter la batterie, sous
100 ohms, à la ligne de déclenchement reliant le premier
groupe de sélecteurs. L'interrupteur d'arrêt normal fonctionne
comme un signal d'arrêt normal pour indiquer à l'opérateur
que l'interrupteur est occupé.
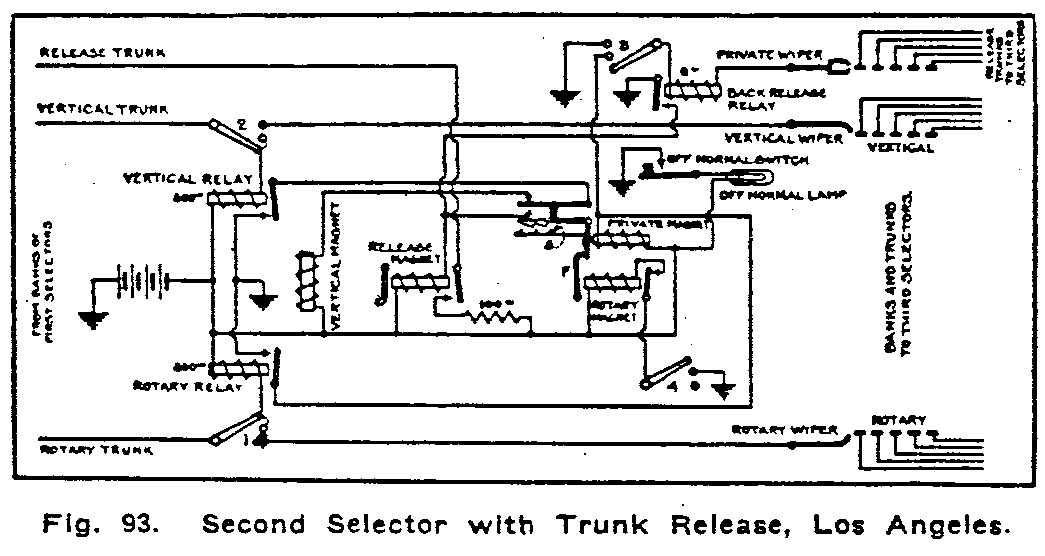
Le troisième sélecteur (Fig. 94) possède les relais
verticaux et rotatifs pontés en permanence, car il n'y a pas
de ligne de déclenchement entre ce dernier et le connecteur.
Il n'y a pas de relais de déclenchement arrière. Les autres
caractéristiques sont identiques à celles du deuxième
sélecteur.
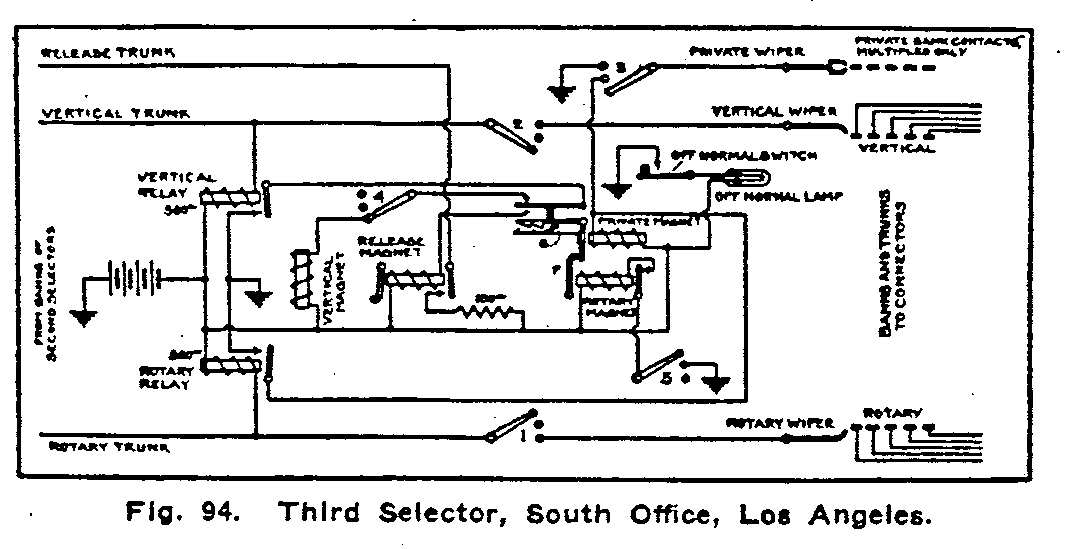
Le connecteur (Fig. 95) est du même type de pontage que celui
utilisé à Dayton.
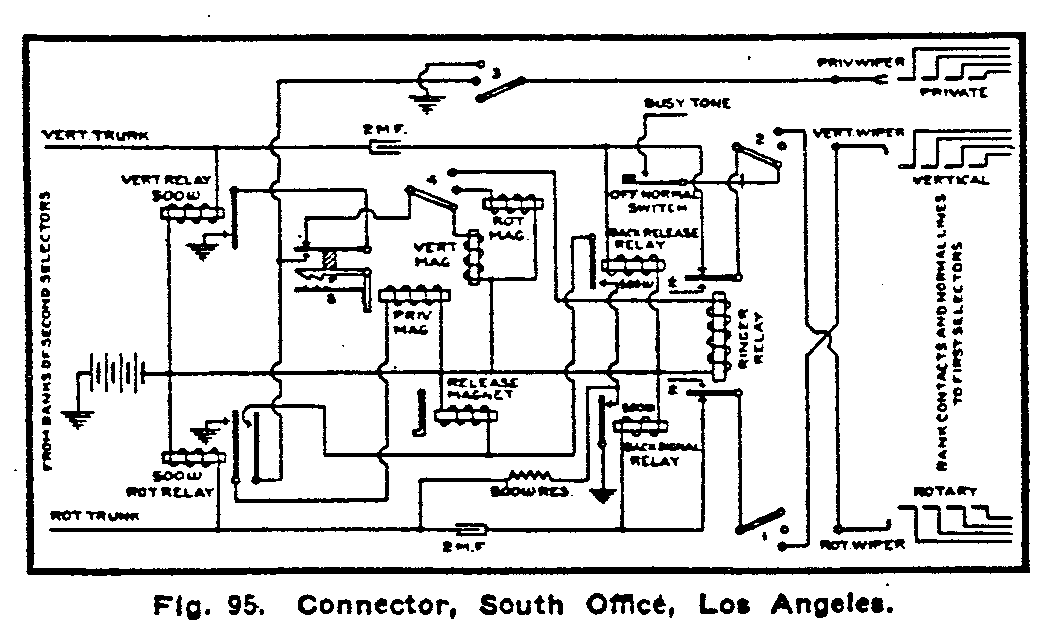
Le relais rotatif commande l'aimant privé. Le relais vertical
commande normalement l'aimant vertical, l'aimant rotatif ou le relais
de sonnerie, selon la position de l'interrupteur latéral.
Lors du déclenchement depuis l'appelant, le relais vertical fournit
la terre et l'aimant privé et le relais rotatif le connectent
à l'aimant de déclenchement. L'appelé L'abonné
dispose d'un relais de signal de retour qui, en liaison avec le relais
de libération arrière, peut être utilisé
pour la libération.
Comme indiqué précédemment, pendant
les heures de pointe, tous les appels du poste principal (manuel) au
poste sud (automatique) sont acheminés directement des opérateurs
« A » du premier vers les opérateurs « B »
du second, et ces opérateurs « B » ont
accès aux lignes des abonnés.
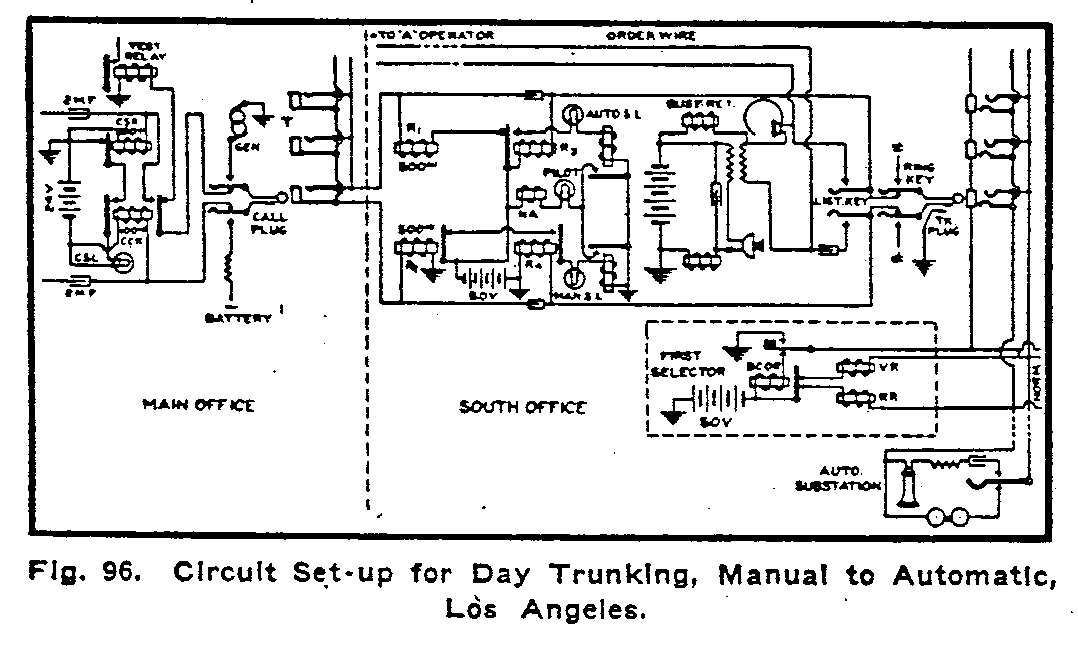
La figure 96 présente le schéma d'une connexion complète
du mode manuel au mode automatique. À gauche se trouve l'extrémité
appelante du cordon d'un opérateur d'abonné Kejiogg, avec
le relais de supervision d'appel habituel (C.S.R.) et le relais de contrôle
d'appel (C.C.R.), le premier alimentant la batterie positive à
l'extrémité, le second la batterie négative à
la gaine.
Chaque opérateur « A » a accès à
un multiple de plusieurs lignes sortantes (T) menant au poste sud. Le
manchon de chaque ligne principale est relié en permanence à
la terre par la bobine de retard R. La ligne d'extrémité
est normalement connectée par la bobine de retard R et le contact
arrière du relais Ra à la batterie de 50 volts. Deux condensateurs
de 2 mf séparent la ligne principale en deux parties. L'extrémité
de l'extrémité appelée reçoit le négatif
de la batterie via l'enroulement du relais R, tandis que l'extrémité
annulaire reçoit la masse, ou le positif, de la batterie via
l'enroulement du relais R. Le circuit de communication passe par la
touche d'écoute et de sonnerie habituelle et rejoint une fiche
à trois conducteurs, dont le manchon est relié à
la terre. Le poste de l'opérateur est identique au poste de batterie
ordinaire, à l'exception de la connexion d'une bobine de retard
à haute résistance, Busj•Ret, entre le négatif
de la batterie et le point entre le récepteur et le secondaire
de la bobine d'induction. Ceci est destiné au test de charge.
Le multiplex de l'abonné est constitué de rangées
de prises à trois conducteurs, dont la pointe et la bague sont
raccordées aux lignes normales verticale et rotative, et le manchon
à la normale privée de l'abonné automatique.
Suivons un appel afin de clarifier l'action.
L'abonné du central appelle le central comme dans mon standard
manuel de batterie commune et donne son numéro à l'opératrice.
Constatant qu'il s'agit du central Sud, l'opératrice « A »
appuie sur un bouton de commande et donne le numéro directement
à une opératrice « B » du central
Sud. Cette dernière attribue la ligne. L'opératrice « A »
effectue ensuite le test d'occupation en mettant en contact la pointe
de la fiche d'appel avec le manchon de la prise.
Si la ligne est libre, aucun courant ne circule dans R ; le manchon
est donc au potentiel de terre, qui est le même que celui du relais
d'occupation de l'opératrice « A ». Trouvant
la ligne libre, elle la branche. À 0, le courant négatif
de la batterie 24 volts circule à travers le relais de commande
d'appel, C C R, le long du manchon, jusqu'au bureau Sud et via R vers
la terre. Au bureau principal, cela déclenche le relais de commande
d'appel, C C R, déconnectant le relais de test d'occupation et
fermant l'extrémité du circuit du cordon. Au bureau Sud,
R déclenche et coupe son contact. Le courant circulant à
travers R modifie le potentiel de tous les manchons de ce manchon au
bureau principal, de sorte que tout autre opérateur « A »
obtiendra le test d'occupation en tentant de l'utiliser.
Au bureau Sud, le contact arrière de R. alimente la batterie
négative à 50 volts via la ligne R. jusqu'au relais de
supervision d'appel principal (C.S.R.) et à la terre. Cela empêche
le voyant de supervision d'appel (C.S.L.) de s'allumer.
L'opératrice « B » du bureau Sud teste
la ligne appelée en mettant en contact l'extrémité
de la prise principale avec le manchon de la prise multiple. Ici, l'état
non occupé est la batterie négative pleine, à 50
volts de la terre, la borne positive de la batterie étant à
la terre.
Le récepteur de l'opératrice étant relié
à la batterie négative par une bobine de retard, aucun
courant ne peut circuler. Mais si la ligne appelée est occupée,
la ligne principale privée est mise à la terre, et le
courant circule alors dans le récepteur de l'opératrice,
ce qui déclenche un déclic d'occupation. Constatant que
la ligne est libre, elle insère la prise principale dans la prise
de l'abonné. Le manchon de la fiche met la terre hors tension
sur la terre privée du premier sélecteur de la ligne appelée,
qui actionne son relais de coupure de pont (BCOR), coupant la batterie
et libérant la ligne pour la sonnerie. Cette terre sur la terre
privée assure également une protection contre les autres
interrupteurs automatiques.
Le poste automatique était câblé comme à
Dayton, dans l'Ohio, à l'exception d'un condensateur, qui était
coupé en série avec le récepteur, comme illustré
sur le schéma de droite. Lors de l'insertion de la fiche principale,
le courant circule de la terre de la batterie, via R., l'anneau de la
fiche principale, d'un côté de la ligne jusqu'au poste
de l'abonné, puis par la sonnette, puis de l'autre côté
de la ligne jusqu'à l'extrémité de la fiche, et
enfin via Ra jusqu'au négatif de la batterie. Ceci met sous tension
R. et R. R. établit son contact, mais lorsque R. est sous tension,
il ne fait rien. L'activation de Ra commute la batterie de R. vers le
voyant de surveillance automatique (Auto). S. L. Cela désactive
le relais de supervision d'appel (C. S. R.) du central, allumant ainsi
le voyant de supervision d'appel (C. S. L.), permettant ainsi à
l'opérateur « A » de savoir que la connexion
est établie. L'allumage du voyant de supervision automatique
du central Sud sert de signal d'alarme à l'opérateur « B »,
qui appelle l'abonné appelé à l'aide d'une touche
manuelle.
Lorsque l'abonné automatique répond, la sonnerie est coupée
et le combiné, avec son secondaire et son condensateur, est mis
en marche. Ce dernier interrompt immédiatement le flux de courant,
permettant à Ra et R de revenir en arrière. Ce dernier
ne provoque aucun changement. R commute la batterie négative
du voyant de supervision automatique (l'éteignant) sur R,, activant
ainsi le relais de supervision d'appel du central et éteignant
le voyant de supervision d'appel (C. S. L.). Les deux opérateurs
sont ainsi informés que l'abonné appelé a répondu.
Une fois la communication établie, l'abonné automatique
raccroche. Ceci allume le voyant de supervision automatique, Auto S
L, au bureau Sud et le voyant de supervision d'appel au bureau Principal.
L'opérateur Principal coupe la connexion, ce qui permet à
R de revenir, alimentant ainsi le voyant de supervision manuel, J, fan.
S L, puisque I est à nouveau alimenté par le courant passant
par la sonnette de l'abonné. Voyant les deux voyants allumés,
l'opérateur « B » coupe la ligne.
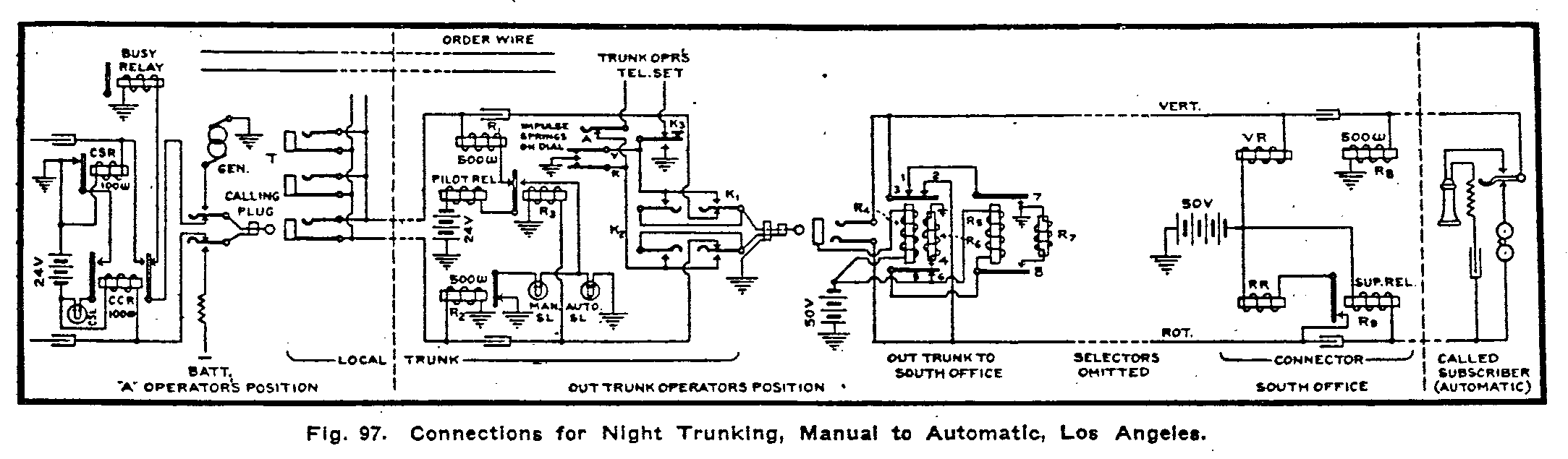
La disposition des lignes de nuit du bureau Principal au bureau Sud
est illustrée à la figure 97, qui présente l'appareillage
du bureau précédent. Des positions de lignes spéciales
sont prévues dans une section du tableau, et chaque position
est équipée d'une partie du nombre total de lignes vers
le bureau Sud. Devant tous les opérateurs « A »
du bureau Principal se trouvent des lignes locales, T, menant à
la position de lignes spéciales, le nombre total de lignes étant
réparti entre les différentes positions.
Le fil de commande relié au poste principal de chaque opérateur
de ligne principale est relié aux boutons de commande d'une partie
des opérateurs « A ». À gauche de
la figure 97 se trouve l'extrémité d'un circuit à
cordon Kellogg avec l'équipement habituel. L'extrémité
de la ligne principale locale, T,
traverse la bobine de retard, R, le contact arrière du relais
R, le relais pilote vers le négatif de la batterie. Le manchon
passe par le relais R,
à la terre. Du côté automatique des condensateurs,
la ligne d'extrémité n'a pas de connexions normales. Le
côté anneau est relié à la terre par R. Ce
dernier peut être appelé relais de supervision de la ligne
principale, car il active non seulement les lampes de supervision de
la section de ligne principale, mais répète également
la supervision automatique à l'opérateur « A ».
La ligne principale de départ est équipée de deux
relais, R et R6.
Le premier est un relais de coupure à action rapide. Normalement,
son ressort principal, 3, avec son contact arrière, 2, maintient
le circuit en court-circuit. Le contact R, à action lente, a
pour fonction de mettre à la terre les lignes via son contact
7.
Lorsqu'il reçoit un appel de nuit pour le bureau Sud, l'opérateur
« A », au moyen d'un fil de commande, répète
le numéro à l'un des opérateurs de la ligne de
sortie. Ce dernier assigne la ligne locale T à utiliser, dans
laquelle l'opératrice A insère la fiche d'appel du circuit
de ligne qu'elle utilise. Côté manchon, le relais de commande
d'appel C C R, en position A, et R, en position de ligne, se montent.
Côté extrémité, la batterie de masse, via
le relais de supervision d'appel C S R, sur la carte A, circule sur
la ligne, via le relais pilote R, vers la batterie négative.
Par conséquent, le voyant de supervision d'appel C S L, ne s'allume
pas.
L'opératrice sélectionne simultanément une ligne
vers le bureau Sud et la branche. Le manchon de la fiche est relié
à la masse, ce qui provoque la montée de R, supprimant
ainsi le court-circuit de la ligne. Au même moment, le ressort
principal 5 se ferme avec le contact 4, provoquant la montée
de R5, ce dernier se verrouillant en position par son propre contact
8 et la bobine de retard R,.
La ligne principale se termine au bureau Sud dans un second temps. Sélecteur,
il n'est pas nécessaire de passer par un premier sélecteur,
car ce dernier a pour fonction de sélectionner le central. Les
deuxième et troisième sélecteurs et connecteurs
utilisés pour les appels entrants ont été installés
comme section de jonction séparée dans la salle de commutation
du central Sud. Ils étaient de type à déclenchement
par jonction.
·Après le branchement sur la jonction du central Sud,
le courant circule pendant un instant du deuxième sélecteur
via la ligne rotative jusqu'à la prise de jonction locale et
à la terre via R. Ceci déclenche et allume le voyant de
surveillance automatique,
Auto. S. L. L'opérateur « B » appuie sur
la touche K, ce qui coupe le circuit arrière et connecte son
poste téléphonique à la jonction sortante.
Cela permet d'obtenir une ligne libre, permettant de signaler et d'actionner
successivement le deuxième sélecteur, le troisième
sélecteur et le connecteur du poste Sud. Le contact A s'ouvre
lorsque le cadran est tourné, comme dans un poste automatique
classique. La figure 97 ne présente pas les sélecteurs,
mais un squelette du connecteur et du poste appelé. Une fois
le poste appelé sélectionné, l'opérateur
appuie sur la touche K, qui met à la terre la ligne verticale
et sonne. La touche K est ensuite relâchée, fermant la
ligne verticale. Les sonneries suivantes peuvent être déclenchées
par la touche d'écoute K, et la touche de sonnerie Ka. En attendant
la réponse de l'abonné appelé, le connecteur alimente
la sonnerie du poste appelé par la bobine de retard de 500 ohms
Ra et le relais de supervision Ra. R. se lève, connectant le
relais rotatif RR et la batterie négative à la ligne rotative.
Ceci alimente R, au central, l'alimentant et allumant le voyant de supervision
automatique Auto.S.L. Lorsque l'abonné automatique répond,
le condensateur du circuit téléphonique interrompt le
courant, laissant R et R retomber. Cela éteint le voyant de supervision
automatique, informant l'opérateur « B »
que l'abonné appelé a répondu. Il alimente également
la batterie négative, via R, au relais de supervision d'appel
CSR, du cordon manuel, alimentant le voyant. Cela éteint le voyant
de supervision d'appel CSL et avertit l'opérateur « A ».
Le relais pilote ne s'alimente pas via les 600 ohms auxquels il est
connecté.
Une fois la conversation terminée, les deux abonnés raccrochent.
L'abonné appelant (manuel) allume le voyant de supervision de
réponse comme d'habitude. En raccrochant, l'abonné appelé
(automatique) ferme le circuit via sa sonnerie, alimentant ainsi R.
dans le connecteur. Ceci ferme la batterie via le relais rotatif vers
la ligne rotative qui raccroche R. au central.
En raccrochant, Ra allume le voyant de supervision automatique, ce qui
informe l'opérateur de la ligne principale de la situation. Lorsque
l'armature de Ra se détache de son contact arrière, elle
coupe la batterie du fil de pointe, permettant au relais de supervision
d'appel du circuit du cordon de l'opérateur « A »
de retomber, allumant ainsi le voyant de supervision. Ainsi, les deux
opérateurs sont informés simultanément que l'abonné
automatique a raccroché.
Lorsque l'opératrice « A » coupe la connexion,
elle provoque le retour de R, allumant le voyant de surveillance manuel.
Mau. S.L. Voyant les deux voyants allumés, l'opératrice
de la liaison débranche la fiche de liaison locale de la prise
de liaison sortante. Le simple retrait de la cosse 1J de la prise déclenche
les interrupteurs automatiques du bureau Sud comme suit : le manchon
de la fiche de liaison, porteur de terre, bloquait R. Ce dernier revient
alors rapidement en court-circuit et court-circuite les lignes verticales
et rotatives en 2 et 3. Le contact 7 de R étant toujours établi,
les deux lignes sont mises à la terre. L'armature n° 5 s'est
entre-temps éloignée du contact 4 (masse) et touche maintenant
le contact 6, qui correspond au négatif de la batterie. Ceci
crée un court-circuit franc sur le relais R, de sorte qu'il commence
à retomber lentement. Une fois retombé, le contact 7 s'ouvre,
coupant la terre des lignes. Ceci achève le déclenchement
des interrupteurs automatiques du bureau Sud. Il est intéressant
de noter le nouveau circuit que cette liaison nous offre pour la communication.
Il est illustré à la figure 98.
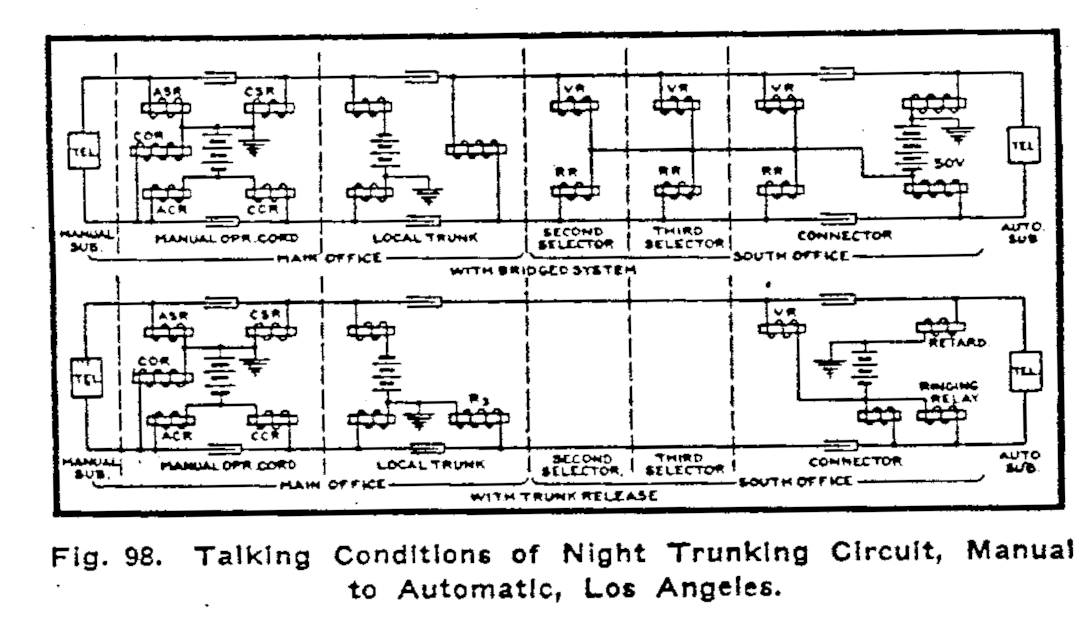
Le schéma supérieur illustre les conditions qui auraient
existé si le système en pont avait été utilisé.
Le schéma inférieur illustre la situation de Los Angeles,
due au déclenchement de la liaison.
En comptant les relais du circuit manuel, on compterait huit ponts sur
la ligne, en plus du relais de coupure, C.O.R., de l'abonné manuel,
qui est relié à la terre. Avec le déclenchement
de la liaison, on ne compte plus que cinq ponts, plus le relais de coupure
et R, dans la ligne principale locale.
Le deuxième sélecteur auquel aboutissait la ligne principale
au bureau Sud était similaire à ceux utilisés par
les abonnés du bureau Sud, à la différence près
que la résistance de 100 ohms au niveau de l'aimant de déclenchement
était omise, tout comme la ligne principale à laquelle
elle alimentait le courant. Le troisième sélecteur était
semblable au deuxième sélecteur ordinaire, conçu
pour une libération complète de la ligne principale.
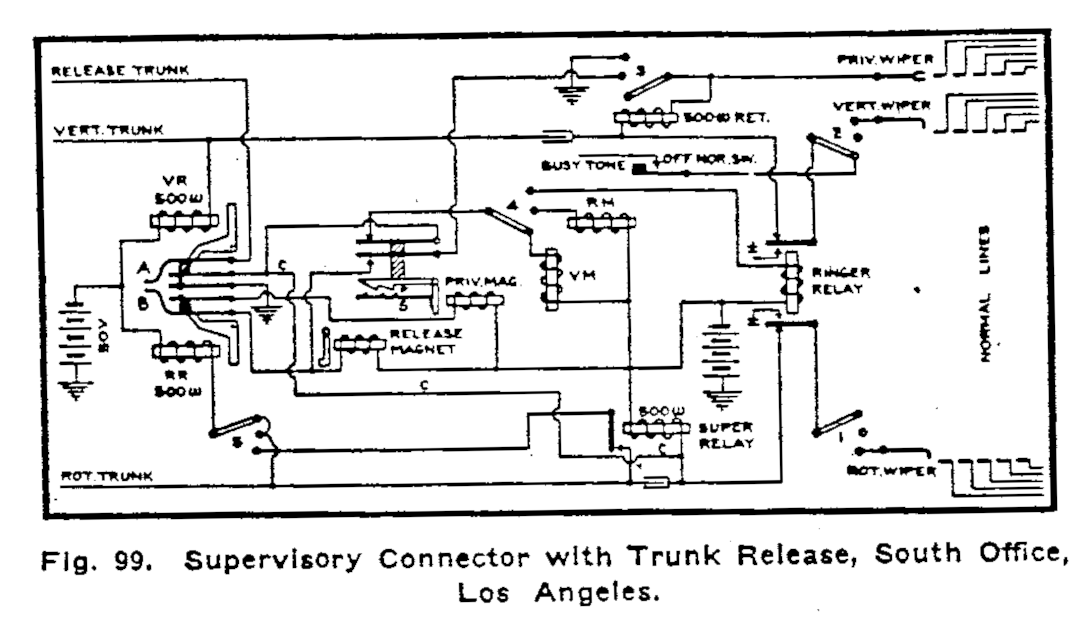
Le connecteur de supervision utilisé sur ce schéma de
ligne principale était câblé comme illustré
à la Fig. 99. Il est de type à libération complète
de la ligne principale et renvoie le courant de libération au
troisième sélecteur par l'intermédiaire des ressorts
de libération avant spéciaux, A B, et l'aimant de déclenchement
lui-même sert à limiter le flux de courant au lieu d'une
résistance spéciale. Le dispositif de supervision comprend
un relais de supervision de 500 ohms alimentant la batterie négative
de la ligne rotative et un retardateur de 500 ohms. Bobine reliant la
ligne verticale à l'essuie-glace privé. En position de
conversation, elle alimente la batterie positive ou de masse de l'abonné
appelé. Le relais de supervision possède un contact qui
contrôle la connexion du relais rotatif à la ligne rotative.
Ceci active la supervision au niveau du tableau manuel décrit
ci-dessus. Le fil C.C.C. a été placé pour équilibrer
les deux côtés du circuit de conversation par rapport à
la masse. Il relie le relais de sonnerie à la ligne rotative,
qui, sans lui, ne présenterait qu'une seule fuite inductive à
la terre. Il ne faut pas oublier que, pour les qualités vocales
des circuits téléphoniques, l'impédance des deux
extrémités à la terre doit être aussi proche
que possible. En ce qui concerne l'équilibre inductif, les bobines
de retard peuvent aussi bien être connectées au pôle
négatif de la batterie qu'à la terre, car les caractéristiques
du courant alternatif ne sont pas affectées par le passage dans
la batterie. Celle-ci agit comme une très faible résistance
non inductive. Ceci explique la présence du relais de sonnerie
connecté à la ligne rotative de la figure 98, schéma
ci-dessous.
Une remarque a été faite au chapitre précédent
sur la méthode de gestion des appels automatiques en manuels.
L'abonné automatique tire simplement sur la touche « 1 »
du cadran, ce qui fait monter les curseurs de son premier sélecteur
au premier niveau et sélectionne une ligne non occupée
vers un opérateur « B » au standard principal.
Le premier sélecteur étant la libération de ligne,
les relais verticaux et rotatifs sont coupés lorsque le commutateur
latéral passe en troisième position. L'abonné est
alors sans moyen de libération. Pour pallier cette difficulté,
chaque ligne principale vers le standard principal a été
équipée de deux relais de libération de série
spéciale, installés sur le support de relais du bureau
Sud.
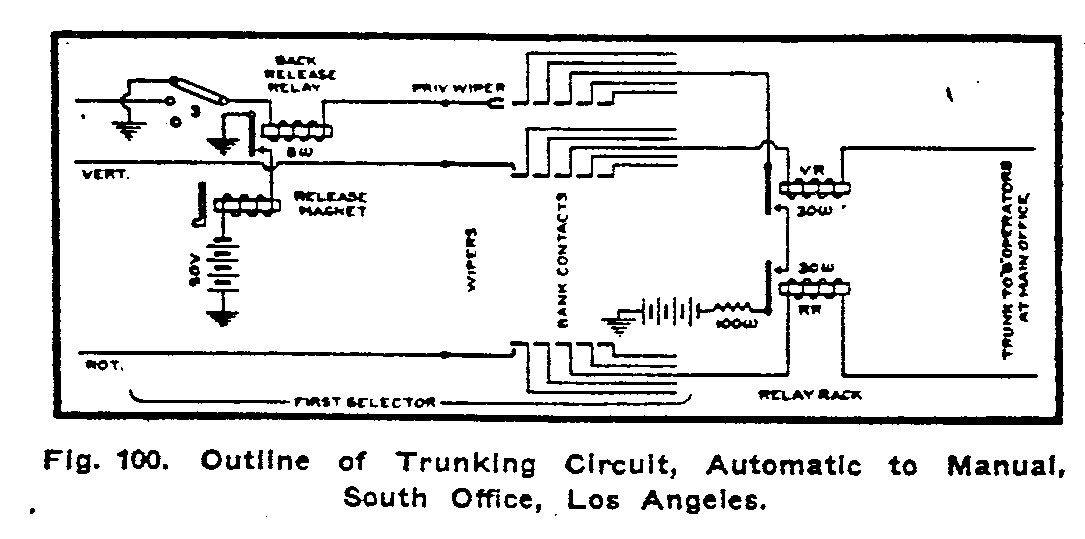
Leur câblage est illustré à la figure 100.
Chaque relais est bobiné à une résistance de 30 ohms
et son noyau est recouvert d'un manchon en cuivre, afin de minimiser
l'impédance au courant de conversation. Une résistance
de 100 ohms relie la batterie au contact du relais rotatif (R.R.). La
ligne de déclenchement se poursuit par le contact du relais vertical
(R.R.) jusqu'aux rangées privées des premiers sélecteurs.
Lors du déclenchement, les deux relais se déclenchent
simultanément et actionnent l'aimant de déclenchement
via le relais de déclenchement arrière, au-dessus du tronc
de déclenchement. Depuis la première installation décrite
dans ces deux chapitres, des centraux supplémentaires ont été
installés, tous automatiques, dans le but de couvrir à
terme toute la ville avec des automatismes, aussi rapidement que le
trafic l'exige. Les problèmes posés par la multiplicité
des bureaux et des longs troncs ont nécessité des inventions
supplémentaires, qui n'interviennent que plus tard dans l'histoire.
Le
système Battle Creek
Le système de déverrouillage du "trunk", testé
à Los Angeles, a connu un tel succès qu'il a été
amélioré. Comme d'habitude, cette amélioration
a consisté à simplifier le circuit de déverrouillage,
réduisant ainsi le nombre de circuits reliés entre eux,
du premier sélecteur au connecteur. La première installation
de cette amélioration a eu lieu à Battle Creek, dans le
Michigan, en 1904. Il s'agissait d'un système de 10 000
unités, équipé de sélecteurs, de seconds
sélecteurs et de connecteurs. Le premier sélecteur était
identique à celui de Los Angeles, à la différence
que le relais de déclenchement arrière (dans l'essuie-glace
privé) était de 0,5 ohm au lieu de 8 ohms. Cette réduction
visait à offrir une plus grande marge de sécurité,
car le relais de déclenchement arrière ne devait pas se
déclencher lorsqu'il était en série avec l'aimant
privé pour tester une ligne non occupée.
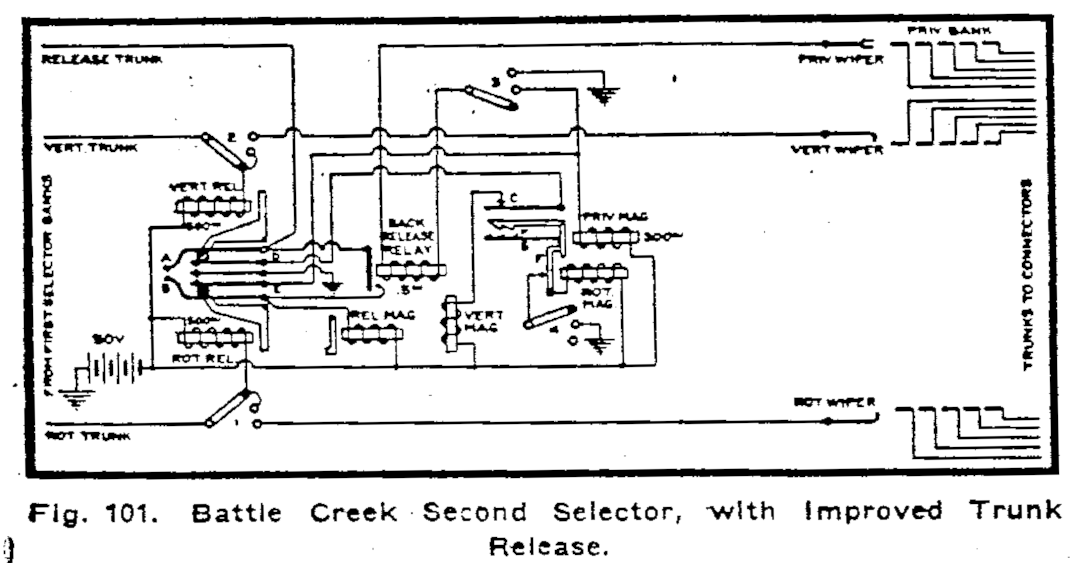
Le second sélecteur est illustré à la figure 101.
Le relais rotatif commande normalement l'aimant privé. Le contact
vertical D du relais commande l'aimant vertical via le contact C de
l'aimant privé. Le palpeur pour une ligne non occupée
est composé de l'essuie-glace privé, du relais de déclenchement
arrière et de l'aimant privé, connecté au négatif
de la batterie ; cependant, le relais de déclenchement arrière
de demi-ohm n'agit pas via l'aimant privé, car de la résistance
de ce dernier.
Le circuit de déclenchement du premier groupe de sélecteurs
(privé) passe par les ressorts de déclenchement spéciaux
A et B, situés sur les relais verticaux et rotatifs, jusqu'à
l'aimant de déclenchement et à la batterie négative.
Le réglage de ces ressorts est tel que si l'un des relais est
alimenté seul, le contact sera établi.
Mais si les relais vertical et rotatif sont relevés simultanément,
A et B se rejoignent, comblant ainsi l'espace vide dans la ligne de
libération.
C'est le moyen utilisé pour libérer une connexion inachevée.
Si, pour une raison quelconque, le deuxième sélecteur
ne parvient pas à terminer son cycle d'opérations ;
après avoir tiré le premier chiffre, l'abonné décide
de ne pas terminer l'appel, il peut raccrocher simplement son combiné.
Ceci met à la terre les lignes verticale et rotative, fermant
A-B. Le négatif de la batterie circule alors momentanément.
Les relais vertical et rotatif relèvent : l'aimant de libération,
les contacts A-B, la ligne de libération, le curseur privé
du premier sélecteur, son relais de libération arrière
et le levier 3 de l'interrupteur latéral à la terre. L'aimant
de libération relie le deuxième sélecteur et le
relais de libération arrière du premier. Les sélecteurs
sont ainsi alimentés, le premier libérant le second sélecteur,
le second actionnant l'aimant de libération du premier sélecteur,
qui remplit une fonction similaire dans cet interrupteur. Le contact
du relais de libération arrière du second sélecteur
est câblé en parallèle avec le contact A-B du tronc
du déclencheur. Cela lui permet d'agir sur l'aimant de libération
et le tronc de libération en une seule opération, ce qui
constitue un progrès notable en termes de simplicité par
rapport au plan suivi à Los Angeles.
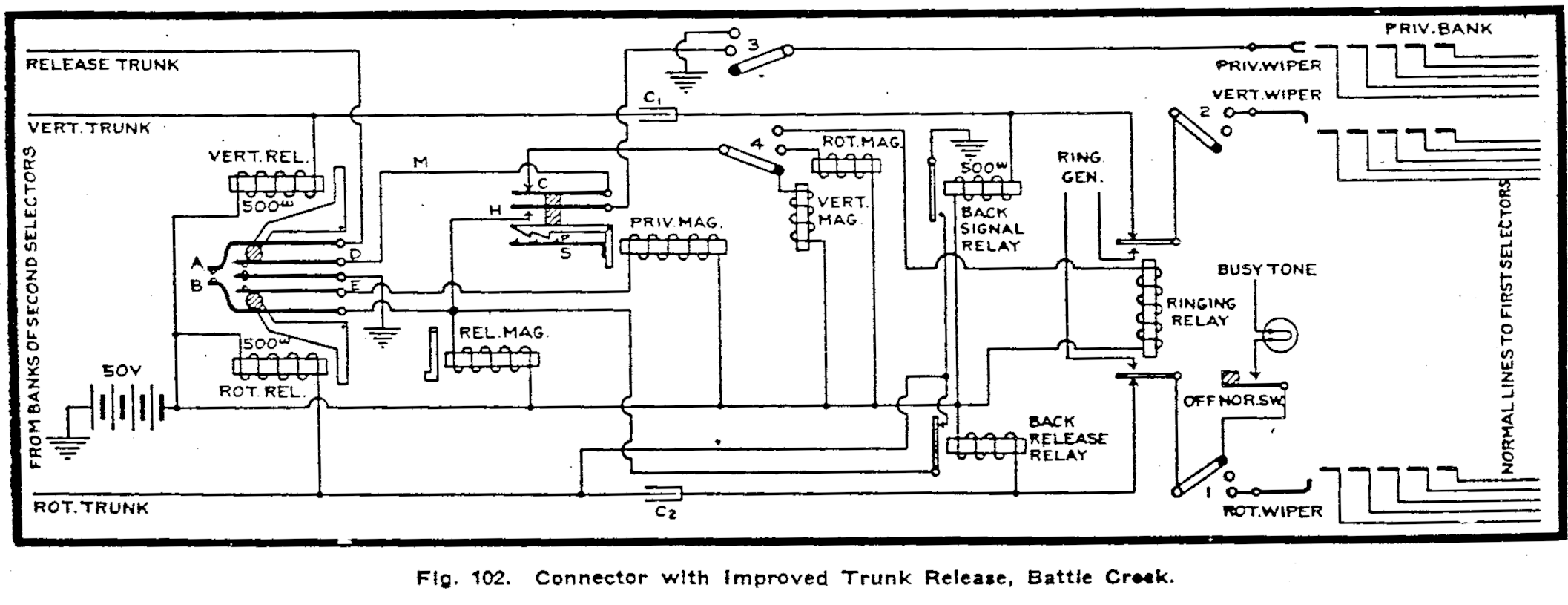
Le câblage des connecteurs est illustré à la figure
102. Le relais rotatif commande l'aimant privé. Le relais vertical
actionne l'aimant vertical, l'aimant rotatif et le relais de sonnerie,
selon la position de l'interrupteur latéral 4. Son fil de contact,
M, est bouclé par un contact, C, sur l'aimant privé afin
d'éviter de déplacer l'un des trois aimants mentionnés
ci-dessus lors du relâchement. Le test d'occupation sur la ligne
appelée est effectué au moyen de l'aimant de libération.
Une fois l'appelé sélectionné, la dernière
impulsion rotative déclenche le relais rotatif et l'aimant privé.
L'interrupteur latéral 3 repose sur le contact central, ainsi,
lorsque l'aimant privé est tiré vers le haut, le négatif
de la batterie est connecté à l'essuie-glace privé
via l'aimant de déverrouillage. Si ce dernier est au sol, en
raison d'une occupation, l'aimant de déverrouillage se soulève,
libérant instantanément le connecteur.
Ignorant ce phénomène, l'abonné appuie sur le bouton
de sonnerie, mettant ainsi la ligne verticale à la terre. L'interrupteur
latéral et les essuie-glaces étant à nouveau en
état normal grâce au relâchement, cette tentative
de sonnerie fait monter l'axe de l'essuie-glace d'un ou plusieurs crans.
L'interrupteur de coupure se ferme, ce qui connecte la tonalité
d'occupation à la ligne rotative via l'interrupteur latéral
1. En attendant la réponse du poste appelé, celui-ci entend
cette tonalité et est informé que la ligne est occupée.
La libération après conversation s'effectue via le contact
A-B, comme décrit pour le deuxième sélecteur. L'abonné
appelé peut également se déconnecter en raccrochant,
s'il a préalablement tourné son cadran d'un ou plusieurs
chiffres. En raccrochant, il active à la fois le relais de retour
et le relais de libération, remontant ainsi l'aimant de libération.
Le circuit utilisé est le suivant : du négatif de
la batterie, en passant par l'aimant de libération, vers la droite
jusqu'au contact du relais de retour, jusqu'au contact du relais de
retour et enfin à la terre. Le relais de retour sert uniquement
à signaler un opérateur téléphonique. Lorsqu'un
abonné automatique souhaite une connexion téléphonique,
il appelle le guichet téléphonique en tirant sur un numéro
de son cadran. L'opérateur téléphonique répond,
prend les détails de l'appel et informe l'abonné qu'il
sera rappelé dès que la ligne sera disponible. Une fois
l'appel établi et l'appelé dans la ville éloignée
en ligne, l'opératrice sélectionne l'abonné local
à l'aide de son cadran et le fait sonner. Lorsque l'abonné
répond, elle lui demande de tirer sur le « 1 ».
Il est alors prêt à poursuivre la conversation. Cette simple
pression permet de relâcher le ressort de terre de son appareil,
afin qu'il puisse, lorsqu'il supervise ou raccroche, utiliser la connexion
de terre. À tout moment pendant la conversation, il peut signaler
à l'opératrice en appuyant sur son bouton de sonnerie.
La figure 103 présente le schéma de la connexion complète,
depuis la bobine répétitive du cordon téléphonique
à gauche, en passant par le premier sélecteur, le deuxième
sélecteur et le connecteur, jusqu'au poste appelé à
droite. On remarquera que, de la bobine répétitive à
l'abonné, trois ponts traversent le circuit : le relais
de supervision sur le câble interurbain, les relais verticaux
et rotatifs du connecteur, à gauche du condensateur, et les relais
de retour de signal, à droite.
Lorsque l'abonné souhaite signaler l'opérateur, il appuie
sur son bouton de sonnerie. Cela met à la terre la ligne verticale
et active le relais de retour de signal. Ce relais met à la terre
la ligne rotative à gauche du condensateur C, de sorte que le
courant circule dans le relais rotatif du connecteur et la moitié
du relais de supervision du câble interurbain. Le premier est
sans effet. Le second active et active un signal devant l'opérateur,
qui prend la ligne et répond à ses besoins.
Ce schéma illustre la simplicité du déverrouillage
amélioré du coffre, surtout si on le compare au premier
déverrouillage du "ttrunk" de Los Angeles. (Fig. 90)
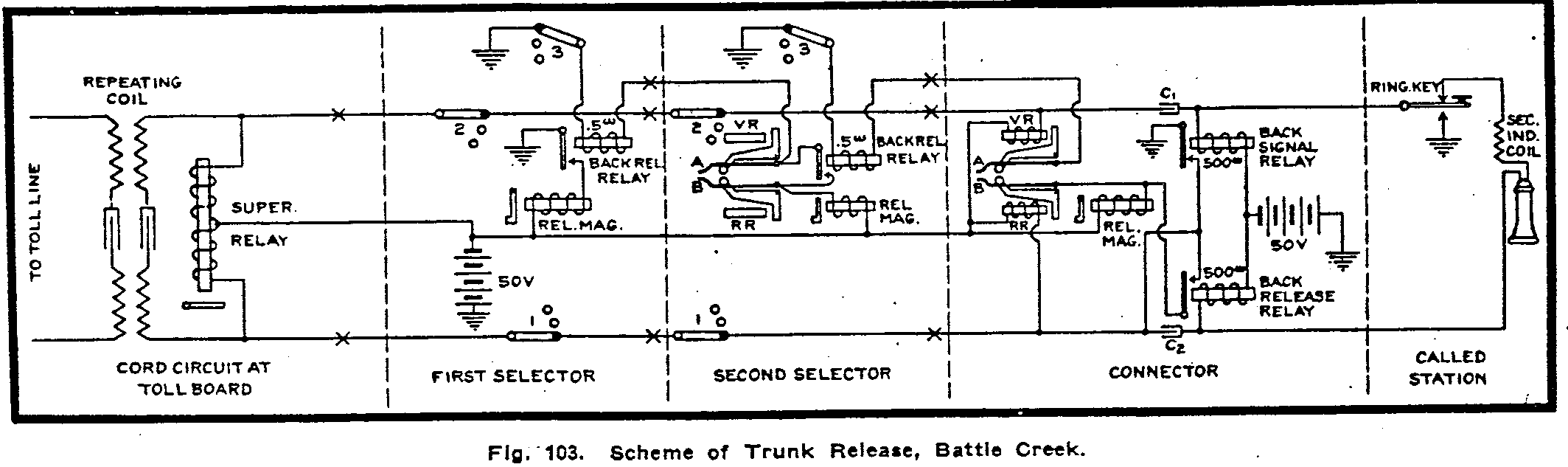
La Fig. 103 montre que le déverrouillage de tous les interrupteurs
est déclenché par l'action conjointe de deux relais :
le vertical et le rotatif du connecteur. Tous les relais des sélecteurs
sont coupés. Lorsque l'opératrice retire sa fiche, les
lignes verticale et rotative sont momentanément mises à
la terre, comme décrit précédemment. Les relais
vertical et rotatif du connecteur touchent alors les contacts A-B. Le
négatif de la batterie circule ensuite à travers l'aimant
de déverrouillage, par-dessus le coffre, jusqu'au relais de déverrouillage
arrière du second sélecteur, puis à la terre. Les
deux se soulèvent, le premier se connectant aux crans qui maintiennent
l'axe d'essuie-glace. Le relais de déclenchement arrière
(du deuxième sélecteur) ferme l'espace en parallèle
avec A-B, permettant ainsi au courant de circuler à travers l'aimant
de déclenchement via la ligne de déclenchement et de revenir
au relais de déclenchement arrière du premier sélecteur.
À la masse, en raison d'une condition d'occupation, l'aimant
de déclenchement déclenche le déclenchement du
deuxième sélecteur, tandis que le relais de déclenchement
arrière du premier déclenche l'aimant de déclenchement
de cet interrupteur.
Lorsque les relais verticaux et rotatifs du connecteur retombent, ouvrant
le contact A-B, tous les relais et aimants de la chaîne de circuits
retombent et le déclenchement est terminé.
Cette chaîne comporte trois circuits, reliés entre eux
par les relais de déclenchement arrière de la manière
la plus simple et la plus naturelle. Le circuit de communication est
aussi propre que possible, composé de deux fils passant par de
bons contacts de frottement et d'une seule paire de condensateurs, avec
seulement deux ponts et aucune bobine série. L'utilisation du
troisième fil (câble de déblocage) a rendu tout
cela possible, et l'amélioration a certainement justifié
la dépense.
Dispositions
des salles de commutation
Il est naturel que, dans tout nouveau système, les ingénieurs
mettent du temps à trouver les meilleures méthodes de
fonctionnement. Le standard automatique était si différent
des tableaux manuels que les méthodes d'agencement des appareils
et des appareils, courantes pour ces derniers, ne convenaient pas aux
premiers. Pendant un certain temps, aucune pratique précise n'a
été établie, chaque cas étant câblé
selon les critères du moment. En général, les premiers
sélecteurs étaient regroupés au même endroit,
les seconds regroupés séparément et les connecteurs
dans un autre groupe. Cela compliquait quelque peu le câblage
et rendait difficile le suivi d'un appel, notamment si un abonné
raccrochait, c'est-à-dire s'il appelait en totalité ou
en partie et ne pouvait pas le raccrocher.
Finalement, certaines idées bien définies sur le regroupement
des commutateurs ont commencé à émerger, ce qui
a conduit à la révision de la disposition des câbles.
Il a été constaté que, dans la mesure où
les premiers sélecteurs représentaient les lignes des
abonnés, les connecteurs qui les desservent avec les appels entrants
devaient leur être associés afin de raccourcir le câblage.
De plus, si les seconds sélecteurs pouvaient être associés
d'une manière ou d'une autre aux groupes de premiers sélecteurs
qu'ils desservent, cela permettrait de simplifier le câblage et
le suivi des appels via les différents commutateurs.
Enfin, M. A. E. Keith a conçu un plan d'implantation qui a résolu
le problème de manière claire et économique. La
demande de brevet a été déposée le 9 mars
1905 et délivrée le 25 septembre 1906 sous le numéro
831876.
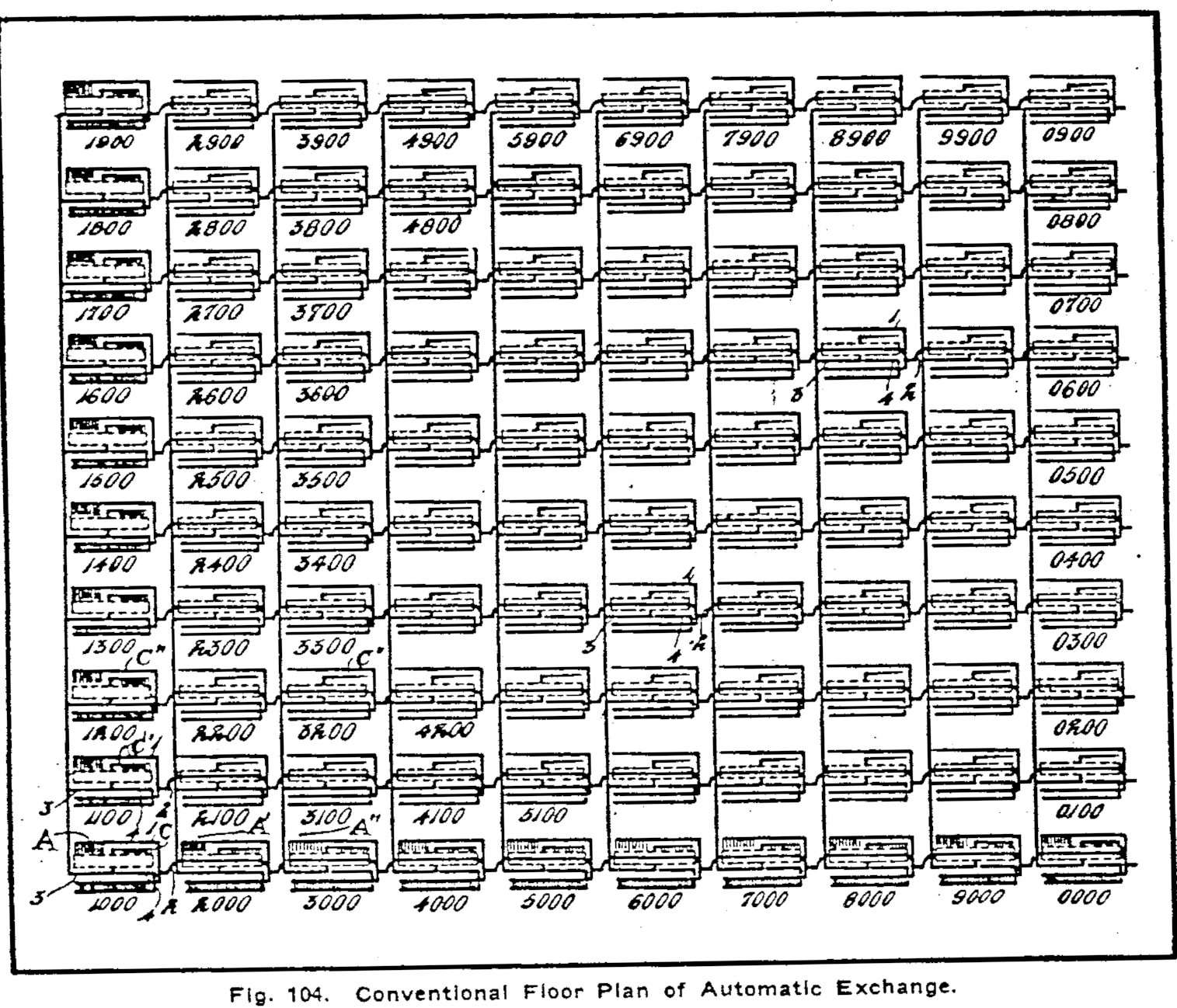
La disposition générale est illustrée à
la figure 104 et peut être qualifiée de plan de sol. Les
commutateurs sont représentés par de courtes lignes verticales
et sont groupés, chaque groupe étant monté sur
un châssis. Il y a dix cadres par rangée verticale et dix
rangées, soit un total de 100 cadres. Chaque cadre représente
les commutateurs desservant 100 abonnés et comprend 100 premiers
sélecteurs, dix seconds sélecteurs et dix connecteurs.
La taille du commutateur illustré est donc de dix mille lignes.
La rangée verticale de gauche représente le premier millier,
qui dessert tous les abonnés dont les numéros commencent
par « 1 », comme « 1248 »
ou « 1746 ». La rangée verticale suivante,
à droite, représente le deuxième millier, tous
les numéros commençant par « 2 »,
comme « 2365 » ou « 2906 ».
La dernière rangée représente le zéro millier,
dont les numéros sont en « 0 ». En fonctionnement
automatique, « 0 » signifie « dix »
et est le dixième d'une série. Dans chaque rangée
verticale constituant un « mille » particulier,
les dix cadres sont disposés dans un ordre précis. En
bas se trouve le cadre de centaines « O » ;
au-dessus viennent, dans l'ordre, la première centaine, la deuxième
centaine, etc., jusqu'à la neuvième centaine. Le cadre
« 0 » contient les premiers secteurs des lignes
dont les numéros vont de 1 000 à 1 099 ;
la première centaine contient les numéros de 1 100
à 1 199 ; la troisième de 1 300 à
1 399, etc. Par exemple, dans la première rangée
à gauche (le premier millier), la troisième centaine sera
1 300, tandis que le cadre adjacent à droite sera 2 300,
puisqu'il se trouve dans le deuxième millier. Dans chaque cas,
le numéro complet du cadre sera son propre numéro de centaine,
précédé du chiffre de millier approprié.
Le nombre total d'abonnés dont les premiers sélecteurs
se trouvent dans la troisième case du premier millier sera compris
entre 1 300 et 1 399 inclus, tandis que la case correspondante
dans la deuxième ligne du millier sera comprise entre 2 300
et 2 399 inclus. On peut donc dire que les lignes horizontales
contiennent des trames de centaines correspondantes, bien qu'elles soient
en milliers différents. Nous avons maintenant la possibilité
de connecter n'importe quel abonné de n'importe laquelle de ces
trames à n'importe quel autre abonné de n'importe quelle
trame. Concernant le problème d'un point de vue automatique,
nous allons sélectionner la ligne souhaitée en trois étapes.
Premièrement, nous choisirons le millier souhaité, qui
est le premier chiffre du numéro. Cette opération est
effectuée par un premier commutateur. Deuxièmement, nous
choisirons une trame particulière du groupe de centaines dans
ce millier, qui est le deuxième chiffre du numéro. Cette
opération est effectuée par un deuxième commutateur.
Troisièmement, nous choisirons un certain numéro dans
la trame sélectionnée, qui est l'un des deux derniers
chiffres du numéro d'appel complet. Cette dernière opération
est effectuée par le commutateur de sélection.
La figure 104 illustre également le cheminement des câbles
destinés à acheminer les appels.
Les courtes lignes verticales en bas de chaque cadre représentent
les 100 premiers sélecteurs appartenant à ce groupe de
100. En haut de chaque courte ligne se trouve la banque de contacts
de ce commutateur. Le câble 2 multiplie tous les contacts de cette
banque dans la première rangée de cadres. De même,
un câble 2, dans chaque rangée, multiplie tous les contacts
de la première banque de sélecteurs dans toutes les trames
de cette rangée. Un dixième des fils du câble 2
aboutissent aux seconds sélecteurs A dans la trame 1000, un autre
dixième des fils aboutissent aux seconds sélecteurs A'
A' dans la trame 2000, et ainsi de suite jusqu'à la trame 0000.
Dans le câble 2 qui dessert la deuxième rangée horizontale
(châssis 1JOO, 2100, 3100, etc.), chaque dixième des fils
se termine par des seconds sélecteurs dans un cadre de cette
rangée horizontale. Ceci est vrai pour toutes les rangées
horizontales. De la même manière, les contacts des seconds
sélecteurs de chaque millier sont multipliés par les câbles
3.
Prenons l'exemple de la rangée verticale gauche des cadres (les
premiers mille), un dixième des fils du câble 3 se termine
par des connecteurs C, dans le cadre 1000. Un autre dixième se
termine par des connecteurs C', C', dans le cadre 1100, et ainsi de
suite jusqu'au cadre 1900. Dans chaque cadre, les groupes de connecteurs
C sont multipliés et acheminés par le câble 4 jusqu'aux
premiers sélecteurs, où ils sont raccordés aux
lignes d'abonnés reliant le central aux sous-stations. Le câble
4 est appelé câble « normal ».
Si un abonné de la trame 1000 souhaite se connecter à
un abonné de la trame 3200, il activera d'abord son propre sélecteur
dans la trame 1000. Cet appareil sélectionnera une ligne non
occupée du câble 2, qui se termine par un second sélecteur,
A, dans la trame 3000. Il manipulera ensuite ce second sélecteur
pour qu'il sélectionne une ligne non occupée du câble
3, montant vers le haut et se terminant par un connecteur C, dans la
trame 3200. Ce sélecteur sélectionnera l'abonné
concerné dans cette trame.
·Mais si l'abonné de la trame 3200 appelle l'un des abonnés
de la trame 1000, Son chemin sera le suivant : de son premier sélecteur
dans le cadre 3200, par le câble 2 vers la gauche, jusqu'à
un deuxième sélecteur dans le cadre 1200 ; de là,
par le câble 2 vers le bas, jusqu'à un connecteur dans
le cadre 1000, de ce connecteur jusqu'au premier sélecteur de
la ligne appelée, et de là, jusqu'au poste.
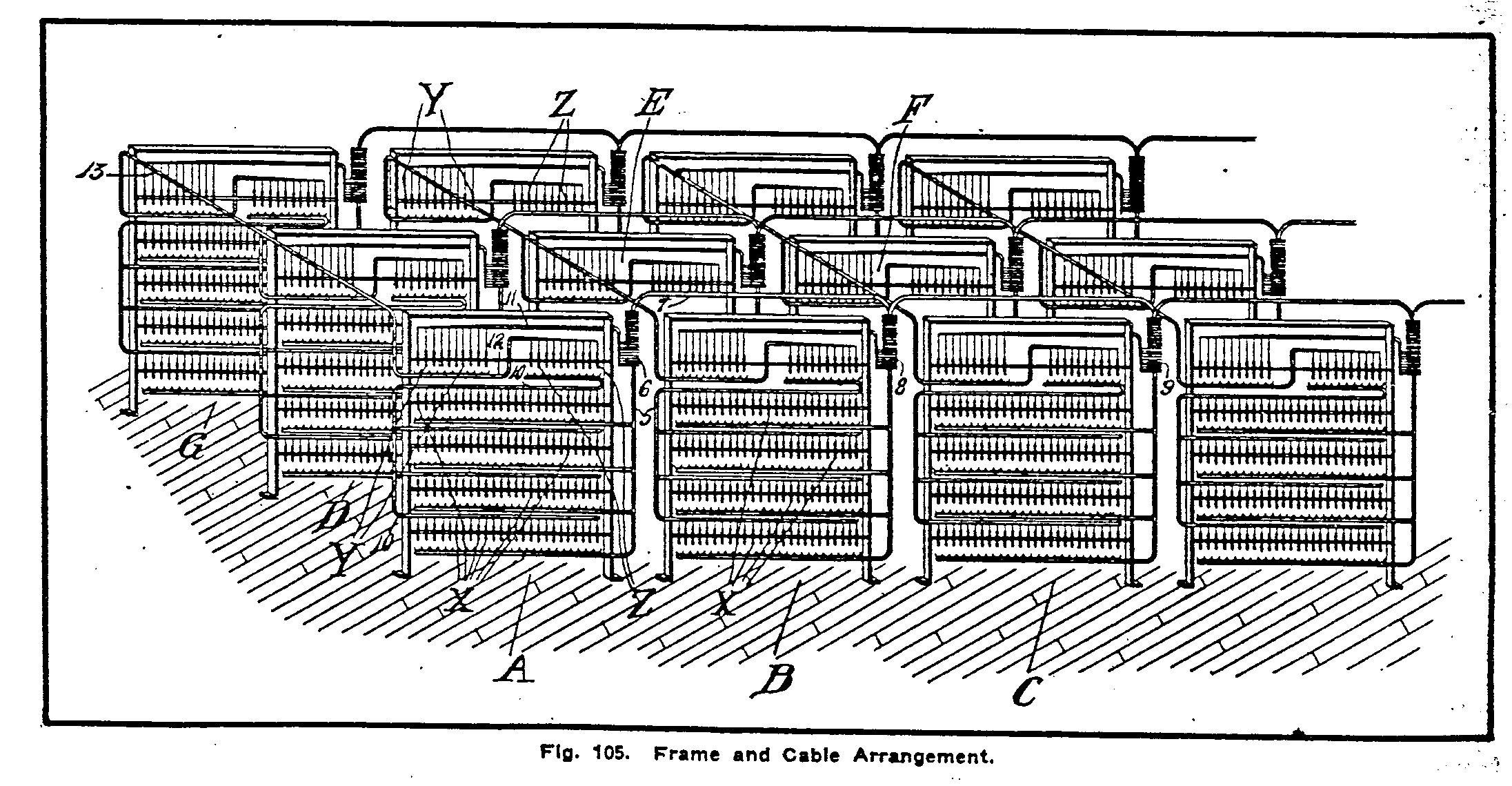
Afin de mieux illustrer les relations entre les fils, les commutateurs
et les câbles, la figure 105 a été préparée :
elle représente une portion de quatre mille, mais elle peut être
interprétée comme s'étendant à la fois vers
la droite et vers l'arrière, de manière à inclure
les 100 cadres d'un échange de dix mille lignes.
Examinez attentivement le cadre le plus proche, c'est-à-dire
les 1000 cadres.
A. Ici, les commutateurs sont chacun représentés par une
ligne verticale épaisse. La rangée de contacts pour les
circuits est représentée par un arc de cercle juste en
dessous de la ligne verticale. Il y a quatre rangées horizontales
de premiers sélecteurs, chaque rangée comportant 25 machines.
Sur l'étagère supérieure de ce cadre se trouvent
les seconds sélecteurs, Y, tandis que le connecteur occupe le
reste de l'étagère. Depuis les rangées de sélecteurs,
le câble 5 achemine toutes les connexions vers une barrette terminale,
6. Dans l'image suivante à droite : B, dont le châssis
2000, un câble similaire transporte tous les fils du premier sélecteur
jusqu'au bornier 8, exactement comme le 6. Ceci est de tous les câbles
du premier groupe de sélecteurs, 5. Dans tous les châssis,
dans le coin supérieur droit de chaque châssis se trouve
un bornier avec des fils provenant de tous les premiers groupes de sélecteurs
de ce châssis.
Le premier câble multiple du sélecteur, 7, va du bornier
6 au bornier 8, multipliant tous les borniers. Ce câble continue
vers la droite, de stflP~.
à la barrette, de sorte que tous les premiers groupes de sélecteurs
de tous les centaines sont multipliés ensemble, quel que soit
le nombre de milliers qu'ils contiennent. Dans le châssis 1000,
A, 11 est le premier câble principal de sélecteur, qui
Le câble multiple 7 délivre un dixième des circuits
du premier sélecteur au bornier 6. Il achemine les dix circuits
vers les seconds sélecteurs Y. Ces dix circuits proviennent tous
du premier niveau, ou niveau inférieur, des premières
banques de sélection des cadres A, B, C, etc., c'est-à-dire
de toutes les banques de sélection des milliers. Dans la banque
de sélection B, dix autres circuits sont dérivés
du premier câble multiple au bornier 8 et, passant par le câble
principal du premier sélecteur, aboutissent aux seconds sélecteurs
de cette banque. Ces dix circuits proviennent du second niveau des premières
banques de sélecteurs des cadres A, B, C, etc. De la même
manière, les circuits provenant de n'importe quel niveau des
premières banques de sélecteurs aboutissent aux seconds
sélecteurs de la banque de sélection « 0 »
du millier que ce niveau représente. De la même manière,
les câbles de la première banque de sélecteurs,
première sélection : tor plusieurs câbles, et les
premiers câbles principaux de sélection unissent toutes
les trames « 100 » de la rangée suivante, c'est-à-dire
D, E, F, etc., qui sont respectivement les trames 1100, 2100, 3100,
etc.
Le même schéma de câblage s'applique à toutes
les rangées.
Les câbles du deuxième groupe de sélecteurs sont
traités exactement de la même manière, bien que
les borniers soient omis dans l'illustration (Fig. 105). Le terme « câble
du deuxième groupe de sélecteurs » désigne
le câble reliant le deuxième groupe de sélecteurs
à ce bornier. Le terme « câble multiple du deuxième
sélecteur » désigne le câble qui multiplie
tous les borniers d'un millier de connecteurs, tandis que les « câbles
principaux du deuxième sélecteur » relient
les borniers aux connecteurs, chaque câble dérivant dix
des cent circuits.
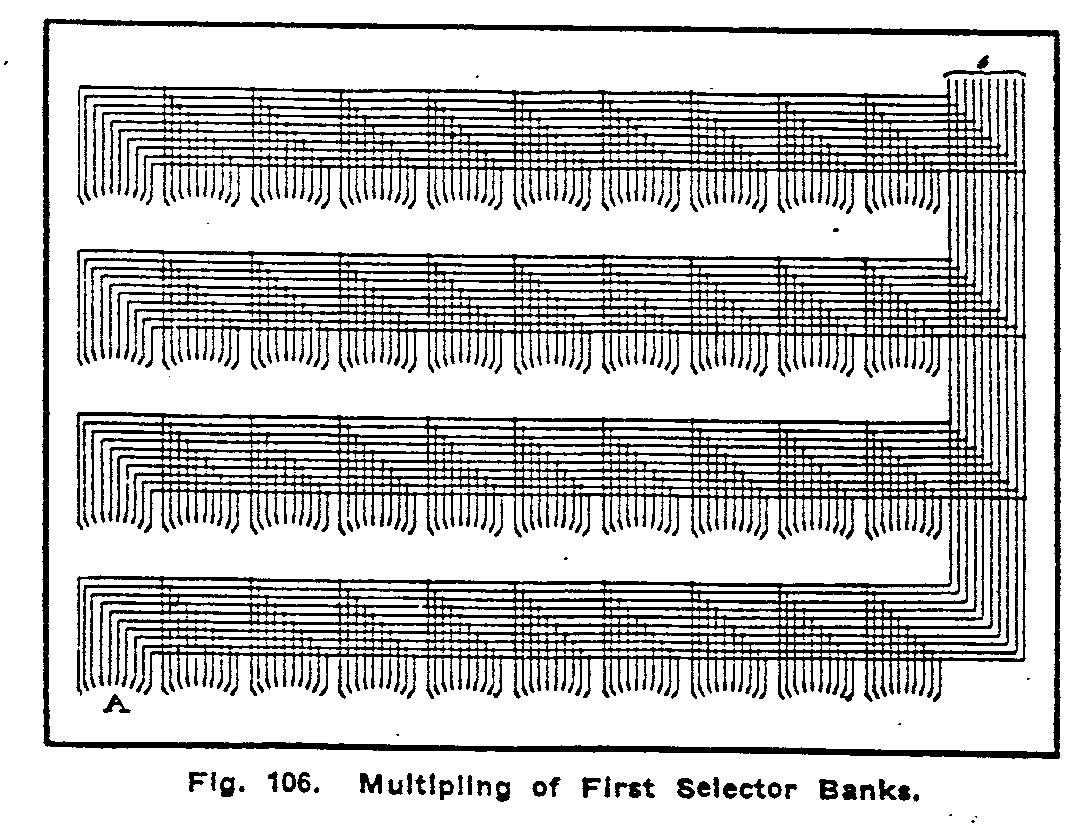
La Fig. 106 montre comment les contacts des premiers sélecteurs
d'un châssis sont multipliés. Chaque rangée courbe
de contacts, A, peut être considérée comme représentant
un certain niveau dans un premier sélecteur. Cinquante d'entre
eux sont représentés, mais le principe s'applique à
l'ensemble des 100. Si nous disons qu'il s'agit des contacts de premier
niveau, on constate que le contact n° 1 de ce niveau est relié
au contact n° 1 de chaque autre rangée de premiers sélecteurs
de ce cadre. Cette connexion point par point est appliquée de
manière cohérente à tous les niveaux. Tous ces
fils aboutissent à un câble, 5, qui monte jusqu'au bornier
6 de la figure 105.
Tous les circuits issus d'un niveau donné (figure 106) aboutissent
à des seconds sélecteurs, au nombre de quelques milliers.
À chaque niveau, il y a dix jeux de contacts, et donc dix seconds
sélecteurs à l'autre extrémité. Ceci permet
de multiplier les chances d'obtenir la connexion souhaitée.
Supposons qu'il s'agisse du cinquième niveau. Si une personne
dans ce cadre appelle un nombre du cinquième millier, ses curseurs
verticaux et rotatifs occuperont le circuit principal jusqu'au premier
des dix seconds sélecteurs du cinquième millier. Simultanément,
son curseur privé mettra à la terre le contact correspondant
dans la banque privée, la rendant ainsi occupée.
Si une autre personne dans ce cadre appelle également le cinquième
millier, son curseur privé trouvera le premier circuit principal
occupé et sera contraint d'emprunter le deuxième circuit,
aboutissant au deuxième des dix seconds sélecteurs. Une
action similaire se produit si plusieurs circuits principaux sont occupés :
les curseurs tournent automatiquement jusqu'à ce qu'un circuit
non occupé soit trouvé.
Pour les appels de ce cadre vers un millier donné, le premier
des dix seconds sélecteurs sera plus occupé que tous les
autres, car il est toujours le premier à être choisi. La
deuxième machine sera moins utilisée que la première,
mais plus que la troisième, la quatrième, etc. Enfin,
les dernières seront rarement, voire jamais, sollicitées
en service.
Ceci nous amène à la manière exacte de connecter
le câble multiple du premier sélecteur, 7 (Fig. 105), qui
va d'une trame à l'autre, multipliant ainsi tous les bancs de
toutes les trames d'une rangée. Ce câble relie nécessairement
des niveaux identiques, puisque chaque niveau correspond à un
millier. Si les fils des contacts individuels de chaque niveau sont
multipliés point par point sur toutes les trames, il en résultera
une répartition très inégale du travail sur les
seconds sélecteurs. La première machine des dix d'une
trame sera la plus sollicitée, la seconde un peu moins, et ainsi
de suite jusqu'à la dernière, qui recevra le moins de
trafic. Pour éviter cela, les connexions sont alternées,
comme décrit ci-dessous.
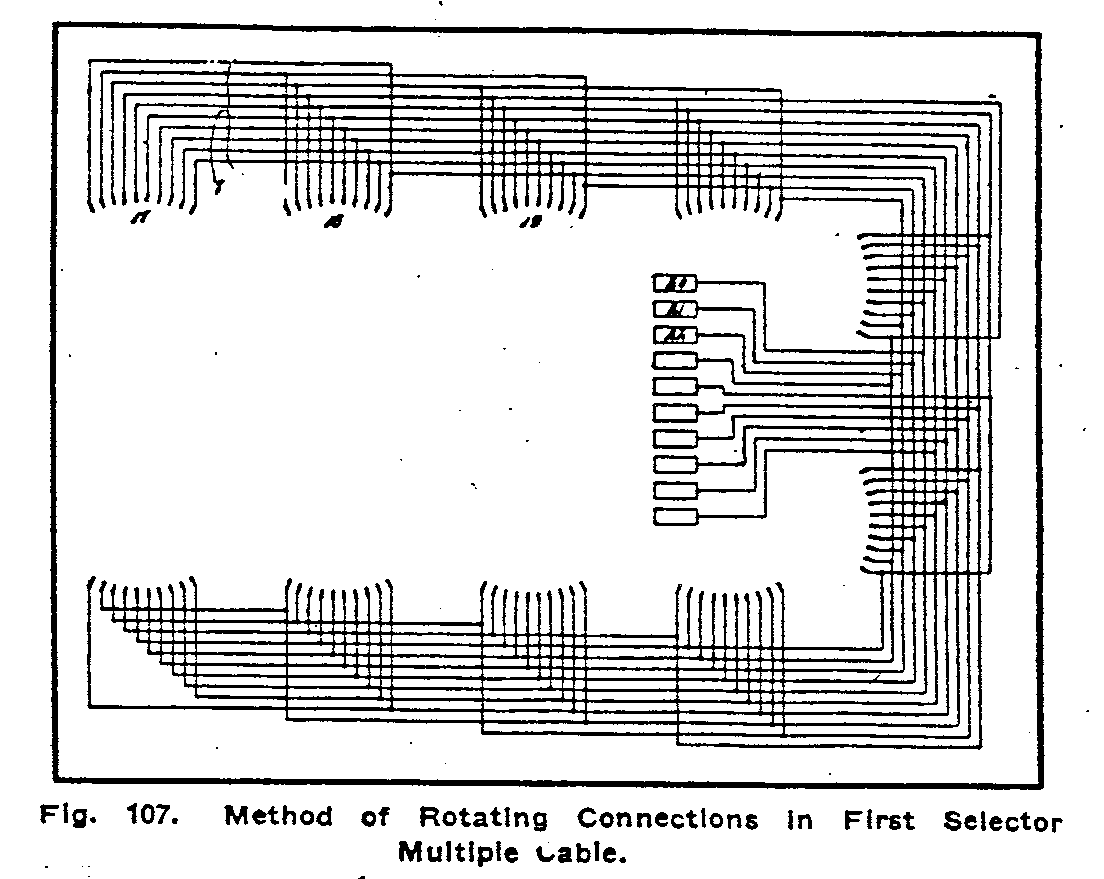
Sur la Fig. 107, supposons que 17 représente un niveau de contacts
d'un premier sélecteur parmi les « 0 »
centaines du premier millier. Puisque tous les contacts des premiers
sélecteurs d'une trame sont multipliés point par point,
17 peut représenter un certain niveau dans ces cent premiers
sélecteurs. Soit également 18 le niveau correspondant
des contacts des premiers sélecteurs de la centaine « 0 »
du deuxième millier. 19 sera alors le même dans le troisième
millier, et ainsi de suite pour les dix trames représentées.
Les dix circuits partant de ce niveau sont répartis dans dix
seconds sélecteurs : 20, 21, 22, etc. Si l'on considère
17, 18, 19, etc. comme les premiers niveaux, les seconds sélecteurs
seront situés dans le premier millier. Dans la batterie 17, le
premier contact, ou contact de gauche, reliera le second sélecteur
20, qui est la première machine du groupe de dix. Le deuxième
contact reliera la deuxième machine 21, le troisième contact
22, et ainsi de suite. De cette façon, tout appel du premier
millier provenant de la trame 17 aura le deuxième sélecteur
20 comme premier choix, le 21 comme deuxième choix, le 22 comme
troisième choix, etc.
Notez cependant que le premier contact de la banque 18 est câblé
au deuxième sélecteur 21, le deuxième du groupe.
Par conséquent, tout appel du premier millier provenant de la
trame 18 aura le deuxième sélecteur 21 comme premier choix,
ce qui n'interférera pas avec le premier choix de la trame 17.
De même, la trame 19 a le deuxième sélecteur 22
comme premier choix, les autres contacts de la banque étant câblés
aux deuxièmes sélecteurs suivants, dans l'ordre.
On constate aisément que cette méthode de câblage
assure une charge relativement uniforme sur les deuxièmes sélecteurs.
Elle réduit également le temps nécessaire à
un premier sélecteur pour trouver un deuxième sélecteur
non occupé. Cette recherche automatique doit être effectuée
entre chaque actionnement du sélecteur. Si le premier sélecteur
est contraint de rechercher au-delà de huit ou neuf points d'occupation,
l'abonné risque de tirer le chiffre suivant avant que le premier
sélecteur ne soit terminé. Si la série d'impulsions
suivante arrive avant que le premier sélecteur n'ait trouvé
une ligne non occupée, les premières impulsions seront
perdues, ce qui entraînera l'obtention d'un numéro erroné.
Si l'abonné souhaitait appeler le 2749, il pourrait obtenir le
2549, en raison d'un changement du deuxième chiffre. Cette méthode
de rotation de l'ordre des connexions s'applique de la même manière
aux câbles multiples du deuxième sélecteur, afin
d'équilibrer le travail des commutateurs de connecteurs.
Commutateur
de ligne Keith
Dans toutes les installations décrites jusqu'à présent,
il y avait un premier sélecteur pour chaque ligne d'abonné.
Un commutateur automatique étant relativement coûteux,
il est évident que des capitaux considérables sont immobilisés
dans les seuls sélecteurs.
Si ces commutateurs étaient utilisés en permanence, ou
presque, on pourrait dire que la dépense est justifiée.
L'expérience a prouvé que pour les standards manuels,
le nombre moyen maximal d'appels simultanés dans un groupe d'abonnés
ne dépasse pas 10 % du nombre de téléphones. Autrement
dit, sur 100, il n'y a pas plus de dix connexions actives. Par conséquent,
si le même ratio est appliqué au fonctionnement automatique,
même aux heures de pointe, seuls dix premiers sélecteurs
seront utilisés. Cependant, des observations ont montré
que le nombre moyen de connexions à un instant T sur un standard
automatique dépasse rarement 5 %. Cela est dû en grande
partie à la libération instantanée offerte par
l'automatisme.
Sur le tableau de commande, une partie des cordons est reliée
par des connexions que l'opératrice n'a pas eu le temps de débrancher.
Il a également été constaté de manière
si uniforme que c'est une vérité incontestable que les
utilisateurs répondent plus rapidement au téléphone
automatique qu'au téléphone manuel. En considérant
un trafic maximal moyen de 5 %, 95 % des premiers sélecteurs
sont identiques aux heures de pointe. Si un groupe de 100 abonnés
pouvait utiliser simultanément dix premiers sélecteurs,
cela permettrait une économie de 90 % sur le coût des premiers
sélecteurs, qui constituent l'élément le plus important
du central téléphonique. Cette économie de 90 %
est en partie compensée par le coût du dispositif qui doit
rendre les dix premiers sélecteurs accessibles aux 100 abonnés.
La nécessité d'un tel appareil a été reconnue
très tôt par l'Automatic Electric Company, mais ce n'est
qu'en 1904 qu'il a été suffisamment perfectionné
pour être mis en service.
Le 3 novembre de la même année, l'interrupteur de ligne
de type Keith fut installé à Wilmington, dans le Delaware.
L'invention de cette merveilleuse machine revient à M. E. A.
Mellinger, dont le savoir-faire s'est manifesté à de nombreuses
reprises dans le développement de l'automatique.
L'interrupteur de ligne était essentiellement constitué
de 100 rangées de ressorts. Chaque rangée horizontale
contenait dix jeux de ressorts, disposés sur un arc de cercle.
Chaque jeu était composé de quatre ressorts et de quatre
contacts, disposés comme sur la figure 108, S et C.
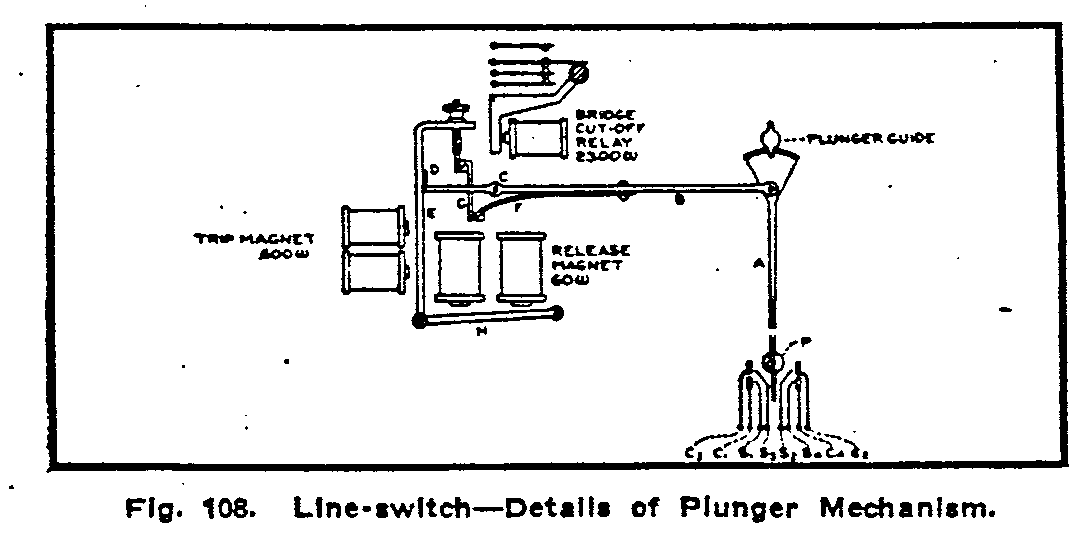
Les ressorts d'une rangée donnée étaient multipliés
et reliés aux trois aimants d'une ligne donnée. Ainsi,
chaque rangée horizontale correspondait à l'une des lignes
d'abonné. Dans chaque rangée horizontale, le premier jeu
de contacts, C C, était multiplié et menait à un
premier sélecteur. Le deuxième jeu de contacts de toutes
les rangées menait à un autre premier sélecteur,
et ainsi de suite pour les dix sélecteurs.
Une longue tige, A, munie d'un rouleau en caoutchouc, P, est conçue
pour être insérée entre les ressorts de chaque jeu,
forçant ainsi les ressorts vers l'extérieur jusqu'à
ce qu'ils touchent leurs contacts respectifs. Ceci connecte la ligne
d'abonné à l'un des premiers sélecteurs. Ce rouleau
et cette tige, A, sont appelés « plongeur ».
Il est porté par un bras, 13, à l'extrémité
duquel il pivote. La queue en éventail du poussoir présente
une encoche qui s'insère sur un bord saillant du guide-poussoir.
Ce dernier est une barre verticale, pivotante en haut et en bas, conçue
pour maintenir tous les poussoirs alignés et opposés aux
jeux de contacts connectés à un premier sélecteur.
Lorsqu'un abonné appelle, son propre poussoir est écarté
du guide-poussoir et, entrant dans le jeu de ressorts de sa rangée
horizontale, les écarte, connectant cette ligne au premier sélecteur
inactif. Simultanément, le guide-poussoir se déplace automatiquement
légèrement, de manière à orienter les 99
poussoirs restants vers le jeu de ressorts suivant. Si un deuxième
abonné appelle, il obtiendra le premier sélecteur suivant,
et les 98 poussoirs restants seront orientés vers le premier
sélecteur suivant. Chaque piston est commandé par le levier
B et l'ensemble d'aimants, montés sur une petite plaque et constituant
une unité amovible. La figure 108 montre ces aimants à
gauche. Un jeu de ressorts de banc est représenté, mais
placé sur le côté, ce qui n'est pas leur position
naturelle. Le reste de l'appareil est représenté tel qu'il
apparaît vu de dessus. Le levier B pivote sur la plaque en C,
tandis que son autre extrémité repose contre une butée
D, située sur l'armature de l'aimant de déclenchement
E. Un ressort est riveté au levier B, dont l'extrémité
libre est maintenue par une biellette G, fixée à une vis
de réglage à son extrémité. de E. La tension
du ressort F tend à enfoncer le piston A dans la butée,
mais le mouvement est empêché par la butée D. Lorsque
l'aimant de déclenchement est excité, en attirant son
armature E, il retire la butée D du levier B. Ce dernier, entraîné
par le ressort, force alors le piston à s'enfoncer dans le jeu
de ressorts opposé à celui auquel il se trouvait.
L'armature de l'aimant de déclenchement E pivote vers l'extrémité
libre de l'armature de l'aimant de déclenchement H. Lorsque l'aimant
de déclenchement est excité et se soulève, la butée
D est déplacée au-delà de l'extrémité
du levier B, de sorte que lorsque l'aimant de déclenchement retombe,
la pression du ressort F retire le piston du jeu de ressorts du groupe
de commutateurs de ligne.
La disposition mécanique du ressort F, qui lui permet de produire
ces deux mouvements opposés, est très intéressante
et mérite d'être soulignée. La tendance naturelle
du ressort est de s'éloigner du pivot C et de se courber encore
plus que ne le montre la figure. Le mouvement qu'il produit sera toujours
celui nécessaire pour augmenter la distance entre son extrémité
libre et le levier B. L'articulation G transmet la force du ressort
à l'armature E, et par la butée D, cette force s'exerce
sur l'extrémité gauche du levier B, auquel le ressort
F est lui-même attaché. Ainsi, une force agissant tendant
à produire une rotation dans un sens à l'extrémité
libre de F, et la même force tendant à provoquer une rotation
dans le sens opposé en D. Comme le bras du levier de C à
D est plus long que celui de C à G, le moment du premier sera
plus grand et l'extrémité B sera repoussée contre
le guide-plongeur. Ce mouvement permet au ressort F de suivre sa tendance
à s'écarter du levier B.
Lorsque la butée D cesse de toucher l'extrémité
gauche de B, les conditions changent. L'armature E, contre laquelle
le ressort F tire, ne peut plus se déplacer, car elle est en
butée. Par conséquent, le seul mouvement permettant au
ressort de s'écarter du levier B est le recul de l'extrémité
gauche, entraînant l'extrémité droite vers l'avant
et entraînant le piston dans les ressorts du levier. Le guide-plongeur,
dont la position détermine le premier sélecteur à
utiliser par la ligne suivante, est commandé par un aimant moteur.
Cet aimant, appelé « aimant de l'interrupteur principal
», agit, par l'intermédiaire d'un cliquet, sur une roue
centrale sur laquelle sont montées des cames actionnant un levier
fixé au guide-plongeur. En pratique, les 100 unités de
ligne (figure 108) sont divisées en quatre groupes de 25 plaques
chacun. Chaque groupe de 25 possède sa propre barre de guidage,
commandée par la roue centrale. La rotation de la roue centrale
déplace les quatre guides-plongeurs en parfaite synchronisation,
maintenant tous les plongeurs libres pointés vers les mêmes
jeux de ressorts.
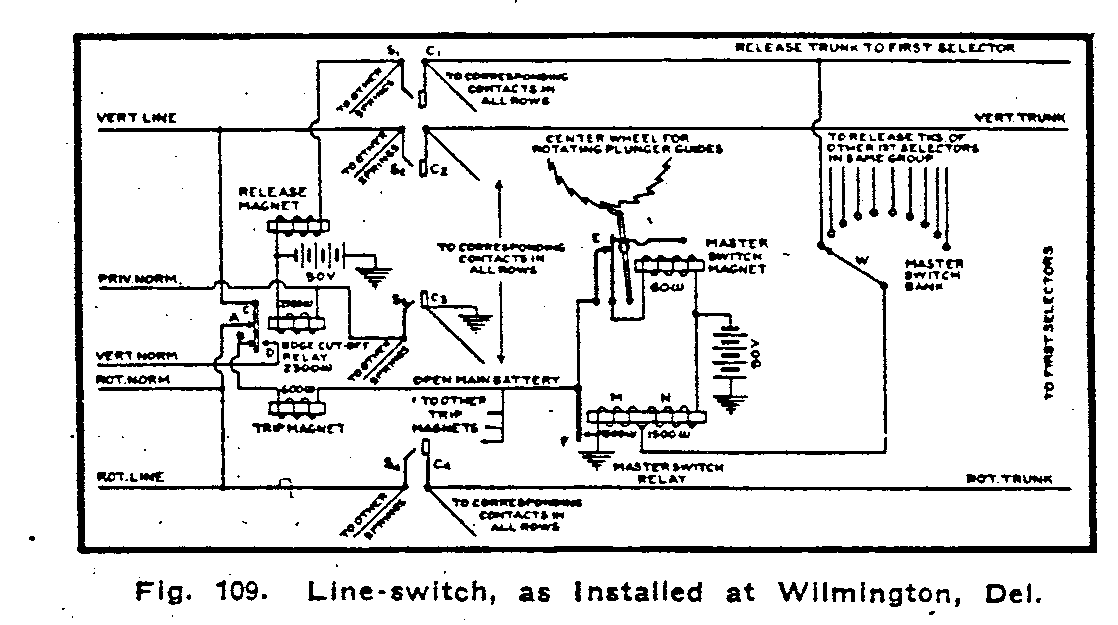
Un schéma simplifié des circuits de l'interrupteur principal
et de l'une des unités de ligne est présenté à
la figure 109.
C,, S,, S,, et S,, constituent un jeu de ressorts et sont conçus
pour toucher les contacts. C,, C:, C., et C, respectivement. Les ressorts
se multiplient par rapport à tous les autres ressorts de la même
rangée horizontale et représentent une ligne donnée.
Les contacts
se multiplient par rapport aux contacts correspondants de toutes les
rangées et représentent un premier sélecteur donné.
Lorsque le plongeur fonctionne dans cette position, les quatre ressorts
représentés entrent en contact avec les quatre contacts
représentés.
Les lignes verticale et rotative venant de gauche correspondent aux
fils d'abonné provenant du poste. Elles sont normalement court-circuitées
par le ressort principal C et un contact arrière, A, du relais
de coupure du pont, tous deux étant connectés par B à
l'aimant de déclenchement et au négatif (principal) de
la batterie.
Ainsi, une mise à la terre sur l'une ou l'autre ligne déclenche
l'aimant de déclenchement. L'aimant de l'interrupteur principal
est doté d'un cliquet fixé à son armature qui agit
sur la roue centrale. Il déplace cette dernière lorsqu'il
est relâché, et non lorsqu'il est tiré vers le haut.
L'aimant de l'interrupteur principal est commandé par le relais
de l'interrupteur principal, dont l'enroulement est en deux parties.
Chaque enroulement est de La résistance est de 1 500 ohms, et
les deux sont connectés en opposition, de sorte que, bien que
le courant circule normalement, l'armature n'est pas attirée.
Un curseur W est fixé au guide du plongeur et se déplace
sur le bloc d'interrupteurs principaux. Chaque point de ce dernier est
raccordé au tronc de déclenchement de l'un des premiers
sélecteurs. La position du curseur correspond à celle
de tous les plongeurs de repos. Le premier circuit de sélecteur
fonctionnant avec l'interrupteur de ligne est illustré à
la figure 110. La disposition générale des relais et des
aimants est identique à celle décrite précédemment
et ne mérite pas de commentaire particulier. Les particularités
de l'interrupteur de ligne sont les suivantes : le tronc de déclenchement
provenant du bloc d'interrupteurs de ligne est relié à
un contact C sur l'aimant de déclenchement. Ce contact est actionné
momentanément par le retour de l'armature lorsque l'aimant de
déclenchement est désexcité. Le relais de repos
(5 500 ohms) ohms)c. est également fixé au tronc de déclenchement
et au premier contact ; de l'interrupteur latéral 4. Le relais
de coupure commande chaque lampe.
Le fonctionnement de l'appareil va maintenant être décrit.
Le cadran de la sous-station est conçu pour donner une impulsion
préliminaire sur le fil rotatif lors de la traction du cadran
pour le premier chiffre. Cela permet au courant de circuler de la terre,
via le fil rotatif, vers les contacts A et B du relais de coupure du
pont (Fig. 109), via l'aimant de déclenchement, le contact B)
et l'aimant de l'interrupteur principal jusqu'au négatif de la
batterie. Cela excite l'aimant de déclenchement, mais pas l'aimant
de l'interrupteur principal, en raison de la faible résistance
(60 ohms) de ce dernier. L'action de l'aimant de déclenchement
permet au plongeur de pénétrer dans les ressorts, S,,
S,, etc., les forçant à revenir à leurs contacts
respectifs.
En S, et S, les positions verticale et Les lignes rotatives sont connectées
directement au premier sélecteur. En S, le relais de coupure
du pont est mis à la masse et excité, ce qui déconnecte
l'aimant de déclenchement en B, supprime le court-circuit des
lignes en A et relie la normale verticale en D. En S, le déclencheur
est connecté à la ligne de déclenchement menant
au premier sélecteur. Ce dernier action place l'aimant de déclenchement
(60 ohms) comme un calage autour de l'enroulement N du relais de l'interrupteur
principal, puisque le curseur W de l'interrupteur principal repose sur
cette ligne de déclenchement. Ceci court-circuite pratiquement
l'enroulement N, ce qui déclenche l'enroulement M et tire l'armature
vers le haut, fermant le contact F. L'aimant de l'interrupteur principal
tire alors vers le haut jusqu'à ce que son cliquet accroche la
dent suivante de la roue centrale. À ce moment précis,
le contact E se rompt, coupant le courant, et un ressort force l'armature
à revenir en arrière, entraînant avec lui le cliquet
et la roue centrale. De ce fait Cela signifie que le guide du piston
déplace tous les pistons de ralenti d'un cran, de sorte que chacun
se trouve en face du premier sélecteur suivant. Le curseur de
l'interrupteur principal, H', participe à ce mouvement et repose
maintenant sur le contact suivant à droite, qui est branché
sur la ligne de déclenchement du premier sélecteur qui
sera utilisé ensuite.
Lorsque l'interrupteur de ligne s'est déclenché sur le
premier sélecteur, l'aimant de déclenchement du premier
s'est connecté au tronc de déclenchement du second et
a alimenté la batterie négative.
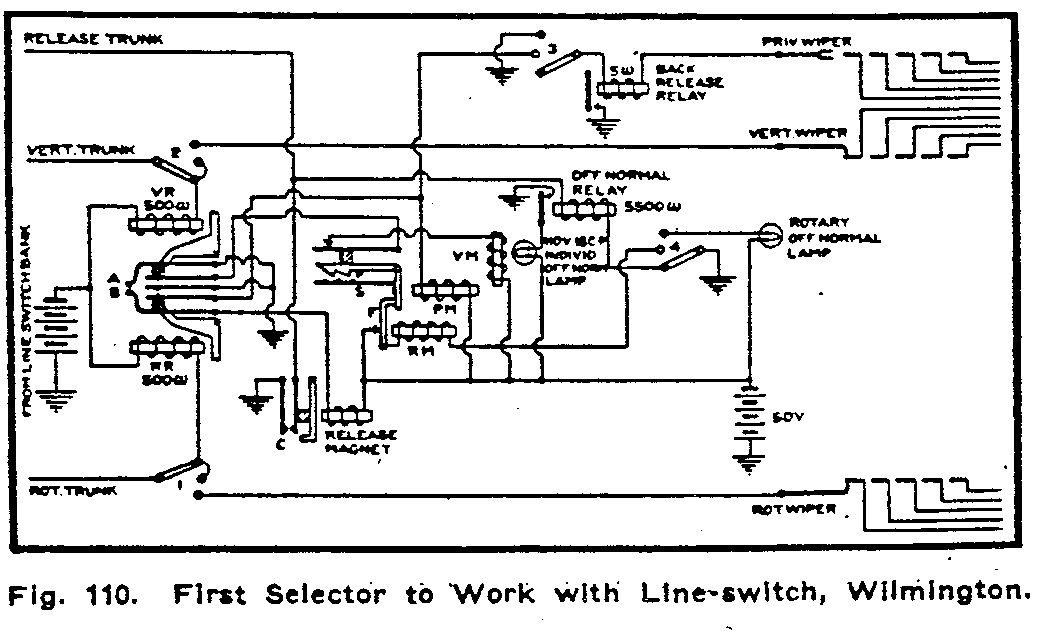
La figure 110 montre que cela a provoqué la circulation d'un
courant dans le relais de coupure, tirant sur sa pointe. En raison de
sa résistance élevée (5 500 ohms), il a empêché
l'aimant de déclenchement de l'interrupteur de ligne de s'activer.
Le relais de coupure a déclenché l'allumage du voyant
de coupure. Si, pour une raison quelconque, l'appareil ne fonctionnait
pas, ce voyant restait allumé, attirant l'attention de l'opérateur.
Mais si l'appel se déroule normalement, le voyant s'éteint
presque immédiatement et le voyant rotatif de coupure s'allume
à sa place. On constate que l'interrupteur de ligne n'entrave
en rien le circuit de communication ou de signalisation, les lignes
verticales et rotatives qui le traversent étant libres de tout
raccordement. Le troisième fil (fil conducteur de déclenchement)
assure les fonctions auxiliaires. Lors du déclenchement, les
fils de ligne verticaux et rotatifs sont mis à la terre au niveau
du poste électrique dans le modèle standard. Ceci provoque
le déclenchement du connecteur et le retour du courant via le
fil conducteur de déclenchement pour déclencher le deuxième
sélecteur, comme décrit précédemment. À
son tour, le deuxième sélecteur renvoie le courant via
le fil conducteur de déclenchement vers le relais de déclenchement
du premier sélecteur (Fig. 100), le tirant vers le haut. Ceci
active l'aimant de déclenchement qui, une fois relâché,
ferme momentanément le contact C, envoyant une impulsion à
l'aimant de déclenchement de l'interrupteur de ligne (Fig. 109),
libérant ainsi ce dernier. Le piston, retiré de la batterie,
repose contre le guide du piston jusqu'à ce que ce dernier ait
suffisamment tourné pour permettre à l'encoche de la queue
en éventail (Fig. 108) de s'adapter sur le bord du guide du piston.
La figure 111 illustre la modification apportée à un seul
groupe de 100 par l'utilisation du commutateur de ligne. Sur l'ancien
système, l'espace à l'intérieur de la ligne brisée
était occupé par 100 premiers sélecteurs. Ceux-ci
sont désormais remplacés par le commutateur de ligne et
dix premiers sélecteurs. L'espace requis dans un central est
ainsi considérablement réduit.
sommaire
Le bureau auxiliaire
Le coût d'une installation téléphonique peut être
divisé en trois catégories :
1. Coût de l'appareillage.
2. Coût du terrain et des bâtiments.
3. Coût du câblage.
Ce dernier poste est le plus important. Il peut représenter entre
la moitié et les deux tiers du coût total du central. Les
pertes doivent être surveillées de près. Si un dispositif
permet de réduire son coût, il convient de le prévoir.
Supposons que nous ayons 100 abonnés vivant à 5 kilomètres
d'un central téléphonique, d'où ils sont approvisionnés
en téléphone. Pour leur fournir un service satisfaisant,
il faudrait 100 circuits de 5 kilomètres. Pendant la majeure
partie de la journée, ces lignes sont inutilisées, et
même aux heures de pointe, seules dix d'entre elles peuvent être
utilisées simultanément, les 90 autres étant inutilisées.
Pour éviter ce gaspillage de lignes partagées, des propositions
ont été faites. Elles constituent, au mieux, une piètre
solution. Si nous plaçons un nombre suffisant de postes sur chaque
circuit pour garantir l'économie d'installation souhaitée,
le service sera d'une qualité insupportable. En revanche, si
nous limitons le nombre de postes par circuit au nombre nécessaire
pour un service de première qualité, l'économie
d'installation est perdue.
Il n'y a qu'une seule solution : limiter le nombre de circuits
desservant notre groupe de 100 abonnés à celui requis
par le trafic aux heures de pointe et rendre chacun de ces circuits
accessible à tous les abonnés. Avec le système
manuel, la seule façon d'y parvenir est de placer un standard
de dérivation au centre des 100 postes, avec un opérateur
pour acheminer les appels vers le bureau principal.
Mais les frais fixes de location, de salaires des opérateurs,
d'éclairage, de chauffage, etc., rendent cette solution plus
coûteuse que l'extension de l'ensemble des 100 circuits jusqu'au
bureau principal.
Certes, un dispositif mécanique de commutation est le seul moyen
de réaliser des économies dans ce domaine lorsqu'il s'agit
de petits groupes.
Un examen attentif de la figure 111 montre comment l'invention du commutateur
de ligne a marqué un début dans ce domaine.
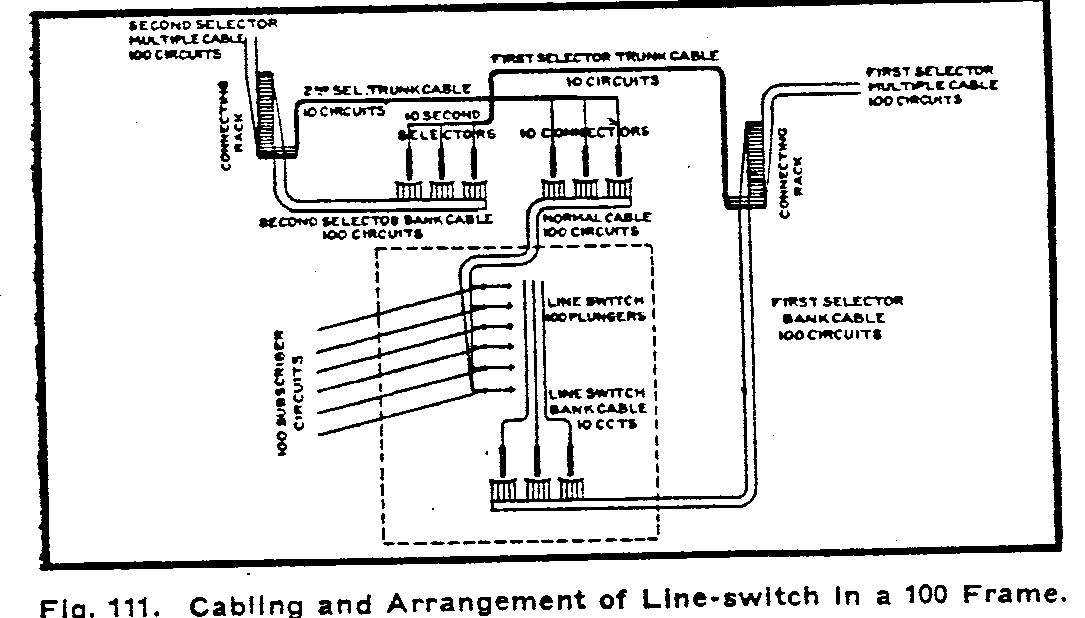
On constate que le câble principal du commutateur de ligne et
le second câble principal de sélection contiennent chacun
dix circuits. Il est donc possible de retirer le commutateur de ligne
et les dix connecteurs du bureau principal et de les installer au centre
des 100 sous-stations, en les reliant au bureau principal par 30 fils.
C'est ce qui a été réalisé pour la première
fois à Dayton, dans l'Ohio, et cela s'est avéré
être un grand succès.
sommaire
Lignes partagées
L'introduction de la ligne partagée fut l'une des premières
tentatives des ingénieurs téléphoniques pour économiser
le fil. Ces économies furent en partie compensées par
l'équipement plus complexe et plus coûteux nécessaire
à la sonnerie sélective. Pourtant, la ligne partagée
s'avéra rentable et se répandit rapidement dans tout le
pays. Le système automatique reposait sur le principe de lignes
individuelles, c'est-à-dire un abonné par ligne. Naturellement,
on objecta à ce nouveau système qu'il ne pouvait pas fournir
de service de ligne partagée. Bien que visant un autre objectif,
il était nécessaire de répondre à cette
demande et de la satisfaire en attendant une solution plus performante.
Les ingénieurs se heurtèrent principalement à deux
problèmes. Le premier était la sonnerie sélective
du poste appelé sans manipulation particulière de la part
de l'utilisateur. Le second était de rappeler sur la ligne d'origine.
Le système Thompson et Robes, utilisant des sonneries polarisées,
deux de chaque fil à la terre, ne pouvait pas être utilisé,
car les deux fils devaient être libres pour actionner les commutateurs.
Le système harmonique, développé par M. W. W. Dean,
était le seul adapté à cet usage, étant
toujours exempt de terre. C'est pourquoi il a été adopté.
La manière de permettre à l'abonné appelant de
déterminer la fréquence du courant de sonnerie à
appliquer à la ligne appelée est simple et intéressante.
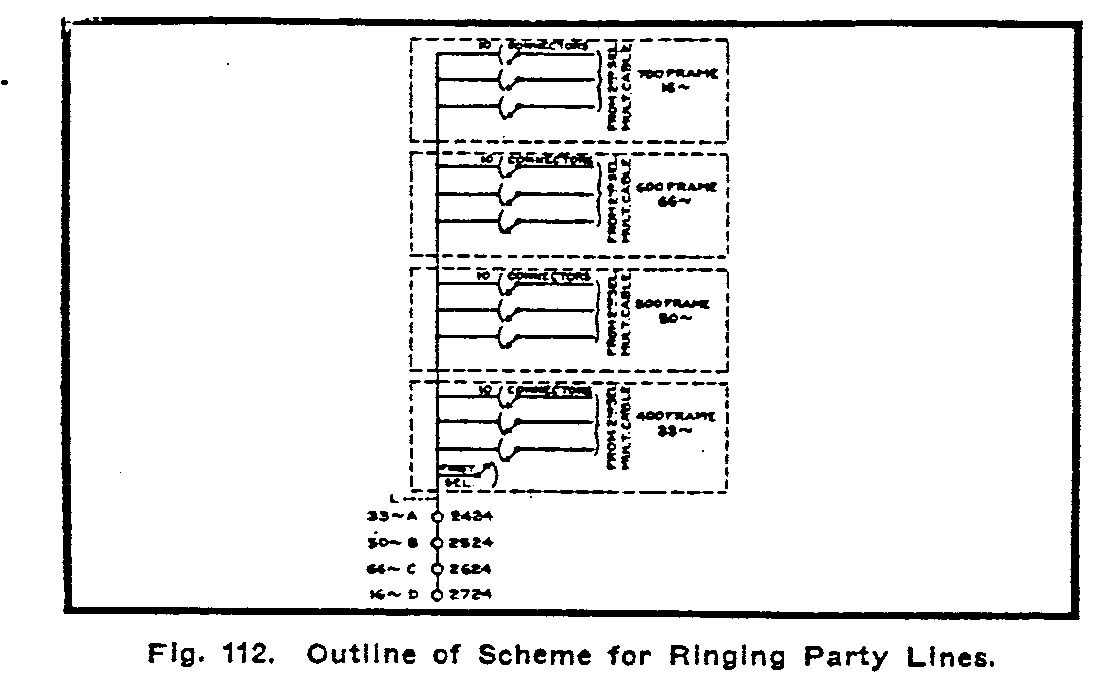
En se référant à la figure 112, supposons que les
quatre rectangles représentent quatre châssis d'un central,
chaque châssis contenant un appareil destiné à desservir
100 lignes d'abonnés. On peut supposer qu'ils appartiennent au
deuxième millier. Seuls les connecteurs sont représentés,
trois de chaque. La ligne L représente le circuit de ligne, sur
lequel se trouvent quatre téléphones. Les quatre sonneries
diffèrent les unes des autres par le fait qu'elles sont réglées
pour sonner sur les fréquences qui leur sont opposées.
Le premier poste, A, sonne sur un courant de 33 cycles, B sur 50, C
sur 66 et D sur 16.
Dans le bureau, la ligne L est multipliée par les rangées
de tous les connecteurs. Supposons que cette ligne ait 24 pour ses deux
derniers chiffres.
Elle sera alors câblée aux contacts 24 de chacun des dix
connecteurs du châssis 400, comme indiqué. La même
ligne est également multipliée aux contacts 24 de chaque
connecteur des châssis 500, 600 et 700.
Les relais de sonnerie de tous les connecteurs du châssis 400
sont câblés avec un courant de 33 cycles, tandis que ceux
des châssis 500, 600 et 700 sont alimentés respectivement
par des courants de sonnerie de 50, 66 et 16 cycles. Ainsi, si un téléphone
du central compose « 2424 », les commutateurs
se comporteront comme suit : le premier chiffre augmentera son
premier sélecteur de deux crans et sélectionnera une ligne
non occupée jusqu'au deuxième millier où se termine
la ligne souhaitée. Le chiffre suivant, 4, reliera la connexion
à l'un des connecteurs du cadre 400. Les deux derniers chiffres,
2 et 4, soulèveront et feront tourner les curseurs de ce connecteur
jusqu'à ce qu'ils reposent sur le contact 24.
En appuyant sur le bouton de sonnerie, le relais enverra sur la ligne
appelée, L, le seul courant qui lui est fourni, 33 cycles.
Ce courant traversera toutes les sonneries de la ligne, mais ne fera
sonner que celle en A, réglée sur cette fréquence.
Si le numéro 2524 avait été tiré sur le
cadran, l'appel aurait été dirigé vers le cadre
500 et se serait terminé sur le contact 24 de l'un des dix connecteurs
de cette ligne. Il arrive ainsi sur la même ligne, L.
Comme tous ces connecteurs sont alimentés par un courant de 50
cycles, le fait de sonner émettra cette fréquence, faisant
sonner la cloche en B. Il est évident que la station C peut être
appelée par le numéro 2624 et la station D par le numéro
2724.
Pour une meilleure mémorisation des numéros, ils ont été
classés comme suit :
Station en ligne. Cote.
A ........... 2424
B ........... 2524
C ........... 2624
D ........... 2724
C'est le chiffre des « centaines » qui détermine
le poste appelé.
Grâce à ce dispositif, l'abonné appelant n'a pas
besoin de savoir qu'il appelle une ligne partagée, car le numéro
d'appel ne sera pas différent des lignes individuelles «
directes » ou « spéciales ».
Pour les appels provenant de n'importe quel poste de la ligne partagée,
un premier sélecteur est fourni comme indiqué. De la même
manière, 99 autres lignes à quatre postes sont câblées
dans les quatre châssis.
Chaque châssis dispose du nombre total de seconds sélecteurs
et de connecteurs, mais seuls 100 premiers sélecteurs sont nécessaires.
Les 100 lignes partagées ainsi gérées occupent
autant de numéros d'appel que si les 400 postes étaient
sur des lignes individuelles. Il convient toutefois de noter que l'on
économise 300 premiers sélecteurs et 300 circuits de ligne
dans l'installation.
L'APPEL DE RETOUR.
Supposons qu'une personne souhaite appeler un poste sur sa propre ligne.
Il tirera le premier chiffre pour son propre millier, par exemple 2.
Une masse est ainsi placée sur son propre fil privé, multipliée
pour contacter 24 de chacun des connecteurs des quatre cadres. Tout
appel entrant par ces connecteurs touchera cette masse, libérera
le connecteur et donnera la tonalité d'occupation. Son prochain
tirage le dirigera vers l'un de ces connecteurs correspondant à
la fréquence de la station souhaitée. Lorsqu'il tirera
les deux derniers chiffres, il sera connecté à sa propre
ligne, mais celle-ci sera occupée par l'appel, de sorte que l'appel
ne pourra pas aboutir. Le problème était de concevoir
un plan permettant de retirer momentanément cette masse de la
ligne privée, afin de permettre au connecteur d'entrer si l'appel
revenait sur sa propre ligne.
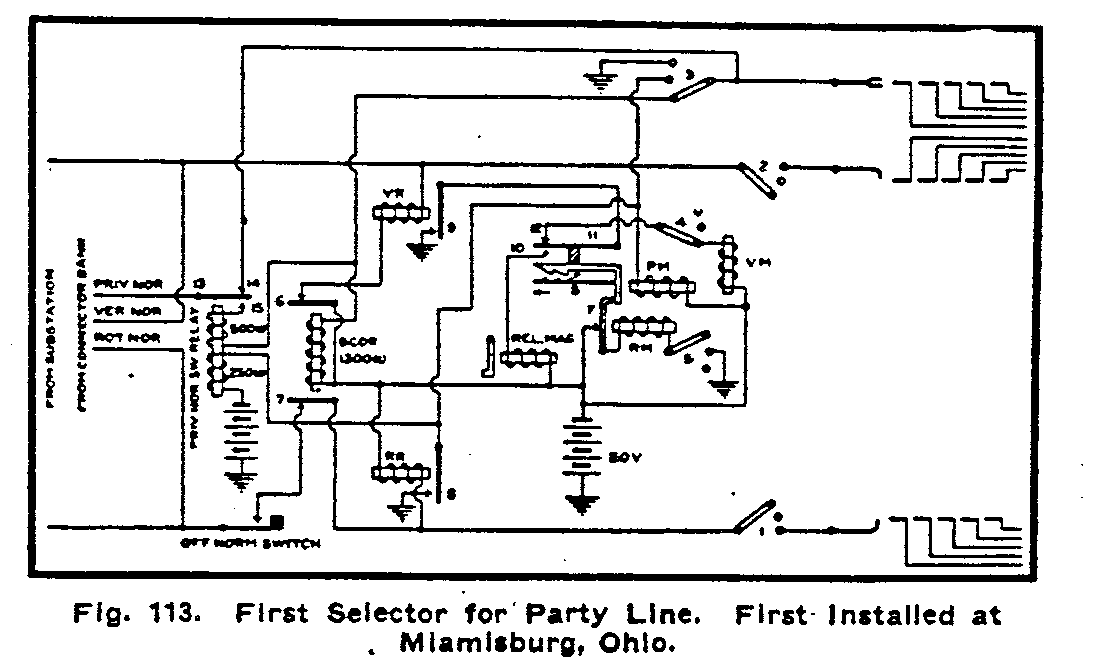
Les moyens sont illustrés à la figure 113. Il s'agit d'un
premier sélecteur de pont, tel que celui installé à
Miamisburg, dans l'Ohio, en juin 1905.
Il s'agissait d'un système à 1 000 et ne comportait
donc que des premiers sélecteurs et connecteurs. Les lignes verticales
et rotatives du poste électrique arrivent à gauche. La
ligne verticale passe normalement par le relais vertical jusqu'à
la batterie négative, qu'elle reçoit par le contact 6
du relais de coupure du pont. La ligne rotative est ouverte à
l'interrupteur d'arrêt normal, mais si ce dernier est fermé,
elle est connectée à la batterie négative par le
contact 7 du relais de coupure du pont et l'enroulement du relais rotatif.
Le contact 8 du relais rotatif commande l'aimant privé comme
d'habitude. Le relais vertical commande l'aimant vertical, mais si l'aimant
privé est excité, il met à la terre l'aimant de
déclenchement par le contact 10 de l'aimant privé. Le
relais de coupure de pont permet de couper la batterie de la ligne lors
de la réception d'un appel. Il est câblé du négatif
de la batterie au premier contact de l'interrupteur latéral 3.
La véritable innovation réside dans l'ajout d'un relais
de commutation de courant normal privé, qui gère le fil
de courant normal privé de la manière décrite ci-dessous.
Son armature, ou ressort principal, 13, est câblée directement
sur le fil de courant normal privé. Le contact avant 15 est relié
par un enroulement de 500 ohms à l'extrémité du
relais de coupure du pont, qui est relié à l'interrupteur
latéral 3. L'enroulement de 250 ohms relie le pôle négatif
de la batterie au ressort principal 8 du relais rotatif, de sorte qu'il
est sous le contrôle de ce dernier, tout comme l'aimant privé.
Chaque fois que le relais rotatif est excité, il déclenche
simultanément l'aimant privé et le relais de commutation
normal privé, car ils sont en parallèle.
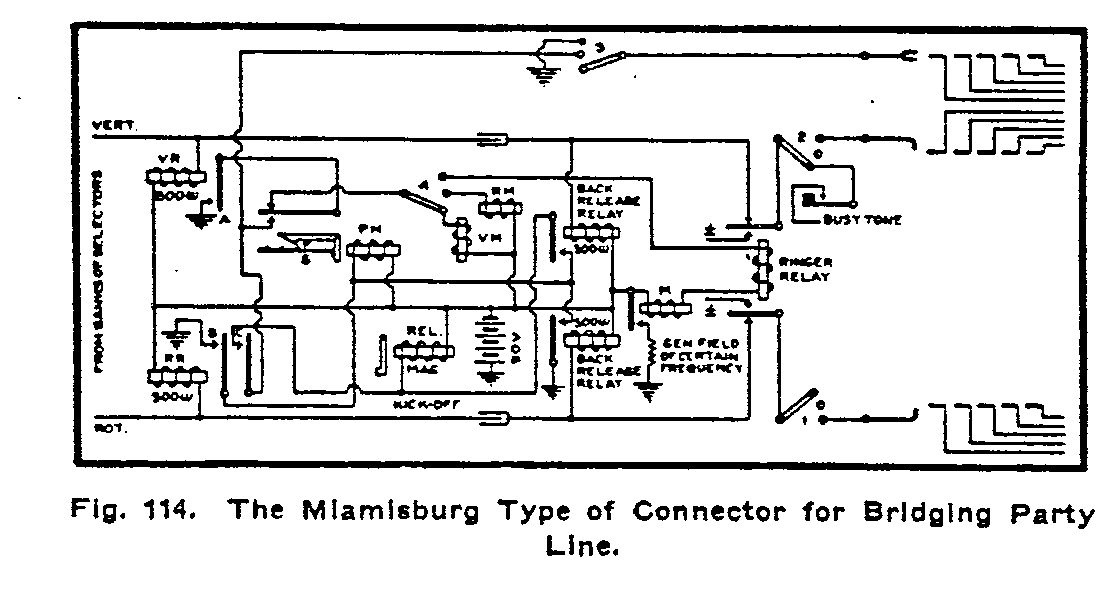
Le connecteur (Fig. 114) diffère peu du type de pont décrit
précédemment, mais les modifications sont très
importantes pour le fonctionnement des lignes partagées. Le relais
rotatif comporte un ressort et un contact supplémentaires, qui
sont intégrés au circuit de l'aimant de déclenchement.
L'aimant de déclenchement est conçu pour déclencher
l'interrupteur du connecteur lors de la remontée, et non lors
de la descente, comme dans les autres interrupteurs.
Du côté du filtre des condensateurs, deux relais de déclenchement
arrière, de 500 ohms chacun, sont pontés afin que l'abonné
appelé puisse déclencher si nécessaire. Le courant
de sonnerie est fourni par un groupe électrogène composé
d'un moteur directement connecté à quatre générateurs
de sonnerie. Ceux-ci fournissent les quatre fréquences de sonnerie
harmonique. Les champs de ces générateurs sont normalement
non excités. Le relais de sonnerie du connecteur est équipé
d'un relais spécial, M, monté en série. Ce relais
M contrôle le courant de champ du générateur, fournissant
la fréquence spécifique utilisée par ce connecteur.
Ainsi, lorsque le relais de sonnerie i3 est excité, le relais
M excite simultanément le champ du générateur.
L'aimant privé présente la particularité de couper
la deuxième dent supérieure, n'en laissant qu'une. L'effet
de ce changement apparaîtra dans la discussion sur le fonctionnement
qui suit. Si un poste sur une ligne partagée appelle un poste
sur une autre ligne, le fonctionnement du premier sélecteur et
du connecteur est essentiellement le même que pour tout système
de pontage. Mais s'il s'agit d'un appel inverse, revenant à un
poste sur sa propre ligne, le fonctionnement est le suivant : la
description doit utiliser librement les figures 113 et 114, et lors
des changements rapides de l'une à l'autre, le lecteur sera tenu
de suivre attentivement les schémas.
Une fois le premier chiffre tiré, l'interrupteur d'arrêt
normal du premier sélecteur (figure 113) est fermé, ce
qui permet une connexion via cet interrupteur sur les lignes verticale
et rotative, les relais verticaux et rotatifs étant pontés,
la batterie négative étant connectée au centre.
En tirant le deuxième chiffre, le relais vertical du connecteur
(figure 114) actionne l'aimant vertical via l'interrupteur latéral
4, faisant monter l'arbre de l'essuie-glace. La masse suivante sur la
ligne rotative alimente le relais rotatif, qui tire l'aimant privé
vers le haut. En retombant, l'aimant privé laisse glisser l'extrémité
du levier de l'interrupteur latéral, S, jusqu'au deuxième
cran, déplaçant ainsi tous les éléments
de l'interrupteur latéral vers leur deuxième position.
Aux bornes 1 et 2, cela n'a aucun effet. En borne 3, le curseur privé
est connecté au contact C du relais rotatif. En borne 4, la commande
du relais vertical est commutée sur l'aimant rotatif.
Le dernier chiffre tiré envoie une série d'impulsions
sur la ligne verticale, actionnant le relais vertical, qui à
son tour actionne l'aimant rotatif via l'interrupteur latéral
4. Cela fait tourner les curseurs vers la ligne appelée, qui,
dans ce cas, est la même que l'appel. À la fin de la série
d'impulsions sur la verticale et avant l'impulsion sur la rotative,
les curseurs du connecteur (Fig. 114) reposent sur les fils normaux
du premier sélecteur (Fig. 113).
Le curseur vertical est sur la normale verticale, le curseur rotatif
sur la normale rotative et le curseur privé sur la normale privée.
N 0'11', lorsque la dernière impulsion arrive sur la ligne rotative,
les relais rotatifs du premier sélecteur et du connecteur sont
activés simultanément. Dans le premier sélecteur
(Fig. 113), le relais rotatif active simultanément l'aimant privé
et le relais de commutation de la normale privée. Ce dernier
commute la normale privée de la masse (interrupteur latéral
3) au négatif de la batterie via le relais de coupure du pont.
Dans le connecteur (Fig. 114), le relais rotatif ferme les contacts
B et C. Le contact C connecte l'aimant de déclenchement au racleur
privé pour le tester, mais comme le relais de commutation normal
privé du premier sélecteur a coupé la masse, rien
ne se passe. Le contact B déclenche l'aimant privé du
connecteur (Fig. 114).
La deuxième dent supérieure ayant été coupée,
le commutateur latéral s'enclenche immédiatement en troisième
position.
Aux bornes 1 et 2, la ligne est connectée en 3, le curseur privé
est mis à la terre. Le courant circule alors de la terre via
l'interrupteur latéral 3 (curseur privé), puis passe par
le curseur privé normal jusqu'au premier sélecteur (Fig.
113), puis passe par les contacts 13 et 15 du relais de commutation
du curseur privé normal, son enroulement de 500 ohms, puis la
bobine de 1 300 ohms du relais de coupure du pont, jusqu'au pôle
négatif de la batterie. Le relais de commutation du curseur privé
normal est alors verrouillé et le relais de coupure du pont est
activé, coupant ainsi les relais verticaux et rotatifs de la
ligne. En 4, Fig. 114, la commande du relais vertical est commutée
sur le relais de sonnerie. Lorsque l'abonné appelant appuie sur
sa touche de sonnerie, il met à la terre le fil vertical. Cela
fait monter le relais vertical du connecteur, alimentant ainsi le générateur
de sonnerie. Ce dernier connecte le courant de sonnerie aux curseurs
verticaux et rotatifs. Ce courant circule sur les normales verticales
et rotatives (Fig. 113) du premier sélecteur jusqu'à la
ligne où il fait sonner l'une des quatre cloches qui lui est
associée.
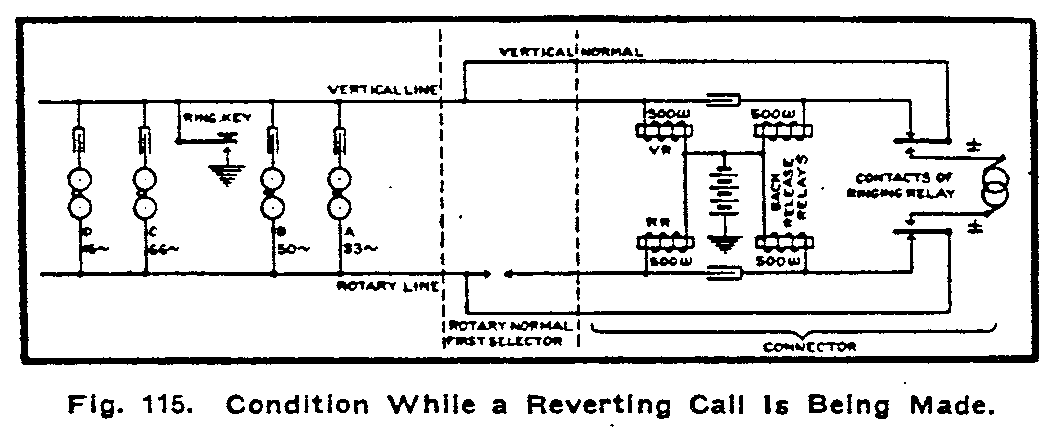
La Fig. 115 illustre schématiquement les connexions importantes
pendant la conversation et la sonnerie. La ligne rotative est interrompue
dans le premier sélecteur, tandis que la ligne verticale est
maintenue. Cela ne déséquilibre pas la ligne, car le rotatif
est connecté aux curseurs du connecteur.
Comme aucun relais n'est connecté à la ligne du premier
sélecteur, il semble impossible de la libérer. Mais lorsque
le crochet descendant met à la terre les lignes verticales et
rotatives, les deux relais de libération arrière du connecteur
actionnent l'aimant de libération, ce qui ramène les curseurs
à la normale lors de la remontée. Le connecteur sera donc
réinitialisé alors que la terre est encore présente
sur les deux fils. La suppression de la terre de la ligne normale privée
permet au relais de coupure du pont du premier sélecteur de se
replier, reconnectant ainsi les relais verticaux et rotatifs de ce commutateur.
Ils se relèvent immédiatement, activent leur aimant de
déclenchement et achèvent la libération de la connexion.
LIGNES PARTAGÉES ET COMMUTATEUR DE LIGNE.
À Grand Rapids, dans le Michigan, la ligne partagée devait
fonctionner via les commutateurs de ligne de batterie locaux. Par conséquent,
la suppression de la terre de la ligne normale privée lors du
test de retour à l'état occupé a dû être
effectuée au niveau du commutateur de ligne plutôt que
du premier sélecteur. Cela a été réalisé
en pontant deux relais de 1 300 ohms sur la ligne, comme illustré
à la figure 116.
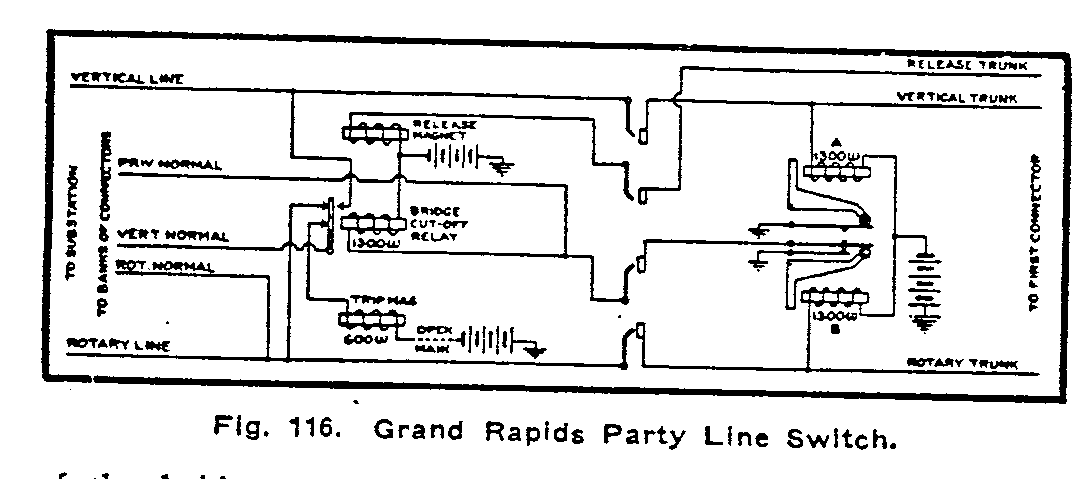
Le relais B est le relais de commutation de la ligne normale privée,
mais il supprime simplement la terre pendant que le connecteur effectue
le test. La terre est ensuite rétablie, ce qui remet le relais
de coupure du pont en position haute, reliant ainsi la normale verticale
à la verticale. Lors du relâchement, les relais A et B
se remettent en position haute. Le relais A rétablit la terre
sur le relais de coupure du pont, que B retire, empêchant ainsi
l'aimant de déclenchement d'être affecté.
sommaire
South
Bend et batterie commune
Jusqu'à cette époque (1904-1905), le système automatique
utilisait des piles sèches dans les instruments de la sous-station
pour les communications. L'objection était fondée, car
le fonctionnement sur batterie commune avait démontré
ses qualités supérieures et était exigé
par les centraux progressifs. L'automatique fut donc réaménagé
pour répondre à ce besoin.
La première centrale à utiliser ce système fut
celle de South Bend, dans l'Indiana, installée en mai 1905.
Cette installation devait fonctionner conjointement avec un tableau
manuel, tous deux situés dans le même bâtiment. Les
appels provenant des abonnés manuels devaient être effectués
manuellement en se branchant sur des prises connectées aux lignes
des abonnés automatiques.
Ces derniers devaient également pouvoir effectuer leurs appels
sans opérateur, grâce à des connecteurs spéciaux
branchés sur les lignes des abonnés manuels. Le tableau
manuel était un multiplexeur à deux fils Kellogg à
batterie commune.
Le circuit de la sous-station révisé est illustré
à la figure 117.
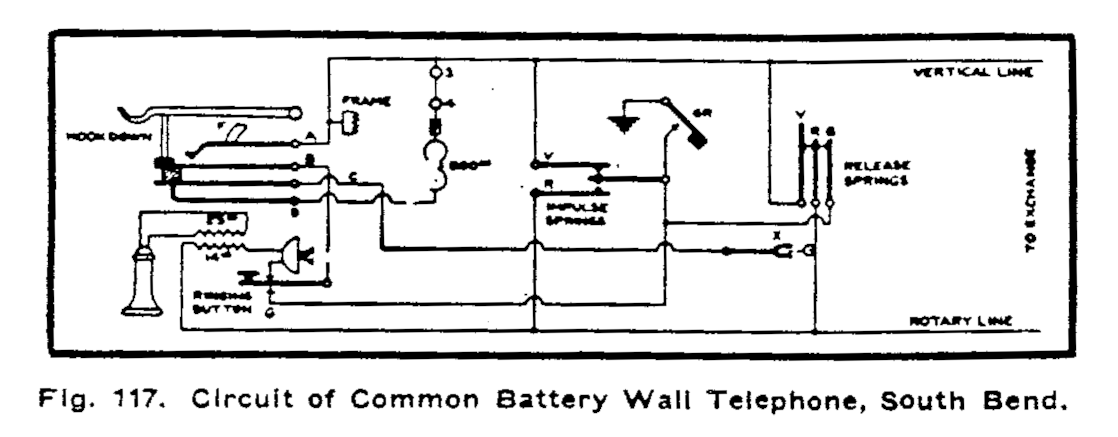
Dans sa version standard, En état, raccroché, la sonnerie
de 500 ohms et le condensateur 2 M.F. étaient seuls sur la ligne.
Le ressort de masse, Gr., est abaissé par le premier tour du
cadran, fournissant la base pour les ressorts d'impulsion, le bouton
de sonnerie et les ressorts de déclenchement. Au raccroché,
le doigt F du cadran forme la butée du ressort supérieur
A.
Lorsque le crochet est relevé, A et B ferment le circuit de communication.
Pendant le mouvement du cadran, le doigt F C se lève, ouvrant
les contacts A-B, séparant ainsi les lignes verticale et rotative
pendant l'arrivée des impulsions. Le poste de communication est
constitué d'une bobine d'induction dont le primaire est en série
avec l'émetteur, le récepteur étant câblé
à l'enroulement secondaire.
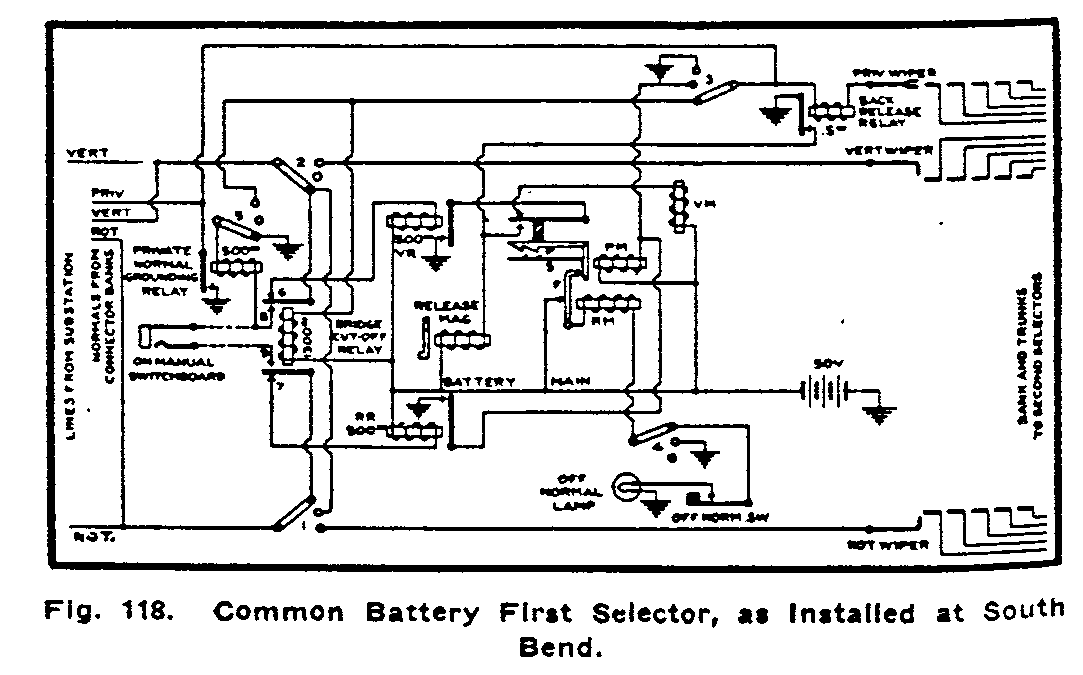
Le premier sélecteur est illustré à la figure 118.
Les lignes verticales et rotatives du poste passent normalement par
les interrupteurs latéraux 1 et 2, les contacts 6 et 7 du relais
de coupure du pont, les relais verticaux et rotatifs, jusqu'à
la borne négative de la batterie. Le relais vertical commande
l'aimant vertical, ou aimant de déclenchement, déterminé
par l'aimant privé. Le relais rotatif commande l'aimant privé.
La relation habituelle entre l'aimant rotatif et l'aimant privé
est observée lors de la rotation pour trouver une ligne non occupée,
le premier étant doté d'un interrupteur individuel. L'interrupteur
de coupure normale se limite à allumer le voyant de coupure normale
pendant l'arrivée des impulsions verticales et s'éteint
dès le début de la rotation. Toutes les étapes
de l'appel, à l'exception de la dernière, sont identiques
à celles du premier sélecteur de déclenchement
de ligne décrit précédemment et n'ont pas besoin
d'être décrites à nouveau. Lorsque la ligne non
occupée est trouvée et que l'interrupteur latéral
passe en troisième position, l'élément 3 est mis
à la terre pour protéger la ligne de coupure. Le fil normal
privé, relié au commutateur latéral 3, partage
sa terre pour se protéger des appels provenant d'autres postes.
De plus, la prise de ligne du tableau manuel doit être occupée
afin que les surtensions ne puissent pas établir de connexion.
Sur la carte Kellogg, le manchon de la prise est au potentiel de masse
lorsque la ligne est libre, mais comporte une batterie lorsqu'elle est
occupée. Par conséquent, l'interrupteur latéral
5 est prévu pour connecter le relais de mise à la terre
de la batterie via le relais de coupure du pont. Cela donne au manchon
de la prise l'état d'occupation souhaité. Si un appel
arrive sur cette ligne depuis un autre abonné automatique, il
arrive par les connecteurs et sur le fil normal. Lorsque l'interrupteur
latéral du connecteur glisse en troisième position, il
met à la terre la batterie. Cela active le relais de coupure
du pont, coupant ainsi les relais verticaux et rotatifs du premier sélecteur.
Le curseur vertical du connecteur transporte le négatif de la
batterie, qui est alimenté par l'interrupteur latéral
2 et le contact g du relais de coupure du pont vers le manchon de la
prise manuelle. Cela rend ce dernier très occupé.
Lorsqu'une connexion est établie entre un abonné manuel
et un abonné automatique, l'opérateur se branche sur la
prise de ligne de ce dernier avec le cordon Kellogg standard. L'extrémité
transmet le positif ou la masse de la batterie via le relais de supervision
de 100 ohms. Le manchon transmet le négatif de la batterie via
le relais de commande de 100 ohms. Ce dernier active le relais de mise
à la terre du contacteur principal du premier sélecteur,
mettant ainsi à la terre le contacteur principal et actionnant
le relais de coupure du pont. Le premier protège la connexion,
le second commute la prise sur la ligne de l'abonné automatique,
créant ainsi un circuit ouvert pour la sonnerie.
Le deuxième sélecteur (Fig. 119) est original car il ne
possède pas de commutateur latéral.
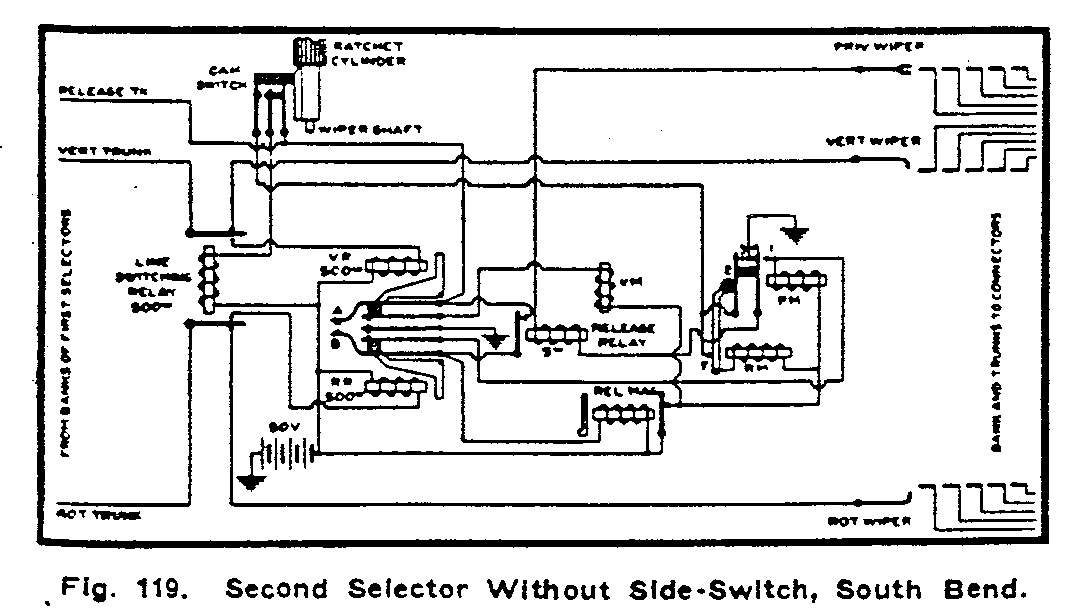
Il est remplacé par le relais de commutation de ligne, le commutateur
à came et certaines fonctions de l'aimant principal. L'alimentation
par batterie des aimants verticaux et rotatifs et de l'aimant principal
est contrôlée par un contact arrière sur l'aimant
de déclenchement. L'aimant vertical est commandé par le
relais vertical, et l'aimant privé par le relais rotatif, comme
d'habitude. Cependant, le contact avant, 1, de l'aimant privé,
relie ce dernier, via le relais de libération, au curseur privé
afin de tester les lignes et de trouver une ligne non occupée.
La ligne de libération de la première rangée de
sélecteurs passe par les contacts A et B (ouverts), le contact
du relais de libération étant en parallèle avec
l'aimant de libération et la batterie. Normalement, l'interrupteur
à came sur l'axe du curseur maintient le relais de commutation
de ligne connecté à la ligne de libération. Par
conséquent, lorsqu'un premier sélecteur est connecté
à ce second sélecteur et met à la terre la ligne
de libération, le relais de commutation de ligne est activé,
connectant les relais vertical et rotatif à la ligne.
Lorsque les impulsions verticales arrivent, l'aimant vertical accélère
les curseurs jusqu'au niveau souhaité. L'impulsion unique active
le relais rotatif et, par son intermédiaire, l'aimant privé.
Instantanément, l'aimant rotatif, mis à la terre par les
bornes 2 et 3 de l'aimant privé, remonte, faisant tourner les
racleurs vers le premier tronc. Le doigt F de l'aimant rotatif presse
l'armature de l'aimant privé vers la droite, fermant le contact
1. Si ce premier tronc est occupé, l'aimant privé trouvera
la terre, ce qui maintiendra l'aimant privé vers le haut, mais
pas le déclencheur. Le relais rotatif peut alors se replier,
car les opérations suivantes échappent à son contrôle.
Ce premier mouvement rotatif a entraîné le déplacement
du commutateur à came vers la droite, ce qui a fait passer le
relais de commutation de ligne du tronc de déverrouillage au
ressort 2 de l'aimant privé. Il est alors maintenu levé
par les contacts 2-3 pendant la recherche du tronc non occupé.
L'aimant rotatif, ayant coupé son propre circuit par le contact
en F, retombe et s'accroche à une nouvelle encoche du cylindre
à cliquet. Le contact F se ferme, le tirant vers le haut, faisant
tourner les curseurs vers le tronc suivant, le doigt F maintenant le
contact 1 de l'aimant privé fermé tandis que le curseur
privé glisse d'un contact à l'autre. Lorsqu'un tronc non
occupé est finalement trouvé, l'absence de masse sur le
curseur privé fait reculer l'aimant privé, ce qui coupe
à la fois l'aimant rotatif et le relais de commutation de ligne.
Ce dernier coupe les relais de ligne et coupe la ligne vers les curseurs.
Le curseur privé est mis à la masse par le contact 4 de
l'aimant privé.
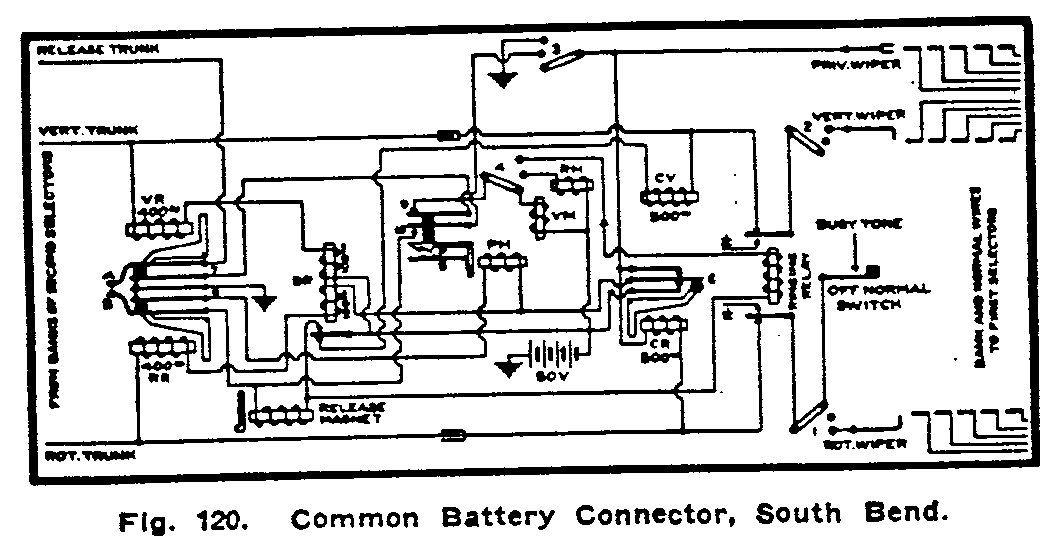
Le connecteur ordinaire (Fig. 120), destiné à l'appel
des abonnés automatiques, diffère sensiblement des connecteurs
décrits précédemment, car c'est ici que les modifications
permettent l'alimentation de la batterie commune pour la communication.
Les relais vertical et rotatif, chacun d'une résistance de 400
ohms, sont en série avec les deux enroulements du relais différentiel
DR. Les deux bobines de ce dernier sont connectées de manière
à s'entraider normalement. La ligne verticale est reliée
en permanence au négatif de la batterie. La ligne rotative, via
les relais rotatif et différentiel, rejoint le ressort 6 du relais
CR, où elle est normalement connectée au négatif
de la batterie. Cependant, le relais CR peut la commuter sur le commutateur
latéral 3, où elle peut ensuite être connectée
à la masse ou au positif de la batterie. Le relais différentiel
DR contrôle la batterie :
alimente le retardateur CV sur son contact arrière, et l'aimant
de déclenchement et le relais de sonnerie sur son contact avant.
En détail, le fonctionnement est le suivant : les impulsions
pour le chiffre des dizaines arrivent sur la ligne verticale, activant
simultanément les relais vertical et différentiel. Ce
dernier ne produit aucun effet. Le relais vertical met à la terre
son ressort 7 et, par l'intermédiaire du contact magnétique
9 et du contact latéral 4, actionne l'aimant vertical, amenant
les curseurs au niveau souhaité. Une impulsion arrive ensuite
sur la ligne rotative, activant les relais rotatif et différentiel.
Ce dernier ne produit aucun effet. Le relais rotatif active l'aimant
secondaire et, en le relâchant, laisse le contact latéral
glisser vers sa deuxième position. À 1 et 2, rien ne se
passe. À 3, le curseur secondaire est connecté au contact
10 de l'aimant secondaire. À 4, le ressort 7 du relais vertical
est commuté sur l'aimant rotatif. Lors de la dernière
traction du cadran, les impulsions transmises sur la ligne verticale
actionnent le relais vertical et l'aimant rotatif, déplaçant
les essuie-glaces vers la ligne connectée. La dernière
impulsion est transmise à la ligne rotative, activant le relais
rotatif et le réseau privé. Si la ligne appelée
est occupée, l'essuie-glace privé reste à la terre.
Par conséquent, la fermeture du contact 10 sur le réseau
privé libère le connecteur. L'abonné appelant,
en activant, met à la terre la ligne verticale, augmentant la
position de l'arbre d'un ou deux crans. Cela ferme l'interrupteur d'arrêt
normal et déclenche la tonalité d'occupation. Si la ligne
appelée n'est pas occupée, le mouvement de l'aimant privé
permet à l'interrupteur latéral de passer en troisième
position.
À 1, l'armature se soulève, coupant la batterie négative
de la ligne appelée. Cela permet à CR de se replier, rétablissant
la batterie négative de la bobine inférieure du relais
différentiel et de la ligne rotative. Le relais rotatif se soulève
alors, fermant A B et la libération se déroule normalement.
L'abonné appelé ne peut pas libérer.
Le connecteur spécial pour l'appel des abonnés manuels
est illustré à la figure 121 et présente plusieurs
caractéristiques inhabituelles dues à la prise à
deux fils de la carte Kellogg.
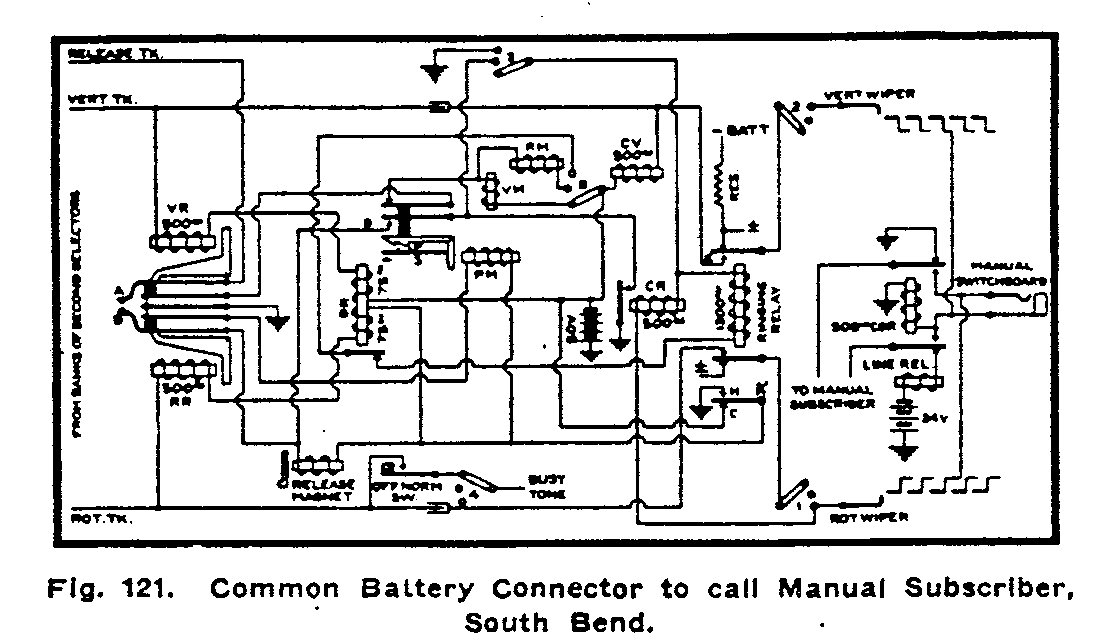
Il n'y a pas de curseur privé, le test d'occupation étant
effectué par le curseur rotatif, le relais CR et l'aimant de
libération, tous en série. Ce test se produit lorsque
la ligne rotative est mise à la masse à la fin du dernier
chiffre. L'interrupteur latéral 3 est en position médiane
et l'aimant privé est soulevé. Si la ligne appel est libre,
le curseur rotatif repose sur un point ouvert. En cas d'occupation,
la masse se trouve à l'extrémité de la prise (point
de la rangée rotative) grâce au relais de supervision du
circuit du cordon opérateur ou au relais CR d'un autre connecteur.
Cette masse fait circuler le courant depuis le pôle négatif
de la batterie via le contact C du relais de sonnerie (aimant de déclenchement),
le contact D de l'aimant privé (interrupteur latéral 3),
le relais CR (essuie-glace rotatif) vers la carte manuelle et la masse.
Le relais CR se déclenche, mettant une masse morte sur l'aimant
de déclenchement, ce qui ramène le connecteur à
sa position normale. Comme d'habitude, la tonalité d'occupation
est émise via l'interrupteur normal (arrêt/activation)
et la sonnerie. Une fois la connexion établie avec la ligne appelée,
le relais de sonnerie est maintenu en permanence par le pôle positif
de la batterie (interrupteur latéral 3) et par le pôle
négatif de la batterie (interrupteur latéral 5). C'est
le relais de sonnerie qui relie le pôle positif de la batterie
au côté rotatif de la ligne appelante pour la communication,
les ressorts H et K assurant cette fonction. La batterie négative
fait circuler le courant dans le relais CV, le contact E du relais de
sonnerie et le curseur vertical, ce qui bloque le relais de coupure
de la ligne manuelle.
Lorsque le bouton de sonnerie du poste appelant est enfoncé,
les relais verticaux et différentiels se déclenchent.
Ce dernier ouvre le circuit du relais de sonnerie, qui retombe, coupant
le circuit de commutation et projetant le courant de sonnerie sur la
ligne appelée. Pendant la sonnerie, une connexion à la
batterie négative via une résistance bloque le relais
de coupure du tableau manuel.
On notera, en se référant aux figures 118 et 119, qu'une
fois le sélecteur terminé, les lignes sont libérées
de tout appareil.
La libération doit s'effectuer via la ligne de libération
et le curseur privé. Dans chaque central, il existe un ou plusieurs
niveaux inutilisés dans les blocs de sélecteurs. On les
appelle « niveaux morts ». Si un abonné
accède par erreur à l'un d'eux, il ne pourra pas libérer.
Pour éviter ce problème, le déclencheur pour niveaux
morts a été conçu et installé. Il se compose
simplement de deux relais de 500 ohms représentant les relais
verticaux et rotatifs. Leur coopération relie le pôle négatif
de la batterie, via une résistance de 60 ohms, au circuit de
déclenchement, qui déclenche les interrupteurs normalement.
sommaire
Répéteurs
interurbains
Après un certain temps, le téléphone automatique
a démontré sa capacité à gérer les
échanges commerciaux dans les centraux de petite et moyenne taille.
Les villes ont une capacité de croissance, et le système
téléphonique doit s'adapter aux besoins, qui ont tendance
à croître plus vite que la population. Il est regrettable
qu'à mesure que la taille d'un central téléphonique
augmente, le coût annuel par téléphone augmente.
La tentative de subdiviser un territoire de central téléphonique
en districts, avec un bureau relativement petit dans chacun, réduit
légèrement les dépenses, mais le coût annuel
augmente néanmoins considérablement.
Le système automatique se révèle très flexible
et s'adapte aux conditions des centraux multi-bureaux.
Il permet de limiter le coût du service par ligne et de réaliser
une économie significative dans la subdivision des bureaux.
Le plus… Un exemple notable est celui de la ville de Los Angeles,
en Californie, où l'on trouve un bureau principal, manuel, et
sept bureaux secondaires, tous automatiques, ces derniers desservant
entre 15 000 et 20 000 abonnés sur un total de 35 000.
Tous les bureaux automatiques sont reliés par des lignes principales,
ce qui permet à un abonné d'appeler n'importe lequel d'entre
eux avec la même facilité et la même rapidité
qu'il appellerait un autre téléphone de son propre central.
À mesure que les lignes devenaient plus puissantes, on a constaté
que les relais ne fonctionnaient plus aussi bien qu'auparavant. Il était
plus difficile de les régler pour qu'ils répondent précisément
à la série d'impulsions rapides. Cela était dû
à la capacité électrostatique des lignes. En tirant
le premier chiffre, l'abonné actionnait un premier sélecteur
dans son propre bureau, dont les relais répondaient facilement.
Mais, tout en finalisant sa connexion, il actionnait les relais d'un
connecteur situé dans le bureau distant, à plusieurs kilomètres
de là. La capacité, à cette distance, a un effet
appréciable sur le comportement des relais. Elle les ralentit,
les rendant moins réactifs et ayant tendance à se maintenir
à chaque rupture du cadran.
Le même problème avait été rencontré
en télégraphie, et une solution satisfaisante avait été
trouvée dans le répéteur, aujourd'hui utilisé
quotidiennement sur des centaines de lignes. Les ingénieurs de
l'Automatic Electric Company se sont donc attachés à produire
un répéteur pour lignes principales qui devrait apporter
un soulagement. Il semble simple de mettre en place un circuit comme
celui de la figure 123 pour répéter les signaux.
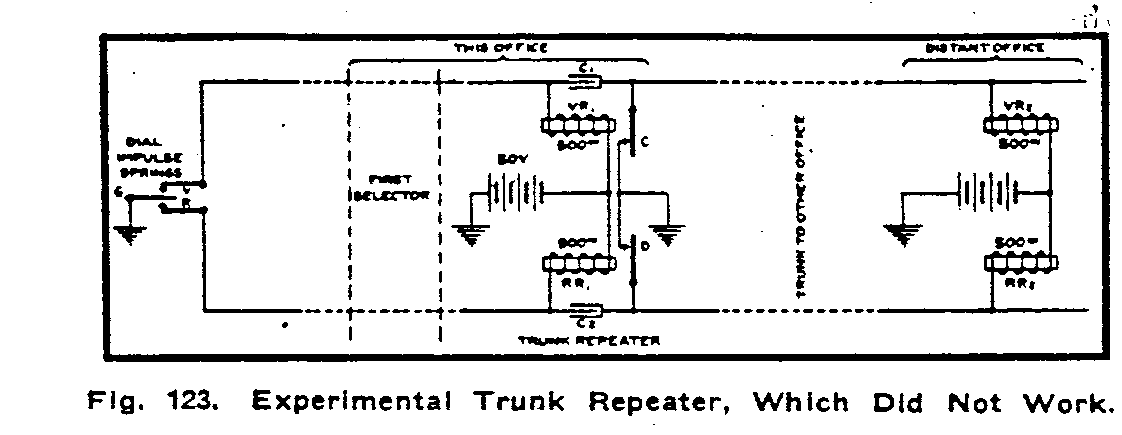
Les condensateurs C et C interrompent la continuité de la ligne
pour le courant de batterie, tout en laissant libre le passage du courant
de conversation. Toutes les impulsions verticales produites par le cadran
de gauche actionnent le relais VR, qui relie à la terre la ligne
verticale à droite du condensateur, transmettant ainsi les signaux
au relais vertical VR, du sélecteur du bureau distant. Les impulsions
rotatives sont transmises de la même manière. C'est sous
cette forme que les premiers essais ont été effectués.
Mais ils ont échoué. Les relais VR et RR, ont agi lentement,
voire pas du tout.
L'examen de la cause a révélé la situation suivante :
lorsque le ressort d'impulsion du cadran se ferme, il relie la borne
gauche du condensateur C, pratiquement hors tension, à la terre.
Lorsque le relais vertical VR se déclenche suite à la
condition du poste d'appel, il ferme son contact C et relie la borne
droite du même condensateur à la terre. Le condensateur
est ainsi court-circuité un instant et donc déchargé.
Lorsque le ressort d'impulsion vertical du cadran se rompt, ce court-circuit
est supprimé. Le courant continue donc de circuler dans VR jusqu'à
ce que le condensateur soit complètement chargé. Le relais
est alors maintenu en position jusqu'à la prochaine impulsion,
ce qui le bloque, ou du moins l'empêche de transmettre des signaux
clairs et fiables. Ce problème a finalement été
résolu en inversant les lignes verticales et rotatives à
droite des condensateurs C et C, comme illustré à la figure
124.
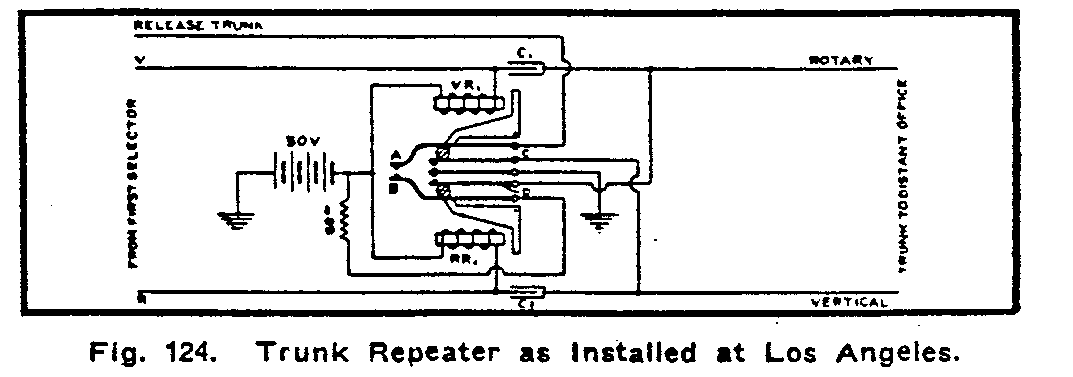
Cette opération a été réalisée vers
janvier 1906 et le circuit a été appliqué au central
de Los Angeles avec un succès remarquable. On observe que le
relais vertical répète toujours les signaux vers la ligne
verticale de l'autre central, mais le condensateur C est désormais
connecté à la ligne rotative de droite. Il n'est plus
en mesure de maintenir le courant à travers VR. Lorsque l'abonné
libère, VR et RR se rapprochent, mettant à la terre les
lignes verticales et rotatives en C et D, libérant ainsi l'appareil
du central distant. Les contacts A et B se ferment, alimentant la batterie
négative via la résistance de 60 ohms jusqu'au circuit
de libération, puis jusqu'à l'appareil du central, libérant
ainsi ce dernier. Ce type de répéteur fonctionne parfaitement
pour les systèmes de batterie locaux, mais une modification est
nécessaire pour une batterie commune.
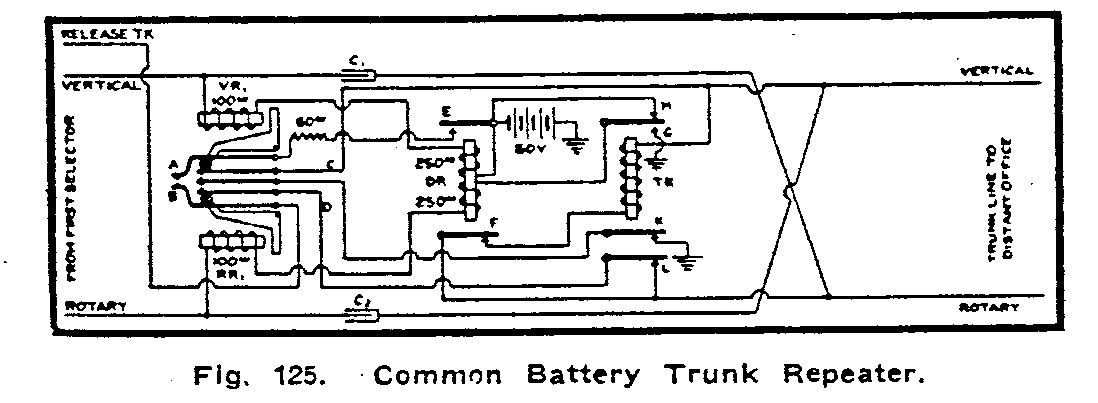
La figure 125 illustre le répéteur de ligne principale
à batterie commune utilisé à Portland, dans l'Oregon,
et à Los Angeles, en Californie, au printemps 1906. Le relais
vertical, VR, est en série avec un enroulement du relais différentiel,
DR, et est connecté en permanence à la borne négative
de la batterie. Le relais rotatif, RR, est connecté en série
avec l'autre enroulement du relais différentiel, à partir
duquel le circuit passe par le contact H du relais de conversation,
TR. Ainsi, chaque côté de la ligne menant à l'abonné
dispose d'une borne négative de la batterie à des fins
de sélection. Le relais de conversation, TR, est normalement
ponté sur la ligne principale, mais il est commandé par
le contact F du relais différentiel. Le relais vertical, par
son contact C, transmet les impulsions à la ligne verticale reliant
le bureau distant. Le relais différentiel suit toutes ces impulsions,
déconnectant le relais de conversation de la ligne. L'impulsion
sur la ligne rotative active le relais rotatif et, par son contact D,
met à la terre la ligne rotative vers le central distant. Le
relais différentiel se déclenche à nouveau et déconnecte
le relais de conversation de la ligne.
Lorsque l'abonné appelé répond, le relais de conversation
du connecteur du central distant se déclenche et commute la ligne
rotative du négatif au positif de la batterie, c'est-à-dire
à la terre. Cela provoque la circulation du courant sur la ligne
rotative vers le répéteur de ligne, via le contact F (relais
de conversation), puis sur la ligne verticale. Le relais de conversation
est ainsi mis sous tension et sa mise à la terre produit trois
résultats : en K, il coupe la terre du contact des relais
vertical et rotatif. en L, il déconnecte le contact D du relais
rotatif de la ligne rotative. en H et G, il commute la ligne rotative
vers l'abonné appelant du négatif de la batterie au positif,
lui fournissant ainsi l'alimentation par batterie nécessaire
à la conversation. On observera que les relais verticaux, rotatifs,
différentiels et de communication ont des relations très
similaires entre eux et avec les lignes que les relais du même
nom dans le connecteur de batterie commun décrit dans le chapitre
précédent.
Une fois la conversation terminée, l'abonné appelé
raccroche, libérant ainsi le relais de conversation. La ligne
rotative de l'abonné appelant est alors remise à la masse.
Ainsi, lorsqu'il raccroche et met les deux lignes à la masse,
les relais verticaux, rotatifs et différentiels sont tous activés.
Les contacts C et D mettent à la masse la ligne principale, libérant
ainsi l'appareil du bureau distant. Le contact E du relais différentiel
alimente la ligne principale via la résistance de 60 ohms et
le contact A-B, via la masse, jusqu'à la ligne principale, libérant
ainsi l'appareil de ce bureau. L'abonné appelant peut libérer
même si l'abonné appelé n'a pas raccroché.
Dans ce cas, le relais de conversation reste sous tension. Si les deux
lignes de gauche sont mises à la masse, le relais rotatif et
l'enroulement inférieur du relais différentiel sont mis
hors tension. Cela permet uniquement aux relais verticaux et différentiels
de monter, ces derniers déconnectant les relais de parole en
F. Le relais de parole, en retour, transmet la tension négative
de la batterie à la ligne rotative (en H), ce qui fait monter
également le relais rotatif. Cela ferme le contact A B et, comme
E est déjà fermé, la tension négative de
la batterie est alimentée par le tronc de déclenchement
pour libérer l'appareil de ce bureau. Simultanément, les
contacts C et D libèrent le bureau distant.
Une combinaison très intéressante de sélecteur
et de répéteur de tronc a été installée
à Columbus, dans l'Ohio, au printemps 1907.
Son circuit est illustré à la figure 126.
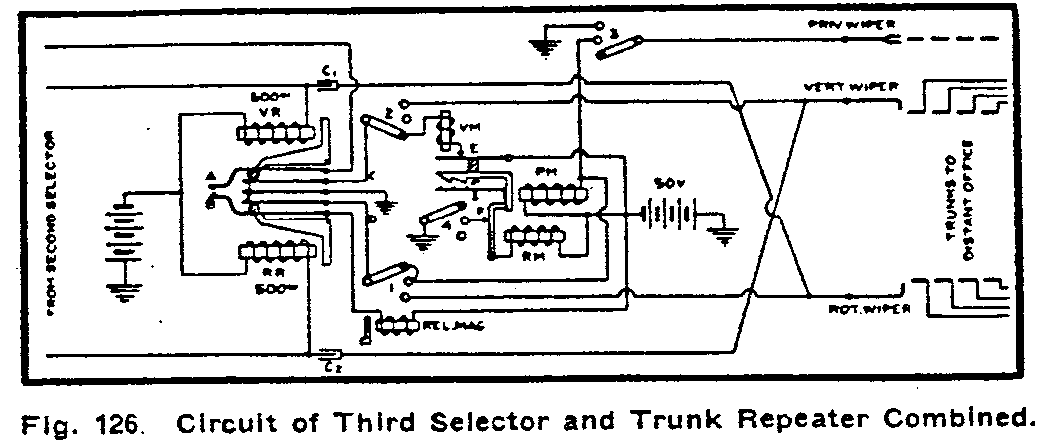
Conçus pour un système de batterie local, les relais verticaux
et rotatifs sont connectés en permanence à la tension
négative de la batterie et aux lignes, comme indiqué.
Deux conducteurs, C et C, séparent les lignes pour permettre
la séparation de l'alimentation de la batterie. Les fils des
essuie-glaces verticaux et rotatifs sont inversés pour éviter
le problème décrit ci-dessus. Le contact C du relais vertical
actionne normalement l'aimant vertical FM, mais une fois l'action du
sélecteur terminée, il est mis à la terre du tronc
vertical comme un répéteur. Le contact D du relais rotatif
assure également une double fonction : il gère l'aimant
privé PM et le tronc rotatif. Une description détaillée
de son action ne semble pas nécessaire, car chaque action a été
expliquée en détail précédemment. Un aspect
très important du répéteur de ligne principale
se trouve dans le plan de division des centraux « sous-central ».
Dans ce plan, un groupe d'abonnés, normalement desservis par
des lignes directes vers le central, voit ses commutateurs et connecteurs
de ligne déplacés vers un point de leur voisinage. De
ce sous-central, seuls les commutateurs nécessaires au trafic
sont acheminés vers le central. Il s'est avéré
plus satisfaisant d'installer un répéteur de ligne principale
au sous-central, sur chaque ligne principale allant au central. Un tel
répéteur de ligne principale, adapté à une
batterie commune, est illustré à la figure 127. Il est
à noter que dans le commutateur de ligne à batterie commune,
son aimant de déclenchement est connecté du négatif
de la batterie à la ligne principale de déclenchement
lorsqu'un abonné est déclenché. Par conséquent,
le contact E du relais différentiel n'a besoin que de mettre
à la terre la ligne principale de déclenchement pour rétablir
le commutateur de ligne JJ. Un relais de coupure, ONR, est ajouté,
connectant le relais de conversation à la ligne principale lorsque
L'interrupteur de ligne se déclenche, le courant passant par
l'aimant de déclenchement de l'interrupteur. Grâce à
sa résistance élevée de 5 500 ohms, il n'affecte
pas l'aimant de déclenchement. L'introduction du répéteur
a permis d'obtenir des signaux d'une netteté et d'une fiabilité
optimales. L'utilisation du répéteur a toutefois apporté
un avantage supplémentaire : sa connexion au système
de batterie standard. Sans lui, l'abonné appelant devait tirer
son courant de communication du connecteur du bureau distant. La transmission
était donc relativement faible. Grâce au répéteur,
il tire le courant de la batterie de son bureau, comme l'abonné
appelé le fait depuis son propre bureau, et la transmission vocale
est ainsi beaucoup plus satisfaisante.
sommaire
Une évolution majeure arriva en
1906 : Le commutateur de ligne, conçu par Alexander
Keith de la Strowger Company, évitait le besoin de connecter
la ligne de chaque utilisateur à un commutateur plus coûteux.
Le nombre de commutateurs utilisés ne devra désormais
être suffisant que pour gérer le nombre maximum d'appels
attendus à tout moment.
La ligne d'abonné aboutit à un appareil appelé
lineswitch (aiguilleur de ligne) ou présélecteur,
de volume réduit, qui a pour fonction d'aiguiller automatiquement
sa ligne, dès qu'il reçoit un appel, vers un premier sélecteur
libre.
Reprendre la suite sur la page Stowger