1877-1910 INTRODUCTION DU TÉLÉPHONE EN EUROPE ET À
L'ÉTRANGER
Des scientifiques du monde entier manifestèrent
un intérêt immédiat pour l'invention de Bell, et
certains d'entre eux ne tarirent pas d'éloges sur l'exploit de
l'inventeur, à l'instar de Sir William Thomson.
L'attention du public se concentra également très tôt
sur les possibilités qui pouvaient en découler.
En Amérique les premiers téléphones Bell commerciaux, fin 1877 appelés de façon populaire "butterstamp", vont équiper les premiers clients.
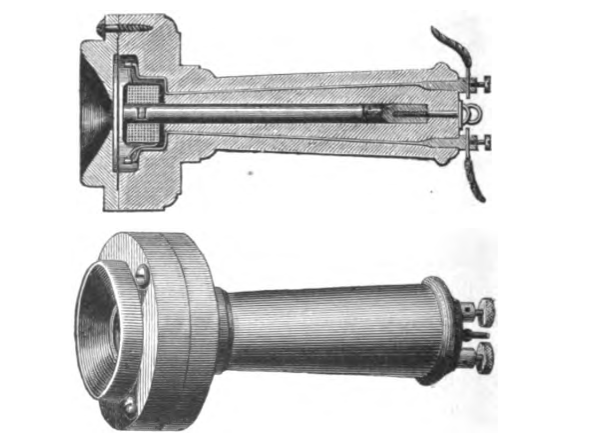 |
D'abord pour un usage
privé en réseau local à un bâtiment ou
un espace privé, puis sur de petits réseaux avec un
petit centre pour interconnecter quelques personnes via un opérateur. Plus tard la même année, le "Butterstamp" a été remplacé par le "Coffin Téléphone " (oui son boîtier fait penser un peu à un cercueil). Le Coffin est équipé d'un générateur à magnéto entraîné par une manivelle à main qui envoie du courant alternatif sur la ligne pour alimenter un dispositif de sonnerie relié directement au bureau central , afin d'alerter un opérateur, ou à l'autre correspondant en point à point. ( Watson a déposé le brevet de la sonnerie , le 1er Août , 1878. ) . |
Les développements commerciaux en
Europe furent initiés par les titulaires de brevets américains,
avec l'aide de quelques personnalités influentes et visionnaires
dans chaque pays. L'importance accordée par Bell à l'obtention
de brevets étrangers et le retard pris dans le dépôt
de la demande britannique ont eu pour conséquence, que la demande
américaine a été déposée beaucoup
plus tard qu'elle ne l'aurait été autrement.
( Le téléphone magnétique de Bell n'était
pas suffisamment puissant pour une utilisation générale
comme instrument d'un central téléphonique, et la compagnie
de téléphone (Bell) ne pouvait pas utiliser l'émetteur
Edison, ni le récepteur magnétique.)
En 1878 Le téléphone existait
déjà depuis près d'un an lorsque l'Europe n'a pas
eu connaissance de son existence.
Tout commence au Royaume Unis, qui n'a reçu aucune publicité
publique, quelle qu'elle soit, jusqu'au 3 mars 1877, lorsque
l'Athénée de Londres l'a mentionné en quelques
phrases. Il n'a pas été bien accueilli, sauf par ceux
qui souhaitaient une soirée de divertissement. Et pour le monde
des affaires tout entier, il a été, pendant quatre ou
cinq ans, une sorte de Billiken scientifique, qui n'a jamais pu être
d'aucune utilité pour les gens sérieux.
L'un après l'autre, plusieurs Américains enthousiastes
se sont précipités en Europe, rêvant de nations
avides de systèmes téléphoniques, et ils ont échoué
l'un après l'autre. Frederick A. Gower
fut le premier d'entre eux. C'était un chevalier d'affaires aventureux
qui a renoncé à un contrat d'agent en échange du
droit de devenir un propagandiste itinérant. Plus tard, il rencontra
une prima donna, en tomba amoureux et l'épousa, abandonna la
téléphonie pour l'aérostation et perdit la vie
en tentant de traverser la Manche.
Le suivant, fut Wilham H. Reynolds, de Providence, qui
avait acheté cinq huitièmes du brevet britannique pour
cinq mille dollars, et la moitié des droits sur la Russie, l'Espagne,
le Portugal et l'Italie pour deux mille cinq cents dollars. L'accueil
qu'il reçut fut illustré par une lettre de lui, conservée.
« Je travaille à Londres depuis quatre mois », écrit-il ;
« Je suis allé à la Banque d'Angleterre et
ailleurs, et je n'ai pas trouvé un seul homme prêt à
investir un seul shilling dans le téléphone.»
Bell lui-même se précipita en Angleterre
et en Écosse pour sa tournée de noces en 1878, espérant
que son invention serait appréciée dans son pays natal.
Mais d'un point de vue commercial, sa mission fut un échec total.
Il reçut de nombreux dîners, mais aucun contrat ;
et revint aux États-Unis appauvri et découragé.
Puis l'optimiste Gardiner G. Hubbard, beau-père
de Bell, se lança contre l'inertie européenne et fonda
les compagnies de téléphone internationales et orientales,
qui restèrent lettre morte.
La même année, même Enos M. Barton,
le fondateur avisé de la Western
Electric, se rendit en France et en Angleterre pour y établir
un commerce d'exportation de téléphones, mais échoua.
Ces hommes talentueux virent leurs projets contrariés par l'indifférence
du public, et souvent par une hostilité ouverte.
« Le téléphone vaut à peine mieux qu'un
jouet », écrivait la Saturday Review ; « il
étonne un instant les ignorants, mais il est inférieur
au système bien établi des tubes à air.»
« Que deviendra l'intimité de la vie ?»
demanda un autre rédacteur en chef londonien. « Que
deviendra le caractère sacré du foyer ?» Les
écrivains rivalisaient d'imagination pour ridiculiser Bell et
son invention. « C'est d'une simplicité déconcertante »,
déclara l'un.
« Ce n'est qu'un tube électrique parlant »,
dit un autre.
« C'est une forme compliquée de porte-voix »,
dit un troisième. Aucun éditeur britannique ne pouvait,
au départ, concevoir une quelconque utilité au téléphone,
sauf pour les plongeurs et les mineurs de charbon.
Des efforts pour gérer les brevets étrangers ont été
entrepris avant le développement du système
d'échange (central ou standard) aux États-Unis, mais
ils ont été rapidement renouvelés, avec de meilleures
chances de succès, lorsque la grande utilité publique
de ce système a été démontrée. Cette
démonstration fut pleinement démontrée lors de
la concurrence entre les intérêts d'Edison
(représentés par la Western Union Company) et de Bell
Company. Cette concurrence s'étendit à l'étranger,
l'alliance conclue en Amérique ne s'appliquant pas aux organisations
étrangères.
L'introduction du téléphone en Europe fut donc entreprise
grâce à l'énergie supplémentaire résultant
des revendications rivales d'Edison et de Bell, ainsi que de quelques
autres entreprises locales.
Un peu plus tard, Edison avait protégé
plus largement son transmetteur à carbone et s'était activement
investi dans l'exploitation de brevets, tandis que l'entreprise manufacturière
alliée à ses intérêts tentait également
de se débarrasser de son appareil. Des sociétés
spéciales furent créées par les détenteurs
des brevets de Bell pour le développement d'entreprises étrangères,
et dès que la National Bell Company
fut créée et dirigée par une équipe compétente,
Hubbard lui-même se rendit en Europe afin de promouvoir
les activités étrangères.
L'International Bell Telephone Company
fut fondée à New York dans le but d'introduire le service
de central téléphonique sur le continent européen,
et la Tropical American Telephone Company
pour développer cette activité en Amérique du Sud,
en Amérique centrale et aux Antilles.
sommaire
Au Royaume-Unis, le colonel Reynolds, de Providence, dans le
Rhode Island, vint à Londres pour vendre les brevets de Bell
et réussit à intéresser d'importants financiers,
qui fondèrent la « Telephone
Company », dont M. James Brand, un marchand influent,
était le président.
Une circulaire, datée du 24 mai 1879, fut publiée par
cette compagnie. Elle contient plusieurs illustrations, donnant « quelques
exemples d'applications pratiques du téléphone ».
Elles concernent toutes les lignes domestiques ou privées, et
la circulaire peut être considérée comme visant
à développer ce secteur, mais il est fait indirectement
référence au système de central.
Le développement du téléphone en Angleterre, bien
qu'il n'ait pas progressé aussi rapidement qu'en Amérique,
a, depuis son introduction, progressé lentement et sûrement.
1877-1880, un grand nombre d'appareils sont utilisés en permanence,
et il a été constaté que plus on s'habitue au téléphone,
plus on en apprécie les avantages. Mais dans le premier pays,
grâce au système central (standard), on communique avec
ses commerçants, on appelle des taxis et on effectue toutes sortes
d'affaires sans sortir de chez soi.
Le représentant d'Edison à Londres était le colonel
Gouraud, alors directeur résident de la Mercantile Trust
Company de New York. Il fonda l'Edison Telephone
Company de Londres, dont le très honorable E. P. Bouverie
était président.
Ces deux sociétés ouvrirent des centraux à Londres
à peu près à la même époque, à
l'automne 1879. Le prix, lui aussi, suscita un tollé général.
Des flots de téléphones miniatures étaient vendus
dans les rues à un shilling pièce ; et bien que le
gouvernement facturât soixante dollars par an pour l'utilisation
de ses télégraphes à imprimeur, la population protesta
vivement contre le fait de payer la moitié du prix.
En 1882 encore, Herbert Spencer écrivait : « Le
téléphone est très peu utilisé à
Londres et est inconnu dans les autres villes anglaises.»
Le premier homme important à se passionner pour le téléphone
fut Lord Kelvin, alors un jeune scientifique sans titre. Il avait
vu les téléphones originaux au Centenaire de Philadelphie
et en était si fasciné que l'impulsif Bell les lui avait
offerts.
Lors de la réunion suivante de l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, Lord Kelvin les exposa. Il fit plus encore.
Il devint le défenseur du téléphone. Il y mit sa
réputation. Il raconta l'histoire des tests effectués
au Centenaire de 1876 et assura aux scientifiques sceptiques qu'il n'avait
pas été trompé. « Tout cela, mes oreilles
l'ont entendu », dit-il, « et ce disque de fer
circulaire me l'a transmis avec une netteté indéniable.»
Les scientifiques et les experts en électricité étaient,
pour la plupart, divisés en deux camps. Certains affirmaient
que le téléphone était impossible, tandis que d'autres
affirmaient que « rien ne pouvait être plus simple ».
Presque tous s'accordaient à dire que ce que Bell avait fait
n'était qu'une plaisanterie. Mais Lord Kelvin persista.
Il martela la vérité : le téléphone
était « l'une des inventions les plus intéressantes
de l'histoire des sciences ». Il fit une démonstration
avec une extrémité du fil dans une mine de charbon. Il
se tenait aux côtés de Bell lors d'une réunion publique
à Glasgow et déclara :
« Les appareils qu'on appelait téléphones avant
Bell étaient aussi différents du téléphone
de Bell qu'une série de claquements de mains est différente
de la voix humaine. Il s'agissait en fait de claquements électriques ;
Bell avait eu l'idée, totalement originale et novatrice, de donner
une continuité aux chocs, afin de reproduire parfaitement la
voix humaine. »
Un à un, les scientifiques furent contraints de prendre le téléphone
au sérieux. Lors d'un test public, un professeur réputé,
encore du nombre des sceptiques, fut invité à envoyer
un message. Il se dirigea vers l'appareil avec un sourire incrédule
et, prenant toute cette démonstration pour une plaisanterie,
cria dans le micro : « Salut, mon petit chou !»
Puis il tendit l'oreille pour une réponse. Son expression se
transforma en une expression de stupeur extrême. « C'est
écrit : “Le chat et le violon” », haleta-t-il,
et il se convertit aussitôt à la téléphonie.
Grâce à de tels tests, les hommes de science furent convaincus
et, vers le milieu de l'année 1877, Bell reçut un accueil
enthousiaste lorsqu'il s'adressa à eux lors de leur congrès
annuel à Plymouth.
Peu après, le Times de Londres capitula. Il fit volte-face et
porta le téléphone aux nues. « Soudain et silencieusement,
l'humanité entière est mise à portée de
voix et d'écoute », s'exclamait-il. « Rien n'était
plus désirable et plus impossible. » Le journal suivant
à quitter la foule des moqueurs fut le Toiler, qui déclara
dans un éditorial : « Nous ne pouvons qu'être
impressionnés par l'image d'un enfant humain commandant à
la force la plus subtile et la plus puissante de la nature, de propager,
tel un esclave, un murmure à travers le monde.»
Peu après les scientifiques et les rédacteurs en chef,
la noblesse arriva. Le comte de Caithness ouvrit la marche. Il déclara
publiquement que « le téléphone est la chose
la plus extraordinaire que j'aie jamais vue de ma vie.» Et, par
un matin d'hiver de 1878, la reine Victoria se rendit en voiture chez
Sir Thomas Biddulph, à Londres, et, pendant une heure, elle s'entretint
et écouta au téléphone Kate Field, assise dans
un bureau de Downing Street. Miss Field chanta « Kathleen
Mavourneen », et la Reine la remercia par téléphone,
se déclarant « extrêmement satisfaite ».
Elle félicita Bell lui-même, présent, et lui demanda
si elle pouvait acheter les deux téléphones ; Bell
lui en offrit alors une paire en ivoire.
Cet incident, on l'imagine, contribua grandement à établir
la réputation de la téléphonie en Grande-Bretagne.
Un fil fut aussitôt tendu jusqu'au château de Windsor. D'autres
furent commandés par le Daily News, l'ambassadeur de Perse et
cinq ou six lords et baronnets. Puis arriva une commande qui porta les
espoirs des téléphonistes au plus haut ciel, émanant
de la banque J.S. Morgan & Co. C'était la première
reconnaissance des « sièges des puissants »
du monde des affaires et de la finance. Un petit central, de dix
fils, fut rapidement mis en service à Londres ;
et le 24 avril 1879, Theodore Vail, le jeune
directeur de la Bell Company, envoya une commande à l'usine de
Boston : « Veuillez fabriquer cent téléphones
portables pour l'exportation dès que possible.» Le commerce
extérieur avait commencé.
Et puis, un coup de tonnerre, un désastre totalement imprévu.
Alors que quelques entreprises énergétiques commençaient
à voir le jour, le ministre des Postes proclama soudain que le
téléphone était une sorte de télégraphe.
Selon une loi britannique, le télégraphe devait être
un monopole d'État. Cette loi avait été votée
six ans avant la naissance du téléphone, mais peu importait.
Les opérateurs téléphoniques protestèrent
et polémiquent. Tyndall et Lord Kelvin avertirent le gouvernement
qu'il commettait une erreur indéfendable.
Mais rien ne pouvait être fait. Tout comme les premiers chemins
de fer avaient été appelés routes à péage,
le téléphone fut solennellement déclaré
télégraphe. De plus, pour ajouter à l'humour absurde
de la situation, le juge Stephen, de la Haute Cour de justice, prononça
le dernier mot qui imposa légalement au téléphone
le statut de télégraphe, et appuya son opinion par une
citation du dictionnaire Webster, publié vingt ans avant l'invention
du téléphone.
Après avoir conquis ce nouveau rival, quelle était la
suite ?
Le ministre des Postes l'ignorait. Il n'avait, bien sûr, aucune
expérience en téléphonie, et aucun de ses fonctionnaires
du service télégraphique non plus. Il n'y avait ni livre
ni université pour l'instruire. Son télégraphe
était alors, comme aujourd'hui, un échec commercial. Il
ne fonctionnait pas. Il n'osa donc pas prendre le risque de construire
un second réseau de lignes et finit par consentir à accorder
des licences à des entreprises privées. Mais la confusion
persista.
Afin de forcer la concurrence, selon les théories académiques
de l'époque, des licences furent accordées à treize
entreprises privées.
Comme on pouvait s'y attendre, la plus compétente avala rapidement
les douze autres. Si on l'avait laissée tranquille, cette entreprise
aurait pu fournir un bon service, mais elle était entravée
et encadrée par une réglementation jalouse. Elle fut contrainte
de verser un dixième de ses revenus bruts à la Poste.
Elle devait se tenir prête à vendre ses services avec un
préavis de six mois. Et dès qu'elle eut installé
un réseau de lignes longue distance, le ministre des Postes s'en
empara et le lui confisqua. Puis, en 1900, la Poste abandonna ses obligations
envers l'entreprise agréée et lança une concurrence
ouverte. Elle entreprit de lancer un second système à
Londres et, deux ans plus tard, découvrit son erreur et proposa
de coopérer. Elle accorda des licences à cinq villes qui
réclamaient la propriété municipale. Ces villes
se lancèrent courageusement, tambour battant, enchaînèrent
les mésaventures et finirent par abandonner. Même Glasgow,
première ville à posséder des biens municipaux,
connut son Waterloo au téléphone. Elle
a dépensé un million huit cent mille dollars pour une
installation obsolète à sa sortie, l'a exploitée
un temps à perte, puis l'a vendue à la Poste en 1906 pour
un million cinq cent vingt-cinq mille dollars.
Ainsi, du début à la fin, l'histoire du téléphone
en Grande-Bretagne a été une « comédie d'erreurs
».
On compte aujourd'hui, dans les deux îles, moins de six cent mille
téléphones en service. Londres, avec ses six cent quarante
miles carrés de maisons, en compte un quart et en gagne dix mille
par an. Aucune amélioration majeure n'est en cours, la Poste
ayant annoncé qu'elle reprendrait et exploiterait toutes les
entreprises privées le 1er janvier 1912.
Le désordre bureaucratique, semble-t-il, va perdurer indéfiniment.
sommaire
Comme les centraux se développaient aux États-Unis depuis
le début de 1878, on a parfois suggéré que la Grande-Bretagne
tardait quelque peu à exploiter les facilités des centraux
téléphoniques. La raison, cependant, réside dans
la situation des sociétés respectives en matière
de brevets.
Le téléphone magnétique Bell n'était pas
suffisamment puissant pour une utilisation générale comme
instrument de communication, et la compagnie de téléphone
(Bell) ne pouvait pas utiliser l'émetteur Edison, tandis que
la société Edison ne pouvait pas utiliser le récepteur
magnétique.
La première démonstration publique de l'émetteur
à charbon Edison en Angleterre eut lieu à la London Institution,
lors d'une conférence du professeur Barrett, le 30 décembre
1878. Quelques semaines plus tôt, l'une des premières expériences
longue distance avait été réalisée entre
Londres et Norwich, sur la ligne télégraphique privée
de MM. Colman. Dans toutes ces expériences, un récepteur
magnétpque avait été utilisé.
Les prix indiqués dans cette circulaire sont
les suivants :
PRIX ACTUELS DES TÉLÉPHONES en Livres et Soumis à
redevance
...............................................A l'unité 6d.
et par an
Téléphone, ébonite, modèle à main
. . 1 ..1 ..... 0
Téléphone, modèle tabatière .. ........
. 0 ..15 ... 0.
Téléphone, modèle boîte en bois . . . .1
. 10 ... 0
(La redevance peut être commuée à tout moment par
un paiement anticipé de cinq ans.)
Téléphone, sonnette avec bouton poussoir et commutateur
automatique 0,300
[La politique de vente a été modifiée ultérieurement
et seule la location est autorisée.]
La Bell Company avait attiré l'attention de Barrett sur ce fait
et avait fait part de son intention d'engager des poursuites pour empêcher
la violation de son brevet. L'émetteur à carbone sans
récepteur était inutile, et l'adoption commerciale du
récepteur magnétique entraînerait certainement des
litiges.
La situation fut rapportée à Edison, et il produisit
immédiatement un récepteur basé sur un principe
entièrement différent.
L'appareil ne devait pas être utilisé longtemps, car il
était moins bien adapté aux exigences du service que le
récepteur magnétique, mais sa production opportune permit
à la Edison Telephone Company de Londres de démarrer ses
activités sans être exposée aux risques d'interférences.
L'utilisation de ce récepteur était limitée, pour
l'essentiel, voire entièrement, à l'Angleterre.
| Pour résumer : En 1879, Edison développa
un nouveau récepteur pour concurrencer celui de Bell. À
la fin de l'année, American Bell avait acquis l'activité
téléphonique de Western Union et le nouveau récepteur
d'Edison trouva son principal débouché en Grande-Bretagne.
Ce nouveau récepteur reposait sur sa découverte de
1874 du principe de l'électromotographe, une modification
du frottement provoquée par la décomposition électrochimique.
Au printemps 1877, Edison avait conçu un récepteur
téléphonique utilisant ce principe : la variation
du signal électrique faisait vibrer la membrane sonore en
modifiant le frottement entre un bras de contact métallique
et une surface mobile traitée chimiquement. Dans la version
finale, la surface était composée de craie. Il reprit
ensuite l'idée en juin 1878 afin de contourner le brevet
initial d'Alexander Graham Bell sur un récepteur téléphonique
électromagnétique. Edison envoya les premiers modèles
de démonstration à Londres en février 1879
et, en juillet, il avait développé un modèle
commercial. Les téléphones envoyés en Grande-Bretagne
combinaient l'émetteur à bouton-poussoir en carbone
et le récepteur à électromotographe Edison qualifia son récepteur de 1877 de « téléphone musical », car il était suffisamment puissant pour diffuser la musique émise par son émetteur à bouton-poussoir en carbone dans un vaste auditorium. Après l'arrivée des nouveaux instruments à Londres en 1879, l'agent d'Edison commença à les surnommer « le téléphone à haut-parleur Edison ». |
Le brevet américain de Bell contrôlait
la transmission de courants ondulatoires correspondant aux vibrations
aériennes produites par la parole.
Les brevets britanniques et étrangers avaient une portée
moindre et, par conséquent, bien que le nouveau récepteur
d'Edison ne fût pas utilisé aux États-Unis, il constitua
une acquisition précieuse pour la Edison Telephone Company de
Londres.
La lettre par laquelle Edison informait le colonel Gouraud de l'expédition
des nouveaux instruments fut reproduite en fac-similé, grâce
à une autre invention d'Edison : le stylo électrique.
(Photographie tirée de l'une des copies.)
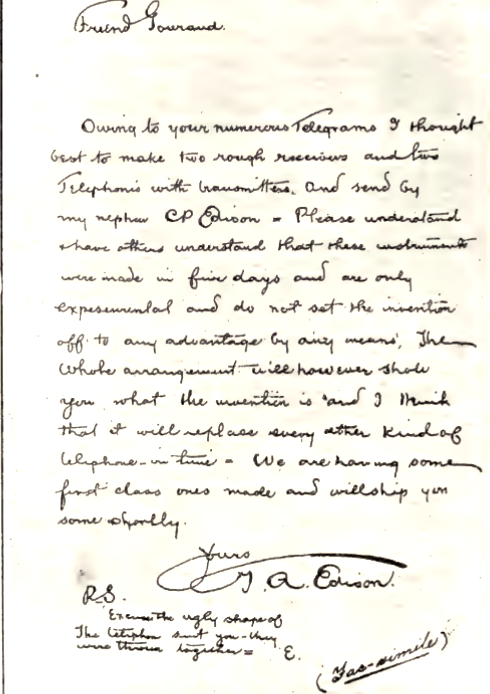 — Lettre d'Edison à Gouraud sur le récepteur à
haut-parleur.
— Lettre d'Edison à Gouraud sur le récepteur à
haut-parleur.
L'une des raisons de la hâte avec laquelle ces instruments furent
expédiés était la venue prochaine du professeur
Tyndall sur le thème de l'acoustique moderne. Ils furent présentés
pour la première fois en fonctionnement au 6, rue Lombard, le
14 mars 1879, et furent décrits dans le Times le 17.
Des descriptions plus détaillées parurent dans Nature
du 20 mars 1879 et Engineering du 21 mars.
Les illustrations des figures suivantes proviennent de ce dernier.
Pour concevoir cet instrument, Edison utilisa un principe
qu'il avait découvert quelques années auparavant.
Dans son brevet américain n°
221 957 daté du 25 novembre 1879, il déclare :
Le mécanisme particulier sur lequel repose cette invention
a été breveté par moi le 19 janvier 1875 et numéroté
158 787. J'ai également déposé une demande
d'application de ce procédé à la téléphonie
le 20 juillet 1877, n° 141, dans laquelle une bande de papier se
déplace sous un point relié au diaphragme. Cette caractéristique
n'est donc pas revendiquée de manière générale
ici. La présente demande porte plus particulièrement sur
des dispositifs qui rendent l'invention parfaitement utilisable dans
le commerce et la rendent fiable et efficace.
L'instrument produit dans un délai aussi court constituait donc
davantage un développement qu'une nouvelle invention.
Près de deux ans auparavant, il avait déposé une
demande de protection pour l'application de ce « procédé
particulier » à la téléphonie, mais uniquement
pour un téléphone musical doté d'un contact à
ouverture et fermeture analogue à celui de Reis. Pressé
de proposer un récepteur indépendant, Edison s'est rapidement
mis au travail pour finaliser l'instrument sous une forme pratique.
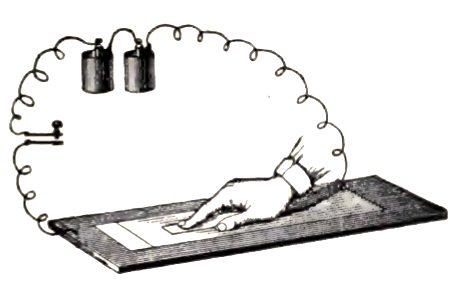 Le principe illustré
à la figure est le suivant : peut être brièvement
décrit :
Le principe illustré
à la figure est le suivant : peut être brièvement
décrit :
Edison a constaté qu'un stylet relié à l'un des
pôles d'une pile, tiré sur une bande de papier posée
sur une surface métallique, était soumis à l'effet
de frottement lorsque la touche faisant partie du circuit était
ouverte et qu'il en était exempt lorsque la touche était
fermée.
Il a appliqué ce principe de mouvement à distance comme
alternative à l'armature et au ressort d'un instrument télégraphique.
Son utilité était davantage liée à l'invention
et au brevet qu'à la pratique, de sorte que l'électro-motographe,
comme il l'appelait, était peu connu.
Lorsqu'un récepteur téléphonique basé sur
un nouveau principe fut nécessaire, Edison pensa naturellement
à l'électro-motographe.
Initialement inventé pour remplacer un électro-aimant
et son armature, il était désormais nécessaire
de le remplacer. Il fallait une certaine audace pour supposer que les
variations de frottement suivraient d'aussi près les infimes
variations d'un courant téléphonique. Mais un diaphragme
muni d'un bras fixé en son centre, un cylindre de craie rotatif
sur lequel le bras appuyait, et un circuit électrique assemblé
démontrèrent rapidement que l'instrument était
un récepteur téléphonique pratique.
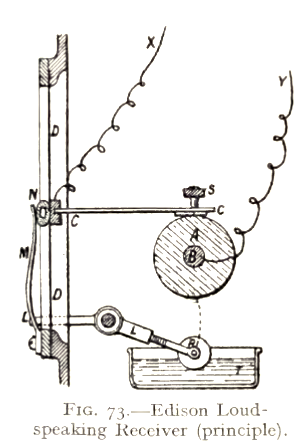
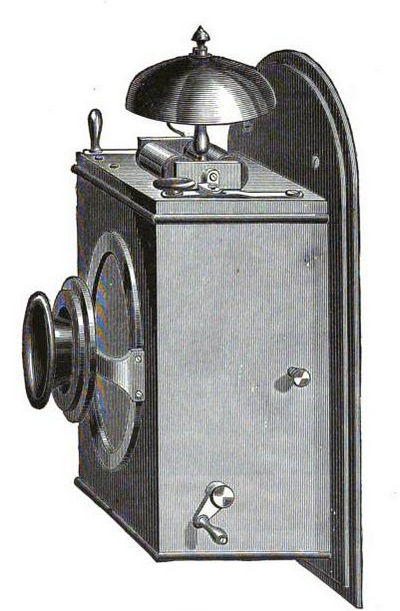

Edison Loud-speaking première forme. Photo version commerciale.
Dans sa version commerciale, l'instrument était de taille réduite
et fixé à un bras dépassant de l'émetteur
de manière à être placé face à l'oreille
du locuteur, comme le montre la photo, le nouveau récepteur d'Edison
parlait fort. Cela contribua à accroître l'émerveillement
populaire et fut considéré comme une vertu. Il constitua
l'un des principaux atouts pour attirer l'attention des capitalistes.
( mémorandum « privé et confidentiel intitulé
« Edison's Loud-speaking » )
Le téléphone perfectionné par M. Edison au cours
de cette année diffère radicalement de tous les instruments
antérieurs du même genre.
L'invention du professeur Graham Bell, jusqu'à présent
la plus répandue, comprend un aimant et une bobine, et le son
est transmis le long du fil, perdant une grande partie de son intensité
en chemin. Dans l'instrument de M. Edison, la voix est reproduite mécaniquement
au bout du fil, et l'orateur est entendu avec un volume sonore et une
netteté équivalents à ceux de sa voix originale.
Cette circulaire fut publiée durant l'été 1879,
et la suite témoigne de la surprise ressentie à Londres
face à la croissance alors réalisée des centraux
téléphoniques outre-Atlantique.
L'ampleur du développement de la téléphonie aux
États-Unis au cours des derniers mois est presque inconcevable.
Dans des villes aussi grandes que Chicago ou Philadelphie, ou aussi
petites que Wilmington, des centraux téléphoniques ont
été mis en place et ont été adoptés
à grande échelle.
Une ligne de démonstration a été installée
entre le 6 Lombard Street (bureau du colonel Gouraud) et les bureaux
de l'Equitable Insurance Company of the United States, à Princes
Street. Neuf autres lignes ont été ajoutées et
reliées à un standard téléphonique au 6
Lombard Street. Bien que de nature expérimentale, le central
ne disposant pas de capacités d'extension, il s'agissait du premier
central londonien équipé du système Edison.
Utilisé depuis un certain temps, il a été inauguré
publiquement en septembre 1879.
Le 6 du même mois, le Times a décrit le système,
soulignant que l'intercommunication téléphonique à
grande échelle était enfin devenue une réalité
dans la Cité de Londres. Les gares, ou plus précisément
les bureaux privés, reliés au central sont situées :
n° 1 dans Copthall Buildings [MM. Parrish],
n° 2 dans Old Broad Street [Pullman Car Association],
n° 3 dans Suffolk Lane [MM. Renshaw],
n° 4 dans Lombard Street [Colonel Gouraud],
n° 5 dans Princes Street [Equitable Insurance Company of United
States],
n° 6 dans Carey Street, Lincoln's Inn [MM. Waterhouse],
n° 7 dans Queen Victoria Street (les bureaux de la compagnie),
n° 8 dans George Yard, Lombard Street [MM. Kingsbury],
n° 9 dans Throgmorton Street [MM. Anderson],
le n° 10 étant notre propre établissement.
Dans un article de fond sur le sujet, le Times remarque :
Nous publions dans une autre chronique les extraordinaires nouvelles
utilisations que cette invention a permis d'accomplir. . . . Il n'y
a aucune limite
au nombre de points entre lesquels une communication peut être
établie, et il est presque impossible de les mettre en relation.
… Actuellement, il existe dix endroits privilégiés
où ce privilège peut être obtenu ; mais il pourrait
tout aussi bien y en avoir dix cents ou dix mille, et, sans aucun doute,
il y en aura d'autre bientôt.
Le central fut transféré au numéro 1 de la rue
Queen Victoria, et les abonnés furent raccordés au plus
vite. Une liste datée du 20 février 1880 contient 172
noms. En province, les compagnies Bell et Edison firent preuve d'une
grande activité pour installer des centraux.
La Compagnie du Téléphone, exploitant les brevets Bell,
a publié une circulaire , non datée, mais dont on pense
qu'elle date de septembre 1879 (une seconde édition est datée
du 10 novembre 1879). Elle stipule :
Un central téléphonique a été établi
dans la ville.
Chaque abonné dispose d'une ligne reliant sa résidence
ou son bureau, équipée des instruments nécessaires,
au bureau de la Compagnie du Téléphone. L'employé
du central répond au signal de l'abonné et établit
instantanément la connexion avec la ligne de toute autre personne
avec laquelle il souhaite communiquer. La conversation peut alors se
poursuivre facilement et en toute confidentialité, sans qu'aucun
tiers ne puisse entendre ce qui se dit.
Dans la troisième édition de la circulaire, datée
du 24 décembre 1879, « Un central téléphonique
» a évolué vers le pluriel : « Des centraux
téléphoniques ont été établis dans
la ville.» Environ 200 noms d'abonnés sont mentionnés
dans cette circulaire. Le premier central téléphonique
et les premiers bureaux de la Bell Company se trouvaient au 36 Coleman
Street, E.C.3.
Conservant le contrôle des centraux téléphoniques,
la Bell Company accorda, le 2 septembre 1879, une licence restreinte
à MM. Scott & Wollaston pour l'utilisation de téléphones
pour les lignes privées et les besoins domestiques. Gower
apporta une légère modification à l'appareil Bell,
jugée très avantageuse. Gower acquit la licence de Scott
& Wollaston et créa la Gower-Bell Telephone
Company.
Une circulaire publiée par cette société commençait
ainsi :
| Il existe, en gros, quatre catégories de
téléphones : 1. Le téléphone original du professeur Bell. 2. Le téléphone électrochimique de M. Edison. 3. Le téléphone Gower-Bell, conçu sur le principe du téléphone Bell, mais beaucoup plus performant. 4. Le téléphone à haut-parleur Gower-Bell, le plus récent et le plus performant des instruments, est la combinaison d'une forme spéciale de l'émetteur microphonique du professeur Hughes, F.R.S., avec le téléphone Gower-Bell comme récepteur; et formule les critiques suivantes à l'égard de ses concurrents : Le téléphone Bell, invention originale et magnifique du professeur Graham Bell, et fondement du système téléphonique, produit des sons très faibles comparés à l'instrument spécial de cette société ; son utilisation commerciale est donc déconseillée. Le téléphone électrochimique Edison peut difficilement être considéré comme un instrument pratique. Son utilisation a été totalement abandonnée aux États-Unis et sur le continent, et les autorités américaines ne parviennent pas à le faire fonctionner de manière satisfaisante. |
La Gower-Bell
Company fut ensuite absorbée par la Consolidated
Telephone Construction and Maintenance Company, une entreprise
manufacturière qui, à la recherche de nouveaux marchés,
introduisit une nouvelle concurrence d'origine anglaise dans certains
pays étrangers.
Sous les auspices de cette société fut créée
la River Plate Telephone and Electric Light Company,
avec une centrale à Buenos Aires, et, en collaboration avec Edison,
des centrales furent établies à Vienne, Lisbonne et Porto.
La concurrence entre Bell et Edison aux États-Unis fut rompue
grâce au vaste brevet obtenu par Bell.
Un accord avait été conclu car la Western Union Company
reconnaissait l'étendue et la validité du brevet initial
de Bell, qui couvrait toutes les méthodes possibles de transmission
électrique de la parole. Les brevets britanniques n'étaient
pas aussi étendus. Bell contrôlait le téléphone
à magnéto, à l'exception du diaphragme à
membrane, qui était exempt de son brevet en raison d'une publication
antérieure dans l'English Mechanic, et Edison contrôlait
l'émetteur à charbon.
La Edison Company, ayant poursuivi ses travaux expérimentaux
préliminaires devint indépendante des brevets de Bell
sur la production de l'électro-motographe. La Bell Company, en
revanche, risquait d'être attaquée par la Edison Company
en raison de l'utilisation de l'émetteur Blake.
Mais aucune attaque définitive ne fut lancée sur la base
des brevets. Commençant sérieusement leurs travaux des
centres d'échange à peu près à la même
époque (septembre 1879), ils poursuivirent leurs entreprises
respectives avec toute l'énergie que produit la rivalité
et démontrèrent rapidement qu'ils fournissaient un service
d'une grande utilité publique. Un ennemi commun est l'aide matérielle
aux alliances, et pour les compagnies téléphoniques britanniques
en 1880, l'ennemi commun était le gouvernement.
Il convient toutefois de souligner ici que l'action du gouvernement
facilita la fusion des intérêts de Bell et d'Edison, et
ne nécessita plus la séparation de l'émetteur à
charbon et du récepteur magnétique, qui semblaient se
compléter naturellement. Même si l'on peut admirer l'ingéniosité
qui a permis de produire le récepteur électro-motographe
au moment où il était requis, et même si l'on peut
reconnaître l'ingéniosité commerciale avec laquelle
ses caractéristiques de haut-parleur ont été recommandées
au public, il est évident qu'en tant qu'instrument pratique,
il était bien inférieur au modèle Bell. Pour le
faire fonctionner, il fallait tourner continuellement une manivelle
à la main. Le volume sonore, dans un usage courant, était
non seulement inutile, mais constituait un inconvénient certain.
Il serait inexact d'affirmer que les intérêts d'Edison
l'aient reconnu, mais l'adoption du récepteur Bell fut recommandée
aux directeurs de la United Company par l'ingénieur d'Edison
(E. H. Johnson) dans un rapport daté du 3 juin 1880, en raison
de la plus grande simplicité d'utilisation de l'appareil.
Voici un extrait de ce rapport : SIMPLICITÉ DE L'APPAREIL
| Il s'agit d'une question d'une importance vitale,
car le téléphone, contrairement à tous les
autres appareils de communication à distance, tels que les
différents systèmes télégraphiques,
est si simple qu'il ne requiert aucune compétence particulière. Or, le grand public étant notoirement incapable de comprendre les opérations mécaniques les plus simples, cette simplicité doit être préservée. Toute complication mécanique supplémentaire limite disproportionnellement le nombre de personnes capables de manipuler l'appareil. Il est vain de chercher à « éduquer le public » au respect des « règles et règlements ». Ceux-ci ne peuvent être imposés qu'aux employés. Compte tenu de ces faits, il est, à mon avis, essentiel pour effectuer la signalisation, la commutation, etc., nécessaires que ces opérations soient réduites à l'action purement automatique consistant à prendre le téléphone en main et à le poser (ou, plus précisément, à le raccrocher). Ni l'inintelligence, ni l'oubli, ni la compréhension imparfaite des règles ne peuvent empêcher l'accomplissement d'un acte aussi simple. Pour obtenir ce degré de simplicité, j'ai été contraint de sacrifier les qualités supérieures du récepteur électro-motographe de M. Edison à la performance supérieure du récepteur magnéto du professeur Bell. Ceci apparaîtra plus clairement en citant quelques opérations effectuées automatiquement par le mouvement d'un crochet sur lequel le téléphone portable est décroché lorsqu'il est utilisé et sur lequel il est posé lorsqu'il n'est pas utilisé. |
Les observations introductives de M. Johnson méritent
d'être soulignées.
Elles témoignent d'une appréciation précoce du
travail qui peut être utilement imposé à l'abonné,
mais sa référence aux « qualités supérieures »
du récepteur électro-motographe et à la « performance
supérieure » du récepteur magnéto en
tant qu'instrument indépendant est moins acceptable.
La loyauté de l'entourage d'Edison envers son chef a été
attestée par M. George Bernard Shaw, employé
pendant un temps par la Edison Telephone Company de Londres, et décrit
dans une liste du personnel comme « Directeur de sortie ».
(« Vous ne devez pas croire, parce que je suis un homme
de lettres, que je n'ai jamais cherché à gagner honnêtement
ma vie. J'ai commencé à tenter ce péché
contre nature à l'âge de quinze ans et j'ai persévéré,
malgré ma timidité et ma méfiance juvéniles,
jusqu'à vingt-trois ans. Ma dernière tentative remonte
à 1879, lorsqu'une société fut créée
à Londres pour exploiter une invention ingénieuse de M. Thomas
Alva Edison – une invention bien plus ingénieuse, comme
elle le prouva, n'étant rien de moins qu'un téléphone
d'une efficacité si fulgurante qu'il beuglait vos communications
les plus privées dans toute la maison au lieu de les chuchoter
avec une certaine discrétion. Ce n'était pas ce que souhaitait
le courtier britannique, aussi la société fut-elle rapidement
intégrée à la National [United] Telephone Company,
après s'être fait une place dans l'histoire de la littérature,
tout à fait involontairement, en me fournissant un emploi. »
Tant que la compagnie de téléphone Edison subsista, elle
encombra le sous-sol d'un immense ensemble de bureaux de Queen Victoria
Street d'artisans américains… Ils adoraient M. Edison, le
considérant comme le plus grand homme de tous les temps dans
tous les domaines possibles de la science, de l'art et de la philosophie,
et exécraient M. Graham Bell, l'inventeur du téléphone
rival, le considérant comme son adversaire satanique ; mais
chacun d'eux possédait (ou prétendait posséder),
sur le point d'être achevé, une amélioration du
téléphone, généralement un nouvel émetteur.
(Le Nœud irrationnel, de George Bernard Shaw),
On peut excuser la phraséologie de M. Johnson, la considérant
comme une dissimulation, mais alors, comme aujourd'hui, le récepteur
Bell possédait des « qualités supérieures »
ainsi qu'une « aptitude supérieure ».
Le prospectus de la United Telephone
Company fut publié le 8 juin 1880, avec un capital de 500 000 £,
dont 200 000 £ en actions attribuées à
la Bell Company et 115 000 £ en actions à la
Edison Company. Dans le prospectus, il était indiqué :
Le réseau téléphonique de ce pays n'a pas encore
été suffisamment développé, en partie à
cause de la position antagoniste des sociétés Bell et
Edison. Une situation similaire existait en Amérique jusqu'à
l'union de ces deux intérêts. Il faut donc s'attendre à
ce que le système téléphonique progresse rapidement
dans ce pays, comme c'est déjà le cas aux États-Unis.
Il convient de mentionner l'argument de la Poste, selon lequel son monopole,
conféré par les lois sur le télégraphe,
s'étend au réseau téléphonique, et une action
en justice est actuellement en cours pour régler cette question.
Les administrateurs sont informés que cette action n'aboutira
pas. L'activité téléphonique privée de la
compagnie ne pouvait être affectée par les lois sur les
postes, et ce service doit payer pour le droit d'utiliser à des
fins lucratives les instruments protégés par les brevets
de la compagnie.
La United Telephone Company exploitait elle-même le réseau
londonien et créait des filiales pour exploiter les centraux
provinciaux sous licence.
En France, le téléphone suscita, dès ses débuts,
un vif intérêt chez les scientifiques.
Après l'Amérique du Nord et l'Angleterre jusqu'en 1910 le téléphone se développe en Europe et dans le monde entier.
Les Français furent les seuls gouvernements
à reconnaître un caractère national.
Napoléon exprima sa reconnaissance de la valeur de la recherche
scientifique et du développement artistique en déclarant
que les sciences qui honorent l'entendement humain, les arts qui embellissent
la vie et transmettent les grandes actions à la postérité,
devaient être spécialement soutenus par un gouvernement
indépendant.
En 1802, alors Premier Consul, il fonda le prix Volta
« pour encourager celui qui, par ses expériences et ses
découvertes, fera progresser l'électricité et le
galvanisme à un rythme comparable à celui réalisé
dans ces sciences par Franklin et Volta ».
Ce prix, initialement d'une valeur de 60 000 francs, porté
à 50 000 francs lors de sa réactivation par Napoléon
III, et maintenu ainsi sous la République, fut décerné
à Bell en reconnaissance de son invention du téléphone.
Le premier prix Volta fut décerné à Ruhmkorff en
1864 pour la bobine d'induction, le suivant à Bell, qui fut également
fait officier de la Légion d'honneur. L'Université de
Heidelberg lui conféra le titre honorifique de docteur en médecine,
en reconnaissance de l'utilisation du téléphone en chirurgie.
En 1902, la Society of Arts de Londres lui décerna la médaille
Albert, et en 1913, la Royal Society lui conféra la médaille
Hughes.
(Un legs fut fait à la Royal Society par feu le professeur David
Edward Hughes, dont les revenus devaient être attribués
chaque année, soit en argent, soit sous forme de médaille,
ou en partie l'un et en partie l'autre, pour)
Mais si la valeur scientifique du téléphone était
hautement louée et que le public avait une vague idée
de ses grandes potentialités, son utilité commerciale
n'était pas pleinement reconnue, et certains indices laissaient
même penser qu'il pourrait s'agir d'un simple jouet scientifique.
En France, comme en Angleterre, le gouvernement
s'empara du secteur téléphonique dès que les travaux
pionniers furent réalisés par des particuliers.
Du Moncel fut l'un des premiers en Europe
à rédiger un traité à ce sujet. Traduit
en anglais, il devint pendant un temps l'ouvrage de référence.
Bien que publié en 1879, il ne contient aucune référence
au système de centraux.
Plus tard, alors que les centraux et les lignes interurbaines connaissaient
des progrès rapides, c'est dans la littérature française
qu'il faut également chercher leurs premières traces.
Brault,
à Paris, publia, à la même époque (1888),
son Histoire de la téléphonie et de l'exploitation des
téléphones en France et à l'étranger, où
les aspects industriels occupaient une place prépondérante.
Son ouvrage était alors unique en son genre dans son analyse
des progrès mondiaux et constitue aujourd'hui une référence
précieuse.
Sur le plan pratique, Ader apporta une
modification à l'instrument Bell et, que ce soit en raison de
cette modification ou d'une amélioration de fabrication, son
récepteur fut très apprécié sur les marchés
européens. Il produisit également un émetteur s'inspirant
étroitement de la forme du crayon de charbon du microphone de
Hughes, l'un des meilleurs du genre.
Tandis que les scientifiques s'intéressaient au téléphone
en tant qu'instrument, en France comme ailleurs en Europe, le système
d'échange fut développé sous l'égide des
États-Unis.
La rivalité entre Bell et Edison s'étendit à Paris,
mais Gower les devança dans une
certaine mesure et obtint la première concession, qui s'appliquait
à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Nantes.
Les intérêts de Bell reçurent une concession pour
Paris uniquement, tandis que ceux d'Edison eurent la chance de couvrir
les mêmes villes que Gower.
Toutes ces concessions furent regroupées au sein de la Société
Générale des Téléphones le 10
décembre 1880 et, à l'exception de Paris et de Lyon, ce
n'est qu'après cette date que les centres d'échanges commencèrent.
En 1889, le gouvernement confisqua pratiquement le réseau parisien
et, après neuf ans de litiges, versa cinq millions de francs
à ses propriétaires. Avec ces débuts insouciants,
le gouvernement sombra dans la désolation. Il rassembla l'ensemble
le plus complet des erreurs commises par d'autres nations et en inventa
plusieurs. Presque tous les maux connus de la bureaucratie furent mis
au point. Le système tarifaire fut bouleversé ; Le
tarif forfaitaire, qui ne peut être appliqué avec profit
que dans les petites villes, a été appliqué dans
les grandes villes, et le tarif des messages, applicable uniquement
aux grandes villes, a été appliqué dans les petites
localités. Les opératrices étaient empêtrées
dans un labyrinthe de règles de la fonction publique. Elles n'avaient
pas le droit de se marier sans l'autorisation du directeur général
des Postes ; et elles ne pouvaient en aucun cas oser épouser
un maire, un policier, un caissier ou un étranger, de peur de
trahir les secrets du standard.
Mais le gouvernement tire un bénéfice net de trois millions
de dollars par an de son monopole téléphonique ;
et jusqu'en 1910, date de la nomination d'un comité d'amélioration,
il ne se soucia guère du désagrément du public.
Paris reçut une leçon marquante en matière d'efficacité
téléphonique en 1908, lorsque son central téléphonique
principal fut totalement détruit par un incendie. « Construire
un nouveau standard téléphonique », disaient
les fabricants européens, « prendra quatre ou cinq
mois.»
Un jeune Chicagoan dynamique fit son apparition. « Nous installerons
un nouveau standard en soixante jours », dit-il, « et
nous accepterons de payer six cents dollars par jour de retard.»
Jamais un travail aussi rapide n'avait été réalisé.
Mais c'était l'occasion pour Chicago de montrer ce dont elle
était capable. Paris et Chicago sont à quatre mille cinq
cents milles l'une de l'autre, soit douze jours de voyage. Le standard
devait mesurer cent quatre-vingts pieds de long et comporter dix mille
fils. Pourtant, la Western Electric l'a terminé en trois semaines.
Il a été transporté à New York par six wagons
de marchandises, chargé sur le paquebot français La Provence
et déposé à Paris en trente-six jours ; de
sorte qu'à l'expiration des soixante jours, il fonctionnait à
plein régime avec une équipe de quatre-vingt-dix opérateurs.
En Belgique, il existe un système gouvernemental depuis
1893 ; il y a donc unité, mais pas d'entreprise. L'installation
est vétuste et trop petite. L'Espagne compte des entreprises
privées qui offrent un service de qualité à vingt
mille personnes. La Roumanie en compte deux fois moins.
En Allemagne, Reis avait mené
des expériences et construit un appareil qu'il appelait un téléphone,
ce qui suffisait à permettre aux Allemands patriotes de se sentir
propriétaires de l'invention.
Le 4 octobre 1877, von Stephan, directeur des Télégraphes,
écrivit à Bismarck qu'il avait établi une communication
entre son bureau de Berlin et la banlieue de Friederichsburg. Il laissa
également entendre qu'il envisageait immédiatement une
application pratique de la nouvelle invention au sein du service télégraphique
impérial, proposant la connexion téléphonique des
bureaux de poste de campagne auxquels le service télégraphique
n'avait pas encore été étendu. À la fin
de 1877, quinze villages étaient ainsi reliés au réseau
télégraphique général. Le système
de central de Berlin ne fut inauguré que le 1er avril 1881. En
Allemagne, le fardeau bureaucratique était le même qu'au
Royaume Unis, mais avec moins de soutien. Il existe un monopole gouvernemental
total. Quiconque commet le délit de louer un service téléphonique
à ses voisins est passible de six mois de prison. Là encore,
le ministre des Postes a exercé une domination absolue. Il a
imposé le secteur du téléphone au modèle
postal. Le patriotisme n'est pas un atout fiable pour l'investigation
des affirmations scientifiques, mais bien qu'infructueux et oubliés,
L'habitant d'une petite ville doit payer un tarif aussi élevé
pour un service modeste que celui d'une grande ville pour un service
important. L'efficacité est satisfaisante, mais pas de vitesse
ni de record.
Les ingénieurs allemands n'ont pas suivi de près les progrès
de la téléphonie aux États-Unis. Ils ont préféré
concevoir leurs propres méthodes et ont ainsi créé
un assortiment hétéroclite de systèmes, bons, mauvais
et indifférents. 1910 Au total, l'investissement s'élève
probablement à soixante-quinze millions de dollars et le nombre
total de téléphones est estimé à neuf cent
mille.
La téléphonie a toujours été très
prisée par le Kaiser. Il a pour habitude, lorsqu'il organise
une soirée de chasse, de faire installer un fil spécial
jusqu'au quartier général de la forêt, afin de pouvoir
converser chaque matin avec son cabinet. Il a décerné
des diplômes et des distinctions par téléphone.
Même son ancien chancelier, von Bülow, a reçu son
titre de comte de cette manière informelle. Mais le premier partisan
du téléphone en Allemagne fut Bismarck. Le vieil Unificateur
comprit immédiatement son utilité pour maintenir l'unité
nationale et commanda une ligne reliant son palais de Berlin à
sa ferme de Varzin, distantes de trois cent trente kilomètres.
Dès l'automne 1877, il s'agissait de la première ligne
longue distance d'Europe.
En Suisse Wietlisbach, avait écrit sur la téléphonie
industrielle, mais principalement avec une application technique.
Le premier central fut celui de Zurich, exploité grâce
à une concession accordée à un groupe d'hommes
d'affaires associés à la Compagnie Internationale de Téléphone
Bell le 24 juillet 1880.
En 1881, des centraux furent ouverts à Genève, Lausanne
et Winterthur par le gouvernement, qui racheta également peu
après le central de Zurich. Quatorze centraux étaient
en service à la fin de 1883, et le double un an plus tard.
Dans la petite Suisse, l'État a été propriétaire
dès le début, mais avec moins de préjudice pour
l'économie qu'ailleurs. Ici, les autorités ont même
délaissé le télégraphe au profit du téléphone.
Elles ont compris l'importance du fil électrique pour maintenir
la cohésion de leurs villages de vallée ; elles ont
ainsi sillonné les Alpes avec un système téléphonique
bon marché et quelque peu fragile, qui transmet soixante millions
de conversations par an. Même les moines de Saint-Bernard, qui
portent secours aux voyageurs bloqués par la neige, ont désormais
équipé leur montagne de cabines téléphoniques.
Le téléphone le plus haut du monde se trouve au sommet
du Mont Rose, dans les Alpes italiennes, à près de cinq
kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Il est relié
à une ligne qui va jusqu'à Rome, afin qu'une reine puisse
parler à un professeur. Dans ce cas, la reine est Marguerite
d'Italie et le professeur est Signor Mosso, l'astronome qui étudie
le ciel depuis un observatoire du Mont Rose. À ses frais, la
reine a fait tendre ce fil par une équipe de monteurs, qui ont
glissé et pataugé sur la montagne pendant six ans avant
de le fixer.
En Belgique Les premières expériences eurent lieu
en 1878. Une société fut créée à
Bruxelles en 1879, et d'autres suivirent.
La concurrence étant jugée insuffisante, les différentes
sociétés furent encouragées à fusionner.
La Compagnie Beige du Téléphone Bell a été
fondée en 1882. Cette société était la filiale
belge de l'International Bell Telephone Company de New York.
Aux Pays-Bas Une société a été créée
sous le nom de Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij en 1881.
La principale particularité des Pays-Bas est qu'il n'existe pas
de plan national, mais plutôt un patchwork, semblable au manteau
multicolore de Joseph. Chaque ingénieur municipal a conçu
son propre type d'appareil et l'a fait fabriquer sur mesure. De plus,
chaque entreprise est légalement délimitée dans
un périmètre de dix kilomètres, de sorte que la
Hollande est parsemée de systèmes de clous à aiguille,
tous différents les uns des autres.
En Autriche, le premier central téléphonique a
été établi à Vienne en 1881 par la Vienna
Private Telephone Company, mais son exploitation a été
poursuivie par une société sous les auspices du consortium
Edison-Gower Bell, représentée par la Consolidated Telephone
Construction and Maintenance Company de Londres.
En Italie, La situation générale en Italie est
similaire à celle de la Grande-Bretagne.
Le gouvernement a toujours monopolisé les lignes longue distance
et s'apprête à racheter toutes les entreprises privées.
Il n'y a que cinquante-cinq mille téléphones pour trente-deux
millions d'habitants, soit autant qu'en Norvège et moins qu'au
Danemark. Et dans de nombreuses provinces du sud et de Sicile, le tintement
de la cloche du téléphone est encore un son inhabituel.
L'International Bell Telephone Company a établi des centraux
à Milan, Turin et Gênes, et des centraux dans une douzaine
d'autres grandes villes ont été créés en
1881 par d'autres groupes sous les auspices d'un groupe de financiers
parisiens.
La Grèce, la Serbie et la Bulgarie comptent à peine
deux mille téléphones chacune.
La petite île glacée d'Islande en compte un quart.
En Turquie, qui était une terre interdite
sous le régime de l'ancien sultan, les Jeunes Turcs importent
des téléphones et des bobines de fil de cuivre.
En Espagne Divers intérêts tentèrent d'introduire
le téléphone , jusqu'à ce que la concession espagnole
devienne un symbole parmi les candidats à la concession. En 1885,
des centraux furent ouverts à Madrid, Barcelone et Valence.
Au Portugal, une concession fut obtenue et des centraux furent
mis en service par la Compagnie anglo-portugaise du téléphone,
sous les auspices des intérêts Edison-Gower Bell mentionnés
précédemment. Le central de Lisbonne fut inauguré
le 2 juillet 1881, et celui de Porto en 1883.
Le Portugal compte deux petites entreprises à Lisbonne et Porto.
En Inde, le développement fut entrepris par la Compagnie
orientale du téléphone, avec l'ouverture en janvier 1882
de centraux à Calcutta, Rangoon, Madras, Bombay et Colombo.
En Égypte La Compagnie de Téléphone (filiale
de la Compagnie Orientale) a établi des centraux au Caire et
à Alexandrie en 1880.
En République argentine, il existait trois sources d'entreprises
téléphoniques : l'une d'origine locale, avec un appareil
belge, le Pan-Telephone, introduit par M. Fels, une autre par la Tropical
American Telephone Company, et une troisième par la River Plate
Telephone and Electric Light Company, créée par la Consolidated
Telephone Construction and Maintenance Company. Les centraux de la Pan-Telephone
Company locale et de la Tropical American Company ont été
regroupés sous le nom de United River Plate Telephone Company,
qui a ensuite repris les intérêts de la Consolidated Company
pour former la United Telephone
Company of the River Plate, qui est aujourd'hui l'une des plus importantes
sociétés étrangères sous gestion britannique.
En Australie L'introduction du téléphone s'est
faite grâce aux brevets Edison. Début 1880, M. F. R. Welles,
de la Western Electric Manufacturing Company, quitta New York pour l'Australie
et, en collaboration avec une entreprise locale – MM. Masters &
Draper – fonda la Melbourne Telephone Exchange Company, qui connut
un essor rapide.
Les efforts pour obtenir des concessions dans les autres colonies d'Australasie
furent moins fructueux, mais l'attention des gouvernements locaux ayant
été attirée sur les avantages du système
de central téléphonique, ces derniers établirent
peu après leurs propres centraux, tout comme le gouvernement
néo-zélandais.
La bourse de Melbourne et celles établies ultérieurement
à Ballarat et Sandhurst, après avoir été
rachetées par le gouvernement, furent reprises par celui-ci le
22 septembre 1887. On comptait alors 1 019 abonnés aux bourses
de la compagnie, dont 752 à Melbourne. L'Annuaire victorien 1887-8,
d'où proviennent ces chiffres, indique qu'« une bourse
a également été ouverte à Geelong, avec
la garantie qu'au moins quarante personnes s'y abonnent. »
La Russie et l'Autriche-Hongrie possèdaient environ cent vingt-cinq mille téléphones chacune. Elles sont au coude à coude dans une course qui n'a jamais été aussi rapide. Dans chaque pays, le gouvernement a été une marraine négligente du téléphone. Il a affamé le secteur par manque de capitaux et n'a déployé aucune initiative pour le développer. En dehors de Vienne, Budapest, Saint-Pétersbourg et Moscou, il n'existe aucun réseau de lignes téléphoniques d'importance. L'impasse politique entre l'Autriche et la Hongrie anéantit tout espoir immédiat d'une vie plus heureuse pour le téléphone dans ces pays ; mais en Russie, un changement de politique récent pourrait ouvrir une nouvelle ère. Des permis sont désormais offerts à une entreprise privée dans chaque ville, en échange de 3 % des recettes. La Russie a ainsi pris une avance inattendue et est désormais, pour les professionnels du téléphone, le pays le plus libre d'Europe !.
L'International Bell Telephone Company a également
été à l'origine de l'introduction du téléphone
en Norvège et en Suède.
En 1880, des franchises furent obtenues pour Christiania et Drammen,
et en 1881, des échanges furent établis par la Compagnie
Internationale Bell à Stockholm, Göteborg et Malmö,
mais à Saint-Pétersbourg (ou Petrograd) et Moscou seulement
en 1883.
Parmi les premiers centraux, on peut citer Honolulu (1880), Rio de Janeiro (1881) et La Valette, à Malte (1883).
Il existe un pays d'Europe de l'Est, et un seul, qui
a adopté l'esprit du téléphone : la Suède.
La téléphonie y a connu un essor fulgurant. La Poste l'a
laissée de côté ; et mieux encore, elle a été
portée par un homme, un bâtisseur d'entreprise d'une force
et d'un talent remarquables, nommé Henry Cedergren. Si
cet homme avait été nommé maître du téléphone
en Europe, l'histoire aurait été différente. Par
son engagement incessant, il a fait de Stockholm la ville la mieux desservie
par le téléphone en dehors des États-Unis. Il a
propulsé son pays vers le sommet, jusqu'à ce qu'avec cent
soixante-cinq mille téléphones, il se classe quatrième
parmi les nations européennes. Depuis sa mort, le gouvernement
a adopté un système dupliqué, et une guerre a été
déclenchée, chaque année plus coûteuse et
absurde.
L'Asie, avec ses huit cent cinquante millions
d'habitants, compte encore moins de téléphones que Philadelphie,
et les trois quarts d'entre eux se trouvent sur la minuscule île
du Japon.
Dès le début, les Japonais étaient des téléphonistes
enthousiastes. Ils disposaient d'un central téléphonique
très fréquenté à Tokyo en 1883. Celui-ci
compte aujourd'hui vingt-cinq mille utilisateurs, et pourrait en compter
davantage s'il n'avait pas été freiné par la politique
particulière du gouvernement. Les fonctionnaires qui gèrent
le système sont compétents. Ils pratiquent un prix équitable
et réalisent dix pour cent de bénéfices pour l'État.
Mais ils ne parviennent pas à répondre à la demande.
L'une des plus étranges aberrations de la propriété
publique est qu'il existe aujourd'hui à Tokyo une liste d'attente
de huit mille citoyens qui proposent de payer pour un téléphone
et ne peuvent l'obtenir. Et lorsqu'un Tokien décède, sa
franchise téléphonique, s'il en possède un, est
généralement prévue dans son testament comme un
bien de quatre cents dollars.
L'Inde, deuxième sur la liste asiatique, ne compte pas
plus de neuf mille téléphones, soit un pour trente-trois
mille habitants ! En réalité, ce n'est pas autant
que cinq gratte-ciel de New York.
Les Indes orientales néerlandaises et la Chine n'en possèdent
que sept mille chacune, mais la Chine a récemment pris
des mesures.
Un fonds de vingt millions de dollars doit être consacré
à la construction d'un système national de téléphone
et de télégraphe. Pékin montre maintenant avec
émerveillement et joie un nouveau central impeccable, doté
de deux centraux de dix mille fils. D'autres sont en construction à
Canton, Hankou et Tien-Tsin. À terme, le téléphone
prospérera en Chine, comme il l'a fait dans le quartier chinois
de San Francisco. Après le siège de Pékin, l'impératrice
de Chine ordonna qu'un téléphone soit accroché
dans son palais, à portée de son trône de dragon ;
Elle était très amicale avec tout représentant
du secteur des « Sons Éclairs Parlants »,
terme chinois pour la téléphonie.
En Perse, le téléphone a récemment fait
son apparition, comme un véritable opéra-comique. Un nouveau
Shah, dans un élan de confiance, a installé une ligne
téléphonique entre son palais et la place du marché
de Téhéran, et a invité son peuple à lui
parler chaque fois qu'il avait des griefs. Et ils ont parlé !
Ils ont parlé si librement et ont tenu un langage si libre que
le Shah a ordonné à ses soldats de sortir et de les attaquer.
Il tira sur le nouveau Parlement et fut aussitôt chassé
de Perse par le peuple en colère.
Il en résulte que le téléphone devrait être
populaire en Perse, bien qu'à l'heure actuelle, il n'y en ait
pas plus de vingt en service.
L'Amérique du Sud, en dehors de Buenos Aires, compte peu
de téléphones, probablement pas plus de trente mille.
Dom Pedro du Brésil, qui s'était lié d'amitié
avec Bel lors du Centenaire, introduisit la téléphonie
dans son pays en 1881 ; mais elle n'a pas réussi à
atteindre dix mille utilisateurs en trente ans.
Le Canada en compte exactement autant que la Suède :
cent soixante-cinq mille téléphones.
Le Mexique en compte peut-être dix mille ; la
Nouvelle-Zélande, vingt-six mille ; et l'Australie,
cinquante-cinq mille.
L'Afrique se trouve tout en bas de la liste des continents.
L'Égypte et l'Algérie comptent douze mille téléphones
au nord ; l'Afrique du Sud britannique en compte autant au sud ;
Et dans les vastes étendues qui les séparent, il n'y en
a guère plus d'un millier.
Quiconque s'aventure en Afrique centrale entendra encore le battement
du tambour de bois, qui est le langage gestuel claquant des indigènes.
Un fil de cuivre traverse la région du Congo, posé là
sur ordre de l'ancien roi de Belgique. Le tendre fut probablement l'œuvre
la plus audacieuse de l'histoire des poseurs de lignes téléphoniques.
Il y avait un tronçon de 1 130 kilomètres dans la
jungle centrale.
Des fourmis blanches mangeaient les poteaux de bois, et des éléphants
sauvages arrachaient les poteaux de fer. Des singes jouaient à
chat perché sur les lignes, et des sauvages volaient le fil pour
en faire des pointes de flèches. Mais la ligne a été
prolongée et, aujourd'hui, elle est animée de conversations
sur le caoutchouc et l'ivoire.
On peut donc presque dire du téléphone qu'« il
n'y a ni parole ni langage où sa voix ne soit entendue ».
On compte même mille milles de lignes en Abyssinie et cent
cinquante milles aux îles Fidji.
En 1910 en gros, on compte dix millions de téléphones
dans tous les pays, employant deux cent cinquante mille personnes, nécessitant
vingt et un millions de kilomètres de lignes, représentant
un coût de mille cinq cents millions de dollars et assurant quatorze
milliards de conversations par an. Et pourtant,
les hommes qui ont entendu le premier cri du téléphone
naissant sont encore vivants et loin d'être vieux.
Aucun pays étranger n'a atteint le niveau élevé
de téléphonie américain.
Les États-Unis comptent huit téléphones pour cent
habitants, tandis qu'aucun autre pays n'en compte la moitié.
Le Canada arrive en deuxième position, avec près de quatre
pour cent, et la Suède en troisième. L'Allemagne compte
autant de téléphones que l'État de New York et
la Grande-Bretagne autant que l'Ohio. Chicago en compte plus que Londres
et Boston deux fois plus que Paris.
Dans toute l'Europe, avec ses vingt nations, on compte un tiers de téléphones
de moins qu'aux États-Unis.
Proportionnellement à sa population, l'Europe n'en compte qu'un
treizième. Les États-Unis écrivent deux fois moins
de lettres que l'Europe, envoient un tiers de télégrammes
et parlent deux fois plus au téléphone. La famille européenne
moyenne envoie trois télégrammes par an, trois lettres
et un message téléphonique par semaine ; tandis que
la famille américaine moyenne envoie cinq télégrammes
par an, sept lettres et onze messages téléphoniques par
semaine. Cette nation, qui possède six pour cent de la planète
et représente cinq pour cent de l'humanité, possède
soixante-dix pour cent des téléphones. Et cinquante pour
cent, soit la moitié de la téléphonie mondiale,
est désormais intégrée au système Bell de
ce pays.
Seules six nations européennes se distinguent : les
Allemands, les Britanniques, les Suédois, les Danois, les Norvégiens
et les Suisses.
Les autres possèdent moins d'un téléphone pour
cent. Le Petit Danemark en possède plus que l'Autriche. La Petite
Finlande offre un meilleur service que la France. Les téléphones
belges ont coûté le plus cher : deux cent soixante-treize
dollars pièce ; et les téléphones finlandais
le moins cher : quatre-vingt-un dollars. Mais un téléphone
en Belgique rapporte trois fois plus qu'en Norvège. En général,
la leçon à tirer en Europe est la suivante : le téléphone
est ce qu'une nation en fabrique. Son utilité dépend du
sens et de l'esprit d'entreprise avec lesquels il est utilisé.
Il peut être un atout précieux ou une nuisance. Trop de
gouvernement ! C'est la principale raison de l'échec de
la plupart des pays.
Avant l'invention du téléphone, le télégraphe
était devenu un monopole d'État et était considéré
comme une sorte de télégraphe.
Les fonctionnaires ne voyaient pas qu'un système téléphonique
constituait un problème technique extrêmement complexe,
comparable à une fabrique de pianos ou à une aciérie.
Ainsi, chaque fois qu'un groupe de citoyens mettait en place un service
téléphonique, les fonctionnaires le regardaient avec jalousie
et le retiraient généralement. Le téléphone
est ainsi devenu une partie intégrante du télégraphe,
qui fait partie intégrante de la poste, qui fait partie intégrante
du gouvernement. Il n'est qu'une fraction d'une fraction d'une fraction,
un simple fragment de la bureaucratie. Dans de telles conditions, le
téléphone ne pouvait prospérer. Le plus étonnant
est qu'il ait survécu.
Géré selon le modèle américain, le téléphone
à l'étranger pourrait atteindre les niveaux américains.
Il n'y a aucune raison raciale à l'échec. La lenteur du
service et les ratés sont les conséquences naturelles
du traitement du téléphone comme s'il s'agissait d'une
route ou d'une caserne de pompiers. Toute nation qui adopte une conception
judicieuse du téléphone, qui ose le confier à des
personnes compétentes et le renforcer avec des capitaux suffisants,
peut s'assurer un service aussi réactif et rapide que son cœur
le souhaite.
Certains pays sont déjà sur la bonne voie. La Chine, le
Japon et la France ont envoyé des délégations à
New York, « la Mecque des téléphonistes »,
pour apprendre l'art de la téléphonie à son apogée.
Même la Russie a sauvé le téléphone des mains
de ses bureaucrates et l'offre désormais gratuitement aux entrepreneurs.
Dans la plupart des pays étrangers, le service téléphonique
s'accélère progressivement. L'engouement pour la téléphonie
« bon marché et peu pratique » s'estompe ;
et l'idée que le téléphone est avant tout un instrument
de rapidité gagne du terrain. Un service longue distance plus
rapide, à des tarifs doublés, est très prisé.
Les races lentes apprennent la valeur du temps, première leçon
de la téléphonie. Nos faucheuses circulent désormais
dans soixante-quinze pays. Nos tramways circulent dans toutes les grandes
villes. Le Maroc importe nos montres à un dollar ; la Corée
découvre le gaspillage que représente le fait de laisser
neuf hommes creuser avec une seule bêche. Et tout cela se traduit
par des téléphones.
En trente ans, Western Electric a vendu pour soixante-sept millions
de dollars d'appareils téléphoniques à l'étranger.
Mais ce n'est qu'un début. Installer un téléphone
pour cent personnes en Chine représenterait une dépense
de trois cents millions de dollars.
Doter l'Europe d'un équipement aussi performant que celui dont
disposent actuellement les États-Unis nécessiterait trente
millions de téléphones, avec des câbles et des standards
téléphoniques adaptés. Et si la téléphonie
pour tous n'est pas encore une question d'actualité dans de nombreux
pays, tôt ou tard, dans l'élan incessant de la civilisation,
elle devra arriver.
Peut-être, dans cet avenir lointain de paix et de bonne volonté
entre les nations, où chaque pays fera pour tous les autres ce
qu'il sait faire de mieux, les États-Unis seront-ils généralement
reconnus comme la source de compétences et d'autorité
en matière de téléphonie. Ils pourraient être
appelés à reconstruire ou à exploiter les systèmes
téléphoniques d'autres pays, de la même manière
qu'ils fournissent actuellement du pétrole, de l'acier, des rails
et des machines agricoles. De même qu'aujourd'hui, l'acheteur
avisé demande du champagne à la France, des jouets à
l'Allemagne, des cotonnades à l'Angleterre et des tapis à
l'Orient, il apprendra à considérer les États-Unis
comme le berceau naturel du téléphone.
APTITUDE ET APPRÉCIATION DU PUBLIC
Les diverses sociétés créées pour établir
des centraux téléphoniques
en Europe et à l'étranger fondaient leurs espoirs de succès
sur les résultats obtenus aux États-Unis. Elles pouvaient
mettre en avant des faits avérés démontrant la
grande utilité d'un tel service.
Aux États-Unis, le public était généralement
extrêmement sceptique quant à son adoption généralisée,
et même ceux qui en pressentaient les grands avantages pour le
public n'étaient pas disposés à se laisser trop
d'illusions.
Le système télégraphique de district a joué
un rôle important dans le développement du réseau,
car il permettait de démontrer des connexions interchangeables
entre quelques abonnés avec peu de travail ou d'investissement.
Les lignes étaient déjà en place, avec des cabines
téléphoniques connectées. Le raccordement des appareils
téléphoniques était relativement simple.
En Europe, il n'existait pas de système télégraphique
de district ; le central téléphonique a été
adopté dans sa forme complète, et par conséquent,
des travaux de construction coûteux ont été nécessaires
pour permettre la démonstration de son utilité.
Mais les pionniers des deux côtés de l'Atlantique n'ont
pas hésité et ont fourni le capital nécessaire
pour permettre à leurs entreprises de franchir les premières
étapes et de les propulser vers des carrières couronnées
de succès.
L'apathie du public aux États-Unis était aussi prononcée
qu'en Europe. L'appréciation fut plus précoce, mais seulement
grâce à la démonstration. Diverses causes ont été
avancées pour expliquer cette adoption plus précoce et
ce développement plus rapide aux États-Unis.
Sans les examiner en détail ni contester les nombreux arguments
qui les ont fondés, une explication suffisante peut être
trouvée dans la confiance et le dynamisme commercial des exploiteurs,
ainsi que dans les conditions économiques du moment.
Les grandes distances séparant les villes américaines
et les retards consécutifs aux communications postales ont contribué
à la généralisation du télégraphe
pour les communications qui auraient été acheminées
par la poste en Europe.
Il est également douteux qu'à l'époque de l'introduction
du téléphone, le service télégraphique local
était aussi bon marché ou aussi répandu aux États-Unis
qu'en Grande-Bretagne.
Ainsi, le téléphone relativement local (comme il l'était
à son introduction) a complété le télégraphe
longue distance et a remplacé le service de messagerie de district
strictement local. Le coût élevé de la main-d'œuvre
aux États-Unis, comparé à celui de l'Europe, incitait
naturellement à adopter plus facilement tout expédient
permettant d'économiser du temps ou de la main-d'œuvre.
Le faible coût de la main-d'œuvre et du service télégraphique
expliquait pourquoi le système de central téléphonique
risquait de connaître un succès moindre en Grande-Bretagne
qu'aux États-Unis.
En 1879, la Chambre des communes nomma une commission spéciale
chargée d'examiner certaines questions relatives à l'éclairage
électrique.
Le 2 mai, Lord Lindsay demanda à Sir William Preece :
Quant à la question de l'induction, vous avez évoqué
l'utilisation du téléphone dans toutes vos recherches
sur ce sujet ; il s'agit, bien sûr, d'un instrument de test
extrêmement délicat ; mais pensez-vous que le téléphone
sera un instrument d'avenir largement adopté par le public ?
Je ne le pense pas. Il n'occupera pas la même place dans ce pays
qu'en Amérique ? J'imagine que les descriptions que nous
recevons de son utilisation en Amérique sont un peu exagérées ;
mais certaines conditions en Amérique nécessitent davantage
l'utilisation d'instruments de ce type qu'ici.
Nous avons ici une surabondance de messagers, de coursiers et autres
personnes de ce genre.
En Amérique, on en a besoin, et l'un des aspects les plus frappants
pour un Anglais est de constater comment les Américains ont adopté
chez eux des sonnettes d'appel, des télégraphes, des téléphones
et toutes sortes d'accessoires domestiques, imposés par la nécessité.
La question de Lord Lindsay a été intercalée dans
une enquête sur un autre sujet, et la réponse de Sir William
Preece peut donc être considérée comme n'ayant pas
été soigneusement pesée. Cependant, elle reprend
certainement, en termes très similaires, les remarques qu'il
avait formulées quelques jours plus tôt (le 23 avril) lors
d'une discussion à la Society of Telegraph Engineers sur un article
de M. Scott intitulé « Récentes améliorations
apportées aux téléphones du professeur Bell ».
Ces « améliorations » étaient celles
de Gower.
M. Scott s'était plaint du retard pris dans l'adoption du téléphone
en Angleterre par rapport aux États-Unis. À ce propos,
Sir William Preece a déclaré :
Le téléphone a été largement utilisé
dans ce pays, mais il ne semble pas y avoir autant de pénurie
en Angleterre qu'en Amérique. Ce qui frappe en Amérique,
c'est l'ampleur considérable de son application.
À Chicago, où l'on reçoit entre 7 000 et 8 000
appels par jour, il n'y a pratiquement aucune maison qui ne possède
dans son hall une sonnette d'appel permettant d'envoyer un message à
un médecin, un portier ou tout autre besoin. La raison pour laquelle
ils y sont contraints est que, la nécessité étant
mère d'invention, cela remplace les domestiques. Ici, nous n'avons
aucune difficulté à trouver des domestiques si nous les
payons, mais la difficulté en Amérique est de trouver
des « boutons » à n'importe quel prix,
comme en Angleterre. Résultat : l'absence de domestiques
a, dans une certaine mesure, contraint les Américains à
adopter ce système de télégraphie pour leurs besoins
domestiques.
Le téléphone est présent dans presque tous les
foyers, seul substitut disponible à l'ancien système.
Peu de gens ont travaillé au téléphone autant que
moi.
J'en ai un dans mon bureau, mais surtout pour la vitrine, car je ne
l'utilise pas, car je n'en ai pas besoin. Si je veux envoyer pour transmettre
un message à une autre pièce, j'utilise un sondeur ou
j'engage un garçon pour le prendre ; et je ne doute pas
que ce soit le cas pour beaucoup d'autres, et c'est probablement la
raison pour laquelle le téléphone n'a pas été
davantage adopté ici.
L'efficacité de cet instrument en Angleterre a été
sérieusement compromise par ces redoutables effets d'induction,
moins ressentis en Amérique, car ils ne disposent pas de longues
lignes souterraines et n'utilisent pas cet appareil à grande
vitesse qui produit un vrombissement si puissant chez nous. Il est impossible,
avec soixante fils dans une canalisation souterraine, de parler au téléphone,
tant les effets d'induction sont importants.
Ces observations peuvent donc être considérées comme
l'expression d'une idée alors répandue en Angleterre,
une idée qui a probablement aussi gouverné l'action ou
l'inaction des autorités.
Peu d'hommes ont fait plus que feu Sir William Preece
pour populariser le téléphone ou pour exprimer une plus
grande appréciation de ses beautés en tant qu'instrument
scientifique. Il était fier d'avoir apporté la première
paire de Bell. Il a perfectionné les caractères en Angleterre.
À la Royal Society, à la British Association et lors d'autres
réunions, il a donné des conférences sur le téléphone
et sur les recherches qu'il avait menées avec ses associés.
Hughes lui a transmis ses premières
idées sur le microphone. Sir William Preece peut être considéré
comme un passionné du téléphone, et il était
électricien au ministère qui contrôlait les télégraphes.
Le ministère a refusé d'acheter le brevet de Bell, et
il a été accusé de myopie et les Anglais en général
d'arriération.
Mais, en refusant ainsi, le gouvernement qui contrôlait les télégraphes
en Angleterre ne se comportait en rien différemment de la société
qui contrôlait la majeure partie des télégraphes
aux États-Unis, bien que l'opinion de cette dernière ait
changé avant 1879.
Dans les deux cas, l'incapacité à anticiper les résultats
réels peut être attribuée à une trop longue
familiarité avec le mot « message ». Les
télégraphistes envoyaient des messages et tenaient à
les transmettre le plus rapidement possible. C'est pour transmettre
des messages aux villages que von Stephan a d'abord perçu l'utilité
du téléphone, mais sans cela, le téléphone
n'aurait probablement pas séduit un télégraphiste
comme moyen de transmission idéal. Il existait des appareils
permettant d'envoyer plus de mots en une minute et de laisser une trace.
On aurait pu s'attendre à ce que le gain de temps résultant
de la livraison directe du message au destinataire soit évident,
mais le facteur temps dans la transmission des messages avait été
soigneusement étudié, et on considérait probablement
que ce gain ne serait pas suffisamment attractif pour le public au point
de justifier l'espoir qu'il paierait massivement les frais d'installation
des lignes.
La véritable différence entre ceux qui prévoyaient
de grands résultats pour le téléphone et ceux qui
étaient disposés à comparer les coûts et
les différences de conditions locales résidait dans le
mot « message ».
Le téléphone rendait possible ce qui était auparavant
considéré comme impossible : la conversation à
distance. Les questions et les réponses étaient immédiates
et spontanées ; le sens des mots était accentué
par l'inflexion et l'emphase. Le « message » n'était
pas comparable à cela. Il faut comparer l'alphabet des sourds-muets
à la parole complète, libre et éloquente. Le téléphone
rapprochait les personnes éloignées avec tous les avantages
d'une conversation rapprochée que permettait l'audibilité.
Ces avantages n'étaient pas à mettre en balance avec le
coût des messagers, même si le temps a montré que
le téléphone a néanmoins permis une économie,
ainsi qu'une révolution.
Après coup, on ne s'étonne pas que quiconque ayant participé
à une conversation téléphonique ait pu douter du
succès commercial du téléphone. Avoir pu converser
par téléphone avant que cela ne soit connu du grand public
était une expérience qui doit être considérée
comme un privilège.
Le sentiment dominant était celui de la crainte et de l'émerveillement,
tempéré par l'incrédulité. Lorsque les circonstances
ne laissaient planer aucun doute quant à la distance réelle
de l'orateur, la transmission claire de ses paroles, la preuve par une
réponse rapide qu'il avait entendu aussi clairement les mots
que vous aviez vous-même prononcés, produisaient l'impression
accablante qu'il s'agissait d'un instrument destiné à
être d'une valeur inestimable pour le public et qui devait procurer
un profit proportionnel à ses initiateurs.
L'apathie du public comme des autorités cédait la place
à l'appréciation partout où des échanges
étaient établis.
Commençant aux États-Unis en 1878, « dans des
villes aussi grandes que Chicago ou Philadelphie ou aussi petites que
Wilmington » — comme l'expliquait le prospectus « Memorandum »
de la London Edison Company —, puis s'étendant à
Londres en 1879, en 1881 ou 1882, des centraux téléphoniques
furent établis dans les principales villes d'Europe, en Inde,
en Amérique du Sud, sur l'ancienne terre des pharaons, et dans
la ville moderne d'Australasie qui tire son nom de Lord Melbourne, premier
Premier ministre de la reine Victoria.
Ces centraux progressèrent si rapidement qu'ils grevèrent
les ressources des propriétaires, et leur croissance fit surgir
de nouveaux problèmes exigeant un traitement scientifique de
pointe et introduisant une nouvelle branche de l'ingénierie.