Origines du central téléphonique urbain
Téléphomanie : Les origines controversées
de la compagnie d’exploitation téléphonique urbaine
aux États-Unis, 1879-1894
Ouvrage de Richard John professeur associé d'histoire
à la faculté des arts libéraux et des sciences
de l'Université de l'Illinois à Chicago.
Richard R. John est un historien spécialisé dans l'histoire
des affaires, des technologies, des communications et du développement
politique américain.
Cet essai revient sur les origines du central téléphonique
urbain aux États-Unis, à l’époque formatrice
de la téléphonie commerciale, de 1879 à 1894. Cette
période a marqué le début et la fin d’une
époque marquante.
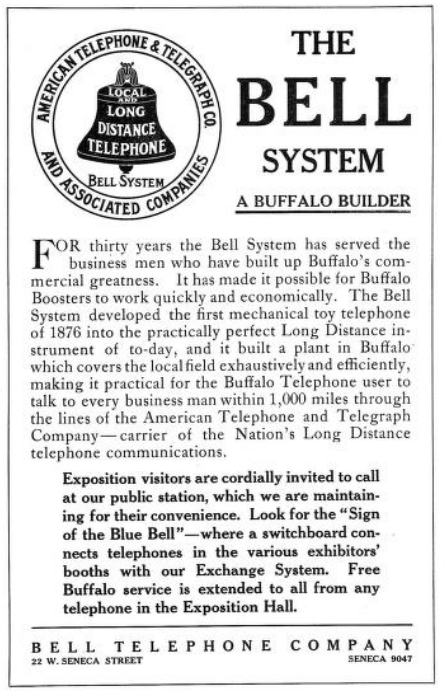
En 1879, les investisseurs bostoniens, qui avaient acquis la
propriété des brevets téléphoniques d’Alexander
Graham Bell, ont négocié avec succès un accord
avec le géant du télégraphe Western
Union pour se partager le marché des communications électriques.
Dès lors, Western Union se spécialiserait dans la télégraphie ;
les investisseurs bostoniens, dans la téléphonie.
En 1894, le deuxième des deux brevets téléphoniques
fondamentaux de Bell a expiré, ouvrant le marché téléphonique
à la concurrence.
Cet essai est divisé en trois parties.
- La première section passe en revue les écrits historiques
récents sur l'ère formatrice de la téléphonie
américaine et souligne dans quelle mesure deux traditions historiographiques
– appelées ici « triomphalisme » et
« révisionnisme » – sont parvenues
à des conclusions similaires concernant les premiers centraux
téléphoniques urbains.
- La deuxième section explore quatre des défis opérationnels
les plus redoutables auxquels les gestionnaires de téléphonie
ont été confrontés : l'acquisition des droits
de passage ; la prévention d'une législation tarifaire
hostile ; l'acheminement des appels téléphoniques ;
et l'interconnexion des opérateurs. À l'exception de l'acheminement,
qui était avant tout une question technique et organisationnelle,
chacun de ces défis avait une dimension politique.
- La troisième section examine comment la compréhension
de l'ère formatrice de la téléphonie commerciale
influence notre compréhension des télécommunications
américaines.
sommaire
Les origines du central téléphonique urbain ont été
doublement contestées.
De toute évidence, il a été le théâtre
d'une incertitude, de tensions et de protestations populaires considérables
(qu'un gestionnaire de téléphonie a qualifiées
de « téléphomanie »).
De plus, son ancrage dans un contexte politique et culturel particulier
a été oublié, voire réprimé. La redécouverte
de ce contexte remet en question les explications conventionnelles de
l'essor des réseaux de communication, devenus omniprésents
dans la modernité.
Les études les plus récentes sur
la commercialisation de la téléphonie aux États-Unis
à son époque de formation (1878-1920) s'inscrivent dans
deux traditions.
- La première célèbre le caractère innovant
de l'American Telegraph and Telephone Company
(AT&T) et la qualifie d'entreprise socialement responsable et techniquement
innovante.
- La seconde critique AT&T pour avoir entravé l'innovation
et ralenti la popularisation de ce nouveau moyen de communication.
La première de ces traditions peut être qualifiée
de triomphaliste dans le sens où elle considère l'industrie
de la téléphonie comme une vision de ceux qui allaient
prendre les rênes du pouvoir chez AT&T. AT&T a été
fondée en 1885 en tant que filiale à 100 % d'American
Bell, la holding détentrice des brevets téléphoniques
d'Alexander Graham Bell.
Pour renforcer leur identification à l'inventeur, les triomphalistes
font souvent remonter les origines d'AT&T à American Bell.
Entre 1885 et 1900, AT&T était un fournisseur de services
longue distance, un service bien moins important à l'époque
qu'il ne l'est devenu depuis. AT&T devint un acteur dominant du
secteur téléphonique en 1900, lorsque, par un tour de
passe-passe juridique, elle devint la société holding
de la constellation d'opérateurs téléphoniques
détenteurs de licences de brevets de Bell, et qui allait être
connue sous le nom de « Système Bell ».
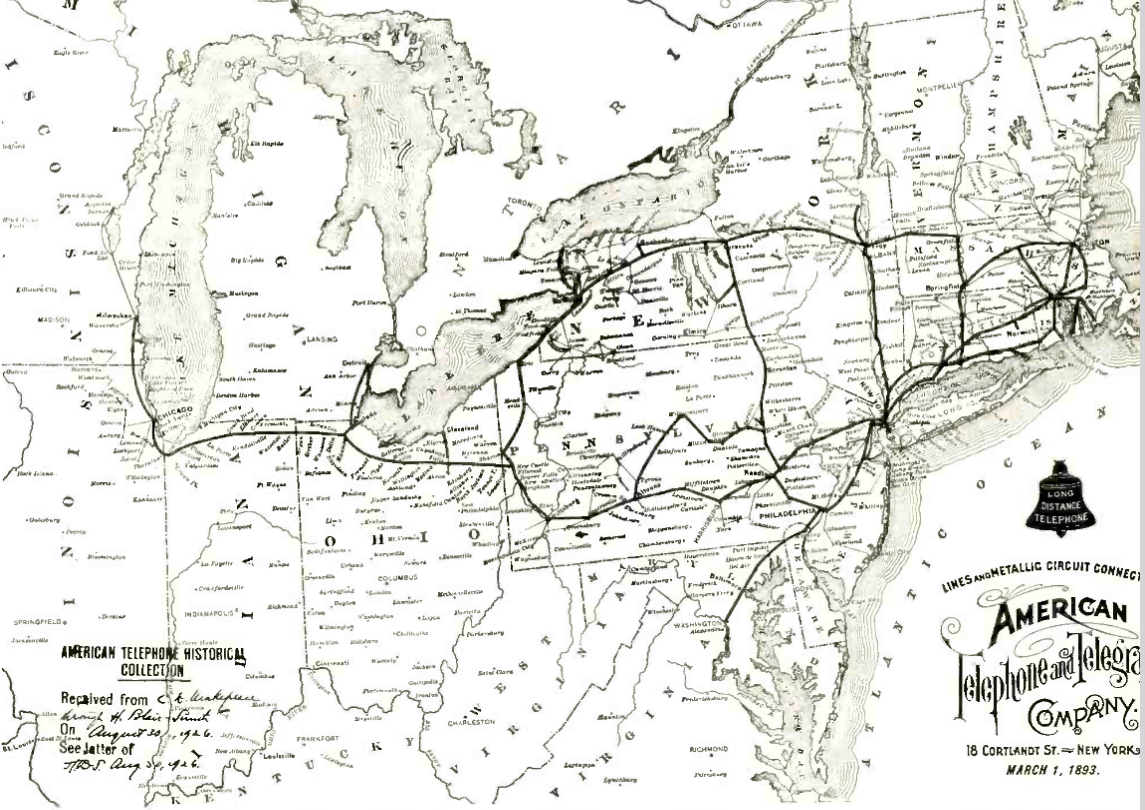 1893
1893
Si les triomphalistes n'ignoraient en aucun cas les opérateurs,
ils en étaient rarement la principale préoccupation. Ils
concentrèrent plutôt leur attention sur la création
par AT&T d'un réseau longue distance, l'établissement
par Western Electric (fournisseur d'équipements d'American
Bell, puis d'AT&T) de normes d'exploitation uniformes, et
l'émergence au sein d'AT&T d'un laboratoire de recherche
et développement (qui acquit une identité distincte en
1925 sous le nom de Bell Labs) chargé de concevoir des solutions
innovantes à des problèmes tels que la transmission téléphonique
longue distance. Deux innovations conçues par les ingénieurs
d'AT&T figurent en bonne place dans presque tous les récits
triomphalistes : le tube à vide de l'UIC Great Cities Institute,
déployé par les ingénieurs d'AT&T en 1915 pour
rendre possible la téléphonie transcontinentale, et le
transistor, inventé par les ingénieurs des Bell Labs en
1948 pour améliorer la commutation téléphonique.
Le triomphalisme d'AT&T frisait souvent l'hagiographie, et on comprend
aisément pourquoi.
À son apogée au milieu du XXe siècle, AT&T
était non seulement admirée pour sa tradition de responsabilité
sociale et d'innovation technique, mais aussi l'un des plus grands regroupements
de capital et de main-d'œuvre au monde. En 1981 encore, AT&T
comptait plus d'actifs (138 milliards de dollars) et d'employés
(1,04 million) que toute autre entreprise aux États-Unis. Qu'AT&T
possédât également le plus grand et le plus important
portefeuille d'opérateurs téléphoniques aux États-Unis
semblait presque hors de propos, même si ce portefeuille expliquait
en grande partie son énorme taille.
En 1984, les triomphalistes d'AT&T subirent ce qui, rétrospectivement,
se révélera être un revers fatal lorsqu'un juge
fédéral ordonna le démantèlement du Bell
System. Le démantèlement de ce qui avait été
l'une des plus grandes organisations du monde témoigna de la
détermination du pouvoir judiciaire à subordonner même
les plus grandes agrégations de capitaux à la discipline
du marché. Pour les triomphalistes d'AT&T, en revanche, ce
fut un désastre monumental, qu'ils qualifièrent –
comme le proclamaient les titres de deux livres sur le démantèlement
– soit de « Mauvais Numéro » soit
de « Viol de 'Ma Bell' ». Hubbard et Vail
avaient un « remarquable historique de prescience ».
Pour H. M. Boettinger, planificateur de la politique
d'AT&T, écrivant la même année, l'héritage
durable de la première génération était
parfaitement illustré par le sous-titre de son histoire de l'industrie :
« Bell, Watson, Vail et la vie américaine, 1876-1976. ».
Les triomphalistes d'AT&T ont largement relayé
les prédictions des premiers promoteurs du téléphone
selon lesquelles, à un moment donné, un réseau
téléphonique relierait tous les foyers des États-Unis.
Les termes mêmes de la charte initiale d'AT&T de 1885, qui
définissait son mandat comme la fourniture de services de téléphonie
longue distance non seulement en Amérique du Nord, mais aussi
dans le « reste du monde connu », semblaient préfigurer,
de manière presque providentielle, la suite des événements.
Parmi les déclarations les plus souvent citées, on trouve
la prédiction confiante de Bell à un groupe d'investisseurs
anglais en mars 1878, soit trois mois seulement après l'établissement
du premier central téléphonique à New Haven, dans
le Connecticut, selon laquelle le « résultat ultime »
de la commercialisation du téléphone serait la création
d'un réseau qui « réunirait les sièges sociaux
de la compagnie de téléphone dans différentes villes
», afin qu'« un habitant d'une région du pays puisse
communiquer oralement avec un habitant éloigné ».
Bien que la prédiction de Bell puisse paraître prosaïque
aujourd'hui, il convient de rappeler qu'en 1878, la portée pratique
du service téléphonique n'était que de trente kilomètres.
Alors qu'en 1941 encore, 98 % des appels téléphoniques
aux États-Unis avaient lieu à l'intérieur des frontières
d'un seul État.
Les triomphalistes d'AT&T se souviennent principalement de Bell
comme du visionnaire qui a légué son invention à
succès à un monde reconnaissant. À juste titre,
l'un des premiers chercheurs extérieurs à qui les dirigeants
d'AT&T ont autorisé l'accès à leurs archives
d'entreprise tant vantées était un biographe de l'inventeur
du téléphone. Ce biographe était l'éminent
professeur d'histoire de l'Université de Boston, Robert
V. Bruce ; la biographie de Bell par Bruce a été
publiée en 1973.
Bell a vécu suffisamment longtemps pour participer au premier
appel téléphonique transcontinental en 1915 – un
pseudo-événement, qualifié par les publicitaires
d'AT&T de « cérémonie d'appel », qui a
été habilement exploité par sa formidable machine
publicitaire. En réalité, le fondateur éponyme
d'« American Bell» et du «
Bell System » n'a joué aucun
rôle dans l'organisation d'AT&T et avait la propension résolument
troublante à faire des déclarations publiques qui, si
elles avaient attiré l'attention du public, ce qui n'a généralement
pas été le cas, auraient pu faire grincer des dents les
dirigeants de Bell. Par exemple, en 1884, Bell informa allègrement
un journaliste d'un journal new-yorkais que les compagnies de téléphone
devaient enterrer leurs lignes, mais qu'elles « ne le feront jamais,
je le crains, tant que la loi ne les y obligera pas ».
Hubbard posa aux triomphalistes d'AT&T un défi d'interprétation
encore plus grand.
Hubbard fut incontestablement l'un des fondateurs de l'empire du téléphone
qui allait finalement être dominé par AT&T. Hubbard
obtint de Bell ses brevets téléphoniques, détenait
un important bloc d'actions téléphoniques et conçut
la stratégie commerciale de location (plutôt que de vente)
de téléphones. (voir histoire bell
)
Pourtant, Hubbard ne bénéficiait pas de la confiance des
investisseurs bostoniens qui prirent en charge les brevets de Bell en
1878 – il entretenait une relation particulièrement difficile
avec le président d'American Bell,
William H.Forbes – et se heurta à plusieurs reprises
au cours des années suivantes aux dirigeants d'American Bell
au sujet de leur traitement des sociétés exploitantes.
L'ampleur du conflit entre Hubbard et American Bell resta cachée
dans les archives d'AT&T, loin de Point de vue. Pourtant, des indices
ont émergé dans la biographie de Bell par Bruce, ainsi
que dans l'hommage d'Arthur Pier à Forbes. Il était donc
logique pour les triomphalistes d'AT&T de faire disparaître
Hubbard au plus vite et de souligner ses nombreuses actions philanthropiques,
comme son rôle clé dans la fondation de la National Geographic
Society.
La querelle entre Hubbard et American Bell mérite qu'on s'y attarde
un instant, ne serait-ce que pour mettre en lumière un aspect
de l'histoire du téléphone à ses débuts
que les triomphalistes d'AT&T ont presque entièrement refoulé.
C'est à ce point que même l'un des fondateurs incontestés
de l'industrie téléphonique de l'UIC
Great Cities Institute estimait qu'American Bell imposait
des restrictions injustifiées aux sociétés exploitantes,
ce qui ralentissait la commercialisation de la nouvelle technologie
et exacerbait le ressentiment qui ne manquerait pas de susciter une
opposition une fois les brevets fondamentaux de Bell expirés
(ce qui, comme chacun le savait, arriverait en 1893 et 1894).
Car Pour que les sociétés d'exploitation prospèrent,
Hubbard a fait une leçon à Forbes en 1884 : elles devaient
appartenir à des investisseurs locaux, plutôt qu'à
American Bell. Les tarifs actuels étaient trop élevés
– le « roc » sur lequel le géant du télégraphe
Western Union a failli s'effondrer.
| Parenthèse :Le Great Cities Institute (GCI) est un pôle de recherche pour les universitaires, les décideurs politiques et les parties prenantes qui partagent la même volonté de répondre à la question : « Que peuvent faire les villes et les régions pour devenir des lieux de vie exceptionnels ? » Grâce à la recherche engagée, le GCI espère répondre à cette question en favorisant le dialogue sur des enjeux clés entre chercheurs locaux, nationaux et internationaux, en facilitant la collaboration et l'engagement du public, et en réalisant des évaluations et des analyses d'impact des politiques. Les travaux du GCI portent sur l'emploi et le développement économique, la gouvernance locale et régionale, la dynamique de la mobilité mondiale, l'énergie et l'environnement, et le bien-être des communautés. Le GCI développe des partenariats stratégiques qui s'appuient sur le capital intellectuel de l'université et sur les connaissances locales des habitants des quartiers, des organismes gouvernementaux et à but non lucratif, des fondations, des entreprises et des organisations civiques... |
Hubbard redoubla ses critiques à l'encontre d'American Bell après la validation, en mars 1888, des brevets téléphoniques fondamentaux d'Alexander Graham Bell par la Cour suprême. Bien que les triomphalistes d'AT&T considèrent souvent cette décision comme une justification de la stratégie commerciale d'American Bell, Hubbard ne la considérait pas comme telle.
La réaction peu flatteuse de la presse à la décision de justice – Hubbard expliqua à un dirigeant d'American Bell peu après la confirmation des droits de brevet de Bell – « montre clairement notre impopularité » : et tant que les tarifs téléphoniques resteraient trop élevés, « ces critiques du public, dont la presse est le porte-parole, seraient justifiées ».
Le péché le plus impardonnable de Hubbard – du moins aux yeux des triomphalistes d'AT&T – résidait dans ses doutes quant aux possibilités commerciales de la téléphonie longue distance.
En 1889, Hubbard rappela à John Hudson, successeur de Forbes, que la grande majorité du trafic téléphonique resterait, dans un avenir prévisible, régional plutôt que national, tout comme pour la distribution du courrier et la télégraphie, où les trois quarts du trafic reliaient les centres commerciaux et leur arrière-pays dans un périmètre de 160 kilomètres. Le scepticisme de Hubbard à l'égard de la téléphonie longue distance explique en partie son soutien enthousiaste à la proposition du ministre des Postes John Wanamaker d'établir, au sein du ministère des Postes, une grille tarifaire qui ferait du téléphone un relais du réseau télégraphique longue distance. Une telle innovation, assura-t-il à Hudson en 1890, « assurerait notre succès pour de nombreuses années ». Comme tant de dirigeants des premières heures du téléphone, Hubbard resta convaincu jusqu'à sa mort (en 1897) que la téléphonie longue distance compléterait, sans pour autant supplanter, la télégraphie, qu'il avait passé près de trente ans à tenter de réformer.
Si les triomphalistes d'AT&T avaient de bonnes raisons de se méfier de Bell et Hubbard, ils ne trouvaient rien à redire à la longue carrière téléphonique du premier président d'AT&T, Theodore N. Vail.
L'idéalisation – et, en fait, presque la déification – de Vail est un thème triomphaliste récurrent. Vail était, déclarait Alvin von Auw, dirigeant d'AT&T, en 1983, dans un long livre de lamentations sur le système Bell bientôt démantelé, non seulement « l'inventeur » du système Bell, mais aussi « l'un des deux ou trois plus grands génies organisateurs de l'histoire de l'industrie américaine ». Pour Boettinger, les superlatifs semblaient presque hors de propos. Plus proche d'un « grand artiste » que d'un « bureaucrate froid et professionnel », Vail avait maîtrisé l'« art » de la gestion pour concrétiser une vision « personnelle » – l'idée que « chaque personne devrait avoir accès à un téléphone » et que tous les téléphones devraient être reliés entre eux : « Les aspects intellectuels et humains de son grand projet demeurent la structure fondamentale des télécommunications de nos jours. » Malgré le « climat anti-technologique » actuel (Boettinger écrivait à la fin des années 1970), il considérait la politique téléphonique comme « bienveillante » et attribuait cette « issue heureuse » à « la vision humaine du service universel » de Vail.
Deux aspects de la longue carrière téléphonique de Vail ont particulièrement marqué les triomphalistes.
Le premier était son soutien enthousiaste à la construction d'un réseau téléphonique longue distance lors de son premier mandat à la présidence d'AT&T (1885-1887).
Le second était sa vision d'expansion, lors de son second mandat (1907-1910), d'un réseau de télécommunications dédié au « service universel ».
1 - Les triomphalistes considéraient souvent le soutien de Vail aux communications longue distance comme sa principale contribution à la commercialisation de la téléphonie avant l'expiration des brevets de Bell en 1894.
Ces récits s'attardaient sur la célèbre querelle de Vail en 1887 avec les investisseurs de Boston :
Vail était favorable à un service étendu ; les investisseurs à des dividendes plus élevés. Devant le refus des investisseurs, Vail démissionna, refusant, selon Boettinger, de « compromettre l'idéal le plus profond de sa vie ».
Ces récits, ainsi que les études universitaires les plus récentes sur Vail, occultent sa décision de conserver la présidence de la Metropolitan Telephone Company, basée à New York, titulaire de la licence Bell à Manhattan et plus grande compagnie téléphonique au monde. Vail resta à la Metropolitan jusqu'en 1889, où il supervisa l'installation de canalisations souterraines pour le quartier central des affaires de la ville, une réalisation impressionnante, dûment commémorée par des journalistes populaires dans les années 1910, mais que les spécialistes plus récents d'AT&T ignorent presque systématiquement.
2 - La deuxième réalisation de Vail saluée par les triomphalistes fut son soutien, lors de son second mandat à la présidence d'AT&T (1907-1919), au « service universel ». Bien que la signification précise de « service universel » reste quelque peu floue (ce qui n'est guère surprenant, compte tenu de son caractère intrinsèquement abstrait), les triomphalistes l'associent non seulement à l'interconnexion des centraux téléphoniques existants, mais aussi à la popularisation du service téléphonique. Le départ de Vail d'AT&T en 1887, affirment-ils, marqua le début d'une période malheureuse dans l'histoire d'AT&T, marquée par le conservatisme, la concurrence et, finalement, une crise financière potentiellement paralysante.
Ce n'est qu'au retour de Vail en 1907 que la situation s'améliorera. Ces récits ne font aucune mention de l'ampleur de la popularisation de la téléphonie entre les deux mandats de Vail à la présidence d'AT&T. Bien que la popularisation de la téléphonie ait eu lieu dans tout le pays, ce processus n'avait jamais progressé aussi rapidement que dans les grands centres urbains comme New York, où elle avait été accélérée par les changements que Vail avait lui-même supervisés auparavant.
La critique révisionniste d'AT&T était, d'une certaine manière, le reflet de la célébration des triomphalistes. Tout ce que les triomphalistes louaient, les révisionnistes l'attaquaient. Ce faisant, ils négligeaient eux aussi le central téléphonique urbain entre 1878 et 1894.
Bien plus importants, du point de vue des révisionnistes, furent les nombreux développements qui suivirent l'expiration des brevets téléphoniques d'Alexander Graham Bell. Aucun consensus ne s'est dégagé quant aux développements les plus fondamentaux après 1894.
Certains ont souligné la concurrence à laquelle les titulaires de licences Bell étaient confrontés de la part d'entreprises exploitantes non Bell (appelées « indépendantes ») ; D'autres ont évoqué une vision plus large des possibilités de la téléphonie favorisées par la concurrence. D'autres encore ont souligné le rôle des consommateurs dans la réinvention du service téléphonique comme moyen de communication populaire. Tous partageaient l'hypothèse selon laquelle peu d'innovations fondamentales avaient eu lieu avant 1894, à l'exception évidente de l'avènement de la téléphonie longue distance et de l'invention du téléphone lui-même. À l'instar des triomphalistes, ils tenaient pour acquis que les principaux leaders du secteur avant 1894 étaient les investisseurs basés à Boston qui dominaient American Bell et, après 1885, AT&T.
Contrairement aux triomphalistes, ils qualifiaient la stratégie commerciale des leaders du téléphone de très conservatrice (axée sur le contrôle de brevets clés et l'enrichissement de profits exceptionnels) et peu différente de celle du géant notoirement réactionnaire du télégraphe, Western Union.
sommaire
Cet essai se distingue des révisionnistes et des triomphalistes en soulignant l'importance des innovations qui ont eu lieu dans l'industrie téléphonique avant 1894 et au sein des sociétés d'exploitation plutôt que chez AT&T. Il met notamment en lumière les innovations qui ont émergé des sociétés d'exploitation des plus grandes villes du pays.
Les historiens des télécommunications oublient souvent qu'à cette époque, la société d'exploitation urbaine était au cœur de l'industrie et que les sociétés d'exploitation de New York et de Chicago étaient respectivement les première et deuxième plus grandes sociétés d'exploitation téléphonique au monde.
L'essor des grandes sociétés d'exploitation urbaines est le fruit d'une collaboration multiforme et peut être considéré comme une collaboration majeure entre les gestionnaires de téléphones, les abonnés et les municipalités où les sociétés d'exploitation détenaient des franchises.
Parmi les personnalités clés figuraient les directeurs généraux des centraux urbains : Charles N. Fay à Chicago ; Edward J. Hall Jr. à Buffalo ; Morris F. Tyler à New Haven.
Le principal forum d'échange d'idées était la National Telephone Exchange Association (NTEA), un groupement professionnel de directeurs d'entreprises téléphoniques qui se réunissait dans différentes villes plus ou moins chaque année entre 1880 et 1890.
(J'ajoute en commentaire : Après que le règlement des brevets Bell-Western Union de novembre 1879 ait cédé l'activité téléphonique aux intérêts de Bell, les représentants des sociétés titulaires de licence Bell se sont réunis lors d'une conférence nationale en septembre 1880 pour comparer leurs notes sur les aspects économiques et techniques de la gestion d'un échange. La convention s'est officiellement constituée sous le nom de National Telephone Exchange Association (NTEA) et s'est réunie une ou deux fois par an jusqu'en 1890. Rapports en 12 volumes. Vous pouvez consulter La sixième réunion annuelle de la Ntea du 16 et 17 septembre 1884.)
La NTEA n'était en aucun cas une organisation secrète : son secrétaire publiait ses actes et la presse spécialisée rendait régulièrement compte de ses activités. Pourtant, elle a été presque oubliée par les historiens récents du téléphone.
Par exemple, un historien récent de Western Electric a observé – reprenant ce qui est devenu un cliché de l'histoire du téléphone – que le directeur général d'American Bell, Theodore N. Vail, a accueilli la première réunion des directeurs d'entreprises en 1885.
Cette affirmation est doublement trompeuse. Non seulement les directeurs d'entreprises se réunissaient depuis 1880, mais Vail était en 1885 président non seulement d'AT&T, mais aussi de la Metropolitan Telephone Company à New York. De plus, l'origine de cette réunion n'était pas la détermination de Vail à mettre de l'ordre dans le chaos, mais plutôt la prise de conscience par les dirigeants d'American Bell de la nécessité d'apaiser la frustration croissante des dirigeants des sociétés d'exploitation. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune preuve que Vail ait assisté à une seule réunion de la NTEA, bien qu'il en ait été nommé membre honoraire en 1885.
Les intérêts d'American Bell et des sociétés d'exploitation étaient loin d'être alignés.
Les investisseurs dominant d'American Bell considéraient les sociétés d'exploitation principalement comme une source de revenus. Cela était tout à fait compréhensible, puisque leur principale source de revenus résidait dans les droits de licence que les sociétés d'exploitation payaient chaque année pour l'utilisation des brevets de Bell.
Les dirigeants des sociétés d'exploitation, en revanche, considéraient American Bell comme un rentier souvent arrogant et impérieux. Le ressentiment latent des dirigeants des sociétés d'exploitation à l'égard des accords de licence d'American Bell fut l'une des principales raisons de la fondation de la NTEA.
Si les dirigeants d'American Bell pouvaient occasionnellement convoquer des réunions des dirigeants des sociétés d'exploitation – comme Vail l'avait fait en 1885 – ils avaient remarquablement peu d'influence sur la gestion de ces sociétés.
Ce point mérite d'être souligné, car les historiens récents du téléphone ont supposé à tort que les décisions opérationnelles étaient prises d'une manière ou d'une autre au sein du cabinet du président d'American Bell. Rien n'est plus faux.
En exemple à la réunion de1884
| Étaient présents : AMERICAN BELL TELEPHONE CO., DE BOSTON, MA. – R. S. Boyd, agent spécial ; T. B. Doolittle, agent spécial ; Thomas D. Lockwood, électricien ; H. S. Thornberry. BELL TELEPHONE CO., DE BUFFALO, BUFFALO, N. Y. – S. H. Cowles, directeur général ; Harlow C. Palmer, trésorier ; E. J. Hall, Jr. BELL TELEPHONE CO., DU MISSOURI – George F. Durant, directeur général. BELL TELEPHONE CO., Philadelphie, PA. – Henry Bentley, Samuel M. Plush, T. E. Cornish, J. E. Kingsley. CENTRAL DISTRICT AND PRINTING TELEGRAPH Co., Pittsburg, PA. – Henry Metzger, directeur général. CENTRAL PENNSYLVANIA TELEPHONE AND SUPPLY Co., Williamsport, Pennsylvanie - H. R. Rhodes, président ; R. M. Bailey, directeur général. CITY AND SUBURBAN TELEGRAPH ASSOCIATION & BELL TELEPHONE Co., Cincinnati, O. - George N. Stone, vice-président et directeur général. COLORADO TELEPHONE Co., Denver, Colorado - E. B. Field, directeur général. CHICAGO TELEPHONE Co., Chicago, III - C, N, Fay, directeur général. CENTRAL UNION TELEPHONE Co., Chicago, Illinois - George L. Phillips. CHESAPEAKE & POTOMAC TELEPHONE Co., Washington, D. C. - Samuel M. Bryan, directeur général. CENTRAL NEW YORK TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Utica, N. Y. - C. A. Nicholson, G. B. Shepard, H. L. Storke. COMMERCIAL TELEPHONE CO., Albany, N. Y. - A. B. Uline, directeur général ; William H. Cull, surintendant. CUMBERLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH CO. et Great Southern TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Nashville, Tennessee - E. S. Babcock, Jr., président ; E. T. Baker, secrétaire et trésorier. DELAWARES & ATLANTIC TELEPHONE & TELEGRAPH Co., Philadelphie, Pennsylvanie - James Merrihew, président ; W. T. Westbrook, surintendant. EAST TENNESSEE TELEPHONE CO., New York - D. I. Carson, secrétaire. EMPIRE STATE TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Auburn, N. Y. - H. L. Storke, Ferd. C. Timpson. HUDSON RIVER TELEPHONE Co., New York - James Bigler, H. L. Storke, A. B. Uline. METROPOLITAN TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., New York - William H. Eckert, surintendant général. MISSOURI AND KANSAS TELEPHONE Co., Kansas City, Missouri - George L. Phillips. MICHIGAN TELEPHONE Co., Detroit, Michigan - W. A. Jackson, directeur général. NEBRASKA TELEPHONE Co., Omaha, Nebraska - Flemon Drake, directeur général. NEWS AND NEW JERSEY TELEPHONE Co., Brooklyn, N. Y. - W. D. Sargent, directeur général. J. C. Reilly, surintendant de la division de Long Island ; C. H. Barney, surintendant de la division du New Jersey. NEW YORK AND PENNSYLVANIA TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Elmira, N. Y. - W. N. Eastabrook, directeur général. NEW ENGLAND TELEPHONE Co. - L. N. Downs, directeur général. NORTH PENNSYLVANIA TELEPHONE Co., Scranton, Pennsylvanie - R. M. Bailey, directeur général. OHIO VALLEY TELEPHONE Co., Louisville, Kentucky - J. B. Speed, président ; James Clark, vice-président et trésorier ; H. N. Gifford, directeur. PACIFIC BELL TELEPHONE Co., San Francisco, Californie - John I. Sabin. PROVIDENCE TELEPHONE Co., Providence, Rhode Island - John W. Duxbury, directeur général. PENNSYLVANIA TELEPHONE Co., Harrisburg, Pennsylvanie - John L. Wilson, William Ker, directeur général. SOUTHERN BELL TELEPHONE AND TELEGRAPH CO., New York - D. I. Carson, surintendant général ; C. E. McClues, surintendant de district ; J. D. Easterlin, surintendant de district ; W. J. Cole, surintendant de district. SOUTHERN MASSACHUSETTS TELEPHONE Co., New Bedford, Massachusetts - Samuel Ivers, trésorier. SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE Co. - Morris F. Tyler, président ; H. P. Frost, directeur général ; E. B. Baker, surintendant. UNITED TELEPHONE Co., Kansas City, Missouri - George L. Phillips. WISCONSIN TELEPHONE Co., Milwaukee, Wisconsin - H. C. Haskins, secrétaire. MEMBRES HONORAIRES AMERICAN BELL TELEPHONE CO., Boston, Massachusetts. BAILEY, C. E., Ingénieur, Central Telephone Co., de La Havane. BELL TELEPHONE CO., DU CANADA. - C. F. Sise, Vice-président. BRIDGEPORT BRASS CO., Bridgeport, Connecticut. - Frederick A. Mason, Trésorier. BEETLE, GEORGE L., Chicago. BERTHON, A., Ingénieur Chef des Services Techniques de la Société Générale des Téléphones, Paris, France. CHERRY, E. V., Vice-président, Standard Electrical Works, Cincinnati, Ohio. CHEEVER, CHAS. A., New York. CHILDS, WM. A., New York. CASSIDY, JOHN, Surintendant général, Hawaiian Bell Telephone Co., Honolulu, H. I. DAY, A. G., C. B. Hotchkiss, New York. KNIGHT, FRANK B., Agent général, Palmer Wire Co. ; F. F. Bullard, Directeur général, Palmer, Massachusetts. LAW TELEGRAPH Co. LOCKWOOD, THOMAS D., Électricien, Boston, Massachusetts. MAYNARD, GEORGE C., Washington, D. C. MCCONNELL, J. F., Pittsburg, Pennsylvanie. PHILLIPS, GEORGE L., Dayton, O. PHILLIPS, E. F., Providence, R. I. PALMER WIRE CO.- F. F. Bullard, Directeur général ; F. B. Knight, Agent général. Post & Co. (Standard Electrical Works), Cincinnati, O., représentée par E. V. Cherry. SAWYER, W. H., Providence, Rhode Island SUNSET TELEPHONE AND TELEGRAPH, Californie. WESTERN ELECTRIC CO., Chicago, Illinois. |
Pour comprendre comment l'invention de Bell s'est transformée en une innovation commercialement viable, il faut changer d'angle de vue, passant du calme olympien du bureau du président d'American Bell à l'effervescence des standards téléphoniques des principales villes du pays.
Car c'est là que se sont posés les principaux défis opérationnels du service téléphonique.
Dans les années 1880, les relations entre American Bell et les sociétés d'exploitation restèrent tendues, conflictuelles et tendues. Chaque société d'exploitation associée à Bell expérimentait différents types d'équipements et poursuivait des stratégies commerciales divergentes. Aucune société d'exploitation ne se ressemblait. Certes, aucune n'était gérée comme Western Union : toutes combinaient un financement conservateur et une stratégie commerciale très innovante. Pourtant, des différences importantes subsistaient.
Nulle part l'omniprésence de la diversité n'était plus évidente que dans les négociations continues, complexes et parfois exaspérantes entre les dirigeants des sociétés d'exploitation et les fonctionnaires qui leur accordaient leurs franchises d'exploitation et réglementaient leurs activités.
Par définition, ces négociations étaient spécifiques à chaque lieu : tout comme le système politique américain était décentralisé, l'environnement politique des sociétés d'exploitation l'était également. Ces négociations étaient bien plus controversées, moins prévisibles et potentiellement plus perturbatrices que les décisions rendues par les commissions de régulation des États à partir de 1907 environ.
Ce n'est qu'après 1907 que les États ont commencé à supplanter les collectivités locales comme principal lieu de régulation.
À cet égard, comme dans tant d'autres, le secteur du téléphone différait radicalement de celui du télégraphe.
Dans le secteur de la télégraphie, la réglementation étatique et fédérale était la norme depuis les années 1860, et la réglementation locale l'exception ; Dans le secteur de la téléphonie, en revanche, la réglementation étatique et fédérale est restée inhabituelle jusqu'après 1907.
Dans le secteur de la téléphonie, toute politique était (à l'exception importante du droit des brevets) locale.
Des sociétés d'exploitation comme la Chicago Telephone peuvent être qualifiées d'« associées à Bell » dans le sens où elles appartenaient en partie à une holding appartenant à Bell : American Bell (et, après 1900, AT&T). Ce lien était évident pour les initiés du secteur, comme il l'est aujourd'hui pour les historiens. Il convient cependant de rappeler qu'il n'était pas toujours évident pour le grand public.
Lors d'un voyage au Colorado en 1907, après le début de son second mandat à la présidence d'AT&T, Vail rencontra un banquier de Denver, qui ignorait tout du lien entre la société d'exploitation téléphonique locale et sa société mère, AT&T. Cet exemple était extrême. Pourtant, cela rappelle que l'industrie téléphonique était bien plus hétérogène, confuse et même chaotique à ses débuts qu'on ne le pense parfois.
Le caractère très hétérogène des débuts de l'industrie téléphonique est mis en évidence par l'absence de nomenclature d'entreprise cohérente.
La grande majorité des sociétés d'exploitation associées à American Bell, comme par exemple la Chicago Telephone Company, ne comportaient même pas le mot « Bell » dans leur nom.
Dans les années 1880, les sociétés d'exploitation les plus importantes étaient de loin celles de New York et de Chicago. New York était la ville la plus populaire du pays, son centre financier et le siège des revues professionnelles influentes Electrical Review et Electrical World. Chicago était la ville à la croissance la plus rapide du pays, la Mecque des fabricants d'équipements téléphoniques et le siège de la prestigieuse revue professionnelle Western Electrician. La centralité de New York et de Chicago dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle – et, par conséquent, leur probable centralité dans l'industrie téléphonique – était évidente pour les dirigeants du secteur dès le début.
Si les détenteurs de brevets de Bell créaient une société d'exploitation prospère à Chicago, prédisait Vail en 1878, cela leur assurerait le contrôle de « tout le Nord-Ouest ». À l'exception de New York et de Chicago – prédisait un associé de Hubbard à peu près à la même époque –, il n'était pas important pour les détenteurs de brevets de conserver une participation financière dans les sociétés d'exploitation, puisque le territoire de chaque société était géographiquement délimité. Lorsque viendra le moment de former « une seule grande compagnie de téléphone » (un espoir commun aux premiers dirigeants de Bell et une obsession de Vail), rien n'empêchera les investisseurs d'unir les « maillons » et de « faire de la chaîne une unité ». « Je pense que Chicago est un point très important », informa Hubbard le même jour, un avocat de Chicago, « peut-être le point le plus important du pays, et il ne faut manquer aucune occasion d'améliorer et de renforcer la position que vous avez déjà acquise ».
Chicago était « vraiment plus importante » que New York, confia Hubbard à Vail le lendemain : « Avec notre siège social dans cette ville [New York], nous pouvons savoir tout ce que fait la société new-yorkaise de l'UIC Great Cities Institute, tandis que la société de Chicago pourrait faire beaucoup de choses contraires à nos intérêts, dont nous ne saurions rien jusqu'à ce que le mal soit fait.
Personne n'a mieux illustré les défis et les opportunités auxquels les dirigeants d'entreprises opérationnelles ont été confrontés au cours de leurs premières années que Charles N. Fay, le directeur général déterminé de la Chicago Telephone Company entre 1879 et 1887.
Très admiré par ses collègues pour sa personnalité affirmée, son sens aigu de l'administration et son agilité politique face aux écueils de la politique de Chicago, Fay n'a pas mâché ses mots pour décrire les défis auxquels l'industrie naissante était confrontée. Sa remarquable affirmation publique, en 1886, selon laquelle les abonnés au téléphone souffraient d'une « téléphomanie » les prédisposant à critiquer les compagnies de téléphone dont ils utilisaient les installations est tout à fait caractéristique.
L'impériosité de Fay lui a presque certainement coûté la présidence de la Chicago Telephone Company : il n'avait pas la capacité, comme l'a déclaré John Hudson, président d'American Bell, en 1887, de s'inspirer de manière constructive des idées des autres.xxxv Néanmoins, son mandat de directeur général offre un aperçu unique des défis opérationnels auxquels les dirigeants des compagnies de téléphone ont été confrontés pendant une période de changements rapides, imprévisibles et souvent déroutants.
sommaire
Le téléphone, proclamait Marshall Jewell, président
de la National Telephone Exchange Association,
dans son discours inaugural devant les membres de l'association en septembre
1882, avait été projeté dans nos « relations
sociales et commerciales » tel un météore :
il avait « saisi » toutes les branches du commerce
de ce pays « plus vite que n'importe quelle entreprise, qu'aucun
grand principe n'a jamais été développé
dans l'histoire du progrès humain ».
Cette invention, s'extasiait Jewell, promettait à l'Institut
des Grandes Villes de l'UIC plus d'« accomplissement »
pour le confort et l'activité humaine que n'importe quelle invention
antérieure à ses débuts, « à
l'exception à peine de la vapeur et de l'électricité ».
Que Jewell ait offert une tribune aussi extravagante au nouveau moyen
de communication n'avait rien de surprenant. En tant que porte-parole
de l'industrie téléphonique naissante, on attendait de
lui qu'il ne tarisse pas d'éloges sur la nouvelle technologie,
et il s'exécuta.
Ayant présidé le Comité national républicain
lors des élections de 1880, Jewell savait comment mobiliser les
foules. Pendant plus de cinquante ans, des promoteurs dans des situations
similaires avaient rendu des hommages tout aussi enthousiastes au télégraphe,
au chemin de fer et à la poste.
Aussi grandiloquent soit-il, le discours de Jewell contenait une part
de vérité.
Le téléphone était devenu un élément
incontournable du commerce américain à une vitesse remarquable.
Et nulle part ailleurs le rythme du changement n'était plus rapide
que dans les plus grandes villes du pays. En 1881, une seule ville de
plus de 15 000 habitants n'avait pas encore créé
de compagnie téléphonique, et seulement neuf villes de
plus de 10 000 habitants. En 1889, 400 millions de conversations
téléphoniques avaient lieu chaque année aux États-Unis ;
à New York, 100 000 conversations avaient lieu chaque jour.
Quatre ans plus tard, le nombre quotidien de téléphones
à Chicago était de 145 000, ce qui en faisait l'entreprise
la plus active au monde. Le rythme du changement était particulièrement
impressionnant si l'on comparait les développements aux États-Unis
à ceux d'autres régions du monde. En 1888, Chicago comptait
autant de téléphones que la Russie ; Boston autant
que les Pays-Bas.
Il est vrai que les sceptiques n'étaient pas inconnus. Le téléphone
ne remplacerait jamais le télégraphe, déclarait
un journaliste en 1881, car la parole restait dépendante de l'«
action » humaine et était donc nécessairement plus
lente que les machines : « Le monde des affaires ne
peut évoluer à un tel rythme, et le nouveau télégraphe
exige des machines, pas des hommes ». Bientôt, déclarait
le sénateur du Colorado Nathaniel Hill trois ans plus tard, le
pays allait être inondé d'une invention encore plus grande
que le téléphone : un appareil qui transmettrait
non seulement la parole – demeurée éphémère
et sujette à malentendu – mais aussi le texte écrit.
L'inventeur Elisha Gray avait présenté
les possibilités d'un tel appareil – ancêtre de ce
que nous appellerions aujourd'hui un télécopieur
– lors de l'Exposition universelle de 1893.
La commercialisation du téléphone, expliquait Gray, avait
créé une demande pour un service « de meilleure
qualité et différent ». La « révolution »
à venir dans les « moyens de communication »
serait accélérée par le télégraphe
– une machine qui, en transmettant une « fax-similé
exacte » d’un texte écrit, « accomplirait
ce qu’une lettre fait en affaires et pourrait être envoyée
aussi rapidement qu’un télégramme ».
La prédiction de Gray s’est avérée excessivement
optimiste : en réalité, le télécopieur
ne deviendrait pas un équipement standard des bureaux avant les
années 1970. Pourtant, l’expansion des entreprises
d’exploitation se poursuivit sans entrave jusqu’en 1888,
année où elle fut ralentie pendant quelques années
par un défi technique connu sous le nom d’induction, grandement
aggravé par la prolifération des tramways, de l’éclairage
et des lignes électriques. Avec l'installation de circuits à
deux fils (ou métalliques), ce problème a été
surmonté, permettant aux réseaux de connaître une
nouvelle expansion, à partir (du moins à New York) vers
1894.
L'expansion de l'industrie téléphonique dans les années
1880 est particulièrement impressionnante si on la compare à
son analogue le plus proche : le télégraphe intra-urbain
(ou de district). « Aucune invention destinée à
faciliter la communication », exultait le rédacteur en
chef du Commercial and Financial Chronicle en 1885, « n'a jamais
connu de progrès aussi rapides. Il y a dix ans, l'idée
même d'utiliser un fil pour transmettre des paroles aurait été
explorée par quatre-vingt-dix-neuf scientifiques sur cent. Il
y a six ans, le téléphone était encore au stade
expérimental, à tel point que la plupart des gens le considéraient
comme un simple jouet scientifique. Aujourd'hui, il est utilisé
dans toutes les villes et grandes agglomérations du pays, et
dans toutes les villes progressistes du monde… ». On peut
« affirmer sans se tromper », déclarait un éditorialiste
d'Electric Age en 1890, « qu'aucune autre invention dans l'histoire
du monde n'a autant accompli en facilitant les transactions commerciales
mondiales ». En un laps de temps étonnamment court, affirmait
un rédacteur de l'Electrical Review, le téléphone
avait acquis une place de choix comme « l'invention suprême
du XIXe siècle.
Pour bien comprendre pourquoi les contemporains considéraient
la commercialisation du téléphone comme un événement
majeur, il est important de reconnaître que le cœur de l'industrie
à cette époque ne résidait pas dans le réseau
longue distance naissant construit par AT&T, mais dans les sociétés
d'exploitation qui se développaient dans les plus grandes villes
du pays. Cette nouvelle perspective ascendante sur l'histoire du téléphone
a été grandement facilitée en 2001 par l'ouverture
à San Antonio, au Texas, d'archives d'entreprise à la
pointe de la technologie par SBC (une ancienne société
d'exploitation). Les fonds des archives de SBC complètent ceux
des archives d'AT&T à Warren, dans le New Jersey.
Alors qu'AT&T collectait des documents relatifs à la téléphonie
longue distance, à la recherche et au développement et
à la fabrication de téléphones, SBC se spécialise
dans les documents commerciaux de centaines d'entreprises, qu'elles
soient liées ou non à Bell, dont la Chicago
Telephone Company. Avant 2001, les historiens du monde des affaires
qui s'intéressaient aux débuts de la téléphonie
n'avaient d'autre choix que de s'appuyer sur AT&T. Inévitablement,
et souvent inconsciemment, cela les a conduits à marginaliser
les sociétés exploitantes et à considérer
les débuts de la téléphonie américaine du
point de vue d'American Bell et, après 1900, de son successeur,
AT&T. Quel que soit le nombre de boîtes de documents examinées
par les historiens, ils ne retrouvaient jamais les rapports des directeurs
ni les procès-verbaux des comités exécutifs d'une
société exploitante de téléphonie (Bell
ou indépendante), car la conservation de ces documents n'avait
jamais été du ressort d'AT&T. Si le caractère
centré sur AT&T des travaux de recherche qui en ont résulté
est compréhensible, il est regrettable, incomplet et déformant.
Les récits historiques, fondés en grande partie (et parfois
exclusivement) sur les archives d'AT&T, en disent généralement
long sur l'élaboration de la politique des opérateurs
téléphoniques, mais peu sur sa mise en œuvre, et
rien sur les politiques souvent très différentes qu'ils
ont suivies. Pour les besoins de cet essai, ces récits seront
qualifiés de centrés sur AT&T, même si, comme
plusieurs l'ont été, ils étaient très critiques
à son égard. Le choix même d'utiliser AT&T comme
acronyme (une convention adoptée, quelque peu à contrecœur,
dans cet essai) risque de confondre l'histoire de l'industrie téléphonique
avec les activités d'une seule entreprise. Avant 1920, il convient
de rappeler que l'acronyme « A.T.&.T » –
généralement composé de points séparant
les lettres et souvent appelé « A.T. & T »
– était largement réservé à la presse
financière et était rarement utilisé par les dirigeants
d'entreprise, même à des fins publicitaires. L'entreprise
était plus généralement appelée « American
Telegraph and Telegraph » ; ses titulaires de licence
étaient les « sociétés associées ».
On a peu à gagner, et beaucoup à perdre, à traiter
les sociétés d'exploitation associées à
Bell, à l'ère des débuts de la téléphonie,
comme si elles faisaient partie d'un seul et même « système
Bell » indifférencié. Le système Bell
n'a jamais été une entité unique ; de ses
origines dans les années 1900 à sa disparition en 1984,
il s'agissait plutôt d'un ensemble de sociétés d'exploitation
liées, parfois étroitement, parfois plus ou moins étroitement,
à une société holding (AT&T), un fournisseur
de services longue distance (également appelé AT&T),
un centre de recherche et développement (connu après 1925
sous le nom de Bell Labs) et un fabricant d'équipements (Western
Electric).
Bien après 1920, les sociétés d'exploitation
associées à Bell ont conservé leur propre identité
visuelle, publié leurs propres magazines, conçu leurs
propres publicités, construit leurs propres sièges sociaux
et même émis leurs propres titres. Parmi les gratte-ciel
les plus marquants des années 1920 sur le plan architectural
figuraient le siège de la New York Telephone Company à
New York et celui de la Pacific Telephone and Telegraph Company à
San Francisco.
L'hypothèse implicite selon laquelle les sociétés
d'exploitation associées à Bell étaient en quelque
sorte moins importantes qu'AT&T a été particulièrement
trompeuse. Ces dernières décennies, cette hypothèse
a acquis une certaine crédibilité. Après tout,
dans les années 1970 et 1980, les partisans d'AT&T ont déployé
des efforts considérables pour populariser l'idée que
l'opérateur longue distance d'AT&T avait longtemps subventionné
les sociétés d'exploitation associées à
Bell. L'existence réelle de cette subvention a fait l'objet d'un
débat très technique, souvent acrimonieux et apparemment
sans fin, sur ce que les initiés du secteur téléphonique
appellent les « séparations ». Il ne fait
cependant guère de doute que, avant 1920, les subventions allaient
dans le sens inverse, c'est-à-dire des sociétés
d'exploitation vers AT&T.
Pour toutes ces raisons, peu d'historiens se sont intéressés
à la stratégie commerciale des sociétés
d'exploitation associées à Bell. Certes, il existe des
historiques d'entreprises, souvent richement illustrés, de plusieurs
sociétés d'exploitation. Pourtant, relativement peu d'attention
avait été accordée aux sociétés d'exploitation
des plus grandes villes du pays dans les années précédant
l'expiration des brevets de Bell en 1894.
sommaire
Rien n'a autant faussé notre compréhension de l'ère
formatrice de la téléphonie américaine que la propension
des historiens du téléphone à supposer que la réglementation
téléphonique a débuté vers 1907, avec la
promulgation d'une loi plaçant les sociétés d'exploitation
téléphonique sous la juridiction des commissions de régulation
des États.
La politique a toujours eu son importance. De multiples façons,
les organismes politiques (et en particulier les organismes politiques
municipaux) ont exercé une plus grande influence sur l'industrie
téléphonique avant 1907 qu'après. L'historien des
technologies Thomas P. Hughes a formulé une hypothèse
célèbre : après 1870, une « constitution
matérielle » fondée sur la technologie a transformé
la société américaine tout aussi profondément
que la « constitution politique » avait transformé
la jeune république.
En téléphonie, cependant, politique et technologie ont
toujours été liées. Prétendre, comme le
font de nombreux historiens, que Theodore N. Vail a adopté la
réglementation gouvernementale après 1907 est une erreur
: Vail n'avait pas le choix. La question pertinente n'a jamais été
de savoir si l'industrie téléphonique resterait non réglementée
– car elle l'avait toujours été – mais plutôt
de savoir comment elle serait réglementée, par qui et
à quelles fins.
Entre 1879 et 1894, les dirigeants des compagnies d'exploitation furent
confrontés à deux défis politiques majeurs. Le
premier concernait l'acquisition et l'entretien des droits de passage ;
le second, la prévention d'une législation tarifaire défavorable.
Chacun de ces défis, distinctif, sera examiné successivement.
Aucune compagnie de téléphone ne pouvait prospérer
durablement dans un grand centre urbain sans concession publique. Les
concessions permettaient aux compagnies d'exploitation de naviguer dans
les méandres souvent périlleux de la politique urbaine
et d'obtenir des droits de passage. Les compagnies d'exploitation connectaient
les abonnés, et ces connexions impliquaient la pose d'une grande
quantité de fils.
À partir des années 1870, chefs d'entreprise et représentants
du gouvernement se sont penchés sur la question de la pose de
ces fils. Certains recommandaient de les enterrer sous les rues de la
ville ; d'autres de les regrouper en câbles aériens.
Chacun avait ses détracteurs. « Je suis tout à fait
convaincu », déclarait William Orton, président
de la Western Union, en 1878, « que lorsque le public comprendra
à quel point les nuisances causées par les fils électriques
souterrains seront bien plus importantes que celles causées par
le projet actuel de poteaux et de fils électriques, il y aura
une protestation bien plus fervente contre l'occupation des rues par
des tranchées que contre les poteaux, même les plus grands.
»
L'un des premiers débats publics sur ce que les critiques appelleraient
la « menace des lignes aériennes » eut lieu à
Chicago en 1875.
Un rapport du conseil municipal concluait que les lignes aériennes
menaçaient l'intégrité du système d'alarme
incendie installé par la ville après l'incendie de Chicago
de 1871. Le catalyseur fut la commercialisation rapide des compagnies
de télégraphe de district, qui fournissaient aux abonnés
les cotations du marché (au moyen d'un dispositif appelé
téléscripteur).
D'autres problèmes étaient anticipés avec la commercialisation
imminente du téléphone, dont l'expansion était
prévue à un rythme encore plus rapide. Initialement, les
échevins envisageaient d'enfouir les lignes d'alarme incendie.
Après avoir calculé le coût, ils décidèrent
d'exiger des propriétaires de tous les autres réseaux
câblés qu'ils enterrent leurs lignes.
La première ordonnance sur les fils électriques souterrains
dans une grande ville américaine fut promulguée par le
conseil municipal de Chicago en mai 1881. La loi obligeait toutes les
entreprises ayant installé des fils électriques dans les
rues de Chicago – ce qui incluait alors la Chicago Telephone Company
– à les enterrer avant mai 1883. Plus tard la même
année, un jury new-yorkais déclara certains poteaux téléphoniques
érigés par Metropolitan comme étant une nuisance,
exposant l'entreprise à des poursuites en vertu de la common
law. En juin 1884, l'assemblée législative de l'État
de New York promulgua une loi exhaustive sur les fils électriques
souterrains. Cette loi fixait un calendrier pour l'enfouissement des
fils aériens de toutes les entreprises de télégraphe,
de téléphone et d'éclairage électrique de
l'État qui exploitaient des franchises dans les villes de plus
de 500 000 habitants, c'est-à-dire New York et Brooklyn.
Les dirigeants des entreprises d'exploitation réagirent à
la législation sur les fils électriques souterrains avec
une inquiétude non dissimulée. L'ordonnance de Chicago
sur les lignes souterraines, avertissait Morris F. Tyler en septembre
1882, constituait « l'attaque la plus sévère »
de la part d'une agence gouvernementale à laquelle les compagnies
de téléphone n'avaient pas encore été confrontées.
Tyler supposait que la loi serait déclarée nulle, car
il tenait pour acquis que ses dispositions étaient impossibles
à respecter. C'était un « principe élémentaire
», expliquait Tyler, que la promulgation d'une loi exigeant «
une chose physiquement impossible est nulle ». Si les exploitants
pouvaient démontrer qu'en enterrant les lignes, « l'entreprise
sera enterrée avec elles », la loi n'aurait aucun effet
pratique.
Thomas D. Lockwood, électricien chez American Bell, a contesté
la présomption selon laquelle le mouvement en faveur de l'enfouissement
des lignes était « véritablement » populaire.
Il s'agissait plutôt, selon lui, de l'œuvre d'« intérêts
particuliers », notamment des « inventeurs professionnels »,
qui avaient tout à gagner à maintenir les voies publiques
du pays dans un état de « convulsion volcanique ».
D'autres imputaient la responsabilité de la législation
aux concessionnaires de canalisations souterraines. « Même
la bande de monopoleurs intrigants qui détient le droit de construire
des métros », balbutiait un rédacteur en chef
de la presse spécialisée en 1884, « ne peut
pas forcer l'enfouissement des lignes téléphoniques »
en l'absence de preuves solides de la faisabilité technique et
de la rentabilité d'un tel projet.
La plausibilité de ces théories quasi conspirationnistes
fut grandement renforcée par la constatation qu'à Chicago,
les ingénieurs de Western Electric, Enos Barton et Milo
Kellogg, avaient publiquement fait pression sur le conseil municipal
pour qu'il enfouisse les lignes. Dans leur « anxiété »
à l'idée de vendre des câbles à la compagnie
de téléphone – comme l'expliquait Norman Williams,
président de la Chicago Telephone Company, à Theodore
N. Vail, principal actionnaire de la compagnie, en 1883 –, Barton
et Kellogg n'hésitèrent pas à « préconiser »
l'adoption de câbles souterrains. Williams concéda que
la tentative de Western Electric d'obtenir des contrats pour des câbles
souterrains était « tout à fait légitime »
d'un point de vue commercial.
Il avertit néanmoins que cela pourrait s'avérer désastreux
pour la Chicago Telephone Company. Williams implora Vail d'entreprendre
un « travail missionnaire » avec Barton et Kellogg ?
Après tout, Barton et Kellogg étaient les dirigeants d'une
entreprise censée coopérer avec American Bell, et dont
American Bell détenait une part substantielle du capital. Barton
et Kellogg ne devraient-ils pas être encouragés à
se montrer plus discrets dans leurs futures déclarations publiques
sur le caractère pratique de ces câbles, et notamment sur
leur adéquation au service téléphonique longue
distance (un fait qui restait à établir) : « La
moindre promesse concernant l'utilisation de ces câbles sera exploitée
par la ville et par les journaux, et il devient donc nécessaire
d'être très prudent dans leurs déclarations au public. »
De nombreux dirigeants du secteur téléphonique, dont Vail,
doutaient encore en 1885 de la faisabilité technique des câbles
souterrains pour le service téléphonique (en particulier
pour les longues distances).
Lorsque les organismes gouvernementaux ont commencé à
exiger l'enfouissement des câbles, les compagnies de téléphone
ont rapidement mis au point des méthodes pour se conformer à
la loi. Les responsables du secteur téléphonique n'avaient
tout simplement pas d'autre solution, a déclaré Thomas
D. Lockwood, électricien américain de Bell, à la
NTEA en 1884, pour enterrer rapidement et à moindre coût
chaque fil téléphonique traversant les quartiers d'affaires
centraux des grandes villes du pays. À Chicago, l'enfouissement
des câbles souterrains a été supervisé par
Charles N. Fay ; à New York, par Vail. (Fay s'appuya initialement
sur des injonctions pour empêcher le conseil municipal d'intervenir
sur les biens de l'entreprise ; cependant, il conclut presque immédiatement
qu'il serait plus prudent de se conformer à la loi.) En règle
générale, les responsables de l'entreprise d'exploitation
parvenaient à un compromis avec les autorités gouvernementales,
qui autorisait l'enfouissement des câbles uniquement dans les
quartiers les plus densément peuplés de la ville. Malgré
cela, le rôle de la réglementation gouvernementale dans
la promotion de l'innovation fut impressionnant et confirma pleinement
la prédiction d'Alexander Graham Bell selon laquelle seule une
décision politique pouvait imposer l'enfouissement des câbles.
L'enfouissement des câbles téléphoniques élimina
l'un des points de discorde les plus visibles entre les citadins et
l'opérateur téléphonique urbain. Loin des yeux,
loin du cœur : l'opérateur téléphonique
semblait moins redoutable lorsque sa présence n'était
plus vantée par un enchevêtrement de câbles sur chaque
artère principale. Ses avantages n'étaient en aucun cas
purement esthétiques : les câbles souterrains étaient
moins coûteux à entretenir et moins susceptibles d'entraîner
l'entreprise dans des poursuites judiciaires. Aucune question ne perplexifait
autant les dirigeants des sociétés d'exploitation que
la tarification du service téléphonique. Initialement,
les titulaires de licences Bell fixaient des tarifs bas pour concurrencer
Western Union, qui avait rapidement commencé à créer
ses propres sociétés d'exploitation téléphonique
en 1878. Cette période de concurrence prit fin en novembre 1879,
lorsque Western Union s'entendit avec les investisseurs bostoniens qui
contrôlaient les brevets Bell pour se partager le marché.
Désormais, les titulaires de licences Bell se concentreraient
sur la téléphonie et Western Union sur la téléphonie.
La volonté de Western Union d'abandonner le téléphone
a longtemps intrigué les historiens du monde des affaires, qui
l'ont souvent qualifiée de pire décision commerciale de
l'histoire. Comment l'expliquer ?
Les dirigeants de Western Union avaient de bonnes raisons de se concentrer
sur leur activité principale, la télégraphie longue
distance. De plus, ils avaient échoué lors d'au moins
une tentative de rachat de Bell et, en 1879, craignaient une attaque
concurrentielle du financier Jay Gould sur leur activité principale.
Rien ne préoccupait davantage les dirigeants de Western Union
que la possibilité que Gould s'allie aux intérêts
de Bell pour créer un empire commun du télégraphe
et du téléphone.
Les dirigeants de Western Union reconnaissaient leur extrême impopularité
et que toute tentative d'absorption des intérêts de Bell
risquait de susciter une législation fédérale visant
à limiter leur pouvoir.
« Des causes extérieures à la force de nos
brevets » ont renforcé les détenteurs de brevets
de Bell dans leur lutte contre Western Union, a déclaré
Forbes à James Storrow, avocat spécialisé en brevets
de Bell, en 1880. « La présence de Gould sur le terrain »,
ainsi que « l'existence d'une opinion publique considérable
contre Western Union » étaient « incontestablement »
des facteurs importants qui « ont grandement accru l'anxiété
de cette entreprise quant à un règlement à l'amiable ».
Tout le monde comprenait qu’une lutte juridique prolongée
aurait été désastreuse. « La séparation
des intérêts », observait Bell en juin 1876,
relatant une conversation récente avec son rival inventeur Elisha
Gray, « entraînera de longs procès et, au final,
la Western Union pourra intervenir et racheter le groupe de son choix ».
En cas de bataille juridique prolongée, prévenait William
Orton, président de la Western Union, en 1878, l'introduction
commerciale du téléphone serait sérieusement retardée,
« quel qu'en soit » le résultat :
« Le premier effet de la concurrence sera une baisse des
tarifs et une augmentation des dépenses. Une lutte prolongée
détruira la valeur de tous les intérêts. »
Les investissements dans « tous ces brevets »
– y compris le téléphone – impliquaient, déclarait
John Murray Forbes, père de William Forbes, en 1880, « trop
de bonne volonté et de travail acharné » –
même s'il ajoutait rapidement qu'il était ravi que les
investisseurs « plus audacieux » en tirent « des
profits mirobolants ».
D'une certaine manière, la solidité juridique des brevets
de Bell, souvent invoquée par les triomphalistes d'AT&T pour
expliquer sa victoire, résultait de la timidité avec laquelle
Western Union les avait contestés devant les tribunaux. Chacun
se souvenait de l'âpreté de la bataille concernant les
brevets télégraphiques de Morse (George Gifford, avocat
spécialisé en brevets chez Western Union, avait participé
au précédent litige) et personne ne souhaitait revivre
ce fiasco.
Cette période de compétition donna un puissant élan
à l'industrie naissante du téléphone. « Elle
devint », comme le rappelait Lockwood en 1887, « un
moyen de diffuser largement l'usage du téléphone sur le
territoire, d'implanter massivement le central téléphonique
et d'habituer le public à son usage fréquent, un moyen
qu'aucune autre agence n'aurait probablement pu égaler ».
Pourtant, elle posa des défis majeurs aux dirigeants des entreprises
d'exploitation. Les « conditions particulières et
défavorables » dans lesquelles le service téléphonique
avait été établi – du moins l'expliquait Hall
en 1881 – et en particulier la vive concurrence entre Bell et Western
Union, avaient rendu la grande majorité des sociétés
exploitantes non rentables et avaient laissé peu de temps pour
« délibérer ou étudier »
les tarifs.
La fusion des sociétés exploitantes Bell et Western Union
en novembre 1879 plaça les dirigeants des sociétés
exploitantes au défi de convaincre les abonnés (comme
on appelait alors les utilisateurs du téléphone) de payer
plus cher pour accéder au réseau désormais élargi.
C'était contre-intuitif, car il était largement admis
que, si une compagnie de téléphone était bien gérée,
elle réduirait ses coûts, à l'instar d'un grossiste,
et répercuterait la différence sur ses clients. Ce que
les économistes appelleraient plus tard les « économies
d'échelle » était une maxime commerciale, et
il semblait inconcevable qu'elle ne s'applique pas à l'industrie
téléphonique.
Ce n'est que lentement que les contemporains de l'UIC Great Cities Institute
se sont convaincus que, dans le secteur de la téléphonie,
contrairement à la plupart des autres secteurs, les coûts
augmentaient avec l'expansion de la production (c'est-à-dire
du service téléphonique). Les dirigeants des sociétés
d'exploitation, comme l'expliquait Hall, avaient appris par «
expérience amère » que les coûts par abonné
augmentaient nécessairement avec l'expansion du réseau
de l'entreprise – une relation, prédisait-il, que l'abonné
moyen trouverait « incompréhensible ». Les porte-parole
de l'industrie manquaient peu d'occasions de souligner cette découverte
dans leurs déclarations publiques à la presse. Pourtant,
comme Hall l'avait prédit, les abonnés restaient sceptiques,
tout comme la presse.
L'idée que les tarifs téléphoniques devraient augmenter
avec l'expansion du réseau était ridiculisée par
un éditorialiste du New York Times dès août 1901.
Pour l'avocat new-yorkais Simon Sterne, c'était tout simplement
absurde. Pour enfoncer le clou, Sterne a fait une analogie entre le
service téléphonique et la sociabilité urbaine.
Juste parce qu'il pouvait – s'il le voulait – saluer tous
ceux qu'il croisait dans la rue, se disait Sterne, il ne voyait aucune
raison de l'obliger à les joindre tous par téléphone.
Les abonnés au téléphone comme lui étaient
bien trop occupés pour utiliser le téléphone comme
moyen de communication : ils limitaient leur usage à leurs
relations professionnelles ou sociales, et ne comprenaient pas pourquoi
l'opérateur téléphonique avait l'audace de leur
faire payer le privilège de parler à des personnes avec
lesquelles ils n'avaient aucune envie de converser.
La plupart des opérateurs télécoms facturaient
un forfait pour l'utilisation illimitée du téléphone
pendant une période donnée. Les abonnés avaient
le droit d'utiliser n'importe quel téléphone du réseau
de l'opérateur (en plus, bien sûr, du leur). Pour prouver
leur statut d'abonné, l'opérateur leur délivrait
des cartes imprimées spéciales. Plusieurs de ces cartes,
émises par la Chicago Telephone Company dans les années
1880, sont conservées aux archives de la SBC à San Antonio,
au Texas. Si un abonné souhaitait utiliser un téléphone
public, il avait le droit de le faire gratuitement.
L'hypothèse selon laquelle l'accès illimité au
service téléphonique était transférable
d'un téléphone à l'autre peut paraître curieuse
aujourd'hui. Pourtant, elle n'a été abandonnée
que progressivement. En 1894, par exemple, des pharmaciens de Milwaukee
ont poursuivi la Milwaukee Telephone Company pour faire respecter le
droit des abonnés à utiliser gratuitement les téléphones
publics. Cette présomption a connu une mort lente : en 1902
encore, un éditorialiste de l’Electrical World la tenait
pour acquise.
Les non-abonnés n’étaient pas censés utiliser
le téléphone d’un abonné – un abus connu
sous le nom de « mise en place de téléphones
publics » (expression empruntée au monde ferroviaire).
« L’utilisation des téléphones d’abonnés
par des clients de passage », expliquait la liste des abonnés
de la Metropolitan Telephone Company pour 1884, « constitue
une violation du contrat et un préjudice pour l’entreprise. ».
En pratique, cependant, cette interdiction s’est avérée
impossible à appliquer, les abonnés ne voyant guère
de raisons de ne pas rendre service à un voisin ou à un
ami. (Comme les abonnés payaient un tarif fixe, la mise en place
de téléphones publics n’augmentait pas le montant
de leur facture.)
Les tarifs fixes – comme on a fini par appeler ce système
de tarification – présentaient plusieurs avantages. C'était
simple, cela favorisait l'expérimentation généralisée
d'un nouveau média inconnu et était facile à gérer :
le seul appareil de mesure nécessaire était un calendrier.
Pour la plupart des entreprises, ce système de tarification fonctionnait
plutôt bien et allait longtemps rester la norme pour le service
local.
Pour le nombre relativement restreint d'entreprises situées dans
les plus grandes villes du pays, les tarifs forfaitaires sont cependant
rapidement devenus un défi opérationnel majeur. Certains
abonnés – bûcherons, commissionnaires et banquiers
– utilisaient leur téléphone presque en permanence,
encombrant les circuits et augmentant les coûts de commutation.
D'autres étaient mécontents des tarifs élevés
pratiqués par l'entreprise. Pour d'autres encore (probablement
le plus grand nombre), les tarifs forfaitaires les décourageaient
d'utiliser le téléphone.
Les dirigeants des entreprises se sont efforcés, avec plus ou
moins de succès, de résoudre le défi posé
par les tarifs forfaitaires.
Ce problème était bien plus urgent que les défis
techniques posés par la téléphonie longue distance.
Pour la grande majorité des utilisateurs du téléphone,
l'unité spatiale pertinente n'était pas la région
(et encore moins le pays), mais la localité. Loin d'être
un réseau homogène, l'industrie téléphonique,
à ses débuts, était un patchwork. Un nombre relativement
restreint de commerçants, d'industriels et de financiers recherchaient
– et étaient prêts à payer – un service
interurbain et (à partir de 1885) même interrégional.
La grande majorité souhaitait simplement appeler un médecin,
commander à manger à l'épicier ou discuter avec
sa famille et ses amis à l'autre bout de la ville.
Pour eux, le service téléphonique local était le
seul type de service téléphonique qu'ils connaissaient
ou souhaitaient. Appeler quelqu'un dans une autre ville – et encore
moins dans un autre État – était un événement
rare et mémorable. Pour la grande majorité des Américains,
cela allait rester vrai jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.
Tout comme le service téléphonique était local,
la réglementation téléphonique l'était aussi.
Dès le début, les compagnies de téléphone
ont évolué dans un environnement réglementaire
extrêmement dense et parfois d'une complexité déconcertante.
Dans ce contexte, les responsables téléphoniques se sont
retrouvés pris dans une lutte perpétuelle avec les autorités
gouvernementales, les associations professionnelles et les groupes d'utilisateurs.
La concurrence dans le secteur de la téléphonie a toujours
été artificielle : contrairement à l'impression
répandue parmi les partisans et les détracteurs du secteur,
à aucun moment de son histoire, la concurrence débridée
n'a prévalu. Dès le départ, le succès ou
l'échec des opérateurs téléphoniques dépendait
de la capacité des responsables à obtenir des chartes
favorables et à empêcher l'adoption de lois hostiles (tant
au niveau local qu'au niveau de l'État). Peu de secteurs ont
été aussi profondément façonnés par
les décisions politiques. Rares sont ceux qui ont su dissimuler
avec autant d'habileté leur influence non seulement sur la technologie
et l'économie, mais aussi sur la politique et la culture.
Le développement de la téléphonie au XXe siècle
a occulté son caractère localiste à ses débuts,
au double sens où elle offrait un service local et était
soumise à la réglementation locale. Il est si courant
aujourd'hui d'appeler un ami ou un parent à l'étranger
– ou d'envoyer un courriel à l'autre bout du monde –
qu'on oublie facilement à quel point une telle pratique aurait
semblé inhabituelle il y a un siècle. On ne saurait trop
insister sur l'importance de distinguer la capacité théorique
d'effectuer une action (comme appeler longue distance) de la probabilité
qu'une telle action soit effectivement réalisée.
Malgré tous les efforts déployés par les publicitaires
de l'industrie téléphonique, rien ne prouve que plus d'un
infime pourcentage d'Américains à la fin du XIXe siècle
ait manifesté le moindre désir de téléphoner
longue distance. S'ils souhaitaient contacter quelqu'un (comme le proposait
une campagne publicitaire téléphonique ultérieure),
ils avaient toujours la possibilité d'envoyer un télégramme
ou une lettre. Le principal – et même le seul – concurrent
du téléphone, comme l'expliquait un initié du secteur
en 1884, était le « petit garçon » sur lequel
les employeurs comptaient pour faire les courses. Le salaire d'un petit
garçon s'élevait à environ 3 dollars par semaine ;
si un employé ne pouvait pas se permettre de payer 1 dollar par
semaine pour un service téléphonique, il était
préférable de ne pas s'abonner.
Aucun directeur d'entreprise n'a accordé autant d'attention à
la question des tarifs (comme on appellerait la tarification du service
téléphonique) qu'Edward J. Hall, Jr., directeur de la
société Bell à Buffalo, dans l'État de New
York. Dès 1880, Hall prédisait que l'utilisation du téléphone
dans les entreprises d'exploitation situées dans les grands centres
urbains se développerait si les directeurs d'entreprise pouvaient
facturer à l'appel plutôt qu'à l'année. Le
système de tarification de Hall, initialement baptisé
« système Buffalo », puis connu sous le
nom de service mesuré, présentait, selon Hall, un « élément
d’équité », en contradiction avec les
tarifs forfaitaires, qu’il reconnaissait (à juste titre)
comme étant purement arbitraires. Le tarif de base était
de 10 cents par appel, avec un minimum de 500 appels par an.
Le service mesuré a rencontré une vive résistance
de la part de nombreux, voire de la plupart des utilisateurs de téléphone,
et a été introduit avec succès avant 1894 dans
un nombre relativement restreint de villes, dont Buffalo et San Francisco.
Pourtant, il n’était pas illogique. Si les sociétés
d'exploitation continuaient à facturer des tarifs fixes –
du moins c'est ce que Hall prévoyait en 1880 –, elles seraient
contraintes, au fil du temps, d'augmenter leurs tarifs à un prix
si « rigide » que le nombre d'abonnés en
serait considérablement réduit. Le service mesuré,
en revanche, encourageait les utilisateurs à définir leurs
propres règles d'utilisation du nouveau moyen de communication.
Des groupes d'individus pouvaient se regrouper pour installer un téléphone,
qu'ils pouvaient ensuite louer à toute personne se trouvant à
proximité :
« Une personne, cinq ou dix personnes peuvent utiliser le
téléphone ensemble ; n'importe qui pourrait venir
dans la rue et l'utiliser ; plus il y en a, mieux c'est.»
Hall reconnaissait que le service mesuré réduirait le
nombre d'appels des gros utilisateurs, car ils seraient désormais
incités à décourager les appels futiles. (Les principaux
coupables étaient, si l'on en croit les articles de la presse
spécialisée, de jeunes employés de bureau, avides
de quiz sur le baseball et d'actualités sportives.) Pourtant,
il était convaincu que cela augmenterait le nombre d'appels des
utilisateurs occasionnels et constituerait donc un bénéfice
social net : « Notre intérêt est d'abord
l'intérêt du public, de rendre tout accessible et gratuit,
même payant, et d'utiliser le plus possible, pour travailler avec
[les utilisateurs] plutôt que contre eux.»
Hall reconnaissait que le service mesuré était difficile
à vendre aux utilisateurs de téléphone habitués
aux tarifs forfaitaires. Il restait néanmoins convaincu que le
« véritable système » consistait
à « rémunérer » chaque service
et proportionnellement au service rendu. Les dirigeants des sociétés
d'exploitation, selon lui, avaient deux options : appliquer un
tarif forfaitaire élevé et fournir un service illimité,
ou payer une petite location et facturer par message, « afin
de généraliser l'usage du téléphone ».
Hall préférait la seconde option. Après tout, selon
son plan, « l'intérêt de l'entreprise est que
les machines soient utilisées au maximum ; l'intérêt
de l'abonné est d'en limiter l'utilisation.» À l'UIC
Great Cities Institute, les incitations étaient inversées :
l'exploitant était incité à restreindre l'utilisation,
tandis que les abonnés ne l'étaient pas.
L'avantage non négligeable du service tarifé était,
et non le moindre, son efficacité à prévenir l'utilisation
non autorisée du téléphone par les non-abonnés.
En 1886, Hall estimait que les appels non sollicités représentaient
entre 25 et 35 % de tous les appels téléphoniques effectués
par les compagnies d'exploitation qui maintenaient leurs tarifs fixes.
Outre l'élimination des appels non sollicités, le service
tarifé créerait des opportunités commerciales pour
les abonnés existants. Si un commerçant affichait à
l'extérieur de son magasin une pancarte annonçant qu'il
possédait un « téléphone public »,
Hall prédisait qu'il gagnerait rapidement un peu d'argent de
poche. Les non-abonnés, du moins le supposait Hall, paieraient
volontiers une petite redevance aux commerçants pour utiliser
leur téléphone ; ces derniers, de leur côté,
partageraient cette redevance avec la compagnie de téléphone.
À Buffalo, observait Hall, certains abonnés professionnels
avaient ainsi réalisé un « profit net »
compris entre 50 et 100 dollars par an.
Pour populariser le service tarifé, Hall a essayé diverses
ruses. Pour encourager les nouveaux utilisateurs, il édita des
tickets prépayés (un peu comme les cartes téléphoniques
actuelles) que les commerçants pouvaient échanger contre
un crédit auprès de la compagnie de téléphone.
Les tickets, se réjouissait un observateur du secteur en 1885,
allaient résoudre le « mal des téléphones
sans abonnement » tout en faisant mieux connaître la
téléphonie comme une « grande commodité ».
Rien, bien sûr, n'empêchait les commerçants de facturer
l'utilisation de leur téléphone aux non-abonnés ;
tant que les abonnés payaient un abonnement annuel fixe, ces
utilisateurs occasionnels n'étaient « pas enclins
à payer, sauf avec des remerciements ».
Aussi bénéfique que fût un service mesuré
pour les utilisateurs du téléphone (abonnés comme
non-abonnés), il imposait une nouvelle charge à l'exploitant.
Désormais, après tout, il faudrait quelqu'un qui devrait
comptabiliser le nombre d'appels de chaque abonné. (Personne
n'avait envisagé de mesurer la durée d'une communication
téléphonique : et, de fait, aucun appareil permettant
de mesurer la durée d'une communication téléphonique
locale n'a été conçu avant 1920.) Pourtant, Hall
resta imperturbable.
Les compagnies de télégraphe de district, observa-t-il,
avaient depuis longtemps mis en place un « système
de boîtes postales » dans lequel les employés
déposaient un ticket chaque fois qu'un abonné demandait
une tâche.
Les compagnies de téléphone pourraient suivre leur exemple.
« Si vous avez été dans un bureau de poste
et que vous les avez vus distribuer du courrier, vous imaginez la rapidité
avec laquelle un opérateur distribue ces tickets une fois habitué. »
La tenue de registres supplémentaire qu'impliquait la proposition
de Hall suscita une vive réplique de George F. Durant, vice-président
de la Bell Company de Saint-Louis. Un tel système, se plaignit
Durant, serait un « cauchemar » à mettre
en œuvre. Dans son bureau, Durant se vantait : « Nous
avons supprimé le papier : nous ne gardons aucune trace
de quoi que ce soit. »« Quel mal y avait-il, demanda
Durant pour la forme, à simplement augmenter les tarifs ?»
Pour illustrer son propos, il raconta une conversation récente
avec un abonné. Le réseau de Saint-Louis, déclarait-il,
devenait trop vaste, rendant plus difficile l’accès à
Internet (les opérateurs ayant davantage de connexions à
établir) et la communication avec un abonné précis
(la ligne étant plus susceptible d’être déjà
utilisée). Ne serait-il pas préférable, concluait
l’abonné, que l’entreprise maintienne la taille de
son réseau (et la qualité du service fourni) en augmentant
ses tarifs à, disons, 120 $ par an.« Le service
mesuré présentait un avantage incontestable par rapport
aux tarifs forfaitaires. Tant que les sociétés d’exploitation
facturaient un abonnement mensuel unique, les abonnés avaient
un cri de ralliement évident : maintenir le tarif bas. »
En revanche, un service mesuré décourageait la mobilisation
politique en divisant les usagers en camps rivaux. Ou, comme le dit
si bien Hall, « il gâchait l'unanimité avec
laquelle ils [les usagers du téléphone] s'unissaient contre
toute tentative d'augmentation des tarifs ».
La perspective que les abonnés du téléphone s'unissent
pour s'opposer à une augmentation des tarifs – ou, plus
inquiétant encore, qu'ils fassent pression pour une baisse –
était une source constante d'inquiétude pour les dirigeants
des compagnies d'exploitation. Les abonnés du téléphone
ont exercé une pression quasi constante sur les autorités
locales et étatiques pour réguler les tarifs pratiqués
par les compagnies de téléphone, et ont, dans un cas célèbre,
obtenu un coup d'État législatif.
En 1884, l'assemblée législative de l'Indiana a adopté
un barème tarifaire maximal pour les compagnies de téléphone
opérant dans l'État.
La Central Union Telephone Company, titulaire de la licence Bell de
l'Indiana, a fait appel de la décision devant la Cour suprême
de l'Indiana, en vain. (La loi était illégale, soutenait-elle,
car son activité avait été rendue possible par
des droits de brevet garantis par le gouvernement fédéral,
sur lesquels l'État de l'Indiana n'avait aucun droit d'interférer.)
La loi tarifaire de l'Indiana a eu un effet considérablement
délétère sur le service téléphonique
dans l'Indiana.
Si la loi était maintenue par les tribunaux, prédisait
un directeur d'entreprise, le service téléphonique dans
l'Indiana serait « sérieusement paralysé »
et, dans de nombreux endroits, l'utilisation du téléphone
« absolument interdite ». Suite à la décision
de justice, cette prédiction s'est réalisée. Le
comité exécutif de la Central Union a voté à
l'unanimité pour autoriser son président à fermer
tous les centraux de l'Indiana qui ne pouvaient pas passer au service
tarifé.
En peu de temps, la Central Union, titulaire de la licence Bell, a fermé
5 de ses 39 centraux et a basculé les autres vers le service
tarifé.ci Au cours des années suivantes, les deux tiers
des centraux téléphoniques de l'État ont été
fermés, y compris la quasi-totalité des centraux du sud
de l'État, ainsi que la moitié des téléphones.
Lorsque 500 abonnés d'Indianapolis se sont regroupés et
ont refusé de payer les nouveaux tarifs, les responsables de
l'entreprise ont menacé de retirer physiquement les téléphones
des « abonnés en grève ».
Les responsables de l'entreprise ont régulièrement qualifié
la protestation des abonnés de « grève ».
Bien que cette phase soit généralement considérée
comme se rapportant exclusivement aux conflits entre la direction et
les travailleurs, dans les années 1880, elle était couramment
utilisée pour désigner non seulement les boycotts de consommateurs
(comme les grèves des utilisateurs de téléphone),
mais aussi les législations hostiles. (Cela signifie que non
seulement un employé, mais aussi un consommateur, et même
un homme politique, pouvait « faire grève »
contre une entreprise.)
Pour les abonnés du téléphone d'Indianapolis, la
politique et l'économie se confondaient. Comme l'a observé
un directeur d'exploitation, il était courant parmi les grévistes
de dire qu'ils « n'avaient aucune plainte à formuler
concernant le service, que le téléphone valait bien ce
qu'il leur coûtait, mais qu'ils se battaient pour ce à
quoi ils estimaient avoir légalement droit ». Pourtant,
le résultat était le même : une baisse des
revenus pour la compagnie de téléphone et une forte réduction
du niveau de service. Les dirigeants des sociétés d'exploitation
ont rarement manqué d'occasions de souligner que la loi tarifaire
de l'Indiana s'était avérée « désastreuse
» pour le secteur du téléphone dans l'Indiana, prédisant
qu'elle servirait d'avertissement aux autres législatures pour
qu'elles ne s'immiscent pas dans leurs prérogatives. Fay est
allé jusqu'à exhorter les sociétés d'exploitation
téléphonique à rendre publiques toutes ces attaques
législatives afin de les décourager de se reproduire.
Le rapport de Fay a reçu la réponse prévisible
selon laquelle une telle publicité ne ferait qu'encourager de
nouvelles attaques législatives. À cette époque,
la plupart des sociétés d'exploitation, suivant l'exemple
d'American Bell (connue pour son « silence d'or »), commentaient
rarement l'actualité dans la presse. Les seules sociétés
d'exploitation à publier des rapports annuels étaient
la New England Telephone Company, la Southern New England Telephone
Company et la New York and New Jersey Telephone Company. La Chicago
Telephone Company ne publia son premier rapport annuel qu'en 1899.
Les dirigeants de la compagnie d'exploitation réagirent avec
colère et inquiétude à la perspective d'une législation
sur les tarifs. Les factures de tarifs maximums, balbutiait Fay, étaient
invariablement l'œuvre d'extorqueurs – la « pire classe
» de notre population – qui les lançaient dans l'espoir
que les responsables de la compagnie de téléphone pourraient
trouver un intérêt à les acheter. Des législateurs
honnêtes, rapportait Fay, pouvaient aider la compagnie à
repousser de telles attaques. Pourtant, tous les législateurs
n'étaient pas honnêtes. Pour parer à toute éventualité,
sa compagnie surveillait de près les projets de loi en cours
à Springfield (la capitale de l'État) et dépensait
des sommes importantes en lobbyistes pour repousser les attaques législatives
contre ses prérogatives.cix La conviction de Fay, de l'UIC Great
Cities Institute, selon laquelle des extorqueurs désireux de
faire chanter les compagnies de téléphone exerçaient
librement leur métier dans les capitales des États était
largement partagée. En effet, cette pratique était si
courante qu'elle fut surnommée « sandbagging ».
Même les rédacteurs hostiles aux licences Bell la déplorèrent
et espérèrent que des mesures seraient prises pour empêcher
qu'elle ne se reproduise.
Les manœuvres de sabotage étaient peut-être notoires,
mais elles pouvaient parfois réussir, et elles ont parfois réussi.
En 1888, par exemple, le conseil municipal de Chicago a contraint la
Chicago Telephone Company à accepter une nouvelle franchise plafonnant
le tarif fixe, après une longue lutte au cours de laquelle le
conseil municipal avait refusé à l'entreprise les permis
nécessaires au maintien du service téléphonique
pour les abonnés ayant changé d'adresse. La consternation
de Fay était exacerbée par la probabilité que d'autres
États suivent l'exemple de l'Indiana. Et le danger était
particulièrement grand dans l'État de New York, où
se trouvent deux des plus grandes compagnies de téléphone
du pays : Metropolitan à New York (ou Manhattan aujourd'hui),
et New York et New Jersey à Brooklyn. Lors de presque chaque
session annuelle de l'assemblée législative de l'État
de New York entre 1888 et 1894, des groupes d'utilisateurs du téléphone
ont fait pression pour une loi sur le tarif maximum. Aucun n'a réussi.
Pourtant, cette agitation a déclenché une enquête
législative majeure, a généré une importante
publicité et a obtenu le soutien de dizaines de groupes d'entreprises,
dont le New York Board of Trade and Transportation, une vénérable
association professionnelle new-yorkaise dont les dirigeants comprenaient
le respecté avocat Simon Sterne.
Rien n'a rendu plus probable la perspective d'une législation
hostile que la menace d'un boycott des utilisateurs du téléphone.
L'un des premiers boycotts a eu lieu à Washington D.C. en 1881,
en réponse à la tentative avortée des dirigeants
de sociétés d'exploitation d'imiter l'exemple de Hall
à Buffalo et de remplacer les tarifs forfaitaires par un service
mesuré. Le plus célèbre a eu lieu cinq ans plus
tard, à Rochester, dans l'État de New York. Durant les
quinze mois qui ont suivi, de novembre 1886 à mars 1888, les
abonnés du téléphone de Rochester ont organisé
un boycott de la compagnie de téléphone, sans précédent
dans l'histoire du téléphone, qui a finalement réussi.
La « guerre du téléphone », comme
la presse l'a surnommée, était unique : rien de tel
ne s'était jamais produit auparavant et rien de tel ne se reproduirait.
Sur les quelque 900 abonnés au téléphone de la
ville, plus de 800 ont signé un engagement à « raccrocher ».
Presque personne n'a violé cet engagement, rendant le service
téléphonique – comme l'a relaté un rédacteur
en chef peu après la fin du boycott – « pratiquement
inutile » pendant plus d'un an.
« Veuillez débarrasser ma maison de votre téléphone »,
a imploré un abonné furieux auprès d'un responsable
de l'entreprise peu après le début de la grève :
tout ce qui touchait à l'entreprise était « indésirable
et inesthétique » : « Quittez la ville
au plus vite et laissez-nous nous reposer. »
Le catalyseur du boycott fut la décision de la Hall's Bell Telephone
Company de Buffalo (le territoire de l'entreprise englobait Rochester)
d'obliger les utilisateurs de téléphone de Rochester à
passer d'un forfait à un service tarifé. Cela allait forcément
susciter la controverse : les abonnés du téléphone
de tout le pays préféraient les tarifs forfaitaires, et
Rochester ne faisait pas exception. L’imposition d’un service
tarifé n’était qu’un des nombreux griefs des
usagers de Rochester à l’égard de l’entreprise.
De plus, ils critiquaient la manière péremptoire avec
laquelle elle avait tendu des centaines de kilomètres de câbles
aériens le long des rues de Rochester, qu’ils considéraient
non seulement laids, mais aussi dangereux. Bien que les lignes téléphoniques
soient à basse tension, elles pouvaient facilement s’emmêler
avec les lignes électriques, ce qui n’était pas le
cas. Les lignes téléphoniques tombées au sol représentaient
donc un danger potentiellement mortel. Les journaux rapportaient fréquemment
des cas de citadins blessés, voire électrocutés,
par des lignes électriques tombées au sol. Dans un procès
célèbre, l’entreprise de Hall a été
tenue responsable du décès d’un homme de Buffalo
électrocuté par un fil électrique tombé
au sol, qui, de l’avis d’un juré, constituaient des
« pièges secrets et mortels pour la vie humaine ».
Si le service de mesure et les lignes aériennes étaient
le principal grief des usagers du téléphone de Rochester,
d'autres considérations, plus purement locales, figuraient également
dans la protestation. Les habitants de Rochester étaient profondément
mécontents que leur compagnie de téléphone ait
son siège social non pas à Rochester, mais à Buffalo.
Comment cela était-il possible, se demandaient-ils, dans une
ville qui avait donné naissance à Western Union ?
Qu'est-ce qui empêchait les commerçants de Rochester, a
déclaré un passionné local du téléphone,
de reconstruire un empire des communications d'« importance
nationale » ?
La contestation de ce passionné a reçu un soutien important
du conseil municipal de Rochester, qui a empêché la compagnie
d'exploitation associée à Bell d'inscrire de nouveaux
abonnés et a laissé entendre qu'elle pourrait même
prendre la mesure encore plus radicale de démanteler ses lignes.
« Il y avait une forte impression populaire »,
expliqua Hall au président d’American Bell, John Hudson,
que la société de Rochester
n’avait aucun « droit légal ».cxx
Enhardi par la loi sur les tarifs de l’Indiana, le conseil municipal
espérait susciter suffisamment d’enthousiasme pour obtenir
un système similaire à New York.
Derrière ces problèmes se cachait un fossé culturel.
Un service tarifé représentait, dans l'esprit des abonnés
de Rochester, une intrusion injustifiée de l'opérateur
téléphonique dans le foyer patriarcal. Tant que les tarifs
fixes prévalaient, John Van Voorhis, chef de la grève,
expliqua à un journaliste local qu'il ne voyait aucun mal à
permettre à ses enfants d'utiliser son téléphone
pour appeler leurs amis. Pourtant, s'il devait payer 10 centimes pour
chaque appel sortant, il cesserait immédiatement cette pratique.
« Je suis heureux de satisfaire mon voisin, comme de toute autre
manière », déclara Voorhis, « et cela ne regarde
pas l'entreprise. » L'affrontement entre Voorhis et Hall met en
évidence le fossé culturel entre Hall, gestionnaire d'un
réseau public, et Voorhis, utilisateur du réseau, qui
s'offusquait de l'ingérence de l'opérateur dans ce qu'il
considérait comme ses affaires personnelles.
Alors que la grève se prolongeait, les promoteurs téléphoniques
rivaux considéraient Rochester comme un marché prometteur.
Parmi eux se trouvait Sylvanus Cushman,
un inventeur non conformiste qui prétendait avoir inventé
le téléphone avant Bell. (La loi américaine sur
les brevets reconnaissant la priorité de l'invention de l'UIC
Great Cities Institute, par opposition à la priorité du
brevet, la revendication de Cushman, si elle avait été
confirmée par les tribunaux, aurait privé American Bell
de son principal actif.). Cushman n'a jamais créé de compagnie
téléphonique à Rochester ; il a cependant
installé plusieurs centraux dans l'Indiana (principalement dans
des villes que Central Union avait désertées suite à
la loi sur les tarifs de l'Indiana).
Comme on pouvait s'y attendre, Cushman s'est rapidement retrouvé
défendeur devant les tribunaux dans un procès pour contrefaçon
de brevet et, en 1888, a été contraint de fermer boutique.
Un rédacteur en chef d'un journal de Rochester a imputé
la grève à Hall. Si Hall avait été moins
obstiné, prédisait-il, la controverse aurait été
rapidement résolue. Pour sortir de l'impasse, le président
Forbes fit appel à David Bigelow Parker, une personnalité
publique respectée et familière avec la dynamique particulière
de la politique du nord de l'État de New York (il était
originaire du comté voisin de Chatauqua) et qui travaillait pour
Bell depuis 1883.
Ce fut une décision judicieuse. Avant sa nomination chez American
Bell, Parker avait mené une longue et brillante carrière
au sein du département des Postes, où il s'était
distingué comme un administrateur compétent et doué
pour les relations publiques. Parker charma tous ceux qu'il rencontra
à Rochester et parvint à négocier la fin de la
grève. (Parker abandonna l'insistance de Hall sur un service
mesuré et persuada le comité exécutif de nommer
au moins un résident de Rochester à son conseil d'administration).
Bien que ce résultat ait constitué un revers pour le service
mesuré, il fut accueilli avec un immense soulagement par le président
de Metropolitan Telephone, Theodore N. Vail, car il éliminait
un point de friction susceptible de déboucher sur une législation
défavorable à Albany. Vail trouva particulièrement
inutile que les responsables d'American Bell aient accusé les
partisans de Cushman de contrefaçon de brevet. En faisant ainsi
étalage de leurs prérogatives légales avec arrogance,
ils avaient « créé un enthousiasme » qui avait
enflammé l'opinion publique et qui fut, à juste titre,
perçu par les abonnés en grève comme une rupture
de la « trêve en suspens ».
Bien que la grève de Rochester n'ait pas abouti à la législation
hostile que Vail craignait, elle semble avoir influencé les recommandations
de l'une des premières grandes enquêtes sur le service
téléphonique.
En 1888, l'assemblée législative de l'État de New
York nomma une commission chargée d'enquêter sur le service
téléphonique dans l'État.
Cette commission, qui se réunit alors que la grève de
Rochester était toujours en cours, publia finalement un rapport
recommandant à la fois une loi sur les tarifs maximums imposée
par l'État (ce que les grévistes de Rochester souhaitaient
vivement) et un passage progressif à un service tarifé
(l'objectif de Hall). Bien que le parlement de l'État n'ait jamais
promulgué la loi tarifaire proposée, son approbation du
service mesuré a ouvert la voie à l'avenir.
Le service mesuré a peut-être été abandonné
à Rochester, mais en moins d'une décennie, il a été
introduit dans la plupart des grands centres commerciaux du pays. L'opposition
farouche des commerçants de Rochester a finalement témoigné
de leur provincialisme.
Le déluge de lois téléphoniques hostiles inquiéta
de nombreux dirigeants du secteur, dont le président d'American
Bell, William L. Forbes.
En 1884, un groupe d'utilisateurs du téléphone basé
au Massachusetts, connu sous le nom de « Telephone
Subscriber’s Association », exhorta le législateur
de l'État à réglementer – une « façon
polie », selon les termes d'un rédacteur en chef,
« de dire “réduire” » –
les tarifs téléphoniques dans tout l'État. L'« ingérence
constante » des législateurs de l'État dans
les affaires de l'entreprise, confia Forbes à l'éminent
banquier Henry L. Higginson en 1886, conjuguée à une menace
de contestation judiciaire des brevets de Bell, le poussa à envisager
sérieusement de vendre ses (petites) participations dans la société
d'exploitation de Nouvelle-Angleterre.
Forbes trouvait particulièrement inquiétante la possibilité
que la Cour suprême invalide les brevets de Bell ; cela « l'inquiétait
au plus haut point », du moins c'est ce qu'il confia à
Higginson. Forbes trouvait tout aussi inquiétante la perspective
d'une législation hostile de l'État. Que les législateurs
s'attaquent ainsi à une entreprise qui s'était révélée
si lucrative pour ses investisseurs paraissait à Forbes le comble
de la folie. Après tout, à cette époque, la grande
majorité des actionnaires d'American Bell vivaient – comme
Forbes – dans le Massachusetts. Forbes se considérait comme
un sauveur du secteur et fustigeait le pouvoir législatif pour
son incapacité à en apprécier le dynamisme inhérent.
« Je ne crois pas », écrivait Forbes à Higginson,
qu'il fût notoire que, si Western Union n'avait rencontré
aucune opposition en 1878 – comme elle l'avait été
de tous –, elle aurait étouffé l'industrie téléphonique
naissante, la considérant comme une interférence avec
le télégraphe, et alors « nous n'aurions pas eu
de téléphone digne de ce nom ».
L'année précédant la grève du téléphone
à Rochester, le président de la NTEA, Charles N. Fay,
s'est penché, dans son discours annuel, sur les défis
auxquels étaient confrontés les dirigeants des compagnies
téléphoniques. Les récentes poursuites judiciaires
contre les agitateurs qui (du moins, c'est ce que Fay croyait) avaient
fomenté l'attentat de Haymarket à Chicago, avaient, selon
Fay, heureusement marqué le « triomphe du droit sur
l'anarchie et le socialisme ». Maintenant que cette crise
était passée, les affaires allaient certainement s'améliorer.
Cela était vrai, même si les autorités étatiques
et locales continuaient de faire pression pour une législation
obligeant les opérateurs téléphoniques à
limiter leurs tarifs et à enterrer leurs lignes, tandis que les
autorités fédérales (menées par le procureur
général) attaquaient les brevets de Bell devant les tribunaux.
Il était « incontestable », concédait
Fay, qu'une « vague d'hostilité populaire »
– une véritable « téléphomanie »
– balayait le pays.
Pourquoi, se demandait Fay, l'industrie téléphonique était-elle
devenue l'objet d'une attaque aussi implacable ? Fay soupçonnait
que l'explication résidait en partie dans la vulnérabilité
particulière des compagnies de téléphone face à
l'extorsion, possédant des installations coûteuses et inamovibles.
Quoi que fasse le gouvernement, la Chicago Telephone Company ne pouvait
guère déménager à Milwaukee. « Partout,
localisées », déplorait Forbes, les compagnies
de téléphone étaient les « monopoles
les plus visibles et les plus tangibles ». Qu'elles se soient
avérées rentables ne faisait qu'empirer les choses. Bien
qu'il n'y ait pas eu de « millionnaires du téléphone »
comparables aux magnats du télégraphe Vanderbilt et Gould,
certains individus (Fay aurait pu se nommer lui-même, mais il
ne l'a pas fait) avaient trouvé le moyen de rentabiliser ce nouveau
média. Et la richesse était presque invariablement une
source de ressentiment. Malgré cela, observait Fay, il restait
perplexe quant à la raison pour laquelle, à une époque
où toute entreprise était suspecte, l'industrie du téléphone
avait suscité une telle inquiétude. Après tout,
dans la « nature des choses », la « grande masse du
peuple » n'y était pour rien. Les 160 000 téléphones
installés par les responsables de la société exploitante
ne desservaient pas plus d'un quart de pour cent de la population. Et
rien de ce que lui ou quiconque faisait ne pouvait étendre significativement
la taille du réseau. « Dans nos rêves les plus fous
», prédisait Fay, « nous ne pouvons espérer
» atteindre plus d'un demi pour cent de la population – une
infime fraction qui était « de toute évidence, à
tous égards, composée de la classe capitaliste aisée
».
Et les riches, du moins c'est ce que supposait Fay, étaient parfaitement
capables de payer les frais que la société pouvait proposer.
Que le téléphone puisse un jour devenir un média
véritablement populaire était incompréhensible
pour Fay.
Ses convictions à ce sujet divergeaient tellement des déclarations
enthousiastes de pionniers du téléphone comme Alexander
Graham Bell qu'elles méritent d'être citées en détail :
Les utilisateurs du téléphone sont des hommes dont l'activité
est si étendue et le temps si précieux qu'ils exigent
une communication locale rapide et universelle. Un ouvrier qui part
au travail avec son panier-repas n'a aucune raison de téléphoner
chez lui et sera en retard pour dîner ; le petit chef de
famille, dont l'épicier habite au coin de la rue, ne débourserait
pas un centime pour un téléphone permettant de le joindre ;
le villageois, dont le rythme est déterminé et constant,
fera chaque fois les quelques pas nécessaires pour aller voir
son voisin afin d'économiser cinq sous. Le téléphone,
comme le télégraphe, la poste et le chemin de fer, n'est
utilisé ou nécessaire que dans des circonstances exceptionnelles
par les pauvres. Il est exigé, on en dépend quotidiennement,
et il devrait être généreusement financé
par les classes capitalistes, marchandes et manufacturières.
Ces discours sur l'oppression du peuple sont de la pure absurdité.
Il est vrai que tout le monde aimerait avoir un téléphone
s'il pouvait en obtenir un gratuitement, mais tout le monde aimerait
aussi avoir des chevaux, des voitures, de quoi manger, boire et se vêtir
gratuitement ; et ces derniers seraient bien plus appréciés
par les pauvres que le téléphone. Si, par conséquent,
l'État doit intervenir pour fournir à tous des produits
de luxe à bas prix, il ferait mieux de commencer par ceux qui
seraient les plus universellement bienvenus.
Fay a développé les lacunes de l'abonné téléphonique
moyen de manière encore plus détaillée l'année
suivante, dans ce qui allait être son dernier discours en tant
que président de la NTEA. La grève du téléphone
de Rochester n'était pas encore résolue, et Fay y pensait
beaucoup. Aucun discours public d'un leader du téléphone
au XIXe siècle n'avait exposé avec plus de franchise les
prémisses qui ont guidé la réflexion des dirigeants
d'entreprises d'exploitation à l'époque où le secteur
était en plein essor. Le discours de Fay était si direct
que les rédacteurs en chef de la presse spécialisée
ont refusé de le reproduire ; il a également été
discrètement omis de certains exemplaires des actes publiés
de la NTEA, notamment chez AT&T.
L'« impopularité » des entreprises d'exploitation
téléphonique, a averti Fay à ses collègues,
était leur « faiblesse la plus flagrante ».
Le fait que neuf hommes sur dix dans chaque communauté soient
hostiles à leur opérateur téléphonique constituait
une « grave menace » pour notre « existence
même ». L'impopularité de la compagnie de téléphone
a eu diverses conséquences : la plus évidente a été
de créer un climat propice à l'adoption de lois, de décisions
administratives et de décisions judiciaires défavorables.
De plus, elle a alimenté le « sentiment vague »
que les franchises des compagnies d'exploitation devaient être
confiées à un « important tiers appelé
l'État » – un sentiment que Fay a qualifié
d'« anti-américain, contre nature et de pur socialisme ».
L'omniprésence de cette hostilité était un « phénomène
extraordinaire » – comment l'expliquer ? Comment,
en effet, un service inoffensif, innocent et utile, fréquenté
par une infime fraction de la population, a-t-il pu devenir « odieux
aux masses » ?
La réponse résidait dans les idées néfastes
popularisées par les abonnés au téléphone.
Fay prévenait que les abonnés pourraient se prendre pour
des « propriétaires conservateurs ». En
réalité, il s'agissait de « socialistes »
qui, à l'instar des Chevaliers du Travail, recouraient aux grèves
et aux boycotts de l'UIC Great Cities Institute pour atteindre leurs
objectifs douteux. Comble de malheur, les grévistes comptaient
parmi les plus riches de la communauté. « Le téléphone
est particulier », déclara Fay, reprenant un thème
développé l'année précédente, car
il était « presque entièrement fréquenté
par les ploutocrates du pays : les commerçants, les banquiers,
les professionnels, les dirigeants de grandes entreprises, etc. ;
en un mot, par la classe la plus riche, la plus instruite et la plus
conservatrice, limitée à environ 0,5 % de la population.
»
Avant Haymarket, expliquait Fay, la plupart des Américains (qu'ils
le sachent ou non) étaient socialistes, dans le sens où
ils s'opposaient aux fortunes colossales amassées par des hommes
comme Astor, Vanderbilt et Gould. Ce ressentiment se traduisit par une
vague de lois anti-entreprises (notamment une législation taxant
injustement les sociétés) et encouragea les syndicats
comme les Chevaliers du Travail à faire valoir leurs droits,
une situation qui culmina à Haymarket.
Après Haymarket, les Chevaliers du Travail avaient heureusement
compris qu'ils ne pouvaient pas « outrepasser » les «
lois du commerce et de la nature humaine ». Les abonnés
au téléphone, malheureusement, n'avaient pas encore retenu
la leçon. Par conséquent, les compagnies téléphoniques
continuèrent d'être exposées à des «
attaques populaires directes et concentrées » à
un degré « jusqu'alors inconnu et impossible parmi les
autres monopoles ». Il incombait aux dirigeants des entreprises
exploitantes de répondre à ces attaques par le «
terrain le plus large et le plus élevé ». Ils doivent
défendre le « bien public » et non le simple «
intérêt pécuniaire ». Ils doivent montrer
même à nos « citoyens les plus éclairés
» qu'il existe un « Chevalier du Travail ignorant, vicieux
et irraisonné » sous le masque du « brillant rédacteur
en chef » ou du « financier conservateur ».
Un « peuple grand et intelligent » ne peut être en
« guerre » avec ses industries productives, « les
moyens et la base mêmes de son existence ». Les entreprises,
tout comme les « grands capitalistes », ont des «
pouvoirs transcendants pour le bien » :
elles ne doivent pas être « toujours » considérées
comme les « ennemis naturels du peuple ». cxlvi Organisation
et éducation étaient à l'ordre du jour : les pauvres
apprendront la « valeur inestimable » des richesses ; le
riche sa « responsabilité envers les pauvres » ;
et les « clients endeuillés » de la compagnie de
téléphone (si les grévistes réussissaient)
écriraient son épitaphe : « Ici repose
le téléphone, le plus grand et le plus bienveillant de
tous les monopoles. »
Peu après le départ de Fay de la Chicago Telephone Company,
ses prédictions ont bien failli se réaliser. En février 1888,
le conseil municipal de Chicago a interdit à la Chicago Telephone
Company de poser des lignes téléphoniques supplémentaires
dans la ville (aériennes ou souterraines).
Cette interdiction empêchait non seulement la compagnie de solliciter
de nouveaux clients, mais aussi de maintenir le service pour les abonnés
ayant changé d’adresse.
Le conseil municipal a probablement utilisé cette interdiction
comme monnaie d’échange pour obtenir de la compagnie une
baisse importante des tarifs. Cela faisait suite – et pourrait
bien être une réponse – à la déclaration
publique stupéfiante d'un responsable anonyme de la Chicago Telephone
Company (probablement pas Fay, puisqu'il était déjà
parti à ce moment-là) selon laquelle la compagnie avait
le droit de facturer les tarifs qu'elle souhaitait et que, même
en augmentant ses tarifs à 500 dollars par an et en réduisant
son nombre d'abonnés à 1 000, elle continuerait à
fournir un service « absolument satisfaisant ».
L'interdiction a eu pour effet – et c'était peut-être
son objectif – de créer un sujet de discorde autorisant
les abonnés à exprimer leur indignation envers la compagnie.
En septembre suivant, 3 000 abonnés – soit près
de la moitié des abonnés de la ville – ont signé
une pétition exhortant le conseil municipal à réduire
le tarif maximum de la compagnie à 75 dollars par an. Des rumeurs
ont circulé selon lesquelles de nombreux signataires de la pétition
avaient accepté de verser à leurs conseillers municipaux
jusqu'à 10 dollars chacun si la baisse des tarifs était
adoptée, ce qui a fait craindre une corruption de la proposition
et un pot-de-vin pour le conseiller municipal. (Ce dernier a répondu
qu'ils avaient utilisé cet argent pour embaucher des collecteurs
de pétitions.)
Le mois suivant, le président de la Chicago Telephone Company,
George Phillips, a rejeté la requête des pétitionnaires,
arguant que le conseil municipal n'avait pas l'autorité nécessaire
pour fixer les tarifs.
Sans se laisser décourager, le conseil municipal a fait pression
sur l'assemblée législative de l'État pour qu'elle
lui accorde ce pouvoir, tandis que 400 abonnés, privés
de service après que le conseil municipal eut refusé à
la compagnie de téléphone l'autorisation de poser des
câbles supplémentaires, ont adressé une pétition
au conseil municipal pour contraindre la compagnie à rétablir
leur service téléphonique.
Peu de personnes au courant de l'actualité doutaient de la possibilité
d'une législation confiscatoire. À Saint-Louis, la compagnie
d'exploitation associée à Bell avait commencé à
démanteler ses équipements en réponse à
une décision du conseil municipal réduisant de moitié
les tarifs téléphoniques. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher
une situation similaire à Chicago où, comme l'a déclaré
un rédacteur en chef, « aucune faveur n'a jamais été
accordée à la compagnie de téléphone » ?
À l'époque progressiste, aucune contestation de l'industrie
du téléphone – pas même la prise de contrôle
du réseau téléphonique pendant la Première
Guerre mondiale – ne s'est produite dans un contexte politique
plus conflictuel ou plus incertain que celui auquel la Chicago Telephone
Company a été confrontée à l'automne 1888.
La lutte pour la franchise s'est terminée par l'octroi d'une
nouvelle charte à la Chicago Telephone Company en janvier 1889.
Parmi les concessions obtenues par le conseil municipal, figurait une
clause autorisant l'installation de téléphones publics.
Les abonnés pouvaient installer un téléphone public
dans n'importe quel lieu public à condition de verser à
la compagnie un supplément de 25 dollars par an. Pour éviter
tout abus de ce privilège, les non-abonnés étaient
censés verser à l'abonné dix centimes pour chaque
appel.
sommaire
La négociation des accords de droit de passage et la prévention
d'une législation tarifaire défavorable constituaient
les principaux défis politiques auxquels les dirigeants des sociétés
d'exploitation urbaines étaient confrontés entre 1879
et 1894. Leur plus grand défi organisationnel était la
conception et l'installation des machines permettant d'acheminer les
impulsions électriques entre les différents abonnés
téléphoniques, ainsi que la coordination des opérateurs
qui les géraient.
Le standard téléphonique
était l'appareil le plus coûteux, le plus complexe et le
plus élémentaire de ces machines.
Entre 1879 et 1894, la conception des standards téléphoniques
progressa rapidement et, dans la plupart des centraux urbains, le standard
téléphonique dut être modernisé à
plusieurs reprises.
À Chicago, le standard téléphonique principal fut
reconstruit cinq fois entre 1879 et 1888. À Buffalo, il fut reconfiguré
trois fois avant avril 1881.
La conception du standard téléphonique de la grande compagnie
d'exploitation urbaine fut en grande partie l'œuvre d'une équipe
ingénieuse d'ingénieurs autodidactes travaillant pour
Western Electric, l'entreprise de fabrication d'équipements électriques
de Chicago dont American Bell prit le contrôle en 1882. La proximité
physique de Western Electric et de la Chicago Telephone Company favorisa
grandement l'innovation : les responsables de la compagnie d'exploitation
eurent amplement l'occasion de proposer des améliorations, tandis
que les ingénieurs n'eurent aucune difficulté à
acquérir l'expérience pratique qui a si souvent servi
de catalyseur au changement.
Parmi les principaux collaborateurs de Western Union figuraient Leroy
Firman, J. J. O'Connell et Charles
E. Scribner.
Leur machinerie fut connue sous le nom de standard
multiple ; Une fois perfectionné, il permettait
à un seul opérateur de connecter jusqu'à 10 000
abonnés différents. (la limite maximale était de
10 000, compte tenu de la longueur des bras de l'opérateur).
Son « idée fondamentale », comme l'expliquait
Lockwood, électricien chez Bell, en 1884, était de permettre
à un seul opérateur de connecter des abonnés sans
se déplacer et avec un minimum d'effort physique. Il ne serait
plus nécessaire de répéter les commandes oralement
ou par des tickets papier (appelés « tickets »).
Firman conçut le premier standard téléphonique
de Chicago, mais ne resta pas longtemps dans le domaine, quittant Western
Electric en 1883. O’Connell inventa un signal électrique
qui éliminait le besoin pour l’abonné de tourner
une manivelle pour joindre l’opératrice – une procédure
standard aux débuts de l’industrie. Scribner conçut
plusieurs mécanismes de rétroaction de l’UIC Great
Cities Institute – dont l’ancêtre du signal d’occupation
moderne – pour informer les opérateurs lorsqu’un abonné
cherchait une connexion ou qu’une ligne était utilisée.
L’inventivité de Scribner chez Western Electric ne se limitait
en aucun cas à la téléphonie.
Seul Edison (ou, selon les partisans de Western
Electric, selon les dires) avait déposé d’autres
brevets ; et seuls Edison et Elihu Thompson en détenaient
davantage. Edison lui-même louait Scribner comme l’inventeur
le plus « industrieux » qu’il ait jamais
rencontré. Après la mort de Scribner, l'ingénieur
d'AT&T, Frank Jewett, le considéra comme le « gland »
à l'origine des Laboratoires Bell. « Si la structure
d'ingénierie qui fait notre gloire aujourd'hui existe au cœur
même d'une grande industrie », déclarait Jewett
en 1919, « c'est à Charles E. Scribner et aux hommes
dont il s'est entouré ».
Sans le leadership précoce de Scribner, ajouta Jewett, « aucune
organisation telle que celle que nous connaissons aujourd'hui ne pourrait
espérer exister. »
Comme la plupart des premiers inventeurs du téléphone,
Firman, O'Connell et Scribner manquaient de formation d'ingénieur
et ne semblaient pas se considérer comme des ingénieurs
électriciens. Cela explique peut-être pourquoi ils furent
si vite oubliés.
L'apprentissage par la pratique n'était pas une méthode
qui s'imposait à la génération suivante d'ingénieurs
de Bell, ni au premier directeur de la recherche d'AT&T, John
J. Carty.
Comme tant de scientifiques industriels du XXe siècle, Carty
approuvait le « modèle linéaire »,
aujourd'hui discrédité, qui attribuait les innovations
techniques à des découvertes scientifiques antérieures.
Si AT&T avait conservé un centre de recherche à Chicago
après le retour de Vail à la présidence en 1907,
Firman, O’Connell et Scribner seraient peut-être restés
célèbres, du moins dans les cercles de Bell. Pourtant,
Vail ferma le centre de recherche de Chicago peu après son retour ;
ce faisant, il s'assura pratiquement qu'ils tomberaient dans l'oubli.
Edison fut peut-être le premier, mais il ne fut en aucun cas le
dernier, inventeur-entrepreneur à voir ses innovations dénigrées
par ses successeurs, les qualifiant de simples « essais ».
Il existait peu de prototypes de standard multiple. Bien que les premiers
concepteurs, comme Firman, se soient inspirés de précédents
télégraphiques, les standards utilisés par les
compagnies télégraphiques intra-urbaines étaient
minuscules en comparaison. Les standards téléphoniques
étaient généralement conçus pour des réseaux
ne dépassant pas 500 nœuds et étaient principalement
destinés à connecter les abonnés à un central
téléphonique, une tâche bien plus simple. Les responsables
des entreprises d'exploitation, en revanche, avaient besoin de standards
capables de connecter un nombre beaucoup plus important de personnes
directement et rapidement. Réduire le temps de connexion était
primordial, car les abonnés ne voyaient que peu d'intérêt
à un service aussi rapide qu'un coursier.
Le bon fonctionnement du standard téléphonique dépendait
de la dextérité des opératrices qui effectuaient
les connexions nécessaires à la réalisation d'un
circuit. La commutation automatique restait une invention du futur.
Chaque appel téléphonique acheminé par les standards
des entreprises exploitantes (145 000 par jour à Chicago
en 1893) nécessitait l'intervention délibérée
d'une opératrice qualifiée, dont la quasi-totalité,
après le début des années 1880, était des
femmes. C'était une époque où, comme l'a si bien
observé un historien, « les femmes étaient
des opératrices ».
Ce n'est qu'après 1920 que les dirigeants des entreprises d'exploitation
associées à Bell commencèrent à supplanter
l'opératrice téléphonique par le matériel
de commutation automatique que nous tenons pour acquis aujourd'hui.
L'héroïne fictive de Theodore Dreiser, Sœur Carrie,
aspirait peut-être à une carrière d'actrice, mais
pour des milliers de femmes actives, un poste d'opératrice téléphonique
était l'un des meilleurs emplois qu'elles pouvaient raisonnablement
espérer.
Pour la grande majorité des abonnés téléphoniques,
les délais de connexion étaient une préoccupation
bien plus pressante que la possibilité de passer un appel longue
distance. Relativement peu d'abonnés souhaitaient converser avec
quelqu'un à des milliers de kilomètres ; tous souhaitaient
contacter rapidement un associé, un membre de leur famille ou
un ami.
La plupart des améliorations progressives apportées à
la conception des standards téléphoniques visaient à
réduire les délais de connexion.
Les responsables des entreprises d'exploitation s'efforçaient
constamment de réduire l'intervalle entre le moment où
un abonné contactait un opérateur et celui où celui-ci
passait l'appel. À cette fin, ils collectaient des données
détaillées sur les temps d'attente moyens. En 1882, le
temps d'attente moyen pour une connexion locale à Chicago était
de cinq minutes ; jusqu'en 1887, il restait (pour une connexion
locale) de 45 secondes. Les longs délais d'attente ont
ralenti l'introduction des équipements de commutation automatique :
un premier test a révélé qu'il était en
réalité plus rapide d'établir une connexion via
un opérateur. En 1900, les opérateurs avaient réduit
le temps d'attente moyen en ligne à seulement 6,2 secondes,
une vitesse qu'aucun système automatique ne pouvait égaler.
L'établissement d'un circuit téléphonique
impliquait une collaboration fructueuse entre au moins trois personnes :
l'opératrice, l'abonné qui appelait et l'abonné
qui décrochait le combiné. La tâche de l'opératrice
était, bien sûr, d'une importance cruciale. Elle devait
non seulement être rapide, mais aussi précise. Il n'était
pas rare, par exemple, qu'une opératrice connecte les mauvais
correspondants. Une de ces erreurs a conduit un abonné à
intenter une action en dommages et intérêts contre l'entreprise.
Il (ou peut-être elle) a été connecté par
erreur au mauvais magasin de chaussures et a porté plainte auprès
de l'opérateur téléphonique lorsqu'il a découvert
qu'il avait acheté la mauvaise paire de chaussures. Fay jugea
ce grief ridicule et modifia le contrat de la compagnie pour l'exonérer
de toute responsabilité : si les abonnés étaient
« assez stupides » pour ignorer à qui ils
parlaient, « ce n'était pas notre faute et nous ne
serions pas responsables ».
Les abonnés devaient eux aussi s'impliquer activement. La compagnie
de téléphone « parfaite », observait
Lockwood en 1884, exigeait la coopération active de l'abonné.
Pour établir une connexion, observait un ingénieur téléphonique,
les abonnés effectuaient les deux tiers du travail.
La « concrétisation d'un appel téléphonique »,
expliquait Angus S. Hibbard, directeur général
de la Chicago Telephone Company, en 1894, « ne dépend
pas entièrement de la compagnie de téléphone ou
de son agent, mais très largement, et dans de nombreux cas presque
entièrement, de l'utilisation intelligente du téléphone
par l'abonné. » En bref, les abonnés au téléphone
étaient un élément nécessaire de la machine.
Les innovations dans la conception des standards téléphoniques
ont contribué à protéger les sociétés
d'exploitation de la concurrence après l'expiration des brevets
fondamentaux de Bell. Désormais, les dirigeants pouvaient utiliser
leurs capacités organisationnelles pour empêcher les concurrents
de pénétrer le marché. L'ingénieur en téléphonie
Herbert Laws Webb observait en 1892 que le « mur intérieur »
qui protégeait l'American Bell Company des attaques concurrentielles
était son portefeuille de brevets ; ses « réseaux »
étaient la position solidement ancrée des sociétés
d'exploitation associées à Bell dans les centres urbains
du pays.
Les brevets avaient été le « noyau et le fondement »
autour desquels les sociétés d'exploitation s'étaient
construites, mais ils ne constituaient plus la « clé
de voûte » de l'« architecture téléphonique ».
L'expiration des brevets fondamentaux de Bell, prédisait Webb,
n'aurait donc « que peu, voire aucun effet » sur
les sociétés d'exploitation téléphonique
des grandes villes. Les entreprises établies occupaient déjà
le terrain, obligeant leurs concurrents non seulement à sécuriser
l'accès aux rues des villes, mais aussi à réaliser
un investissement en capital substantiel.
Les dirigeants des entreprises d'exploitation tenaient pour acquis que
les équipements qu'ils installaient resteraient au mieux en service
cinq ans, faisant de ce secteur un exemple classique du dynamisme inhérent
au capitalisme que l'économiste autrichien Joseph Schumpeter
qualifierait plus tard de « tempêtes » de «
destruction créatrice ». Le passage des circuits mis à
la terre aux circuits métalliques, expliquait John
J. Carty, électricien chez Bell, lors d'une visite du central
du Metropolitan en 1892, avait obligé l'entreprise à remplacer,
au cours des cinq dernières années, l'intégralité
de ses fils, câbles et tableaux.
« Aucun autre service public », concluait Webb,
« n'est exposé aux bouleversements qui surviennent
dans le secteur téléphonique, et aucun ne fait l'objet
de modifications et d'améliorations aussi constantes. »
Tout comme les sociétés d'exploitation d'équipements
téléphoniques avaient été transformées
entre 1879 et 1894, leur structure organisationnelle l'était
également. Là encore, le principal innovateur était
Hall.
Les sociétés, expliquait Hall dans un document remis à
la NTEA en 1890, avaient le potentiel, si elles étaient correctement
structurées, d'être plus efficaces que les « personnes
physiques ». Les sociétés n'avaient pas d'« âme »,
mais elles ne devaient pas souffrir de « paralysie ».
Pour exploiter pleinement leur potentiel, ils devaient être conçus
de manière à ce que les lignes hiérarchiques soient
claires et faciles à comprendre. Pour rendre cette conception
explicite, Hall a conçu un organigramme. C'était, se souvient
Hibbard, le « premier du genre que j'aie jamais vu ou entendu
».
Les organigrammes sont parfois associés à un frein à
l'innovation. Pour les dirigeants des compagnies téléphoniques
de la fin du XIXe siècle, cependant, ils ont eu l'effet inverse.
En clarifiant les lignes hiérarchiques, ils ont permis à
des managers compétents de coordonner les talents de leurs subordonnés.
Ou, pour le dire de manière plus abstraite, ils ont institutionnalisé
l'entrepreneuriat.
Les innovations organisationnelles au sein des compagnies d'exploitation
entre 1879 et 1894 ont jeté les bases de la fusion ultérieure
des sociétés opérationnelles en un réseau
téléphonique régional, puis national et international.
La création de ce réseau a pris des décennies.
Pourtant, plusieurs des questions qui allaient longtemps préoccuper
les constructeurs de réseaux, comme l'exclusion des concurrents,
furent abordées très tôt.
L'une des questions qui préoccupait les dirigeants des sociétés
d'exploitation était de savoir si les compagnies téléphoniques
étaient (comme les chemins de fer et les sociétés
de messagerie) des transporteurs publics. L'avocat Morris F. Tyler,
diplômé de Yale, aborda cette question lors de la deuxième
réunion de la NTEA en 1882. Selon Tyler, les sociétés
d'exploitation possédaient certaines des caractéristiques
généralement associées aux transporteurs publics.
Par exemple, elles bénéficiaient d'une franchise ;
en effet, elles ne pouvaient pas installer de poteaux et de câbles
sans une telle franchise.
Pourtant, ils se distinguaient également des opérateurs
de télécommunications classiques à plusieurs égards.
Au lieu d'être ouverts à tous, leurs services restaient
réservés à un « nombre bien défini
de personnes », chacune ayant conclu avec l'entreprise un «
contrat clair et plus ou moins permanent ». À cet égard,
les abonnés au téléphone ressemblaient à
un « grand club » : le directeur de l'exploitant exerçait,
comme le directeur du club, « un certain contrôle sur ses
membres » .
La question de l'inclusion et de l'exclusion prit une tournure concrète
lorsqu'un concurrent de Western Union souhaita obtenir d'un exploitant
de téléphonie les mêmes privilèges que ceux
que cette entreprise avait accordés à Western Union. Tyler
ne pensait initialement pas que les exploitants pouvaient faire de distinction
entre deux entreprises de télégraphe, mais il changea
d'avis après avoir consulté les avocats d'American Bell.
Grâce aux brevets de Bell, les avocats ont statué que les
sociétés exploitantes pouvaient refuser de s'interconnecter
avec qui bon leur semblait.
Qu'American Bell officialise ou non sa relation avec Western Union en
rachetant le géant du télégraphe était une
toute autre affaire.
Le président d'American Bell, William H. Forbes, prédisait
en 1888 que l'achat de Western Union serait très probablement
rentable pour les deux entreprises, sans doute parce qu'il mettrait
fin à la concurrence sur le marché du télégraphe
longue distance (sur lequel American Bell était entrée
subrepticement afin de générer des revenus pour ses lignes
longue distance). Pourtant, Forbes doutait que cela soit politiquement
réalisable.
Le Congrès, la presse et les concurrents de Western Union et
d'American Bell (notamment Postal Telegraph) continuaient de considérer
le monopole comme pernicieux, et une telle consolidation risquait de
déboucher sur une législation défavorable.
Certes, l'acquisition de Western Union n'était peut-être
pas trop impopulaire, mais il subsistait un « risque réel
» qu'une fusion plus formelle des deux « monopoles »
– American Bell et Western Union – ne provoque un «
tollé et des attaques accrus » qui pourraient aboutir soit
à l'adoption de « lois tarifaires » paralysantes,
soit à un vote d'« acclamation » pour « l'administration
et la propriété publiques du télégraphe
et du téléphone ».
Le fait que Forbes ait pu envisager une telle mesure témoignait
de la récente construction par les ingénieurs d'AT&T
de son propre réseau longue distance rudimentaire. La construction
du réseau longue distance d'AT&T était, à tous
égards, l'une des réalisations techniques les plus remarquables
de l'ingénierie électrique de la fin du XIXe siècle.
Il est cependant important de distinguer la rhétorique hyperbolique
avec laquelle ses promoteurs ont justifié sa construction, et
ses résultats concrets. Personne n'était plus sensible
à cette distinction entre rhétorique et réalité
qu'Angus S. Hibbard, directeur d'une compagnie de téléphone
du Wisconsin qui, en 1885, devint le premier directeur général
d'AT&T.
Les prétentions avancées concernant la téléphonie
longue distance étaient si exagérées, note Hibbard
avec ironie dans un rapport sur le sujet qu'il prépara pour la
réunion de la NTEA de septembre 1885, qu'elles avaient « privé
l'ouvrier de ce secteur » de « toutes les lauriers
qu'il pouvait espérer » en faisant paraître
ses réalisations « insignifiantes au vu des merveilles
vantées pour son art ». Il restait à démontrer,
rappelait Hibbard à ses collègues, que les services longue
distance (appelés à l'époque « lignes
à péage ») pouvaient être exploités
de manière rentable. Cela n'était peut-être pas
surprenant, l'activité étant encore si récente.
Non seulement des obstacles techniques majeurs restaient à surmonter,
mais les dirigeants d'AT&T devaient trouver un moyen de convaincre
les utilisateurs de profiter du nouveau service. En bref, les appels
longue distance n'étaient pas encore commercialisés. « On
n'a pas encore proposé », expliquait Hibbard l'année
suivante, « ce que l'on pourrait appeler un service de ligne
à péage parfait ou populaire, et les possibilités
d'un tel service n'ont pas été clairement démontrées
par les résultats actuels. Lorsque la téléphonie
longue distance, sous une forme perfectionnée, sera considérée
comme aussi certaine que le voyage en train ou le service postal américain,
on peut supposer qu'une nouvelle catégorie de clientèle
se développera.» Et lorsqu'elle le sera, ce « service
perfectionné de l'UIC Great Cities Institute » –
exempt de « désagréments gênants »
– sera « certainement considéré comme
l'un des plus grands avantages modernes et devra bénéficier
de la plus large clientèle d'un peuple progressiste.
D'autres étaient plus sceptiques. Le trafic longue distance avait
« toujours été une source de pertes réelles
pour l'entreprise », rapportait Tyler à ses actionnaires
dans le rapport annuel de la Southern New England Telephone Company
en 1886, même s'il avait été « affectueusement
considéré » par certains dirigeants du secteur téléphonique
– Tyler entendait sans doute Vail par là – comme une
source de profits importants. « Les courtiers en bourse »,
observait un commentateur dans l'Electrical Review en 1887, «
ne sont pas susceptibles de se fier à un message téléphonique
», une phraséologie qui pouvait être « indistincte
» lorsqu'ils pouvaient recevoir un message écrit par télégraphe.
La supériorité de la parole sur le texte écrit
restait une idée que peu de contemporains des années 1880
étaient prêts à envisager. En effet, c'est précisément
cette limitation de la téléphonie – le fait qu'elle
ne laissait pas de message enregistré – qui a incité
Thomas Edison à inventer ce que beaucoup considéraient
comme sa plus grande invention : le phonographe. En repensant à
cette période depuis 1910, le directeur de la New York Telephone
Company soulignait que, pour que les communications longue distance
soient acceptées, il fallait transformer l'idée même
du secteur téléphonique. L'idée ancienne, observait-il,
était que le service téléphonique serait local
et que le téléphone remplacerait les télégraphes
de district largement utilisés dans les années 1870. Personne
à l'époque, se disait-il, ne pensait que les communications
longue distance deviendraient un jour commercialement viables. Hibbard
s'efforça de prouver le contraire aux sceptiques. À cette
fin, en 1889, il élabora, en collaboration avec John J. Carty
et F. P. Pickernel, des normes techniques pour les sociétés
exploitantes qui, du moins l'espéraient-elles, permettraient
un jour aux abonnés de se connecter au réseau longue distance
depuis leur propre téléphone. (À ses débuts,
la téléphonie longue distance nécessitait un équipement
spécial, disponible uniquement dans certaines stations longue
distance.) Dans la « nouvelle ère » qui
suivrait l'expiration des brevets fondamentaux de Bell, déclaraient
Hibbard, Carty et Pickernel, les sociétés associées
à Bell domineraient leurs localités respectives grâce
à une combinaison de normes techniques élevées
– notamment l'adoption de circuits métalliques (ou à
deux fils) – et à la formation rigoureuse des ingénieurs
en téléphonie.
La publication de ce rapport pourrait laisser penser que les sociétés
d'exploitation associées à Bell ont investi dans des circuits
métalliques pour faciliter la transmission téléphonique
longue distance. Pourtant, ce n'était qu'en partie vrai. Les
circuits métalliques étaient devenus nécessaires
dans les années 1890, également pour protéger les
signaux téléphoniques des interférences –
appelées induction – causées par les services publics
d'électricité concurrents, tels que les lignes de tramway
et les réseaux électriques et d'éclairage. Si AT&T
n'avait jamais été créée et si la « nouvelle
ère » de la téléphonie n'avait jamais
été proclamée, les dirigeants des sociétés
d'exploitation des grands centres commerciaux auraient tout de même
dû procéder à la conversion des lignes terrestres
aux circuits métalliques. Ce projet coûteux impliquait
non seulement la reconstruction de l'installation souterraine, mais
aussi le recâblage du standard téléphonique. Si
l'expansion du service téléphonique fut ralentie au début
des années 1890, c'est principalement pour cette raison. Une
fois la conversion achevée, les sociétés d'exploitation
étaient prêtes à connaître l'essor remarquable
qui allait se produire à partir de 1894 environ.
Les normes techniques élevées proposées par Hibbard,
Carty et Pickernel en 1889 devinrent, après 1894, un moyen pratique
pour les titulaires de licences Bell d'empêcher leurs concurrents
d'accéder à leur réseau. En réalité,
les principaux obstacles à l'interconnexion n'étaient
pas techniques, mais stratégiques. En 1900, Frank Colvin, agent
spécial d'American Bell, a admis que les téléphones
Bell ne s'interconnecteraient pas avec ceux de leurs concurrents.
Les concurrents de Bell ont compris que l'interconnexion pouvait constituer
un atout stratégique majeur.
Après l'expiration des brevets de Bell en 1894, ils ont fait
pression sur les législatures des États pour obliger les
titulaires de licences Bell et AT&T à s'interconnecter avec
eux, affirmant que les compagnies de téléphone étaient
des opérateurs publics. Les avantages de l'interconnexion ont
particulièrement touché James Keelyn, président
de la Western Telephone Construction Company, une société
non Bell. Bientôt, prédisait Keelyn en décembre
1894, les législateurs des États imposeraient l'« utilisation
sans discrimination » des lignes longue distance aux entreprises
non affiliées à Bell, tandis que les principales compagnies
de télégraphe, à savoir Western Union et Postal
Telegraph, fourniraient des installations longue distance en concurrence
directe avec AT&T. Le fait que ni Western Union ni Postal Telegraph
n'aient choisi d'entrer sur ce marché, qui resterait dominé
par AT&T, en dit long sur l'inertie administrative et la timidité
technique qui avaient caractérisé l'industrie télégraphique
américaine dans les années qui avaient suivi son remaniement
par Jay Gould.
Si les législateurs refusaient d'agir, il restait toujours la
possibilité que les tribunaux le fassent. En 1900, l'ingénieur
en téléphonie Kempster Miller déclarait que les
tribunaux allaient bientôt décréter que les compagnies
de téléphone étaient des opérateurs publics
et exiger des titulaires de licences Bell qu'ils s'interconnectent avec
leurs concurrents.
Après 1900, plusieurs concurrents de Bell – connus à
cette époque sous le nom d'« indépendants »
– s'opposèrent à l'interconnexion, arguant que cela
les empêcherait d'établir leur propre réseau longue
distance. Cependant, ce mouvement s'essouffla après la faillite
du principal fournisseur indépendant de services longue distance
en 1908. Le Congrès déclara les compagnies de téléphone
opérateurs publics en 1910 et le ministère de la Justice
força AT&T à s'interconnecter avec ses concurrents
en 1913.
Ce n'est qu'avec l'établissement du service téléphonique
New York-Chicago en 1892 qu'il devint évident que la téléphonie
longue distance avait un avenir. Pourtant, même ce triomphe ne
parvint guère à atténuer l'hostilité populaire
envers ce secteur. Ce n'est qu'après 1900, suite à l'installation
de circuits métalliques, au passage à la batterie standard
et, surtout, à l'introduction du service téléphonique
à tarif fixe, que la téléphonie devint véritablement
populaire dans les centres urbains du pays. Cette popularisation marqua,
dans une large mesure, l'aboutissement de la longue campagne de promotion
du service téléphonique à tarif fixe, lancée
en 1881 par Edward J. Hall, Jr.
En 1920, la position dominante des sociétés d'exploitation
associées à Bell dans les principaux centres urbains du
pays ne posait plus aucun problème. Elle était devenue,
pour ainsi dire, une seconde nature, une évidence de la vie quotidienne.
sommaire
Peu de récits historiques sur l'ère de formation de l'industrie
téléphonique accordent plus qu'une brève mention
aux hommes qui ont dirigé les sociétés d'exploitation
entre 1879 et 1894, comme Edward J. Hall Jr., Morris F. Tyler et Charles
N. Fay.
Pourtant, plus que les présidents d'American Bell, ce sont eux
qui ont pris les décisions administratives qui ont transformé
la téléphonie en une entreprise commercialement viable
(bien que pas encore véritablement populaire).
L'oubli des dirigeants des sociétés d'exploitation s'inscrit
dans une propension plus générale des historiens du téléphone
(révisionnistes comme triomphalistes) à raconter l'histoire
de la téléphonie à cette époque du point
de vue d'American Bell.
L'importance excessive accordée à la téléphonie
longue distance a été particulièrement trompeuse :
jusqu'en 1892 au moins, elle est restée une entreprise commerciale
très problématique, que des initiés bien informés,
comme Norvin Green, président de Western Union, ont rapidement
qualifiée d'échec.
L'hostilité populaire envers les grandes entreprises urbaines
a considérablement diminué après 1900 et, au cours
des deux décennies suivantes – une période souvent
qualifiée d'« apogée des relations conflictuelles »
entre le gouvernement et les grandes entreprises aux États-Unis
par l'UIC Great Cities Institute –, elle n'a atteint que sporadiquement
l'intensité des protestations des abonnés au téléphone
des années 1880. En rejetant les projections pessimistes de Fay
quant au potentiel futur de ce nouveau média, ses successeurs
ont conquis une importante cohorte d'utilisateurs de téléphone,
beaucoup moins critiques à l'égard de l'industrie que
leurs prédécesseurs.
La popularisation de la téléphonie urbaine a atténué
l'hostilité populaire, comme l'avaient prédit les dirigeants
des entreprises. L'affaiblissement de l'hostilité populaire envers
les opérateurs téléphoniques a marqué un
tournant remarquable dans une industrie qui, dans les années
1880, était régulièrement décriée
comme l'une des plus célèbres du pays.
Depuis les années 1790, les commentateurs sociaux ont mythifié
les innovations dans la transmission de l'information afin de souligner
l'ampleur du défi que représentait l'extension de l'autorité
politique sur un territoire géographiquement étendu. Du
Pony Express et du câble transatlantique au Fast Mail et à
la création d'AT&T, ils ont donné à la conquête
spatiale une importance quasi millénaire. Ce faisant, ils ont
involontairement banalisé d'autres innovations, en apparence
plus prosaïques, comme la commercialisation de la téléphonie
urbaine. Des générations d'historiens ont inconsciemment
fait écho à ce biais spatial en qualifiant d'extensive
la trajectoire principale du développement économique
américain au XIXe siècle. Beaucoup moins souvent, du moins
avant l'avènement de l'ordinateur, les historiens ont mis en
avant des innovations dans l'acheminement de l'information, telles que
celles supervisées par les responsables des opérations
téléphoniques entre 1879 et 1894.
La commercialisation de la téléphonie urbaine était
l'une de ces innovations. De diverses manières, elle a bouleversé
les attentes conventionnelles concernant les environnements propices
à l'innovation. Elle ne devait guère à la concurrence
et s'est déroulée dans un environnement réglementaire
très incertain, d'une complexité exaspérante et
souvent hostile, et a même été favorisée
par celui-ci.
La Chicago Telephone Company n'a en aucun cas conquis le conseil municipal
de Chicago. À de nombreuses reprises dans les années 1880,
le conseil municipal lui a arraché de précieuses concessions ;
En 1888, elle menaçait de l'expulser de la ville.
Le langage utilisé par les historiens pour caractériser
l'ère formatrice de la téléphonie américaine
aggrave le problème. Confondre AT&T ou même American
Bell avec l'industrie téléphonique – et qualifier
cette industrie d'« entreprise » ou même de «
système » – occulte la contribution des sociétés
exploitantes à son expansion commerciale. Des métaphores
relationnelles telles que « association » ou « réseau
» sont plus appropriées. Ces métaphores soulignent
la persistance de relations durables entre des organisations qui, bien
que liées, conservaient une identité distincte.cxcix
Le monde entier n'était pas Chicago, ni même New York d'ailleurs.
Pourtant, Chicago et New York comptaient. En téléphonie,
comme dans tant d'autres domaines, les villes étaient des foyers
d'innovation.
Car c'est là que les innovations clés en matière
d'acheminement téléphonique, notamment le standard téléphonique
multiple, ont été développées et perfectionnées.
Si l'Amérique a grandi à la campagne et s'est installée
en ville, comme l'a dit un historien avec une ironie mémorable,
la téléphonie a suivi la direction opposée.
Bien installés dans leurs bastions urbains, les dirigeants des
entreprises d'exploitation ont tendu la main à l'arrière-pays
et, ce faisant, ont amorcé la transformation capitale de l'infrastructure
informatique, passant d'un patchwork de systèmes largement autonomes
à ce réseau plus ou moins homogène que nous tenons
aujourd'hui pour acquis.